Journal D'un Missionnaire ______
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PDF Hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/148447 Please be advised that this information was generated on 2021-10-04 and may be subject to change. ІА^ й INTEGRATION OF CHURCH AND GOVERNMENT MEDICAL SERVICES IN TANZANIA EFFECTS AT DISTRICT LEVEL T.W.J. SCHULPEN INTEGRATION OF CHURCH AND GOVERNMENT MEDICAL SERVICES IN TANZANIA. EFFECTS AT DISTRICT LEVEL. lU~~p. Cover design by George Li langa Nyumba ya Sanaa P.O. Box 4904 Dar Es Salaam Tanzania INTEGRATION OF CHURCH AND GOVERNMENT MEDICAL SERVICES IN TANZANIA. EFFECTS AT DISTRICT LEVEL. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, op gezag van de rector magnificus prof. mr. F.J.F.M. Duynstee, volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op woensdag 25 juni 1975 des namiddags te vier uur door T1M0THEUS WILHELMUS JOSEF SCHULPEN geboren te Rijswijk 1975 African Medical and Research Foundation Box 30125, Nairobi, Kenya. Promotores: Dr. V.F.P.M, van Amelsvoort Prof. Dr. A.T.L.M. Hertens Financial support for the study and this publication has been given by: MEMISA ("Medische Missie Actie"), Rotterdam. The Jan Oekker-Fund and the Dr. Ludgardine Bouwman-Fund, Amsterdam. MISEREOR, Aachen, West Germany. The Hubrecht Janssen-Fund and the Schuffner-Fund, Amsterdam. This study was made with the co-operation and permission of the Ministry of Health of Tanzania. -

FISH FARMING PROJECT Project Period
PROJECT PROPOSAL SUMMARY SHEET Project Title: FISH FARMING PROJECT Project Period: 1 YEAR Target areas: KASHOZI PARISH BUKOBA DIOCESE Total funds requested: GBP 15,000 Proposal submitted to: ALLIANCE OF RELIGIONS AND CONSERVATION Proposal submitted by: BUKOBA CATHOLIC DIOCESE Applicant’s address: Applicant’s telephone: Applicant’s e-mail: Applicant’s legal status: RELIGIOUS ORGANISATION Project Leaders’ name: Date of Submission: EXECUTIVE SUMMARY For the past few years the Catholic Diocese of Bukoba has been trying to find ways and means of mitigating the currently passive culture of her members in participating in community development programs especially through initiatives originating from and developed by the church organizations such as the youth, women, men and other church groups. KASHOZI FISH FARMING PROJECT is a result of such initiatives. It has been developed through dialogue between the leadership of the church at Diocese level and the leadership of the parish and by involving representatives of the organizations of the church in the parish. Through this interactive process it was found out that even though the parish is the oldest in the Diocese the evangelization process and member response has been declining due to a number of challenges among which are weak economies of the members and outbreak of new religious denominations both of which contribute to poor participation of the catholic Christians in activities that promote evangelization at different levels. KASHOZI FISH FARMING PROJECT is only a component of the ongoing process for development of a comprehensive community development program (CONSERVATION AND FOOD SECURITY PROGRAM). This program is expected to promote other components as agro forestry, environmental management and other areas according to nature and priority. -

NETWORK Title of the Project the Link Between Youth Unemployment
COMMUNITY BASED MONITORING SYSTEM (CBMS) NETWORK Title of the Project The Link between Youth Unemployment and Vulnerability in Tanzania: Case Study of Bukoba Municipal Council and Muleba District Council in Tanzania Project Period One Year from August, 2013 to July, 2015 Formatted: Font color: Black I. Project Overview 1. Title of the Project The Link between Youth Unemployment and Vulnerability in Tanzania: Case Study of Bukoba Municipal Council and Muleba District Council 2. Project Proponent a. Name of Institution: Institute of Rural Development Planning, Dodoma b. Name of Head of Institution Prof. Innocent Zilihona c. Mailing Address P. O. Box 138, DODOMA, TANZANIA 4 Telephone and Fax Numbers Tel: +255 26 2302147 Fax: +255 26 2301341 d. E-mail Address: [email protected] e. Web-site: www.irdp.ac.tz f. Brief Profile of the Proponent Institution The Institute of Rural Development Planning (IRDP) is a corporate body established by the Parliamentary Act No. 8 of 1980. The Act provides a legal framework for establishing the Institute which is an important national centre for provision of training, research and consultancy services in the field of Rural Development Planning and Management that will alleviate qualitative and quantitative shortages of skilled manpower within the framework of sustainable capacity building directed towards reducing poverty and attaining sustainable development. IRDP helps to enhance and strengthen capacity for Rural Development practitioners by providing post-secondary education and training, research and consultancy services. IRDP is thus a multi-disciplinary and multi-sectoral body empowered to oversee and coordinate the provision of expertise to in-service and pre-service personnel involved in Rural Development Planning in the country. -

Part II. Africa
Center for Applied Research in the Apostolate Georgetown University Washington, D.C. Global Directory of Catholic Seminaries Part II: Africa January 2017 Michal J. Kramarek, Ph.D. Fr. Thomas P. Gaunt, S.J., Ph.D. Santiago Sordo-Palacios Part II: Africa Number of Seminary Records for Africa in the Directory of Seminaries by Country This part of the Directory of Catholic Seminaries describes seminaries in Africa. The map above illustrates the number of seminary records in the Directory by country. Overall, the Directory includes 750 seminary records for Africa. Among countries in this world region, the Directory includes the highest number of seminary records for Democratic Republic of the Congo (115 seminaries), Nigeria (93 seminaries), and Tanzania (52 seminaries). 2 Comparison between the Number of Seminaries in the Annuarium Statisticum Ecclesiae (ASE) and Its Equivalent in the Directory of Catholic Seminaries (DCS) in Africa by Country1 Number of seminaries in ASE Number of seminaries in DCS Secondary Philosophy Not ASE Secondary Philosophy Not DCS schools and classified total schools and classified total theology theology Algeria 0 0 - 0 0 3 0 3 Angola 50 30 - 80 4 25 12 41 Benin 8 4 - 12 0 6 5 11 Botswana 2 0 - 2 0 0 1 1 Burkina Faso 13 5 - 18 1 4 7 12 Burundi 9 5 - 14 0 3 8 11 Cameroon 23 20 - 43 4 18 15 37 Cape Verde 11 0 - 11 0 0 0 0 Cen. Afr. Republic 9 2 - 11 0 1 7 8 Chad 8 2 - 10 2 3 5 10 Comoros 0 0 - 0 0 0 0 0 Congo 6 2 - 8 1 4 0 5 Dem. -

White Fathers)
MISSIONARIES OF AFRICA (WHITE FATHERS) November: Month of the Holy Souls Issue No. 440 Contents Page Editor’s Word 3 Celebrating 150 years. Rutherglen. 4 -12 Human trafficking in Tandale 13 -14 Fr. Francois Samson 15-17 Lands of Blood and Bile 18-20 Africa is changing. 21-25 Ways to help fund our Mission 26 Data Privacy Notice 27 Parents and Friends 28 Prayers for the Dead 29 Information 30-31 Gift Aid Form 32 Important News Flash At 11.30 a.m. on 9th December 2018 there will be a concele- brated Mass of Thanksgiving for 150 years of Mission to Africa. It will be held at Our Lady, Queen of Apostles Church, Heston TW5 0RL. The Right Reverend John Wilson, Auxiliary Bishop of Westminster will preside. Afterwards there will be a buffet in the Parish Hall . Friends, family, ex-students, supporters, parishion- ers - you are all invited to thank the Lord with us. 2 Editor’s Word. The poet described Autumn as “the season of mists and mellow fruitfulness”. A beautiful image as the year gradually comes to an end. For many people in their “declining years” it is an image of their lives that is exact. Surrounded by family and friends, looked after and loved. So it should be for all. But for many people it is sadly and scandal- Fr. Michael Heap MAfr ously not so. In this issue of our Magazine we have a couple of articles that may (hopefully) upset some people. We hear about trafficked people forced into prostitution so as to survive from day to day, and of people who profit from the trade in human lives and human dignity. -

428 HIRTH (Jean-Joseph) (Mgr), Missionnaire D'afrique, Père Blanc
de la théologie, commencée à Nancy. Enfin le mission, tandis que Mgr Livinhac continuait 428 15 septembre 1878, Mgr Lavigerie lui conférait son voyage vers le Buganda. A Kamoga, on la prêtrise dans la basilique de N.-D. d'Afrique bâtissait, on cultivait la terre, on creusait un HIRTH (Jean-Joseph) (Mgr), Missionnaire près d'Alger. puits, on faisait la classe. Comme partout d'Afrique, Père Blanc, évêque titulaire de Le P. Hirth fut nommé directeur et plus tard ailleurs dans leurs missions de ce temps, les Théveste (Thebessa), premier vicaire apostoli- supérieur du noviciat des frères-coadjuteurs, pères y rachetèrent de nombreux esclaves et que du Kivu-Ruanda (Niederspechbach, 25.3. où sa connaissance de la langue allemande et recueillirent des orphelins, qu'ils instruisirent 1854 — Kabgayi, 6.1.1931). Fils de Johan et son esprit de condescendante charité produisi- et éduquèrent chrétiennement. Par ailleurs, de Sauner, Cathérine. rent les meilleurs fruits. Appelé ensuite à l'école ils avaient réussi à gagner la confiance des indi- apostolique de Saint-Eugène, il y enseigna avec gènes du Bukumbi et ils pouvaient circuler Monseigneur Hirth est un enfant de cette talent et dirigea avec habileté ces jeunes gens. et enseigner librement dans les villages. Mais vaillante Alsace, qui fournit aux missions des Ses succès auprès de ses élèves de la classe de les conversions étaient rares. En somme durant ouvriers aussi nombreux qu'appréciés pour leur rhétorique le firent sans doute remarquer de longtemps, il n'y eut que les enfants rachetés et constance et leur intrépidité. Son père, qui ses supérieurs. -

The History of Evangelization in Tanzania
The History of Evangelization in Tanzania Peter George Kafumu, OFM Cap Graduate of Theology Jordan University College Introduction The Gospel of St. Matthew tells us that Jesus Christ arrived on African soil not primarily as a missionary but as a refugee (cf. 2:13- 15). He was still a baby, and Herod of Galilee sought to kill him (cf. 2:16). Africa welcomed Jesus, and so the history of Christianity had its beginnings on our continent with the noble “yes” of hospitality that echoes into eternity (cf. 25:34-35, 46). A modern phase of the missionary movement in Africa, a movement that began at the end of the eighteenth century, continued throughout the nineteenth century, and extended into the twentieth-century led to the dramatic expansion of Christianity on the continent. In their attempt to spread the Christian faith, win converts and transform African societies, Christian missions of all denominations opened schools and disseminated education. Africans, however, were not passive recipients of new influences and cultural patterns. African choices, African needs, and erstwhile efforts to Africanize Africa’s Christian experience by securing the roots of Christianity within the African context all served to shape the parameters of cultural exchange and Africa’s manner of adopting Christianity. It was in the 19 th century that the movement to evangelize Tanzania began to gather momentum. This paper is an attempt to discuss the history of this movement. In accomplishing its task, this paper will present the leading figures who carried out the work of evangelization in Tanzania and their missionary enterprises. -

The Family Pastoral Sabject
PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA ISTITUTO SUPERIORE DI CATECHESI E SPIRITUALITÀ MISSIONARIA SEZIONE DI CATECHESI THE FAMILY PASTORAL SUBJECT FOR THE CHRISTIAN FORMATION IN RULENGE-NGARA DIOCESE (TANZANIA) KAMBONA Grace Richard TESINA DI MAGISTERO IN SCIENZE RELIGIOSE (Indirizzo di Catechesi missionaria) Moderatore: Prof. MEDDI Luciano Correlatore: Prof. COLOMBO Giovanni ROMA 2009 DEDICATION Firstly I dedicate this work to the Blessed Trinity, the perfect model of the Christian family. May all families create more communion in the light of Holy Trinity. Secondly I dedicate it to all Africa Christian families that they may truly become schools for authentic formation in the Christian faith and human values, and homes where all may increase in wisdom, in stature, in favour with God and with people. II ACKNOWLEDGEMENTS “For Yahweh is good, his faithful love is everlasting, his constancy from age to age” (Ps. 100:5). First of all I bow my head before the Almighty for all his blessings. Having come to the realization of the goal I aimed at, I cannot forget the many and various persons who have in different ways helped me towards it. Therefore I want to thank with all my heart everyone who has contributed, to make my goal a reality. My heart felt thanks and gratitude naturally goes first to my family; my parents, sisters, brother and all other members of my family for their care and moral support. My deep thanks to my bishop NIWEMUGIZI Severine for awarding me the scholarship that gave me the chance to deepen my Christian faith throughout the course and through daily experiences of different cultures. -
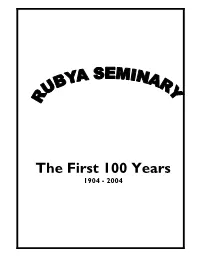
The First 100 Years 1904 - 2004 INTRODUCTION
The First 100 Years 1904 - 2004 INTRODUCTION It is Rubya Seminary: Our Alma Mater, which this book celebrates and that we have gathered here to celebrate her centenary since her existence. Her fame echoes throughout the cosmos. She stimulates interest and commands attention. Rubya Seminary is a treasure of Bukoba Catholic Diocese and is one of its pride and glories. St. Mary's Rubya Seminary is a diocesan priest-training school under the leadership of the local ordinary of Bukoba Diocese. It was founded by the White Fathers at Kyegoromora in 1903, and then transferred to Rubya in December 1904. The term seminary is the English rendering of the Latin word ‘Seminarium’ meaning nursery, which “was commonly used to describe a place where young seedlings were prepared for eventual transplantation”. The term seminary has been adopted in ecclesiastical circles to mean “A college or school for the training of young men destined for the priesthood”. The Apostolic Exhortation: Pastores Dabo Vobis of Pope John Paul II, defines the seminary as an “educational ecclesiastical community, indeed a particular educating community….., committed to formation of future priests”. Hence Rubya Seminary was founded by the White Fathers under Bishop Hirth. As Fr. Deogratias Rwechungura eloquently put it, "The purpose of its founders and the aim of its successive legal owners from the very beginning up to the present day was, and still is, to prepare young Tanzanians for that sublime calling of the priesthood, so that they may cater for the spiritual and religious needs of their own fellow country men."1 Rubya Seminary is the Alma Mater, the seedbeds of long standing where many great men were once young seminarians. -

Institutional Component for the Lake Victoria Basin Final National Report
PREPARATION OF NATIONAL / REGIONAL MANAGEMENT FRAMEWORK: INSTITUTIONAL COMPONENT FOR THE LAKE VICTORIA BASIN FINAL NATIONAL REPORT Preparation of National / Regional Management Framework: Institutional Component for the Lake Victoria Basin Final National Report January 2007 ISSUE REGISTER Copies Ministry of Water: Lake Victoria Environmental Management 5 hard; 1 soft Project SMEC Tanzania 1 hard; 1 soft SMEC International Pty Ltd 1 hard; 1 soft Prepared by: SMEC International Pty Ltd, 2006 Level 5 118 Walker Street NORTH SYDNEY NSW 2060 © Ministry of Water, Lake Victoria Environmental Management Project 2006 This document is and shall remain the property of the Ministry of Water, Lake Victoria Environmental Management Project, United Republic of Tanzania. The document may only be used for the purposes of which it was commissioned and in accordance with the Terms of Engagement for this commission. The contents of this document cannot be used or copied without the prior written permission of the Ministry of Water, United Republic of Tanzania. Document Status: Reviewer Approved for Issue Rev. No. Author Date Name Signature Name Signature Final Project Team Hatten, C Sabet, H Sabet, H* January, 2007 Preparation of National / Regional Management Framework: Institutional Component for the Lake Victoria Basin Project Reference: 07787.009 i Consultancy Services for the Preparation of National/Regional Management Framework Institutional Component for the Lake Victoria Basin (Tanzania) (07787.009) PREPARATION OF NATIONAL / REGIONAL MANAGEMENT FRAMEWORK: -
Rubya Designated District Hospital
ANNUAL REPORT 2012 TABLE OF CONTENTS FORE WORD....................................................................................................... 2 MISSION, VISION AND GOAL STATEMENTS ................................................... 3 AKNOWLEDGEMENT ......................................................................................... 4 LIST OF ABREVIATIONS .................................................................................... 5 INTRODUCTION.................................................................................................. 7 COMMUNITY AND HEALTH STATUS ................................................................ 9 TOP TEN DISEASES OPD 2011 .... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.11 TOP TEN DISEASES AT IPD FOR 2012. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.12 HEALTH POLICY & INFRASTRUCTURE.......................................................... 12 HOSPITAL MANAGEMENT............................................................................... 13 STAFF ESTABLISHMENT AS AT 31/12/2012................................................... 15 ARRIVALS AND DEPARTURES IN 2012 .......................................................... 16 FINANCES ......................................................................................................... 17 OUT-PATIENT DEPARTMENT (OPD)............................................................... 17 ADMITTED PATIENS IN DIFFERENT DEPARTMENTS FOR YEAR 2012....... 20 THEATRE DEPARTMENT................................................................................ -
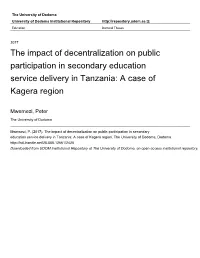
The Impact of Decentralization on Public Participation in Secondary Education Service Delivery in Tanzania: a Case of Kagera Region
The University of Dodoma University of Dodoma Institutional Repository http://repository.udom.ac.tz Education Doctoral Theses 2017 The impact of decentralization on public participation in secondary education service delivery in Tanzania: A case of Kagera region Mwemezi, Peter The University of Dodoma Mwemezi, P. (2017). The impact of decentralization on public participation in secondary education service delivery in Tanzania: A case of Kagera region, The University of Dodoma, Dodoma. http://hdl.handle.net/20.500.12661/2420 Downloaded from UDOM Institutional Repository at The University of Dodoma, an open access institutional repository. THE IMPACT OF DECENTRALIZATION ON PUBLIC PARTICIPATION IN SECONDARY EDUCATION SERVICE DELIVERY IN TANZANIA: A CASE OF KAGERA REGION PETER MWEMEZI DOCTOR OF PHILOSOPHY THE UNIVERSITY OF DODOMA OCTOBER, 2017 THE IMPACT OF DECENTRALIZATION ON PUBLIC PARTICIPATION IN SECONDARY EDUCATION SERVICE DELIVERY IN TANZANIA: A CASE OF KAGERA REGION By Peter Mwemezi A Thesis Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy of the University of Dodoma The University of Dodoma October, 2017 CERTIFICATION The undersigned certify that they have read and hereby recommend for acceptance by the University of Dodoma a thesis entitled: “The Impact of Decentralization on Public Participation in Secondary Education Service Delivery in Tanzania: A Case of Kagera Region” in fulfilment of the requirement for the degree Doctor of Philosophy of the University of Dodoma. ...............................................................................