Rapport Final Nov2002cafpd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

340102-Fre.Pdf (433.2Kb)
r 1 RAPPORT DE MISSION [-a mission que nous venons de terminer avait pour but de mener une enquête dans quelques localités du Mali pour avoir une idée sur la vente éventuelle de I'ivermectine au Mali et le suivi de la distribution du médicament par les acteurs sur le terrain. En effet sur ordre de mission No 26/OCPlZone Ouest du3l/01196 avec le véhicule NU 61 40874 nous avons debuté un périple dans les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso et le district de Bamako, en vue de vérifier la vente de l'ivermectine dans les pharmacies, les dépôts de médicament ou avec les marchands ambulants de médicaments. Durant notre périple, nous avons visité : 3 Régions : Koulikoro, Ségou, Sikasso 1 District : Bamako 17 Cercles Koulikoro (06 Cercles), Ségou (05 Cercles), Sikasso (06 Cercles). 1. Koulikoro l. Baraouli 1. Koutiala 2. Kati 2. Ségou 2. Sikasso 3. Kolokani 3. Macina 3. Kadiolo 4. Banamba 4. Niono 4. Bougouni 5. Kangaba 5. Bla 5. Yanfolila 6. Dioila 6. Kolondiéba avec environ Il4 pharmacies et dépôts de médicaments, sans compter les marchands ambulants se trouvant à travers les 40 marchés que nous avons eu à visiter (voir détails en annexe). Malgré notre fouille, nous n'avons pas trouvé un seul comprimé de mectizan en vente ni dans les pharmacies, ni dans les dépôts de produits pharmaceutiques ni avec les marchands ambulants qui ne connaissent d'ailleurs pas le produit. Dans les centres de santé où nous avons cherché à acheter, on nous a fait savoir que ce médicament n'est jamais vendu et qu'il se donne gratuitement à la population. -
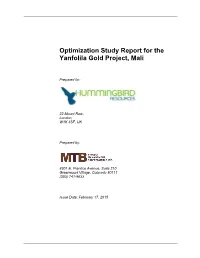
Optimization Study Report for the Yanfolila Gold Project, Mali
Optimization Study Report for the Yanfolila Gold Project, Mali Prepared for: 22 Mount Row, London, W1K 3SF, UK Prepared by: 8301 E. Prentice Avenue, Suite 210 Greenwood Village, Colorado 80111 (303) 741-9633 Issue Date: February 17, 2015 TABLE OF CONTENTS 1.0 EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................. 1 1.1 Introduction .......................................................................................................... 1 1.2 Location ............................................................................................................... 1 1.3 Ownership............................................................................................................ 1 1.4 Climate and Physiography ................................................................................... 1 1.5 History ................................................................................................................. 3 1.6 Geological Setting ................................................................................................ 3 1.7 Deposit Types ...................................................................................................... 3 1.8 Exploration ........................................................................................................... 4 1.9 Mining .................................................................................................................. 4 1.10 Processing .......................................................................................................... -

FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune
FINAL REPORT Quantitative Instrument to Measure Commune Effectiveness Prepared for United States Agency for International Development (USAID) Mali Mission, Democracy and Governance (DG) Team Prepared by Dr. Lynette Wood, Team Leader Leslie Fox, Senior Democracy and Governance Specialist ARD, Inc. 159 Bank Street, Third Floor Burlington, VT 05401 USA Telephone: (802) 658-3890 FAX: (802) 658-4247 in cooperation with Bakary Doumbia, Survey and Data Management Specialist InfoStat, Bamako, Mali under the USAID Broadening Access and Strengthening Input Market Systems (BASIS) indefinite quantity contract November 2000 Table of Contents ACRONYMS AND ABBREVIATIONS.......................................................................... i EXECUTIVE SUMMARY............................................................................................... ii 1 INDICATORS OF AN EFFECTIVE COMMUNE............................................... 1 1.1 THE DEMOCRATIC GOVERNANCE STRATEGIC OBJECTIVE..............................................1 1.2 THE EFFECTIVE COMMUNE: A DEVELOPMENT HYPOTHESIS..........................................2 1.2.1 The Development Problem: The Sound of One Hand Clapping ............................ 3 1.3 THE STRATEGIC GOAL – THE COMMUNE AS AN EFFECTIVE ARENA OF DEMOCRATIC LOCAL GOVERNANCE ............................................................................4 1.3.1 The Logic Underlying the Strategic Goal........................................................... 4 1.3.2 Illustrative Indicators: Measuring Performance at the -

VEGETALE : Semences De Riz
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ********* UN PEUPLE- UN BUT- UNE FOI DIRECTION NATIONALE DE L’AGRICULTURE APRAO/MALI DNA BULLETIN N°1 D’INFORMATION SUR LES SEMENCES D’ORIGINE VEGETALE : Semences de riz JANVIER 2012 1 LISTE DES ABREVIATIONS ACF : Action Contre la Faim APRAO : Amélioration de la Production de Riz en Afrique de l’Ouest CAPROSET : Centre Agro écologique de Production de Semences Tropicales CMDT : Compagnie Malienne de Développement de textile CRRA : Centre Régional de Recherche Agronomique DNA : Direction Nationale de l’Agriculture DRA : Direction Régionale de l’Agriculture ICRISAT: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics IER : Institut d’Economie Rurale IRD : International Recherche Développement MPDL : Mouvement pour le Développement Local ON : Office du Niger ONG : Organisation Non Gouvernementale OP : Organisation Paysanne PAFISEM : Projet d’Appui à la Filière Semencière du Mali PDRN : Projet de Diffusion du Riz Nérica RHK : Réseau des Horticulteurs de Kayes SSN : Service Semencier National WASA: West African Seeds Alliancy 2 INTRODUCTION Le Mali est un pays à vocation essentiellement agro pastorale. Depuis un certain temps, le Gouvernement a opté de faire du Mali une puissance agricole et faire de l’agriculture le moteur de la croissance économique. La réalisation de cette ambition passe par la combinaison de plusieurs facteurs dont la production et l’utilisation des semences certifiées. On note que la semence contribue à hauteur de 30-40% dans l’augmentation de la production agricole. En effet, les semences G4, R1 et R2 sont produites aussi bien par les structures techniques de l’Etat (Service Semencier National et l’IER) que par les sociétés et Coopératives semencières (FASO KABA, Cigogne, Comptoir 2000, etc.) ainsi que par les producteurs individuels à travers le pays. -

Preliminary Final Report
DREF: Preliminary Final Report Mali: Ebola virus disease preparedness DREF operation Operation n° MDRML010 Date of Issue: 30 November 2014 Glide n° EP-2014-000039-MLI Date of disaster: N/A Operation start date: 19 April 2014 Operation end date: 31 August 2014 Host National Society: Mali Red Cross Operation budget: CHF 57,715 Number of people affected: Up to 8 million people in at- Number of people assisted: 12,483 risk communities of Bamako, Kayes, Koulikoro and Sikasso; N° of National Societies involved in the operation: IFRC and Mali Red Cross N° of other partner organizations involved in the operation: Ministry of Health A. Situation analysis Description of the disaster In February 2014, there was an outbreak of the Ebola Virus Disease (EVD) in Guinea, which spread to Liberia, Nigeria, Senegal and Sierra Leone, and most recently Mali, causing untold hardship and hundreds of deaths in these countries. As of 10 November 2014, a total of 14,490 cases, and 5,546 deaths had been recorded, which were attributed to the EVD. In the Democratic Republic of Congo (DRC), an outbreak of the EVD was also reported, but is considered of a different origin than that which has affected West Africa. Mali, with a population of 14.8m (UNDP 2012) shares a border with Guinea, which has been especially affected by the EVD, and therefore the risks presented by the epidemic to the country are high. Summary of response Overview of Host National Society On 19 April 2014, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) released CHF 57,715 from the Disaster Relief and Emergency Fund (DREF) to support the Mali Red Cross Society (MRCS) with EVD preparedness activities for a period of three months specifically in the areas of Bamako, Kayes, Koulikoro and Sikasso. -

Dossier Technique Et Financier
DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER PROJET D’APPUI AUX INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES MALI CODE DGD : 3008494 CODE NAVISION : MLI 09 034 11 TABLE DES MATIÈRES ABRÉVIATIONS ............................................................................................................................ 4 RÉSUMÉ ....................................................................................................................................... 6 FICHE ANALYTIQUE DE L’INTERVENTION ............................................................................... 8 1 ANALYSE DE LA SITUATION .............................................................................................. 9 1.1 STRATÉGIE NATIONALE .......................................................................................................... 9 1.2 L’IMPACT DE LA CRISE .......................................................................................................... 11 1.3 DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE LA DÉCENTRALISATION ET LES DISPOSITIFS D’APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME ................................................................................................................. 12 1.4 L’ANICT ............................................................................................................................ 15 1.5 QUALITÉ DES INVESTISSEMENTS SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE DES CT .................................... 25 1.6 CADRE SECTORIEL DE COORDINATION, DE SUIVI ET DE DIALOGUE ........................................... 29 1.7 CONTEXTE DE -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural
MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 01 Au 03 NOVEMBRE 2014 SELON LE SATTELITE MODIS
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI DE L’EAU ET DE l’ASSAINISSEMENT UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS(DNEF) SYSTEME D’INFORMATION FORESTIER (SIFOR) SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 01 au 03 NOVEMBRE 2014 SELON LE SATTELITE MODIS. LATITUDES LONGITUDES VILLAGES COMMUNES CERCLES REGIONS 11,0390000000 -7,9530000000 SANANA WASSOULOU-BALLE YANFOLILA SIKASSO 11,0710000000 -7,3840000000 KOTIE GARALO BOUGOUNI SIKASSO 11,1700000000 -6,9060000000 FOFO KOLONDIEBA KOLONDIEBA SIKASSO 11,2570000000 -6,8230000000 FAMORILA KOLONDIEBA KOLONDIEBA SIKASSO 11,4630000000 -6,4750000000 DOUGOUKOLO NIENA SIKASSO SIKASSO 11,4930000000 -6,6390000000 DIEDIOULA- KOUMANTOU BOUGOUNI SIKASSO 11,6050000000 -8,5470000000 SANANFARA NOUGA KANGABA KOULIKORO 11,6480000000 -8,5720000000 SAMAYA NOUGA KANGABA KOULIKORO 11,7490000000 -8,7950000000 KOFLATIE NOUGA KANGABA KOULIKORO 11,8600000000 -6,1890000000 BLENDIONI TELLA SIKASSO SIKASSO 11,9050000000 -8,3150000000 FIGUIRATOM MARAMANDOUGOU KANGABA KOULIKORO 11,9990000000 -10,676000000 DAR-SALM N SAGALO KENIEBA KAYES 12,0420000000 -8,7310000000 NOUGANI BENKADI KANGABA KOULIKORO 12,0500000000 -8,4440000000 OUORONINA BENKADI KANGABA KOULIKORO 12,1210000000 -8,3990000000 OUORONINA BANCOUMANA KATI KOULIKORO 12,1410000000 -8,7660000000 BALACOUMAN BALAN BAKAMA KANGABA KOULIKORO 12,1430000000 -8,7410000000 BALACOUMAN NARENA KANGABA KOULIKORO 12,1550000000 -8,4200000000 TIKO BANCOUMANA KATI KOULIKORO 12,1700000000 -9,8260000000 KIRIGINIA KOULOU KITA KAYES 12,1710000000 -10,760000000 -

9781464804335.Pdf
Land Delivery Systems in West African Cities Land Delivery Systems in West African Cities The Example of Bamako, Mali Alain Durand-Lasserve, Maÿlis Durand-Lasserve, and Harris Selod A copublication of the Agence Française de Développement and the World Bank © 2015 International Bank for Reconstruction and Development / Th e World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433 Telephone: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org Some rights reserved 1 2 3 4 18 17 16 15 Th is work is a product of the staff of Th e World Bank with external contributions. Th e fi ndings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily refl ect the views of Th e World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent, or the Agence Française de Développement. Th e World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. Th e boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of Th e World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Nothing herein shall constitute or be considered to be a limitation upon or waiver of the privileges and immunities of Th e World Bank, all of which are specifi cally reserved. Rights and Permissions Th is work is available under the Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO) http:// creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Under the Creative Commons Attribution license, you are free to copy, distribute, transmit, and adapt this work, including for commercial purposes, under the following conditions: Attribution—Please cite the work as follows: Durand-Lasserve, Alain, Maÿlis Durand-Lasserve, and Harris Selod. -
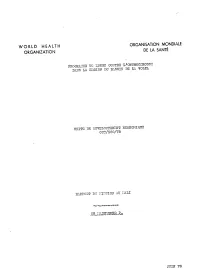
OCP-EPI-78.Pdf (1.012Mb)
,'/ WORLD HEALTH ORGANISATIONMONDIALE ORGANIZATION DE LA SANTÉ PROGTTA:.,tr'T]DIT,UîTECOITîNET.,'O}TCHOCtrRCOSJI VOITÀ D},ITS I,t N]]GIOI\T DÜ B-tSSTliI DE IÂ Ü]TITD DE DE\TEIO?PEIi.II1I{T ECO}TOÏ'ITQUIT o cY/rco/ta Rl,?PO"l,[ Dr] 1;I]SIO]I 'irU i'iittrI -3-3-=-g-=.i= l)B-iË"§trIElE9=L-c JUI}T 78 I 'Dr I'flasumbu]ro Iie Conseiller en Sarrté Publique OMS/oITCrro/ECo RAPPORT DE MISSIO1T AU I\TA],7 Du B Juillet au 14 Juillet 197e, le Dr L[asumbuko srest rend.u par Ia route au Mali pour effectuer une misslon dont les buts étaient de : 1 ) Passer e11 revue avee les Autorités sanitaires m.aliennes' Ies principaux problèmes de Santé Fublique qrri se posent dans llaire malienne du Programne OCP ; Z) Faisant suite à r:ne question posée au Directeur du Progranme par 1a DéIégatlon malierur.e et relative à 1:r Mécteci-ne Îraditionnelter lors de Ia 2ème Coirférence anrruelle des Conttés }Tationaux d.e lutte Coiitre trtO::chocer- cose, il slag:issait d.rexantiner, avec 1es eetfrices d.e trlllnstitut }Tational d.e Recherche sur Ia Phamacopée et Ia i{édecine Îraditionnelletr de Bqmakor d.e son utilisation dans 1a lutte contre Ia nraladie éventuel-lement contre 1 lOnchocercosêo é §ikasso- au Mini st èr3u8 8"8 Ê8*8R8t u* âoÏli,îSt iBû€ îfi g*lSi*tt,i à ttec-nercne sur Ia ?hamacopée"di8"B8fit et Ia Médecine Traditiorurelle. 1. vis.iLe à sihassq Mili-eu Sikasso 2ène Région d.u Mali est frontalièr'e de Ia Har-rte-Volta à ItEst, tle la Côte drlvoire au Sr-rd et de 1a lépubliclue d.e Gulnée au Sud-Ouest. -

Latitudes Longitudes Villages Communes Cercles Regions
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT REPUBLIQUE DU MALI DE L’ASSAINISSEMENT ET UN PEUPLE - UN BUT- UNE FOI DEVELOPEMENT DURABLE DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS(DNEF) SYSTEME D’INFORMATION FORESTIER (SIFOR) SITUATION DES FOYERS DE FEUX DE BROUSSE DU 01 au 03 MARS 2015 SELON LE SATTELITE MODIS. LATITUDES LONGITUDES VILLAGES COMMUNES CERCLES REGIONS 13,7590000000 -11,1200000000 GALOUGO NIAMBIA BAFOULABE KAYES 13,3720000000 -11,1300000000 BOULOUMBA GOUNFAN BAFOULABE KAYES 13,3630000000 -11,1380000000 KENIEDING GOUNFAN BAFOULABE KAYES 13,2690000000 -10,7690000000 LAHANDY DIOKELI BAFOULABE KAYES 13,2680000000 -10,7550000000 BANGAYA DIOKELI BAFOULABE KAYES 13,1800000000 -10,6990000000 KABADA KOUNDIAN BAFOULABE KAYES 12,8550000000 -10,2300000000 DIBA BAMAFELE BAFOULABE KAYES 13,5880000000 -10,4320000000 TAMBAFETO OUALIA BAFOULABE KAYES 13,6200000000 -11,0330000000 DJIMEKOURO MAHINA BAFOULABE KAYES 13,6180000000 -11,0430000000 NEGUETABAL MAHINA BAFOULABE KAYES 14,4590000000 -10,1500000000 TRANTINOU DIAKON BAFOULABE KAYES 13,2600000000 -10,4720000000 SOBELA BAMAFELE BAFOULABE KAYES 13,0910000000 -10,7880000000 NANIFARA KOUNDIAN BAFOULABE KAYES 12,8830000000 -6,5380000000 M^BEDOUGOU SANANDO BARAOUELI SEGOU 12,1340000000 -7,2900000000 TYEMALA MERIDIELA BOUGOUNI SIKASSO 11,8240000000 -7,3790000000 BOROMBILA DOGO BOUGOUNI SIKASSO 11,7890000000 -7,5170000000 FARABA DOGO BOUGOUNI SIKASSO 11,5640000000 -7,3600000000 SABOUDIEBO ZANTIEBOUGOU BOUGOUNI SIKASSO 11,3640000000 -6,8730000000 KOUMANTOU KOUMANTOU BOUGOUNI SIKASSO 11,4000000000 -7,6240000000 FOULOLA -

Decision N° 2019- 003196 / Men- Sg Le Ministre De L'education Nationale
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE REPUBLIQUE DU MALI ------------------- --------------------------- Un Peuple - Un But - Une Foi SECRETARIAT GENERAL --------------------------- DECISION N° 2019- 003196 / MEN- SG PORTANT ORIENTATION DES ELEVES TITULAIRES DU D.E.F, SESSION DE JUILLET 2019, AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, Vu la Constitution ; Vu la Loi N° 99-046 du 28 décembre 1999, modifiée, portant Loi d'Orientation sur l'Education ; Vu l’Arrêté N°09-2491/MEALN-SG du 10 septembre 2009 fixant les critères d’orientation, de transfert, de réorientation et de régulation des titulaires du Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF) dans les Etablissements d’Enseignement Secondaire General, Technique et Professionnel ; Vu la Décision N°10-03621/MEALN-SG du 30 août 2010 fixant les directives pour la sélection des Etablissements Privés d'Enseignement Secondaire aptes à accueillir des élèves pris en charge par l'Etat; Vu le Décret N°2019 – 0328/P-RM du 05 mai 2019, portant nomination des membres du gouvernement. Vu la Décision N°2019-001743/MEN-SG du 26 juin 2019 Portant Organisation de Mission d'Evaluation des Etablissements Privés d'Enseignement Secondaire en vue de léligibilité pour la periode 2019-2020 à 2021-2022 Vu la Décision N°2019-002029/MEN-SG du 11 juillet 2019 Déterminant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission nationale d’orientation et du comité régional d’orientation des élèves titulaires du diplôme d’études fondamentales (DEF), session d'août 2019 Vu la Décision N°2019-003159/MEN-SG du 18 Octobre 2019, Portant modification de la décision N°2019-003036/ MEN- SG-CPS du 04 octobre 2019 Portant liste d'éligibilité des établissements susceptibles de recevoir des élèves à la charge de l'Etat au titre de l'année scolaire 2019-2020.