Debout, Partisans !
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Conspiracy of Peace: the Cold War, the International Peace Movement, and the Soviet Peace Campaign, 1946-1956
The London School of Economics and Political Science Conspiracy of Peace: The Cold War, the International Peace Movement, and the Soviet Peace Campaign, 1946-1956 Vladimir Dobrenko A thesis submitted to the Department of International History of the London School of Economics for the degree of Doctor of Philosophy, London, October 2015 Declaration I certify that the thesis I have presented for examination for the MPhil/PhD degree of the London School of Economics and Political Science is solely my own work other than where I have clearly indicated that it is the work of others (in which case the extent of any work carried out jointly by me and any other person is clearly identified in it). The copyright of this thesis rests with the author. Quotation from it is permitted, provided that full acknowledgement is made. This thesis may not be reproduced without my prior written consent. I warrant that this authorisation does not, to the best of my belief, infringe the rights of any third party. I declare that my thesis consists of 90,957 words. Statement of conjoint work I can confirm that my thesis was copy edited for conventions of language, spelling and grammar by John Clifton of www.proofreading247.co.uk/ I have followed the Chicago Manual of Style, 16th edition, for referencing. 2 Abstract This thesis deals with the Soviet Union’s Peace Campaign during the first decade of the Cold War as it sought to establish the Iron Curtain. The thesis focuses on the primary institutions engaged in the Peace Campaign: the World Peace Council and the Soviet Peace Committee. -
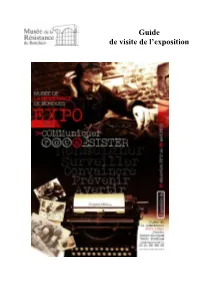
Guide De Visite De L'exposition
Guide de visite de l’exposition 1 En guise d’introduction En lien avec le thème du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2012-2013, « Communiquer pour résister. 1940- 1945 », l’exposition proposée par le Musée de la Résistance de Bondues invite à explorer le rôle joué par les moyens de communication dans la lutte contre l’Allemagne nazie et le régime de Vichy. Si l’on définit simplement la communication comme l’acte d’établir des relations avec quelqu’un, on constate que ce rôle est double : la communication des résistants est orientée d’une part vers une forme de propagande et de contre-propagande (communication « externe ») et d’autre part vers l’organisation du « monde résistant » (communication « interne »). En effet, les différentes techniques de communication sont utilisées par les résistants à la fois pour convaincre ceux qui ne résistent pas, soit l’immense majorité de la population française, et nuire aux ennemis. Elles permettent également aux résistants d’échanger entre eux et d’organiser la circulation des informations et du matériel. Quelle qu’en soit la forme, la communication constitue une part non négligeable du travail des résistants. Certains d’entre eux s’y consacrent même exclusivement, au péril de leur vie. Le présent guide de visite reprend chacun des treize panneaux de l’exposition. Chaque panneau fait l’objet d’une synthèse, qui s’efforce de mettre en lumière les acteurs de la Résistance dans une perspective le plus souvent régionale. Toutes les synthèses sont suivies de quelques documents qui les illustrent ou les approfondissent. -

Ambivalent French Communists in May 1968
ISSN 2239-978X Journal of Educational and Social Research Vol. 4 No.6 ISSN 2240-0524 MCSER Publishing, Rome-Italy September 2014 A Missed Opportunity or Party Rational? Ambivalent French Communists in May 1968 Yutaka Okuyama, Ph.D CEO. Crimson Academy [email protected] Doi:10.5901/jesr.2014.v4n6p435 Abstract The purpose of this study is the investigation of organizational behavior of the French communists in the May Movement in 1968. Particularly at the first part of the movement, a severe rivalry between the French Communist Party (PCF) and the radical student organizations occurred. Although both of them pursued the same political goals, they could not work out for a united front. Such a behavioral choice taken by the French communists enormously influenced the course of the events. Even if the atmosphere had not been ripe enough for a revolutionary movement, the actors involved could have pulled it off through instigative appeals in order to create an acute situation. Since the electoral results had clearly indicated that the PCF possessed a concrete support mechanism, the party could have a chance to grasp a casting board, even cooperating with the students. However, the PCF did not take it. Did the communists miss the opportunity? No, they did not. The French communists acted based on their party rational, combining both new and traditional ideas on that occasion. For the party, the May Movement offered them an occasion to show the public what they stood for. That was quite enough for a social movement actor as well as a political party. -

L'unef, Les Étudiants Pendant La Guerre De 1939
_______________________ Les Cahiers du GERME n° 25 juin 2005 ________________________ - 34 - DOSSIER : LF3NE- , LES ET3DIANTS PENDANT LA 23ERRE DE 1939-19R5 ET SO3S LFOCC3PATION : ATTENTISMES, COLLA9ORATIONS ET RESISTANCES Contributions * Robi order : - L ,NE8 des années noires, dix ans après, état des lieux, état des débats .. * 1lexandra Gottel0 : - La correspondance de l ,NE8 pendant la Seconde guerre mondiale : une vue d ensemble .. * Stéphane erceron : - L ,NE8 des années noires .. * Didier 8ischer : - Les étudiants et la Résistance ou les itinéraires d une refondation .. * Philippe ezzasalma : - De la défense du parti & la Résistance : itinéraires de jeunes militantes communistes .. * Hacques 9arin : - De la Résistance au s0ndicalisme étudiant .. T moignages et documents * Deux discours de Louis Laisne0. * ,ne lettre de 8ranFois de Lescure. * Souvenirs de Colette 4loch7Sellier. * Notes de arcel 4leibtreu. * - La question juive ., rapport Gillot et motion, 1E avril 1921. * Discours d 1bel 4onnard, 3 mai 1923. * Compte rendu du congrès de l ,NE8, 2 avril 1925 (Extraits) * embres de la direction nationale de l ,NE8, 193E71925. _______________________ Les Cahiers du GERME n° 25 juin 2005 ________________________ - 40 - Journal de l6AGE de 2oulouse, f-vrierO.ars 19,0. Nous so..es encore dans ? la dr4le de uerre A. L6association fait le lien entre l6-tudiant (portant falucheD en a.phi et labo et l6-tudiant .obilisé (en unifor.e avec casqueD. FE7 2oulouse, copie transmise par Fabien Cluzel. _______________________ Les Cahiers du GERME n° 25 juin 2005 ________________________ - 41 - L2UNEF des ann es noires : di, ans aprAs, état des lieu,, état des débats. Robi Morder L'0NEI a pu paraQtre un peu fade. On ne peut pas la classer comme un mouvement auxiliaire de la Eévolution nationale, encore moins comme un mouvement collaborationniste, malgré le maréchalisme affiché de certains journaux d'AGE ou l'appartenance au Conseil national de Vichy d'un de ses présidents. -

Inventaire Charles Tillon
INVENTAIRE CHARLES TILLON I. « Charles Tillon, soixante-dix ans d’insoumission » A. CHARLES TILLON, MUTIN DE LA MER NOIRE CT1 ASSOCIATION FRATERNELLE DES ANCIENS DE LA MER NOIRE ET DE LEURS AMIS, 1949-19731 Dossier 1 : Commémoration des mutineries de la Mer Noire Statuts, déclaration à la Préfecture de Police, 1949 Convocations aux Assemblées Générales et aux repas fraternels, 1949-1973 PV ou comptes-rendus des Assemblées Générales (1954, 1958, 1959, 1966) + 2 lettresCommémoration du 40e anniversaire des mutineries, 1959 Commémoration du 54e anniversaire des mutineries, 1973 Cartes de membres de Charles Tillon, 1959, 1964 + 3 lettres de Tillon adressées au Bureau de l’Association : désaccord (1961, 1962, 1963) Photographies : A noter : une photographie des membres de l’Association fraternelle des Anciens de la Mer Noire (s.d.) Dossier 2 : Année 1967 : 48e anniversaire des mutineries et 50e anniversaire de la Révolution d’Octobre Correspondance : CARREL André, DUBREUIL, Mme MOTTUT, QUESNEL, TONDUT. Documents sur la commémoration des mutineries de la Mer Noire Documents sur le commémoration du 50e anniversaire de la Révolution d’Octobre. Dossier 3 : 1969, 50e anniversaire des mutineries de la Mer Noire Notes de Charles Tillon pour son intervention Liste des personnes présentes Résolution adoptée le 18 mai 1969 Correspondance : BASSET, BREST, CHOMEL, COCHIN, CORBIERE, DOUBLIER, ESCOLA, FRECHARD, GILLE, GLEIZE, JOUANNO, MARIN, MONRIBOT, OURVOIS, PAULY, PEREZ, ROLLET, THOMAS, TONDUT, VUILLEMIN. Dossier 4 : Activités de l’Association 1 Ce dossier, dans son intégralité, figurait parmi les documents de travail de Ch. Tillon en vue de la rédaction de son ouvrage La Révolte vient de loin. 1 Liste des mutins et/ou des membres de l’Association : 1946, 1949, 1950, 1958, sd Convocations aux réunions de bureau et PV, 1952, 1953, 1958, 1961, 1965, 1969, 1971 [A noter : PV de la réunion de bureau du 7 mars 1953 démettant Ch. -

Kommunistiska Internationalen Och Andra Världskriget
Pierre Broué Komintern och Andra världskriget Detta är två kapitel (nr 33 och 34) ur Broués stora arbete om den Kommunistiska internatio- nalens historia. På marxistarkivet finns sedan tidigare flera kapitel ur boken: Komintern fem år senare (kap 17), Kommunistiska Internationalen 1926-1933 (kap 23-25), Kommunistiska Internationalen 1933-1938. Folkfrontspolitiken införs (kap 29-31), Motorsågsmassakern (kap 32) och Dödsbudet. Upplösningen av Komintern (kap 35). I och med publiceringen av före- liggande två kapitel så finns nu bokens samtliga avslutande kapitel – 29-35 – på marxistarkivet. Översättningen är utförd av Björn-Erik Rosin Efter resp. kapitel nedan följer kompletterande lästips med artiklar, dokument m m. Om den marxistiske historikern Pierre Broué: Björn-Erik Rosin: Kortfattad presentation av P Broué Daniel Bensaid: Om Pierre Broué, för Encyclopédia Universalis Vincent Présumey: Pierre Broué (1926-2005) - En stor historikers liv och verk Bibliografi – Pierre Broués viktigaste arbeten Innehåll 33. Ett märkligt mellanspel ........................................................................................................ 1 34. Det ”Stora fosterländska kriget” ........................................................................................ 29 1 33. Ett märkligt mellanspel Den tysk-sovjetiska non-aggressionspakten var en av de avgörande händelserna i Europas historia under första hälften av förra seklet. Det har gett upphov till åtskillig polemik, inte alltid seriös ur historisk synvinkel, eftersom de framför allt varit inspirerade av en vilja att likställa nazism och kommunism, allt i enlighet med detta enda tänkesätt som idag försöker inta historikernas domäner. En överraskning får sin förklaring Denna pakt kom egentligen inte som någon överraskning för seriösa politiker och experter. Men den blev det för allmänna opinionen runt om i världen, i ”demokratier” som i ”dikta- turer”, som inte varit beredda på den. -

(Cccp) 1921-1988 261 J 6
Archives du Parti communiste français Archives de la commission centrale de contrôle politique (CCCP) 1921-1988 261 J 6 / 1 - 19 Inventaire réalisé par Catherine Bensadeck et Roland Krivine, mis à jour et complété par Pierre Boichu, sous la direction de Guillaume Nahon, directeur des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Bobigny Janvier 2005, mai 2012 Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 1 Intitulé : Archives de la commission centrale de contrôle politique du PCF. Références : FRAD093/261J6/. Dates extrêmes : 1921-1988. Importance matérielle : 1,8 ml. Modalités d’entrée : dépôt dans le cadre d’une convention avec le PCF. Conditions d’accès : les documents sont librement communicables après un délai de 25 ans, sauf les documents contenant des informations mettant en cause la vie privée des personnes pour lesquels le délai est fixé à 100 ans. Toute exception à ces dispositions suppose l’obtention préalable d’une dérogation auprès du déposant. Conditions de reproduction : sur autorisation du déposant. 2 AVANT PROPOS C’est avec intérêt, plaisir et une grande fierté que le Conseil général accueille aux Archives départementales et met à disposition du public le fonds des archives du Parti communiste français, reconnu par l’Etat comme relevant du patrimoine de notre pays. C’est la première fois qu’une formation politique de cette dimension décide d’ouvrir et de rendre accessible le plus largement possible ce qui constitue une partie de notre mémoire nationale. Cette masse de documents permettra de mieux voir et comprendre l’originalité du mouvement ouvrier français, son rôle dans la constitution de notre République et les valeurs dont celle-ci s’honore : liberté, égalité, fraternité. -

Communist Women's Resistance In
Communist Women’s Resistance in Occupied Paris: Engagement, Activism and Continuities from the 1930s to 1945 Amy Victoria Morrison Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Discipline of History School of Humanities University of Adelaide March 2018 i CONTENTS Abstract ii Thesis declaration iii Acknowledgements iv Abbreviations v Introduction and Review of the Historiography 1 Chapter One The Growth of the Parti Communiste Français and the Increasing Political Engagement of Women in the 1930s 42 Chapter Two The Transition from Legal Party to Illégale Organisation to Resistance Network, 1939-1941 79 Chapter Three The Consequences of Activism, 1942: police investigations and the treatment of women resisters 116 Chapter Four Underground Newspapers, 1942-1943: a platform for women’s mass resistance 150 Chapter Five The Resilience of Female Resisters Inside the ‘Fortress of Fascism’, 1944 193 Conclusion 233 Bibliography 240 ii Abstract The French communist resistance movement has been recognised as one of the most active networks of the French Resistance during World War II. This thesis addresses a gap in the scholarly literature concerning both the structure of the movement and the contribution of women to the communist resistance. While women are now included in the majority of general histories, the historiography has tended to understate the participation of female resisters. Women, however, were extensively involved as members of the communist resistance movement. This thesis allows us to gain an understanding of women as key contributors to the functioning of resistance networks. This study argues that women were integral to the success of the communist resistance movement. Detailed investigation of female communist resisters enables us to develop a deeper understanding of the emergence of resistance and how it was sustained. -

Fonds Francis Crémieux
Fonds Francis Crémieux Répertoire (25AR/1-25AR/130) Par M. Lacousse, H. Thoulhoat, A. Dejeux et S. Le Flohic Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2005 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_028002 Cet instrument de recherche a été encodé en 2012 par l'entreprise Numen dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 25AR/1-25AR/130 Niveau de description fonds Intitulé Fonds Francis Crémieux Nom du producteur • Crémieux, Francis (1920-2004) Localisation physique Pierrefitte DESCRIPTION Présentation du contenu Présentation matérielle : Dates extrêmes : 1896-2004. Importan-ce matérielle : 126 cartons (25 AR 1-130), 18 mètres linéaires. Modalités d'entrée : legs de Francis Crémieux du 8 mars 1999 [entrée n° 4986 du 24 septembre 2004 ; entrée n° 5022 du 26 avril 2005]. Conditions d'accès : libre. Reproduction à titre privé : libre. Reproduction à titre public : sur autorisation de l'exécuteur des droits moraux. Instrument de recherche : récolement méthodique détaillé, 175 p., 2005. Notice biographique de Francis Crémieux (1920-2004) : Origines familiales : Francis Crémieux est né le 27 octobre 1920, à 14 heures 30, au 29, passage des Favorites, dans le quinzième arrondissement de Paris. Son père, Benjamin Esdras Crémieux (1888-1944), est alors âgé de 32 ans : c'est un diplomate, un critique littéraire et de théâtre, et le traducteur renommé de Pirandello. Sa mère, Marianne Ragazziggi Stephanopoli de Comnène (1887-1978) est également traductrice et femme de lettres. -

FRACHON Benoît
FRACHON Benoît Né le 13 mai 1893 au Chambon-Feugerolles (Loire), mort le 4 août 1975 aux Bordes (Loiret) ; ouvrier métallurgiste ; secrétaire de la CGTU (1933-1936), secrétaire de la CGT (1936-1939), secrétaire général de la CGT (1945-1967), président de la CGT (1967-1975) ; membre de l’Assemblée consultative provisoire (1944-1945). Troisième enfant d’une famille ouvrière qui devait en compter cinq, Benoît Frachon naquit au Chambon- Feugerolles, ville minière et industrielle située en plein bassin houiller de la Loire. Le père, mineur, surveillant des travaux de fond, mourut prématurément à cinquante et un ans d’une crise d’urémie. Comme ses frères et sœurs, Benoît Frachon reçut une éducation religieuse, mais il fréquenta l’école publique. Il fut reçu au certificat d’études primaires en juillet 1904 – 29e (sur 88 reçus) du canton, 1er (sur 6) de son école, dont il conservera toute sa vie un souvenir vivace. Il entra au Cours supérieur de l’école du Chambon-Feugerolles, mais, après avoir échoué au concours des bourses, il abandonna les études deux ans plus tard. Il avait alors treize ans. Apprenti chez un petit patron – ancien ouvrier métallurgiste, il acquit les bases du métier et put se faire embaucher après la mort de son père dans une boulonnerie, où il devint tourneur grâce à l’aide de l’outilleur avec lequel il travaillait. En 1909, il adhéra au syndicat. L’adolescent a déjà été sensible aux solidarités ouvrières comme à la rigueur de la répression des mouvements sociaux : pendant la grève des mineurs d’octobre 1902, ainsi qu’à l’occasion du Premier Mai. -

Les « 45000 » Et Les « 31000 » De L'essonne
Les « 45000 » et les « 31000 » de l’Essonne 1 Table des matières Qui sont les 45000 et les 31000 d’Auschwitz-Birkenau ...................................................................... 6 Charlotte DUDACH, née Delbo - 31601 ............................................................................................. 9 Son engagement de jeunesse ............................................................................................................ 9 De Paris à Buenos Aires ................................................................................................................... 9 La Résistance ................................................................................................................................... 9 L’arrestation ..................................................................................................................................... 9 L’exécution de Georges Dudach .................................................................................................... 10 De Romainville à Auschwitz .......................................................................................................... 10 Ravensbrück ................................................................................................................................... 11 Le retour au théâtre de Jouvet ........................................................................................................ 11 La Suisse et les premiers écrits ..................................................................................................... -

Notes and References
Notes and References PREFACE 1. As Lenin expounded it in 'What is to be done?', V. I Lenin, Collected Works, vol. 5, May 1901-February 1902, London, Lawrence and Wishart; Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1961; and in V. Lenine, Un pas en avant, deux pas en arriere (La crise dans notre parti), Moscou, Editions du Progres, 1970. 2. See note 1. 3. Serge Wolikow, 'Les rapports du PCF et de l'Internationale Communiste (1925-1935)" Cahiers d'Histoire de l'Institut Maurice Thom;, no. 25-26, 2eme tri mestre 1978, p. 24. 4. Dominique Labbe, Le discours communiste, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1977, p. 32. CHAPTER 1 1. Guy de Carmoy, Politiques etrangeres de la France, Paris Table Ronde, 1967, p. 202. 2. Charles-Andre Julien, L 'Afrique du Nord en marche, nationalismes musulmans et sou verainete fran(aise, Paris, Julliard, 1972, p. 30. 3. Hubert Deschamps, 'Ne former qu'un seul peuple', Methodes et doctrines coloniales de la France, Paris, Armand Colin, 1953, p. 102. 4. Colette Jeanson et Francis Jeanson, L'Algerie hors la loi, Paris, Seuil, 1955, p. 54. 5. Pierre Stibbe, 'Le regime de l'Algerie depuis 1834', in Jean Dresch et al., La question algerienne, Paris, Editions de Minuit, 1958, p. 59. 6. The 1884 law enabled Arab-Berbers to participate in the election of two-fifths of the Municipal Councillors. They had to wait until 1919 before they could take part in the election of the Mayor and his deputies. The Superior Councils, composed of top civil servants and representatives of the population appointed by the Governor, numbered seven Arab-Berbers out of sixty members.