Entre Autres
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

(@ Generat Aoecmbly (Gigg) R Lter TURKMEN
UNITED NATIONS Generat AoecmblY Dt str. (@ GENERAI, A/4O/904t 26 Noeember I98 5 ORIGINAL: ENGI.ISE Fortieth sesslon Agenda iten 39 CO!,I!,IEI,IORATION OF TAE FOR?I ETH ANNIVERSARY OF THE UNITED NATIONS Le-tte,r dqteq.lS.t{oyerpPer 1,995 from t.he permanent Representatiee of Turkey to the United Nations t{ith reference to the letter dated g Novenber lg85 fron the pernanent Representa!lee of Burqaria to the unlted Nations addressed to rour Excelrency (A/40/5691 and upon lnstrrrctlons from ny Governnent, you I have the honour to resuesr to have the enclosed text and its appendices concerntng ehe oppressive pol.ici.es of the Governnent of Bulgaria aqainst Che Turklsh ninority in that country clrculated as an officiar. docunent of the General Assenrbly under agenda item 39. (gigg) r lter TURKMEN Ambasaador Pernanent Repr esentat ive Relssued for technical reasons. 85-34508 1787i (Er English^/40/9o4 Page 2 ANI{EX His Excellency Mr. Turgut Ozal, Prine Minister of Turkey, ln his atatenent to the ceneral Assembly on 22 October 1985, conitenned the pollcies of oppression of ninoritiea in certain countries in vlolatl.on of thelr specific inCernational obligations. He stated: nsuch is the cas€ of the Turkiah rninority in Bulgaria ehere the rights of that minorlty are being persisgently tranPled upon. includtng freedom of rellglon and conacience, and lhe rigbt to Preaerve its cultural identityn. The leCter addressed to the Secr etary-cener at by the Permanent Repreeentative of Bulgaria on I November 1985, thich in egsence reProduces the press release by che Bulgarian Permanent Mission to the united Nations on 22 October 1985, is in fact an admission of guilt. -

The Development Path of the Serbian Language and Script Matica Srpska – Members’ Society of Montenegro Department of Serbian Language and Literature
Jelica Stojanović THE DEVELOPMENT PATH OF THE SERBIAN LANGUAGE AND SCRIPT MATICA SRPSKA – MEMBERS’ SOCIETY OF MONTENEGRO DEPARTMENT OF SERBIAN LANGUAGE AND LITERATURE Title of the original Serbian Edition: Jelica Stojanović, Put srpskog jezika i pisma, Belgrade, Srpska književna zadruga, 2017, The Blue Edition series For the publisher JELICA STOJANOVIĆ Editor DRAGO PEROVIĆ Translation NOVICA PETROVIĆ ©Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Подгорица, 2020. Jelica Stojanović THE DEVELOPMENT PATH OF THE SERBIAN LANGUAGE AND SCRIPT Podgorica 2020 MILOš KOVAčEVIć THE DEVELOPMENT PATH OF THE SERBIAN LANGUAGE AND SCRIPT, MADE UP OF STRAY PATHS Only two years have passed from the two hundredth anni- versary of the beginning of Vuk Karadžić’s struggle for “intro- ducing the folk language in literature”, that is to say, from the introduction of the Serbian folk language in the Serbian literary language, or to put it in the more modern phrasing of today: the standard language. The beginning of that struggle is connected to the year 1814, when, in the royal city of Vienna, Vuk’s first grammar book came out: The Orthography of the Serbian Lan- guage Based on the Speech of the Common Folk, which dealt with resolving the three most important standard-related issues: a) the issue of the Serbian orthography, b) the issue of the morpho- logical structure of the Serbian language, and c) the issue of the name of the language and its national boundaries. Rare are the languages, if, indeed, there are any, which have had such a turbulent history of two hundred years. The histor- ical development of a language can be followed at two histor- ical levels: that of its internal and that of its external history. -

Magdalena Elchinova-Alien by Default- The
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/301342440 Alien by Default: The Turks of Bulgaria at Home and in Immigration Chapter · May 2005 CITATIONS READS 6 200 1 author: Magdalena Elchinova New Bulgarian University 12 PUBLICATIONS 33 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Religion and Migration in the Black Sea Region View project Resettlers and Migrants on the Two Sides of the Bulgarian-Turkish Border: Heritage, Identity, Cultural Interactions View project All content following this page was uploaded by Magdalena Elchinova on 17 April 2016. The user has requested enhancement of the downloaded file. Published in: R. Detrez and P. Plas (eds.), Developing Cultural Identity in the Balkans: Convergence vs. Divergence (Brussels: P.I.E.-Peter Lang), 2005, 87–110. CHAPTER 4 Alien by Default: The Identity of the Turks of Bulgaria at Home and in Immigration Magdalena ELCHINOVA New Bulgarian University, Sofia This article discusses how the identity of the Bulgarian-born Turks, who form the second biggest ethnic and religious group in Bulgaria, has been shaped and reshaped in critical situations and under the impact of changing politics of identity. The point of departure is the so-called „Revival process‟ which took place between 1984-1989, the last years of communist rule in the country. It was an assimilation campaign against the Turkish minority, aimed at the transformation of its identity and, ultimately, at its Bulgarisation. The last three months of this assimilation campaign were marked by the massive exodus of Turkish families from Bulgaria to Turkey. -

Racism, Xenophobia and Ethnic Conflict
Studies in Disarmament and Conflicts: THE DYNAMICS OF THE ARMS RACE INTERNATIONAL TERRORISM AND WORLD SECURITY ARMS CONTROL AND TECHNOLOGICAL INNOVATION CONTEMPORARY TERROR: Studies in Sub-state Violence THE HAZARDS OF THE INTERNATIONAL ENERGY CRISIS THE ARMS RACE IN THE 1980s SOUTH-EASTERN EUROPE AFTER TITO: A Powder-keg for the 1980s? REASSESSING ARMS CONTROL THE ARMS RACE IN THE ERA OF STAR WARS PERSPECTIVES ON THE ARMS RACE THE ARMS RACE IN AN ERA OF NEGOTIATIONS SPACE AND NUCLEAR WEAPONRY IN THE 1990s CONTROLLING THE INTERNATIONAL TRANSFER OF WEAPONRY AND RELATED TECHNOLOGY RISING TENSION IN EASTERN EUROPE AND THE FORMER SOVIET UNION 23 M Racism, Xenophobia and Ethnic Conflict Edited by Simon Bekker and David Carlton 1 INSTITUTE J OF | DEVELOPMENT I STUDIES | LIBRARY Indicator Press November 1996 © Indicator Press, 1996 Editors: Simon Bekker and David Carlton Layout/Production: Rob Evans Proofreading: David Carlton, Simon Bekker Administration: PatFismer Printing: Creda Press (Natal) Indicator South Africa University of Natal Private Bag X10 Dalbrldge 4014 Durban, South Africa ISBN: 1-86840-211-8 CONTENT^^^JTAM A MmdJL I MtS %J* Preface by Carlo Schaerf i List ojAbbreviations il Notes on Contributors iii Introduction by Simon Bekker iv Part One Identity, ethnicity, conflict 1 Hakan Wiberg Violent and peaceful settlements of ethnic conflicts: Some Theses on the Determinants 21 Klaus Gottstein Are nations natural economic units? 31 Carl Kaysen Military intervention in intrastate and ethnic conflict 49 George W. Rathjens Part Two Security, identity and the peace process in Northern Ireland ... 63 Bill McSweeriey Conflict, ethnicity and democratisation in contemporary South Africa 77 Simon Bekker Racism, xenophobia and the extreme right: A Five-Country Assessment 97 Christopher T. -
The Jews of Bulgaria from Early Emancipation to Early Sionism: and in Between?
1 “Encounters and Estrangements”, Pisa, November 12, 2012 Marco Dogo The Jews of Bulgaria from early emancipation to early sionism: and in between? The story of the Bulgarian Jews is based on a plot that can be summed up in a matter of minutes. At the close of the Ottoman rule they were a religious group that enjoyed official recognition. Demographically, they were the result of multiple immigrations and stratifications, but their homogeneous outward appearance was determined by the language they spoke, which for the vast majority was Judeo-Spanish. They were suddenly injected into a radically new institutional context by the decisions of the Congress of Berlin. The Treaty defined their legal position in the newly formed Bulgarian nation-state: like all Bulgarian citizens they would enjoy to the full both civil and political rights, and like any other resident on Bulgarian soil they would also enjoy freedom of religion and religious organization. It must be said, however, that the main concern of the legislators for peace was to protect the Muslim citizens of the new Principality. In any case, these principles were incorporated nine months later into the Constitution of Tărnovo, with no record of any attempt to limit their range. It is true that the Constituent Assembly was working “under Western eyes”: but the eyes of the Russian provisional civil governor were closer. Rather than to external European influences, then, the liberalism and the democratism of the Constitution of Tărnovo should probably be attributed to the wave of euphoria following the liberation of the country, also as regards the question of minorities. -

Diþ Polýtýka
DIŞ POLİTİKA - FOREIGN POLICY A Quarterly of the Foreign Policy Institute Vol. XXV 2000 Nos. 3-4 CONTENTS PAGES Foreword Seyfi Taşhan The Fruitful Legacy Erik Cornell..........................................................................................................4 Turkey’s vision for future should be built on her eventual membership Mükerrem Hiç......................................................................................................7 Copenhagen Criteria – Minorities – Turkey Pulat Tacar .........................................................................................................12 Turkmenistan and Turkey: Establishment and Development of Fraternal Relations Bayram S. Atayev ..............................................................................................17 About Actuality Aspects of Kazakhstan: Turkish Geopolitical Vector Abylkhozhin Juldusbek.....................................................................................20 Russia and Turkey: Horizons of Developing Policy Vladlen Martynov..............................................................................................23 Commonwealth of States Versus Turkey Ayhan Kamel......................................................................................................31 Perspectives for Stability in the Balkans: An Overview Ali Hikmet Alp ...................................................................................................38 The Balkans: Out of the Past Cornel Codita .....................................................................................................49 -
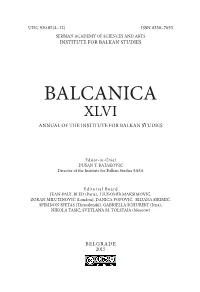
On a One-Sided Interpretation of the Yugoslav Past
UDC 930.85(4–12) ISSN 0350–7653 SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES BALCANICA XLVI ANNUAL OF THE INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES Editor-in-Chief DUŠAN T. BATAKOVIĆ Director of the Institute for Balkan Studies SASA Editorial Board JEAN-PAUL BLED (Paris), LJUBOMIR MAKSIMOVIĆ, ZORAN MILUTINOVIĆ (London), DANICA POPOVIĆ, BILJANA SIKIMIĆ, SPIRIDON SFETAS (Thessaloniki), GABRIELLA SCHUBERT (Jena), NIKOLA TASIĆ, SVETLANA M. TOLSTAJA (Moscow) BELGRADE 2015 Miloš Mišić http://www.balcanica.rs Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia doctoral research holder On a One-sided Interpretation of the Yugoslav Past Marie-Janine Calic, Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert. Munich: C.H. Beck, 2010; Serb. ed. Istorija Jugoslavije u 20. veku. Belgrade: Clio, 2013, 490 p. he author of this synthesis is the German historian of Croatian origin Marie-Janine Calic, daughter of the historian and writer Eduard Calic. PriorT to her current position as professor of history at Ludwig Maximilian University in Munich, she was a researcher at the German Institute for International and Security Affairs in Ebenhausen and Berlin (1992–2004). She also served as political advisor to the UN Special Representative for the former Yugoslavia in Zagreb (1995) and to the Special Coordinator of the Pact for the Stability of South-East Europe Bodo Hombach in Brussels (1999–2002). Calic also served as expert/consultant of the ICTY in The Hague. She is already known to Serbian readership by her book Social his- tory of Serbia 1815–1941. Sluggish progress in industrialisation (2004) derived from her doctoral thesis. -
Minorities Report
Defying Prejudice, Advancing Equality–1: Minorities in central and eastern Europe and the former Soviet Union rter Richard Ca Photograph: Roma family in Suceag, Romania Richard Carter EveryChild Copyright © 2001 EveryChild EveryChild is an international non-governmental organisation that works to promote the right and need of every child to grow up in a family. 4 Bath Place, Rivington Street London EC2A 3DR Tel: 020 7749 2430; Fax: 020 7749 2463 Email: [email protected] Website: www.everychild.org.uk Cover design: Brendan Davies The contents of this document may be freely reproduced or quoted, provided any reference is fully credited to EveryChild. Readers citing the document are asked to use the following form of words: Carter, Richard (2001), “Defying Prejudice, Advancing Equality–1: Minorities in central and eastern Europe and the former Soviet Union,” London: EveryChild. EveryChild: Defying Prejudice, Advancing Equality – 1 ii CONTENTS Page • Foreword vi • Executive Summary 1 • PART 1: MINORITIES AND DISCRIMINATION 3 What is a minority – and why does it matter? 3 Minorities in central/eastern Europe and the former Soviet Union 4 The irresistible rise of nationalism? 5 Nationalism in central/eastern Europe and the former Soviet Union 7 Nationalism resurgent 11 • PART 2: THE SITUATION IN THE REGION 14 Numbers of minority groups in the region 14 Discrimination against minorities: why we should be concerned 15 • PART 3: MINORITIES IN THE REGION: A RESOURCE 20 • PART 4: DEFYING PREJUDICE, ADVANCING EQUALITY 79 Breaking the cycle -

Neo-Ottomanist Hegemonic Order and Its Implications on Ankara's
ZOLTÁN EGERESI Neo-Ottomanist Hegemonic Order and its Implications on Ankara’s Foreign Policy in the Balkans Budapest, 2018 Corvinus University of Budapest International Relations Multidisciplinary Doctoral School International and Security Studies Subprogram PHD THESIS Zoltán EGERESI Neo-Ottomanist Hegemonic Order and its Implications on Ankara’s Foreign Policy in the Balkans Supervisors: László Csicsmann, Dr. Habil Erzsébet N. Rózsa, Dr. Habil. Budapest, 2018 © Zoltán Egeresi Table of Contents Acknowledgments ......................................................................................................................... 5 List of Figures, Tables and Maps ................................................................................................... 6 List of Abbreviations ..................................................................................................................... 8 Introduction 10 Hypotheses, methodology and literature review ....................................................................... 21 1. Hypotheses ........................................................................................................................ 21 1.1. Conceptualizing Turkish foreign policy ...................................................................... 21 1.2. Hypothesis 1 – Neo-Ottomanism in Turkish foreign policy ....................................... 28 1.3. Hypothesis 2 – The AKP’s neoliberal foreign policy ................................................... 38 2. Theoretical Foundations ................................................................................................... -

European Perspectives of the Western Balkans Countries
European perspectives of the Western Balkans countries I Afrim HOTI – Igor KOSÍR (editors) Prishtina 2015 AAB College © Authors of this international team of university teachers and researchers Editors: Prof. ass. dr. Afrim HOTI University of Prishtina, Kosovo Faculty of Philosophy Department of Political Science Prof. Ing. Igor KOSÍR Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia Faculty of Political Science and International Relations International Relations and Diplomacy Department Opponents: Prof. PhDr. Peter TEREM Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia Faculty of Political Science and International Relations International Relations and Diplomacy Department Associate Prof. Ing. Obadi Saleh Mothana OBADI Institute of Economic Research, Bratislava Slovak Academy of Sciences, Slovakia Associate Prof. Ing. Peter KNAPIK Bratislava University of Economics, Slovakia Faculty of Commerce International Trade Department Prof. Dr Arsim BAJRAMI University of Prishtina Faculty of Law Copy Editor: Besfort MEHMETI AAB College, Prishtina With the decision of the editorial board of AAB College No. 1229/2015. date 07.10.2015 is decided to be published the monograph European Perspective of the Western Balkans Countries which can be used as a university textbook AAB College, Prishtina in cooperation with Institute for Promoting European Values in Bratislava, Slovakia, University of Prishtina, Kosovo, as well as Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia Prishtina 2015 1st edition ISBN 978-9951-494-53-3 Contents Preface .......................................................................................................... -

Muslim Minorities in Bulgaria
ELENA MARUSHIAKOVA & VESSELIN POPOV Muslim Minorities in Bulgaria Historical background Historians usually associate the entry of Islam in the terri- tory of Bulgaria and the subsequent emergence of Turkish and other Muslim minorities with the conquest of Bulgaria by the Ottoman Empire in the 14th century, when the coun- try was incorporated into the Empire. There is no doubt, however, that the much-disputed roots of the ethnic and religious mosaic of present day Bulgaria are older than that. We have to emphasise the fact that, in the Balkans, history is not so much a science as a constructive element in the process of nation formation and an essential struc- ture of national consciousness. Various scholary theories are often embedded into specific national doctrines and we should not be surprised at the radical discrepancies in eve- ry historical explanation of the same events or processes. The different periods in Bulgarian historical science are dominated by two extremely contradictory theories about the Ottoman invasion and the origin of the Turkish popula- tion in Bulgaria (Zheliazkova: 1997, 14). The contradictory policies of the Bulgarian state with respect to the Turkish and the other Muslim minorities in the different historical periods were based on these major theories. According to the first theory, the cruel genocide of Bulgarians after the Ottoman invasion was followed by intensive colonisation of the population in Anatolia (Asia Minor). This population was linked to the Ottoman mili- 1 tary invasion and was an important element in the coloni- tradition associates the Kizilbash with various Sufi broth- sation policy of the invaders. -

The Case of Bulgaria Dr
Transition, Violence and the Role of NGOs: the Case of Bulgaria Dr. Evgenii Dainov1 1. Violence in the post-modern world It is a mistake to think of violence as an aberration – a virus in the software that can be eradicated by narrow specialists. It verges on conceptual and political impotence to grasp violence as the product of a specific recent outside influence – television, pornography, Terminator-3, Tom and Jerry, George W. Bush – that can be legislated away or voted out. In post-modern times violence – particularly violence between large groups – is to do mostly with identity, status and recognition. In times when such matters are seen as settled and self- evident, they do not produce violence. In times when moorings are adrift – they do. There are things that can be done to counter, minimize or de-fuse violence. Some measure of success in this seems to be possible under two basic scenarios. One: when deciding to do something about violence, it may be useful to keep oneself as far away as possible from conceptual thinking (in order not to paint oneself into a corner by not seeing the full possibilities because of pre-existing conceptual limitations); and just try out all sorts of things that look as if they may work. And / or, two: have the right – the useful – conceptual basis, on which to construct a system of activities. There are few things more de-mobilising than seeing the results of action based on erroneous concepts. For example, if one were to follow a current school of thought and manage to, quickly and dramatically, improve living standards in the greater Middle East, this would not eradicate terrorist violence, because it would be based on an erroneous concept.