L'histoire De Montréal Vécue ********
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

State of Wisconsin
CONSTITUTION 0F THE STATE OF WISCONSIN. ADOPTED IN CONVENTION, AT xVIADISON, ON THE FIRST DAY OF FEBRUARY, IN THE YEAR OF OUR LORD ONE THOUSAND EIGHT HUN DRED AND FORTY-EIGHT. PREAMBLE. We, the people of Wisconsin, grateful to Almighty God fbr oar freedom, in order to secure its blessings, form a more perfect gorer:; • menu insure domestic tranquility, and promote the general weifars ; do establish this CONSTITUTION. ARTICLE I. DECLARATION OF RIGHTS. SECTION I. All men are born equally free and indepandent, ar;d have certain inherent rights, among these are life, liberty and the pursuit of happiness ; to secure these rights, governments are insti tuted among men, deriving their just powers from the consent of tha governed; SEC. 2. There shall be Heither slavery nor involuntary servitude m this State otherwise than for the punishment of crime, whereof the party shall have been duly convicted. SEC. 3. Every pjrson may freely speak, write and pubh'sh his sentiments on all subjects, being responsible for the abuse of that right, and no laws shall be passed to restrain or abridge the liberty of speech or of the press. In all criminal prosecutions or indictmentii for libel, the truth may be given in evidence, and if it shall appear to the jury, that the matter charged as libellous, be true, and was published with good motives, and for justifiable ends, the party shaii be acquitted ; and the jury shall have the right to determine the law and the fact. SEC. 4. The right of the people peaceably to assembly to consul': for the common good, and to petition the Government or any depa/t ment thereof, shall never be abridged. -

Living and Learning in New France, 1608-1760
CJSAEIRCEEA 23) Novemberlnovembre 2010 55 Perspectives "A COUNTRY AT THE END OF THE WORLD": LIVING AND LEARNING IN NEW FRANCE, 1608-1760 Michael R. Welton Abstract This perspectives essay sketches how men and women of New France in the 17th and 18th centuries learned to make a living , live their lives, and express themselves under exceptionally difficult circumstances. This paper works with secondary sources, but brings new questions to old data. Among other things, the author explores how citizen learning was forbidden in 17th- and 18th-century New France, and at what historical point a critical adult education emerged. The author's narrative frame and interpretation of the sources constitute one of many legitimate forms of historical inquiry. Resume Ce croquis d'essai perspective comment les hommes et les femmes de la Nouvelle-France au XVlIe et XV1I1e siecles ont appris a gagner leur vie, leur vie et s'exprimer dans des circonstances difficiles exceptionnellement. Cette usine papier avec secondaire sources, mais apporte de nouvelles questions d'anciennes donnees. Entre autres choses, I' auteur explore comment citoyen d' apprentissage a ete interdite en Nouvelle-France XVlIe-XV1I1e siecle et a quel moment historique une critique de ['education des adultes est apparu. Trame narrative de ['auteur et ['interpretation des sources constituent une des nombreuses formes legitimes d'enquete historique. The Canadian Journal for the Study of Adult Education/ La Revue canadienne pour i'ill/de de i'iducation des adultes 23,1 Novemberlnovembre 2010 55-71 ISSN 0835-4944 © Canadian Association for the Study of Adult Education! L' Association canadienne pour l' etude de I' education des adultes 56 Welton, ({Living and Learning in New France, 1608-1760" Introduction In the 1680s one intendant wrote that Canada has always been regarded as a country at the end of the world, and as a [place of] exile that might almost pass for a sentence of civil death, and also as a refuge sought only by numerous wretches until now to escape from [the consequences of] their crimes. -

Schéma D'aménagement Et De Développement Révisé 2010
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 2010 II LISTE DES AM ENDEMENTS Numéro de règlement Date d’entrée en vigueur 2011-678 9 juin 2011 2013-781 9 décembre 2013 2014-819 16 janvier 2015 2015-834 23 novembre 2015 2016-915 3 mars 2017 2017-954 19 décembre 2017 2018-992 4 octobre 2018 2019-1026 18 juin 2019 RÉALISATION : Ville de Rouyn-Noranda COORDINATION DU PROJET : Violaine Lafortune RECHERCHE ET RÉDACTION : Violaine Lafortune Frédéric Gauthier CARTOGRAPHIE : Natalie Marsan SUIVI ET SUPERVISION PAR LE COMITÉ D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME : Mario Provencher, maire et président du comité Marc Bibeau, conseiller municipal Jean Olivier, conseiller municipal Pierre Monfette Robert Deschênes MISE EN PAGE : Isabelle Lacombe RÉVISION LINGUISTIQUE : Carmen Dion GRAPHISME: Karine Berthiaume EXPLICATIONS DU GRAPHISME DE LA PAGE COUVERTURE : L’illustration de la page couverture représente la Ville de Rouyn-Noranda en tant que territoire. La forme du globe terrestre nous rappelle cette occupation et sa couleur cuivrée nous ramène directement à notre dénomination de Capitale nationale du cuivre. Tous les éléments et couleurs qui se trouvent sur la sphère sont une énumération non exhaustive des ressources naturelles, de l’économie, du progrès et des services disponibles dans notre ville. Le point central de l’image est une famille, parce que la population est toujours au premier plan et que ce schéma d’aménagement et de développement est conçu en pensant à la qualité de vie des générations présentes et à venir. Finalement, la couleur dominante verte nous rappelle que Rouyn-Noranda est une ville en santé et soucieuse de son environnement. -

Chapman's Bookstore 2407 St
'. , ~ ~- - - ---rom-: iii ,~-----.--- AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION Montreal Conference AT McGILL UNIVERSITY JUNE 6 TO I2, I900 Programnle and Guide ISSUED BY THE LOCAL COMMITTEE MONTREAL THE HERALD PRESS eont~nts History of Montreal Description McGill University Montreal Libraries Sunday Services Summary of Points of Interest in and about Montreal Programme of Local Elltertainment Local Committee Wheelmen's Favorite Routes Map of Montreal Advertisers Published for the I,oca\ Committee By F. E. PHELAN, 2331 St. Catherine Street, lVIontreal HISTORY HE history of Montreal as a centre of population commences with the visit of Jacques Cartier to the Indians of the town of Hochelaga in 1535. The place was situated close to T Mount Royal, on a site a short distance from the front of the McGill College Grounds, and all within less than a block below Sherbrooke Street, at Mansfie1.d Street. It was a circular palisaded Huron-Iroquois strong hold, which had been in existence for seyeral generations and had been founded by a party which had broken off in some manner from the Huron nations at Lake Huron, at a period estimated to be somewhere about 1400. It was at that time the dominant town of the entire Lower St. Lawrence Valley, and apparently also of Lake Champlain, in both of which quarters numerous settlements of the same race had sprung from it as a centre. Cartier describes how he found it in the following words: " And in the midst of those fields is situated and fixed the said town of Hochelaga, near and joining a mountain which is in its neighbour hood, well tilled and exceedingly fertile; therefrom one sees very far. -
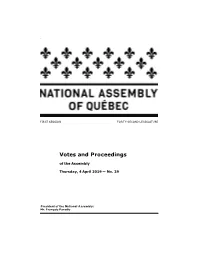
Votes and Proceedings of the Assembly
FIRST SESSION FORTY-SECOND LEGISLATURE Votes and Proceedings of the Assembly Thursday, 4 April 2019 — No. 29 President of the National Assembly: Mr. François Paradis Thursday, 4 April 2019 No. 29 The Assembly was called to order at 9.40 o’clock a.m. _____________ ROUTINE PROCEEDINGS Statements by Members Mr. Émond (Richelieu) made a statement to congratulate figure skater Ms. Maude Frappier and basketball player Ms. Myriam Leclerc on their athletic achievements. _____________ Mr. Proulx (Jean-Talon) made a statement to underline the 20th anniversary of the organization Le Verger, Centre communautaire en santé mentale. _____________ Mrs. Lavallée (Repentigny) made a statement to underline the 15th anniversary of Ensemble vocal Vox Luminosa. _____________ Mrs. Rizqy (Saint-Laurent) made a statement to pay tribute to Mr. Claude Leblanc for his volunteer work and community involvement. _____________ Mrs. McCann (Sanguinet) made a statement to congratulate the athletes of Sanguinet riding on their athletic performances. 445 4 April 2019 Mr. Bérubé (Matane-Matapédia) made a statement to pay tribute to Mrs. Carole Duval, Director General of the Mont-Joli Regional Airport. _____________ Mrs. Hébert (Saint-François) made a statement to pay tribute to Mr. Claude Leblanc for his volunteer work and community involvement. _____________ Mr. Ouellette (Chomedey) made a statement to underline the work of a Université de Sherbrooke team in the fight against planned obsolescence and for the right to repair. _____________ Mr. Lévesque (Chapleau) made a statement to underline the 50th anniversary of the Club de l’âge d’or de Templeton. _____________ Mrs. Laforest (Chicoutimi) made a statement to underline the 125th anniversary of the Institut des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil. -

Chauveau Lévis La Peltrie Montmorency Vanier
RÉGION DE QUÉBEC RÉGION DE GATINEAU RÉGION DE TROIS-RIVIÈRES Lac à la Grandes- in Pêche Saint-Tite Saint-Adelphe Chem Ed el R Piles (VL) we ou (V) R (P) PROPOSITION RÉVISÉE DE DÉLIMITATION i te ss Sainte-Brigitte-de-Laval (V) (3 ) d Shawinigan (V) o 6 u arr u s 6 07 C efo Château-Richer (V) ur Lac t Lac n ) (3 (366) e Hérouxville (P) ro ale des Piles u ip 1 DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES Hayes c Lac H in 5 3 Saint-Séverin (P) r 5 Lac- s P Lac 5 Delage e La Pêche (M) ute 1 R Ro Lac à la te o d Lac la u u McGregor Delage o te A e Perchaude R 1 CONFORMÉMENT AU SECOND RAPPORT r Retenue u Lac-Beauport (M) 5 (V) t 9 è i o Lac à la r iv o LAVIOLETTE– u Île Tortue R t Stoneham-et- e FÉVRIER 2017 Lac Enchanteresse L Lac a R Tewkesbury (CU) u Beauport Tourbillon r e i SAINT-MAURICE) v n i Val-des-Monts (M) 5 t è 5 i Saint-Mathieu-du-Parc (M) ( e r Saint-Gabriel-de-Valcartier (M) Lac Lac e n e i n e M g Saint-Charles Fortier r ( o e 7 (3 n 3 Lac n L'Ange-Gardien (M) al 51 É Bouleva ) p ) ' R t i l c Neigette m in i Lac du r e v P o C d Frontière Québec–Terre-Neuve-et-Labrador Saint-Stanislas (M) Circonscriptions proposées r in i r h e e è e Sud-Ouest m m (cette frontière n’est pas définitive) i n e r t rd i e r h n c C d a e a y e s ut u C É o - r r x a to Réseau routier s Lac Ray b u Lac-Saint- e M le A P Lac s mond u o i Jaune ( n Québec (V) R n Joseph (V) q B 3 Limite de circonscription actuelle (2011) o Clément t 5 Réserve et établissement indien s c i é GATINEAU u v 1 R a le e ) i ) o è J v d u a r 6 e t r e Limite nationale d 6 e Saint-Narcisse (P) e 3 3 52 r V CHARLEVOIX– l 3 CHARLEVOIX– ( 5 G a e a 9 t Cantley (M) r u è l a o Lac i c S Carte de base : Ministère de l’Énergie et des a ti u L'Ange-Gardien (M) R v r n o o Limite provinciale i t e f Perceval ie e u Ressources naturelles du Québec n e R r r r c (3 u a r CÔTE-DE-BEAUPRÉ e 7 a u a Limite municipale 1 C CHAUVEAU J ( ) 3 u e Lac des 0 Les limites municipales sont celles d r A 7 ) e è u t i Roches Shawinigan (V) Limite d'arrondissement existant le 30 septembre 2016. -

Daily Life in New France
Daily Life in New France From History of Canada Online The Seigneurial System condition that he met certain requirements. The seigneur had to build a manor house, a place of Because New France was an agrarian, rural worship, a fort, and a mill. society with almost four out of every five people living on a farm, one of the roots of daily life They had to live on their land or hire a was the seigneurial system. A land distribution responsible individual to do so on their behalf. and holding system patterned on European The seigneur was responsible for defense as well feudalism, it created a highly distinctive as for acting as judge in matters of dispute. settlement pattern. Initially, almost all seigneurs were male but by The system was originally developed by the establishment of Royal Government in 1663, Cardinal Richelieu but significantly extended more than half were women. This resulted from and refined by Jean Talon. The king owned all the French equal inheritance system as well land in New France. Seigneuries were grants of because many men joined the fur trade or land made by the Crown to members of the military. Also, given the fact that New France nobility and varied in size from ten square was a violent, frontier society, many men died kilometers to close to two hundred square prematurely bequeathing their land to their kilometers. The seigneurs, or lords, in turn, then wives. parceled out the land and rented it to the habitants who worked it. By the middle of the The habitant had his own unique duties under eighteenth century, there were over two hundred the system as well. -

Women of New France
Women of New France Introducing New France Today it may be hard to imagine that vast regions of the North American continent were once claimed, and effectively controlled, by France. By 1763 some 70,000 French speakers based primarily in what is now the province of Quebec, managed to keep well over 1,000,000 British subjects confined to the Atlantic seaboard from Maine to Florida. France claimed land that included 15 current states, including all of Michigan. The early history of North America is a story of struggle for control of land and resources by Women in New France French settlers in Nouvelle France (New France in English), English settlers We know very little about the everyday lives of people in what in the Thirteen Colonies, and Native peoples who already lived in the areas was New France, particularly the women. Native women, from a that became the US and Canada. wide range of nations along the St. Lawrence and Great Lakes river system, had lived in North America for thousands of years before the arrival of French explorers. While there was a good deal of variety among Indian societies, most Native women lived more independent lives than did their European counterparts. In some societies, in addition to the usual child-rearing and household economy practices, Native women had real political power and could elect village and tribal leaders. New France 1719 European Women’s Roles European women’s lives, like those of their Native American counterparts, were shaped by the legal, cultural, and religious values of their society. -

Programme De Financement Des Infrastructures
Engagements de plus de 25 000 $ ANNEXE - PFI JANVIER À MARS 2019 MINISTÈRE DE LA FAMILLE SERVICE DE GARDE CIRCONSCRIPTION No VALEUR MONTANT MONTANT TOTAL SÉQ NOMINALE INTÉRÊT (CAP. + INTÉRÊT) No DIVISION NOM ADRESSE (division) No NOM 1 2312-3318 CPE NEZ-À-NEZ 567, rue Desjardins Nord, Granby, QC, J2H 1Z5 206 Granby 1 431 763,61 $ 332 228,84 $ 1 763 992,45 $ 2 3000-2069 CPE DE MONTRÉAL-NORD 4875, boulevard Léger, Montréal-Nord, QC, H1G 6P8 360 Bourassa-Sauvé 2 061 342,68 $ 340 078,01 $ 2 401 420,69 $ 3 1627-7204 CPE JOLI-COEUR INC. 18, rue Louis-Jolliet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC, G3N 2N6 720 La Peltrie 1 554 734,12 $ 229 734,86 $ 1 784 468,98 $ 4 2315-3299 CPE L'ESCARGOT INC. 8055, rue Collerette, Saint-Léonard, QC, H1P 2V6 364 Jeanne-Mance - Viger 152 450,86 $ 12 956,39 $ 165 407,25 $ 5 2958-0909 CPE MON AUTRE MAISON ET B.C. DE LA GARDE EN M.F344, rue de Monseigneur-Panet, Nicolet, QC, J3T 1B7 150 Nicolet-Bécancour 646 861,93 $ 88 815,32 $ 735 677,25 $ 6 1364-2186 CPE LA RUCHE 2555, rue Leclaire, Montréal, QC, H1V 3A8 352 Hochelaga-Maisonneuve 1 058 876,91 $ 156 464,65 $ 1 215 341,56 $ 7 1503-0893 CPE PIERROT LA LUNE INC. 1080, boulevard Sainte-Foy, Longueuil, QC, J4K 1W6 246 Marie-Victorin - $ 396 145,11 $ 396 145,11 $ 8 1478-5323 LES PETITS AMIS DE LORRAINE INC. 70, rue Belfort, Lorraine, QC, J6Z 2T5 536 Blainville - $ 291 345,15 $ 291 345,15 $ 9 1356-8654 CPE LA GROSSE TORTUE 2391, rue Nicolas-Pinel, Québec, QC, G1V 4H9 702 Jean-Talon - $ 21 432,26 $ 21 432,26 $ 10 3000-8426 CPE UATIKUSS 204, rue Lorraine, Schefferville, QC, G0G 2T0 902 Duplessis - $ 352 170,74 $ 352 170,74 $ 11 3000-4897 CPE LA GRANDE OURSE 2600, rue Principale, Sainte-Julie, QC, J3E 2H6 256 Verchères - $ 213 292,81 $ 213 292,81 $ 12 2326-4443 LES PETITS TRÉSORS DE BOISBRIAND 505, chemin de la Grande-Côte, Boisbriand, QC, J7G 3K7 502 Groulx - $ 78 908,57 $ 78 908,57 $ 13 3000-4994 CPE LA PETITE RUCHE ENSOLEILLÉE 820, boulevard de la Chapelle, Pointe-Calumet, QC, J0N 1G1 492 Mirabel - $ 16 311,13 $ 16 311,13 $ 14 2758-8557 CPE L'ANODE MAGIQUE INC. -

New France from 1713-1800 by Adam Grydzan and Rebecca
8 Lessons Assignment Adam Grydzan & Rebecca Millar Class: CURR 335 For: Dr. Christou Lesson 1: Introduction Overview: This lesson is the introductory lesson in which we will overview the parties involved in “Canada” at the time exp: New France, Britian, First Nations. In addition, we will begin to explore the challenges facing individuals and groups in Canada between 1713 and 1800 and the ways in which people responded to those challenges. It will involve youtube clips showing an overview of where Canada was at the time and involve students using critical thinking skills to understand how the various parties felt during the time. Learning Goal: Critical thinking skills understanding the challenges people faced between 1713 and 1800 as well as knowledge of the structure of Canada in 1713 and the relationship between France, Britian and the First Nations during this time. Curriculum Expectations: 1. A1.2 analyze some of the main challenges facing individuals and/or groups in Canada between 1713 and 1800 and ways in which people responded to those challenges, and assess similarities and differences between some of these challenges and responses and those of present-day Canadians 2. Historical perspective Materials: Youtube Videos: Appendix A1: Video - A Part of our Heritage Canada https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O1jG58nghRo Appendix A2 Video – A Brief History of Canada https://www.youtube.com/watch?v=ksYSCWpFKBo Textbook: Appendix A3 Textbook – Pearson History Grade 7 http://kilby.sac.on.ca/faculty/nMcNair/7%20HIS%20Documents/His7_Unit1.pdf Plan of Instruction: Introduction (10 minutes): The lesson will begin with playing the two videos that introduce the ideas of security and events and perspectives leading up to the final years of New France. -
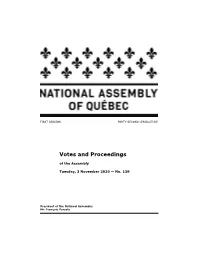
Votes and Proceedings of the Assembly
FIRST SESSION FORTY-SECOND LEGISLATURE Votes and Proceedings of the Assembly Tuesday, 3 November 2020 — No. 139 President of the National Assembly: Mr. François Paradis Tuesday, 3 November 2020 No. 139 The Assembly was called to order at 1:41 p.m. _____________ ROUTINE PROCEEDINGS Statements by Members Mr. Rousselle (Vimont) made a statement to underline the 30th anniversary of the organization Éduc’alcool. _____________ Mr. Tremblay (Dubuc) made a statement to underline Mr. André Gagné’s generosity and efforts to hand out candy to children on Halloween during the pandemic. _____________ Mr. Derraji (Nelligan) made a statement to congratulate Mr. Philippe Boucher, award recipient at the Forces AVENIR gala. _____________ Ms. Proulx (Côte-du-Sud) made a statement to underline École Saint-Joseph students’ project to set up an outdoor skating rink. _____________ 2593 3 November 2020 Ms. Perry Mélançon (Gaspé) made a statement to underline the heroic actions of Ms. Roberte Boucher and Mr. Gérald Ouellet. _____________ Mr. Martel (Nicolet-Bécancour) made a statement to underline citizens’ heroic actions during the 20 June 2020 boating accident on Rivière Nicolet. _____________ Mr. Fontecilla (Laurier-Dorion) made a statement to underline the 10th white poppy campaign. _____________ Mr. Schneeberger (Drummond−Bois-Francs) made a statement to pay tribute to the organization Parrainage civique Drummund’s volunteers, participants and team members. _____________ Ms. Boutin (Jean-Talon) made a statement to pay tribute to Ms. Gloria Lizama, Director of the organization Le Mieux-Être des Immigrants. _____________ At 1:51 p.m., Mr. Picard, First Vice-President, suspended the proceedings for a few minutes. -

Bureau De Développement Rapport Annuel 2003-2004
Bureau de développement Rapport annuel 2003-2004 Une autre première pour HEC Montréal PLUS DE 1 600 000 $ AMASSÉS ! La campagne Déjà demain, édition 2003-2004, a permis de dépasser pour la première fois la barre du million de dollars. C’est dire à quel LE PRÉSIDENT point l’engagement des amis de HEC Montréal Louis Larivière 1982 est fort et déterminé. C’est dire aussi combien la LES VICE-PRÉSIDENTS Guy Bélisle 1976 cause du savoir en gestion regroupe de plus en Jean-Guy Daoust 1971 plus d’adeptes. Gil Demers 1984 Jean Guertin 1965 Toute campagne de financement menée par W. Robert Laurier 1967 le milieu universitaire devient essentielle pour Luc N. Martin 1979 Jean Raymond 1976 assurer un enseignement de qualité supérieure. Déjà demain, tel que Paul G. Vien 1959 son nom l’indique d’ailleurs, ne fait pas exception à cette règle. Devant les bouleversements technologiques, la mondialisation et les secousses que produit un monde en mutation continue, il faut être en mesure de répondre rapidement et efficacement aux incessantes inter- rogations découlant de ces phénomènes. C’est par un enseignement à la fine pointe prodigué par des professeurs de haut niveau soutenus par de la recherche de calibre international et par des outils innovateurs que nous pouvons réaliser pleinement notre mission et, in fine, assurer notre avenir. Votre soutien et le fait que BusinessWeek, dans son édition du mois d’oc- tobre 2004, classe notre programme de M.B.A. au dixième rang des éco- les internationales hors États-Unis nous permettent de croire avec assu- rance que HEC Montréal répond adéquatement aux nouveaux enjeux.