Theorisation Ancree Du Religieusement Acceptable Au Quebec
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
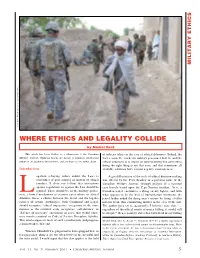
Where Ethics and Legality Collide
MILITARY ETHICS DND photo AR2011-0125-09 by Corporal Tina Gillies. Tina Corporal by AR2011-0125-09 DND photo WHERE ETHICS AND LEGALITY COLLIDE by Michel Reid This article has been written as a submission to the Canadian of military ethics in the case of ethical dilemmas. Indeed, the Military Journal. Opinions herein are meant to stimulate intellectual very reason we teach our military personnel how to analyze debate in an academic environment, and are those of the author alone. ethical situations is to impart an understanding that sometimes doing the right thing is not that easy, and that sometimes all Introduction available solutions have serious negative consequences. egalism (obeying orders and/or the Law) is A good illustration of the tools of ethical decision-making sometimes of poor counsel in matters of ethical was offered by Dr. Peter Bradley in a previous issue of the conduct. It does not follow that infractions Canadian Military Journal, through analysis of a fictional against regulations or against the Law should be case loosely based upon the Capt Semrau incident.1 In it, a ignored. There should be, in the military profes- Canadian patrol encounters a dying enemy fighter, and with Lsion, a formal mechanism to examine cases where an ethical what appears to be the best of humanitarian intentions, the dilemma forces a choice between the moral and the legalist patrol leader ended the dying man’s misery by firing a bullet courses of action. Authorities, both Command and Legal, into his head, thus committing murder in the eyes of the law. -

Gotovina Et Al Judgement Volume II
IT-06-90-T 38520 D38520 - D37937 International Tribunal for the UNITED Case No. IT-06-90-T Prosecution of Persons Responsible for NATIONS Serious Violations of International Date: 15 April 2011 Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia Original: English since 1991 IN TRIAL CHAMBER I Before: Judge Alphons Orie, Presiding Judge Uldis Ėinis Judge Elizabeth Gwaunza Registrar: Mr John Hocking Judgement of: 15 April 2011 PROSECUTOR v. ANTE GOTOVINA IVAN ČERMAK MLADEN MARKAČ PUBLIC ______________________________________________________________________ JUDGEMENT VOLUME II OF II ______________________________________________________________________ Office of the Prosecutor Counsel for Ante Gotovina Mr Alan Tieger Mr Luka Mišetić Mr Stefan Waespi Mr Gregory Kehoe Ms Prashanti Mahindaratne Mr Payam Akhavan Ms Katrina Gustafson Mr Edward Russo Counsel for Ivan Čermak Mr Saklaine Hedaraly Mr Ryan Carrier Mr Steven Kay, QC Ms Gillian Higgins Counsel for Mladen Markač Mr Goran Mikuličić Mr Tomislav Kuzmanović 38519 Table of contents General abbreviations 7 1. Introduction 9 2. Sources and use of evidence 13 3. The Accused 37 3.1 Ante Gotovina and the Split Military District 37 3.1.1 Position of Ante Gotovina within the Split Military District 37 3.1.2 Ante Gotovina's powers as a commander 52 3.2 Ivan Čermak and the Knin garrison 73 3.3 Mladen Markač and the Special Police 86 4. Crimes committed in municipalities (July-September 1995) 105 4.1 Murders 105 4.1.1 Overview of the charges 105 4.1.2 Benkovac municipality 106 4.1.3 -

The Meritorious Service Cross 1984-2014
The Meritorious Service Cross 1984-2014 CONTACT US Directorate of Honours and Recognition National Defence Headquarters 101 Colonel By Drive Ottawa, ON K1A 0K2 http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhr-ddhr/ 1-877-741-8332 © Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014 A-DH-300-000/JD-004 Cat. No. D2-338/2014 ISBN 978-1-100-54835-7 The Meritorious Service Cross 1984-2014 Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Canada, wearing her insignia of Sovereign of the Order of Canada and of the Order of Military Merit, in the Tent Room at Rideau Hall, Canada Day 2010 Photo: Canadian Heritage, 1 July 2010 Dedication To the recipients of the Meritorious Service Cross who are the epitome of Canadian military excellence and professionalism. The Meritorious Service Cross | v Table of Contents Dedication ..................................................................................................... v Introduction ................................................................................................... vii Chapter One Historical Context ........................................................................ 1 Chapter Two Statistical Analysis ..................................................................... 17 Chapter Three Insignia and Privileges ............................................................... 37 Conclusion ................................................................................................... 55 Appendix One Letters Patent Creating the Meritorious Service Cross .............. 57 Appendix Two Regulations Governing -

Down to One: Canada's Presence In
PEACEKEEPING AND PEACEMAKING Down to One: Canada’s Presence in Cyprus 1964-2011 Character Education • Consider the causes of conflict in human nature • Evaluate different methods of conflict resolution • Apply the lessons of peacekeeping in Cyprus to their own lives Facts PEACEKEEPING AND PEACEMAKING MINUTES • Cyprus, roughly the size of P.E.I., gained independ- ence from Britain in 1960 and faced serious internal Major General Alain R. strife between Greek Cypriots and Turkish Cypriots by 1963 Forand, peacekeeper • Nearly 30,000 Canadian Forces members served in extraordinaire Cyprus, many on several peacekeeping rotations from “There were two wounded 1964–1993. Cyprus is the UN’s longest peacekeeping commandos so, as I went to mission get these guys, I placed two machine guns and told them • 28 Canadians died in Cyprus with a total of 181 that if I am fired upon I will fatalities related to the UN mission there give you the order to fire. As I Before the Reading went down to get the first one I was fired upon, so I gave the • What do Cyprus, Crete, Corfu, Sicily, Capri and The Star of Courage Étoile du Courage order to fire back.” Then www.veterans.gc.ca Malta have in common? Share any information you Captain Alain Forand was have as a group about these places, especially Cyprus speaking about his rescue of two wounded soldiers • Make a list of countries that contain populations of of the Canadian Airborne. The lightly armed com- divergent origins—such as French and English Canada. mandoes had found themselves trapped between bel- What are the pros and cons of divergent populations? ligerent forces as the well armed Turkish Forces in Cyprus 1964-2011 Presence : Down to One: Canada’s • If you were a media relations officer for the Canadian advanced. -

Special Edition the Korean War Veteran Royal 22E Regiment Royal
Special Edition The Korean War Veteran Internet Journal for the World’s Veterans of the Korean War July 15, 2014 The Korean War Veteran sincerely appreciates the opportunity to republish from the Toronto Sun, this fine tribute to all members, past, present and departed of our Royal 22e Regiment, now marking its centennial year since its formation as a French-speaking infantry regiment in World War One, and the 63rd anniversary of its Special Force 2nd Battalion going into action in the Korean War, followed into action in successive years of the war by the R22eR 1st Battalion and the R22eR 3rd Battalion Royal 22e Regiment Royal Guard of Honour makers history at Buckingham Palace BY SIMON KENT, SPECIAL TO THE TORONTO SUN FIRST POSTED: MONDAY, JULY 14 Royal Guard of Honour of Canada’s proud, 100-year old Royal 22e Regiment assembles at Waterloo Barracks, preparatory to marching to Buckingham Palace and St. James Palace – All photographs taken by Lynda Hayden LONDON, England – O Canada, you do put on a fine military show. A piece of Canadian history was reprised Monday when soldiers from the Royal 22nd Regiment stood guard outside two Royal residences in the heart of London. The men from the Quebec-based unit marched to their posts at Buckingham Palace and St James’s Palace respectively to begin six days guarding the British Royal Family, to the cheers of thousands of tourists thronging the capital. The R22eR Royal Guard of Honour marches to Buckingham Palace as thousands of Londoners and tourists cheer the proud Canadians as they move to their posts. -

UNITED NATIONS MEDALS Page
17 May 2019 CHAPTER 5 UNITED NATIONS MEDALS Page 03 United Nations Service Medal – Korea 05 General Information UN Medals 07 UN Emergency Force (Egypt) UNEF 08 UN Truce Supervision Organization in Palestine UNTSO 09 UN Observer Group in Lebanon UNOGIL 10 UN Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan UNGOMAP 11 Office of the Secretary-General in Afgh. & Pakistan OSGAP 12 UN Military Observation Group in India and Pakistan UNMOGIP 13 Organisations des Nations Unies au Congo ONUC 14 UN Temporary Executive Authority in West New Guinea UNTEA 15 UN Yemen Observation Mission UNYOM 16 UN Force in Cyprus UNFICYP 18 UN India Pakistan Observation Mission UNIPOM 19 UN Emergency Force Middle East UNEFME 20 UN Disengagement Observer Force (Golan Heights) UNDOF 21 UN Interim Force in Lebanon UNIFIL 22 UN Iran / Iraq Military Observer Group UNIIMOG 23 UN Transition Assistance Group in Namibia UNTAG 24 UN Observer Group in Central America ONUCA 25 UN Iraq / Kuwait Observer Mission UNIKOM 26 UN Angola Verification Mission II UNAVEM 27 UN Mission for the Referendum in Western Sahara MINURSO 28 UN Observer Group in El Salvador ONUSAL 29 UN Protection Force (former Yugoslavia) UNPROFOR 32 UN Confidence Restoration Operation in Croatia UNCRO 33 UN Advanced Mission in Cambodia UNAMIC 34 UN Transitional Authority in Cambodia UNTAC 35 UN Operations in Somalia UNOSOM 36 UN Operations in Mozambique ONUMOZ 37 UN Observer Mission Uganda / Rwanda UNOMUR 38 UN Assistance Mission in Rwanda UNAMIR 39 UN Observer Group for the Verification of the Elections in Haiti -

CANADIAN AIRBORNE REGIMENT 40Th
AIRBORNE REGIMENT ASSOCIATION of CANADA celebrates the CANADIAN AIRBORNE REGIMENT th 40 ANNIVERSARY Come and celebrate the 40th Anniversary of the CANADIAN AIRBORNE REGIMENT with the Airborne Regiment Association of Canada (ARAC) and the 34 th Anniversary of the Cyprus Crisis. Open to all past members of the Regiment, those who were in non-jump support roles (1 AB FSSU, 1 AB SSU), past and current jumpers of all “strips” i.e.: CABC, CFPMD, regular and reserve force jump companies, foreign paratroopers, 1 Can Para, 1 FSSF, Aircrew, White or Red Maple Leaf jumpers, everyone is welcome to celebrate this special event. 12 APRIL 2008 at the Rideau Canal WO’s and SGT’s Mess 4 Queen Elizabeth Dr, Ottawa, ON, K2P 2H9 (613) 992-4346 MEET and Greet 1700-1900 Dinner 1900 followed by PRESENTATIONS and DANCE Guest Speaker: MGen Alain Forand, CMM, OStJ, SC, MSC CD DINNER RESERVATIONS: must be paid prior to 5 April 2008 DRESS: Association dress w/miniature medal(s), appropriate civilian or “period dress” (para smock, combats pants, boots). Cost: $40.00 / per person tax and gratuity included payable by cheque or credit card to: ARAC KIT SHOP 3 - 36 de Varennes, Gatineau QC J8T 0B6 Contact Marlene to confirm attendance. Tickets will not be issued but attendance will be confirmed at the door. IMPORTANT: If you have confirmed your attendance prior to 5 April and do not attend you will be expected to pay your meals. ARAC: (819) 568-6669 FAX: (819) 569-1074 EMAIL: [email protected] Web Site: www.airborneassociation.com Accommodation: The following hotels are within walking distance: Cartier Place Hotel Embassy Hotel and Suites 180 Cooper Street 25 Cartier Street Reservations – 1-800-236-8399 Reservations – 1-800-661-5495 Holiday Inn Hotel and Suites Westin Ottawa 111 Cooper Street 11 Colonel By Drive Reservations – 1-800-267-8378 Reservations – 1-613-560-7000 . -

Déterminés Que Jamais À Avoir Du Plaisir!
Vol. 20 - No 22 11 juin 2014 Au choix Le journal mois bimensuel 1432-14s22 de la communauté militaire région de Montréal 1829-14s22 www.journalservir.com Car and Truck Rentals No de convention 40012192 Journée de la santé 2014 Plus déterminés que jamais à avoir du plaisir! Malgré la pluie et le temps gris, quelque 1500 personnes ont profité de la Journée de la santé pour se détendre ou, comme le sergent Bruno Turcotte, pour repousser leurs limites. À lire en pages 6 et 7 Photo: cpl Louis Brunet, Imagerie Saint-Jean Photo:cpl Alana Morin Photo: cpl Louis Brunet, Imagerie Saint-Jean Photo: cpl Louis Brunet, Imagerie Saint-Jean Q Le Fonds du Q Nos athlètes Q Le colonel Chafai souvenir honore courent à commande nos leur mémoire 4 Ottawa 19 réservistes 3 15 1800_14s22 TRAX LS LOUEZ À /2 SEM À 0.9% $ $* PENDANT 48 MOIS 750 99 OUVERT LE SAMEDI de rabais supplémentaire aux militaires PRIX À L’ACHAT DE 19 436$ Modèle LTZ illustré. Comprend le transport. * Versement initial de 2 050$ 2 11 juin 2014 / SERVIR - Page - Page 11 juin 2014 / SERVIR Programmes et services pour les Programs and services for Veterans vétérans et leurs familles and their families Des services de transition de carrière à la réadaptation ou aux From career transition services to rehabilitation support services psychologiques, divers programmes et services sont and mental health services, there are programs and en place pour aider les vétérans canadiens et leurs familles en services to help Canada’s Veterans and their families transition à la vie civile. -
Le Bgén Lanthier À La Tête Des Troupes Du Québec Le Col
La Cour du Roi & Domaine des Kiley’s Secteur de Shannon Nous avons le terrain qui correspond aux besoins Plus de 25 ans d’expérience de votre famille. en orthodontie Le journal de la communauté militaire ‐ Région de Québec Yvan Carrier 418.875.1991 Adsum, Garnison Valcartier, CP 1000, succ. Forces, Courcelette (QC) G0A 4Z0. No convention : 40012192 1 877.717.1991 418 803-9596 www.developpementsc.com www.orthogl.com LE MERCREDI 14 AOÛT 2013 www.journaladsum.com Bienvenue auto-constructeurs! ARTICLE EN P. 3 ARTICLE EN P. 4 – PHOTO : CPL NICOLAS TREMBLAY, IMAGERIE VALCARTIER – PHOTO : CPL LOUIS BRUNET, IMAGERIE SAINT-JEAN/MONTRÉAL LE BGÉN LANTHIER À LA TÊTE LE COL GOSSELIN DIRIGE LE DES TROUPES DU QUÉBEC GROUPE DE SOUTIEN DE LA 2 DIV CA Le 13 juillet, le lieutenant-général Peter Devlin a remis le commandement de la 2e Division du Canada au Le 12 juillet, le brigadier-général Richard Giguère a remis le commandement du Groupe de soutien de la brigadier-général Jean-Marc Lanthier. 2e Division du Canada au colonel Hercule Gosselin. DUR À L’OUVRAGE IL Y A 70 ANS, LES CANADIENS DÉBARQUAIENT EN SICILE Le 6 août, l’adjudant Mathieu Nault Un contingent des Forces armées et d’autres membres de l’Unité canadiennes se dresse sur un d’intervention immé diate, du terrain élevé pour le dévoilement 1er Bataillon, Royal 22e Régiment, d'une plaque commémorative à ont aidé des membres du Yukon Assoro, en Sicile, le 27 juillet. Wildland Fire Management Afin de souligner le 70e anniver- Department à dégager des saire de la campagne de Sicile, broussailles qui pourraient servir 60 militaires ont parcouru de combustibles durant une certaines des routes empruntées incendie de forêt, dans le cadre par les militaires canadiens qui de l’Opération NANOOK à sont débarqués sur les plages Whitehorse (Yukon). -

Le 4E Bataillon, Royal 22E Régiment Défile Dans Les Rues De Laval Le 4E
Vol. 21 - No 7 8 octobre 2014 Au choix Le journal mois bimensuel 1432-14s22 de la communauté militaire région de Montréal 1829-14s22 www.journalservir.com Car and Truck Rentals No de convention 40012192 Le 4e Bataillon, Royal 22e Régiment défile dans les rues de Laval 3 Photo: cpl Nédia Coutinho, Imagerie Saint-Jean Photo: élof Oscar Morgado Photo: cpl Jacinthe Morsani, 2 GPRC Un premier exercice de campagne pour The Royal Montreal Un séjour au Népal les élèves-officiers du Collège militaire 7 Regiment Helps pour sept Rangers Hampstead Turn 100 5 juniors canadiens 15 2014 CRUZE LS 35$* 9 JOURS SEULEMENT | DU LUNDI 6 AU MARDI 14 OCTOBRE /SEMAINE 1ER MOIS 0% 0$ DÉPÔT LOCATIONLOCATION48MMOISOIS GRATUIT INTÉRÊT DE SECURITÉ 750$ Changements d’huile gratuits de rabais supplémentaire pour 2 ans, 40 000 km aux militaires * 80 000km. 16¢ kilomètre excédentaire. Taxes en sus. Détails chez votre concessionnaire. Photo à titre indicatif. Offre disponible aux propriétaires des véhicules de marques Chevrolet, Cobalt et HHR, Pontiac, Oldsmobile, Saturn, Saab (des années 1999 ou 1800_14s7 plus récent) ainsi qu’aux membres de la même famille résidant à la même adresse. 2 Ça fait 50 ans que c’est moins cher que vous pensez. est de 32 975 $ / 27 540 LES CONCESSIONNAIRES TOYOTA CÉLÈBRENT essionnaires), frais de transport OUVERT s Canada et sont disponibles sur le conditions applicables, les offres e euvent changer sans préavis. * Offres LEUR 50 ANNIVERSAIRE AU CANADA. l’assistance à la location de 0 $ / 500 le samedi de de 150,24 $ / 115,35 155,26 avant taxes 10h à 16h 8 octobre 2014 / SERVIR - Page - Page 8 octobre 2014 / SERVIR Modèle avec Groupe Touring illustré Modèle avec Groupe Premium illustré Modèle avec Groupe Touring + Technologie illustré SF de 27 990 $ / 22 325 29 365 avant taxes, frais concessionnaire 165 taxes (applicables chez certains conc AA) est de 4,0 L / 3,6 4,3 par 100 km. -

Canadian Soldiers in Cyprus
Canadian Soldiers in Cyprus: Understanding the human experience of peacekeeping through oral history. Camas Eriksson HIST 394 Dr. James Wood March 28, 2012 “There’s this myth about Canadians being peacekeepers and that we’ve never been to war. You just have to look at Canadian history, Canada has been at war virtually since our foundation…I was at a dinner party, about a year ago, and someone said: “What was it like serving for thirty years and never having to be in a war?” And I said, “You have no idea what you’re talking about.” I’ve been in seven combat zones where people were shooting, over the years. Somalia, Bosnia, Afghanistan, Iraq, Congo, Cyprus….Every one of those places I could have been killed.”1 - Colonel John Joly (Retd.) The involvement of the Canadian military in international conflicts is a topic often left to the periphery of public consciousness. As Canadians, we take pride in our historical role as UN peacekeepers, preventing violence rather than participating in it. However, many Canadians do not truly understand what peacekeeping means for the soldiers involved. The words above, expressed by retired Colonel John Joly, reflect a common sentiment among those who have served in Canadian peacekeeping operations around the world. While researching this paper, I interviewed four men who served in the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) during the Turkish invasion of Cyprus in 1974. Colonel John Joly (Retd), Major- General Cameron Ross (Retd), Captain Terrance Swan (Retd) and Chief Warrant Officer Tom Walton (Retd) each provided an individual perspective on their time serving as part of the Canadian Airborne Regiment in Cyprus. -

Growing Strong Hydro-Québec Nulrpr Report Annual | Growing Strong on April , , Hydro-Québec Boldly and Resolutely Took Its fi Rst Steps
Annual Report growing strong Hydro-Québec | Annual Report growing strong On April , , Hydro-Québec boldly and resolutely took its fi rst steps. Since then, our company has been through several surges in its development — times of change and maturation marked by challenges that forged a sense of commitment in men and women determined to build on the heritage left to them by their predecessors. Today, years later, we’re still as energetic and driven. Hydro-Québec is a major producer, transmission provider and distributor of electricity. It conducts research and promotional activities in the areas of energy and energy transformation and conservation, as well as all other energy-related fi elds. The Québec government is its sole shareholder. The company has separated its core operations into six divisions. It now competes freely with other power producers, while its transmission and distribution activities remain regulated. Financial Highlights Corporate Administration Highlights Corporate Management Message from the Board of Directors Chairman of the Board Corporate Governance and the President and Report of Activities of Chief Executive Offi cer the Board of Directors Review of Operations and Board Committees Hydro-Québec Production Code of Ethics and Rules of Professional Conduct for Hydro-Québec Pétrole et gaz Directors, Executives and Hydro-Québec TransÉnergie Controllers of Hydro-Québec Hydro-Québec Distribution Generating and Hydro-Québec Équipement Transmission Facilities Hydro-Québec Technologie Major Facilities (map) et développement industriel Sustainable Development On the cover: Eastmain-. The site of the future generating station, Financial Review seen from the tailrace. The tailrace Management’s Discussion will channel the turbine discharge and Analysis back into the Eastmain River.