Germanica, 41 | 2007
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

10-12-2019 Turandot Mat.Indd
Synopsis Act I Legendary Peking. Outside the Imperial Palace, a mandarin reads an edict to the crowd: Any prince seeking to marry Princess Turandot must answer three riddles. If he fails, he will die. The most recent suitor, the Prince of Persia, is to be executed at the moon’s rising. Among the onlookers are the slave girl Liù, her aged master, and the young Calàf, who recognizes the old man as his long-lost father, Timur, vanquished King of Tartary. Only Liù has remained faithful to the king, and when Calàf asks her why, she replies that once, long ago, Calàf smiled at her. The mob cries for blood but greets the rising moon with a sudden fearful reverence. As the Prince of Persia goes to his death, the crowd calls upon the princess to spare him. Turandot appears in her palace and wordlessly orders the execution to proceed. Transfixed by the beauty of the unattainable princess, Calàf decides to win her, to the horror of Liù and Timur. Three ministers of state, Ping, Pang, and Pong, appear and also try to discourage him, but Calàf is unmoved. He reassures Liù, then strikes the gong that announces a new suitor. Act II Within their private apartments, Ping, Pang, and Pong lament Turandot’s bloody reign, hoping that love will conquer her and restore peace. Their thoughts wander to their peaceful country homes, but the noise of the crowd gathering to witness the riddle challenge calls them back to reality. In the royal throne room, the old emperor asks Calàf to reconsider, but the young man will not be dissuaded. -

Download Download
Angelica Forti-Lewis Mito, spettacolo e società: Il teatro di Carlo Gozzi e il femminismo misogino della sua Turandot Alla Commedia dell'Arte Carlo Gozzi si rifece, almeno inizialmente, perché gli offriva uno spettacolo da contrastare al teatro di Goldoni, di Chiari e, più tardi, al nuovo dramma borghese e alla comédie larmoyante. A questo scopo l'Improvvisa poteva offrirgli aiuti preziosi: la teatralità pura degli intrecci, svincolati da ogni rapporto con la vita reale e contemporanea; le Maschere, cioè tipizzazioni astrat- te; il buffonesco delle trovate comiche che, insieme alle maschere, escludeva ogni possibile idealizzazione delle classi inferiori, degradate a oggetto di comico; e, infine, il carattere nazionale della Commedia, che escludeva qualsiasi intrusione forestiera. Ma anche se Gozzi si erge a strenuo difensore della Commedia dell'Arte, è chiaro che le sue fiabe hanno in realtà ben poco a che fare con l'Improvvisa e il loro tono, sempre dominato da personaggi seri, è ben più drammatico, mentre le varie trame non sono ricavate dalla solita tradizione scenica ma da racconti ita- liani ed orientali, nel loro adattamento teatrale parigino della Foire. L'esotismo e la magia, inoltre, erano anch'essi elementi ignoti alla Commedia dell'Arte e la lo- ro fusione con la continua polemica letteraria sono chiara indicazione di come il commediografo fosse ben altro che un mero restauratore di scenari improvvisati. Trionfano nelle fiabe i valori tradizionali, dall'amor coniugale {Re Cervo, Tu- randot, Donna serpente e Mostro Turchino), all'amore fraterno, la fedeltà e la virtù della semplicità (Corvo, Pitocchi fortunati e Zeim re de' Geni). -

UCLA Electronic Theses and Dissertations
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title Polemics and the Emergence of the Venetian Novel: Pietro Aretino, Piero Chiari, and Carlo Gozzi Permalink https://escholarship.org/uc/item/1sm8g0zm Author Stanphill, Cindy D Publication Date 2018 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Polemics and the Emergence of the Venetian Novel: Pietro Aretino, Piero Chiari, and Carlo Gozzi A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Italian by Cindy Diane Stanphill 2018 ã Copyright by Cindy Diane Stanphill 2018 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Polemics and the Emergence of the Venetian Novel: Pietro Aretino, Piero Chiari, and Carlo Gozzi by Cindy Diane Stanphill Doctor of Philosophy in Italian University of California, Los Angeles, 2018 Professor Massimo Ciavolella, Chair Pietro Chiari (1712-1785) and Carlo Gozzi (1720-1806) are well-known eighteenth-century Italian playwrights. Their polemical relationship has been the object of many studies, but there is a dearth of work dedicated to their narratives and novels, with none in English language scholarship, though a small and growing number of Italian studies of the novelistic genre in eighteenth-century Italy has emerged in recent years. In my dissertation entitled, Polemics and the Rise of the Venetian Novel: Pietro Aretino, Piero Chiari, and Carlo Gozzi, I examine the evolution of the Italian novel in a Venetian context in which authors, some through translation, some through new work, vie ii among themselves for the center in the contest to provide literary models that will shape and educate the Venetian subject. -

Ferruccio Busoni Biography
Ferruccio Busoni His Life And Times Beginnings Youth in Italy The Prodigy is Heard Busoni as Composer Free at Last First Experiences Marriage Busoni as Editor Hitting his Stride Busoni as Conductor Masterpiece Unveiled America again Turandot /Die Brautwahl The Author Debuts Back on the Road Paris, D’Annunzio Opera’s Seduction Liceo Rossini War in Europe The Artist at 50 The Last Years Final Enthusiasms Last Days FERRUCCIO BUSONI - HIS LIFE AND TIMES The Busoni heritage begins in Spicchio, a little village on the north bank of the Arno, inhabited mainly by barge-men, one of whom bore the name. The family is thought originally to have come from Corsica. Though reasonably well-off in their day, the Busonis fell on hard times, and upon the father’s death, moved to Empoli. Additional misfortune followed when the second son of three, Giovanni Battista also died later of a long illness in 1860, his wife following shortly thereafter. From this group of three sons, it would be the eldest, Ferdinando who would produce the artist the world learned to know and cherish. In Empoli his siblings became prosperous makers of felt hats, but Ferdinando would have none of that. He hid himself in corners to read the classics and practice the clarinet. Nothing would alter his intention to be a musician of prominence; he was capricious, self-willed, hot-tempered and impatient. These qualities would, lifelong, result in a reputation as difficult, highly-strung, opinionated, quarrelsome and to some a jeffatore...the possessor of the “evil eye.” He was largely self-taught, attained a high degree of proficiency on his instrument, adopted a career as a travelling virtuoso. -

Carlo Gozzi and the Rhetoric of Conservatism
Maria Galli Stampino Family, City or State, and Theater: Carlo Gozzi and the Rhetoric of Conservatism It might seem odd to utilize rhetorical tools to analyze an Early Modern play written in Venice. Plays are not often framed that way. Furthermore, throughout its ‘republican’ history (697–1797), Venice did not have a ruling family, a long- standing court, appointed poets or rhetors; indeed, the serenissima was not a principality or a monarchy, but rather an oligarchy, in which the Doge was elected by his peers, and where his power was limited in many different ways.1 This political and cultural situation seemingly negates another condition for rhetorical readings in a particularly Early Modern context: the existence of a court; for courts are believed to have been keen on imbuing with meaning as many events and situations as possible, and with a view to representation. In other words: in an Early Modern setting, but without a court, the postulation of a respective rhetorical intent might seem problematic. Finally, Carlo Gozzi’s Le gare teatrali (written in 1751, but not printed until 2011) was never performed, and so did not have an actual theatrical audience that might have been convinced. These are superficial considerations, of course. Neither the genre of a text, nor the existence of a proto-absolutist court, nor the presence of an audience are sine qua non conditions for rhetorical acts. In fact, as Brian Vickers pointed out several decades ago, Early Modern culture was saturated with rhetoric; any text, including the ones without actual spectators, was pervaded by “a concept of elocutio lost even on modern historians of rhetoric, by which it [sc. -
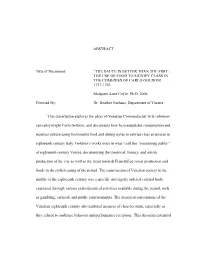
The Use of Food to Signify Class in the Comedies of Carlo Goldoni 1737-1762
ABSTRACT Title of Document: “THE SAUCE IS BETTER THAN THE FISH”: THE USE OF FOOD TO SIGNIFY CLASS IN THE COMEDIES OF CARLO GOLDONI 1737-1762. Margaret Anne Coyle, Ph.D, 2006 Directed By: Dr. Heather Nathans, Department of Theatre This dissertation explores the plays of Venetian Commedia del’Arte reformer- cum-playwright Carlo Goldoni, and documents how he manipulates consumption and material culture using fashionable food and dining styles to satirize class structures in eighteenth century Italy. Goldoni’s works exist in what I call the “consuming public” of eighteenth century Venice, documenting the theatrical, literary, and artistic production of the city as well as the trend towards Frenchified social production and foods in the stylish eating of the period. The construction of Venetian society in the middle of the eighteenth century was a specific and legally ordered cultural body, expressed through various extra-theatrical activities available during the period, such as gambling, carnival, and public entertainments. The theatrical conventions of the Venetian eighteenth century also explored nuances of class decorum, especially as they related to audience behavior and performance reception. This decorum extended to the eating styles for the wealthy developed in France during the late seventeenth century and spread to the remainder of Europe in the eighteenth century. Goldoni ‘s early plays from 1737 through 1752 are riffs on the traditional Commedia dell’Arte performances prevalent in the period. He used food in these early pieces to illustrate the traditional class and regional affiliations of the Commedia characters. Plays such as The Artful Widow, The Coffee House, and The Gentleman of Good Taste experimented with the use of historical foods styles that illustrate social placement and hint at further character development. -

Titre: Elisabetta Caminer Turra E L'europa Letteraria : Riflessioni Sulla
Titre: Elisabetta Caminer Turra e L’EUROPA LETTERARIA: riflessioni sulla traduzione Auteur(s): Rotraud von Kulessa, Universität Augsburg Revue: CIRCULA, numéro 2, pages 18-30 ISSN: 2292-8235 Directeurs: Wim Remysen et Sabine Schwarze URI: http://hdl.handle.net/11143/7989 DOI: 11143/7989 Circula : revue d’idéologies linguistiques, no 2 Elisabetta Caminer Turra e L’Europa letteraria: riflessioni sulla traduzione Rotraud von Kulessa, Universität Augsburg rotraud . kulessa @ phil . uni - augsburg . de Riassunto: L’articolo analizza il ruolo del giornale settecentesco veneziano Europa letteraria nel dibattito sulla lingua italiana. Elisabetta Caminer, figlia del direttore del giornale, si impegna come giornalista e traduttrice in questa querelle che verte anche sulla questione della riforma della com- media italiana. Verrà dimostrato come i due giornalisti, padre e figlia, difendono un concetto dinami- co della lingua italiana. Parole chiave: Europa letteraria; Elisabetta Caminer Turra; giornalismo veneziano; secolo XVIII; tra- duzione Abstract: The article analyses the role of the 18th century venetian Europa letteraria in the debate on the Italian language. Elisabetta Caminer Turra, daughter of the journal’s director, acts as a journalist and as a translator in this quarrel which focuses also on the question of the reform of Italian comedy. The article illustrates how father and daughter try to defend a dynamic concept of the Italian lan- guage. Keywords: Europa letteraria; Elisabetta Caminer Turra; Venetian journalism; 18th century; transla- tion Circula : revue d’idéologies linguistiques, no 2 18 1. Introduzione Già prima del famoso articolo della Germaine de Staël «Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni», pubblicato nel 1816 nel primo numero della rivista milanese Biblioteca Italiana, Elisabetta Caminer Turra (1751-1796) si fa paladina delle traduzioni, soprattutto di opere francesi, per rinnovare la lette- ratura italiana e più particolarmente il suo teatro. -

Summary and Synopsis
THE ONCE AND FUTURE TURANDOT A Comic Opera in Three Acts An Original Variation on the Turandot Story by Patricia Herzog Copyright © 2016 Patricia Herzog Summary and Synopsis The Turandot most of us know is the eponymous heroine of Giacomo Puccini’s opera, completed by Franco Alfano in 1926, two years after the composer’s death: a spellbindingly beautiful woman utterly devoid of feeling, an ice princess, barbarously cruel, man-hating and man-slaying—until she herself is slain by love. The versions of the Turandot story that most influenced Puccini and his librettists, Giuseppe Adami and Renato Simoni, are plays by Carlo Gozzi (1762) and Friedrich Schiller (1801). In these works, Turandot is still desperate not to marry, but her reasoning is different, as is her reason for accepting Prince Calaf. Puccini’s Turandot vows never to be possessed by a man because the spirit of a female ancestor, dragged off and killed by a conquering invader, dwells inside her. There in no mention of such an ancestor in either the Gozzi or the Schiller. In the Gozzi, Turandot offers this explanation to Calaf: “ … I am not heartless. But I abhor your sex, and I defend myself in the only way I know, so that I may remain free from men. Why should I not be as free as you are?”i The enlightened Schiller goes him one better: “I am not cruel, as they say, but shun the yoke of Man’s despotic sway. In virgin freedom would I live and die …. Shall I, the daughter of an emperor, not have that birthright which belongs to all? Be slave to brutish force, that makes your sex our lord? … If nature dowered me with beauteous treasure you tyrants think t’was all to serve your pleasure. -

A Tale of Two Carlos: an Examination of the Ongoing Battle Between The
Utah State University DigitalCommons@USU All Graduate Theses and Dissertations Graduate Studies 5-2011 A Tale of Two Carlos: An Examination of the Ongoing Battle Between the Marginalized and the Privileged as Exemplified by Carlo Goldoni and Carlo Gozzi During the 18th Century David Josh Patterson Utah State University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.usu.edu/etd Part of the Theatre and Performance Studies Commons Recommended Citation Patterson, David Josh, "A Tale of Two Carlos: An Examination of the Ongoing Battle Between the Marginalized and the Privileged as Exemplified by Carlo Goldoni and Carlo Gozzi During the 18th Century" (2011). All Graduate Theses and Dissertations. 1006. https://digitalcommons.usu.edu/etd/1006 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate Studies at DigitalCommons@USU. It has been accepted for inclusion in All Graduate Theses and Dissertations by an authorized administrator of DigitalCommons@USU. For more information, please contact [email protected]. A TALE OF TWO CARLOS: AN EXAMINATION OF THE ONGOING BATTLE BETWEEN THE MARGINALIZED AND THE PRIVILEGED AS EXEMPLIFIED BY CARLO GOLDONI AND CARLO GOZZI DURING THE 18th CENTURY by David Josh Patterson A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in Theatre Arts Approved: ____________________________ ____________________________ Colin Johnson Shane Graham Major Professor Committee Member ____________________________ ____________________________ Adrianne Moore Matt Omasta Committee Member Committee Member ____________________________ Mark R. McLellan Dean of Graduate Studies UTAH STATE UNIVERSITY Logan, Utah 2011 Copyright © David Josh Patterson 2011 All Rights Reserved ABSTRACT A Tale of Two Carlos: An Examination of the Ongoing Battle Between the Marginalized and the Privileged as Exemplified by Carlo Goldoni and Carlo Gozzi During the 18th Century by David Josh Patterson, Master of Arts Utah State University, 2011 Major Professor: Dr. -

Love, Power, and Companionate Marriage in Puccini's Turandot Valerie V
Grand Valley State University ScholarWorks@GVSU Peer Reviewed Articles School of Communications 10-2014 Mythic Rhetoric: Love, Power, and Companionate Marriage in Puccini's Turandot Valerie V. Peterson Grand Valley State University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.gvsu.edu/com_articles Part of the Gender, Race, Sexuality, and Ethnicity in Communication Commons ScholarWorks Citation Peterson, Valerie V., "Mythic Rhetoric: Love, Power, and Companionate Marriage in Puccini's Turandot" (2014). Peer Reviewed Articles. 13. https://scholarworks.gvsu.edu/com_articles/13 This Article is brought to you for free and open access by the School of Communications at ScholarWorks@GVSU. It has been accepted for inclusion in Peer Reviewed Articles by an authorized administrator of ScholarWorks@GVSU. For more information, please contact [email protected]. Ohio Communication Journal Volume 52 – October 2014, pp. 20-35 Mythic Rhetoric: Love, Power, and Companionate Marriage in Puccini's Turandot Valerie V. Peterson Using a rhetorical perspective, specifically Kenneth Burke's understanding of myths as "forward looking partisanships," this essay explores the mythic story of Turandot and its relationship to love, power, and companionate marriage.1 First, Burke’s understanding of myth is outlined and connected to the history and travels of Turandot. Then, a detailed rhetorical analysis of the 1998 PBS video of Puccini's opera performed at the Forbidden City, Beijing, suggests why the Turandot myth seems to appear in certain places and moments, and what it might have offered to audiences, in this instance, on a spiritual level. In the 1995 young teen "Junior Books" rendition of an ancient story, Marianna Mayer provides rare insights into the psyche of Turandot, enigmatic ice princess. -

The Afterlife of Shakespeare's Plays
THE AFTERLIFE OF SHAKESPEARE’S PLAYS: A STUDY OF CROSS-CULTURAL ADAPTATIONS INTO OPERA AND FILM by Suddhaseel Sen A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of English and the Collaborative Program in South Asian Studies University of Toronto © Copyright by Suddhaseel Sen (2010) Library and Archives Bibliothèque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l'édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-97766-8 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-97766-8 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l'Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distrbute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette thèse. Ni thesis. Neither the thesis nor la thèse ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent être imprimés ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

Prokofjew Und Die Dramaturgie in L'amour Des Trois Oranges
„Vite, rideau! Et qu‘on commence!“ Prokofjew und die Dramaturgie in L‘amour des trois oranges Masterarbeit zur Erlangung des Grades Master of Arts im interuniversitären Masterstudium Musikologie an der Karl-Franzens-Universität Graz Vorgelegt von Julia CHRISTIANSEN Institut für Musikwissenschaft Begutachterin: Priv.-Doz. Mag. Dr.phil. Kordula Knaus Graz, 2012 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ..............................................................................................2 2. Sergej Prokofjew - ein neoklassizistischer Avantgardist .......................4 2.1 Ein „enfant terrible“ in russischer Tradition? ...................................4 2.2 Eine Forschung so ambivalent wie ihr Gegenstand .......................10 3. Vom Märchen zum offensichtlichen Theater: Der dramaturgische Werdegang von „L‘amour des trois oranges“ ............................................17 3.1 Gozzis Commedia dell’arte ............................................................18 3.1.1 Die Commedia dell’arte ......................................................18 3.1.2 Gozzis „L’amore delle tre melarance“ .................................21 3.2 Meyerholds Stück der Theaterrevolution .......................................34 3.2.1 Meyerhold und die Revolution des Theaters ......................35 3.2.2 Doktor Dapertuttos „Ljubov k trjom apelsinam“ ..................39 3.3 Der Komponist als Librettist ...........................................................50 4. Eine „einfache Tonsprache“ für Amerika ...............................................65