Développement Durable Et Territoires, Vol. 10
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Environment Is All Rights: Human Rights, Constitutional Rights and Environmental Rights
Advance Copy THE ENVIRONMENT IS ALL RIGHTS: HUMAN RIGHTS, CONSTITUTIONAL RIGHTS AND ENVIRONMENTAL RIGHTS RACHEL PEPPER* AND HARRY HOBBS† Te relationship between human rights and environmental rights is increasingly recognised in international and comparative law. Tis article explores that connection by examining the international environmental rights regime and the approaches taken at a domestic level in various countries to constitutionalising environmental protection. It compares these ap- proaches to that in Australia. It fnds that Australian law compares poorly to elsewhere. No express constitutional provision imposing obligations on government to protect the envi- ronment or empowering litigants to compel state action exists, and the potential for draw- ing further constitutional implications appears distant. As the climate emergency escalates, renewed focus on the link between environmental harm and human harm is required, and law and policymakers in Australia are encouraged to build on existing law in developing broader environmental rights protection. CONTENTS I Introduction .................................................................................................................. 2 II Human Rights-Based Environmental Protections ................................................... 8 A International Environmental Rights ............................................................. 8 B Constitutional Environmental Rights ......................................................... 15 1 Express Constitutional Recognition .............................................. -

Environmental Governance (Technical Paper 2, 2017)
ENVIRONMENTAL GOVERNANCE TECHNICAL PAPER 2 The principal contributions to this paper were provided by the following Panel Members: Adjunct Professor Rob Fowler (principal author), with supporting contributions from Murray Wilcox AO QC, Professor Paul Martin, Dr. Cameron Holley and Professor Lee Godden. .About APEEL The Australian Panel of Experts on Environmental Law (APEEL) is comprised of experts with extensive knowledge of, and experience in, environmental law. Its membership includes environmental law practitioners, academics with international standing and a retired judge of the Federal Court. APEEL has developed a blueprint for the next generation of Australian environmental laws with the aim of ensuring a healthy, functioning and resilient environment for generations to come. APEEL’s proposals are for environmental laws that are as transparent, efficient, effective and participatory as possible. A series of technical discussion papers focus on the following themes: 1. The foundations of environmental law 2. Environmental governance 3. Terrestrial biodiversity conservation and natural resources management 4. Marine and coastal issues 5. Climate law 6. Energy regulation 7. The private sector, business law and environmental performance 8. Democracy and the environment The Panel Adjunct Professor Rob Fowler, University of South The Panel acknowledges the expert assistance and Australia – Convenor advice, in its work and deliberations, of: Emeritus Professor David Farrier, University of Wollongong Dr Gerry Bates, University of Sydney -

Year 10 High Court Decisions - Activity
Year 10 High Court Decisions - Activity Commonly known The Franklin Dam Case 1983 name of the case Official legal title Commonwealth v Tasmania ("Tasmanian Dam case") [1983] HCA 21; (1983) 158 CLR 1 (1 July 1983) Who are the parties involved? Key facts - Why did this come to the High Court? Who won the case? What type of verdict was it? What key points did the High Court make in this case? Has there been a change in the law as a result of this decision? What is the name of this law? Recommended 1. Envlaw.com.au. (2019). Environmental Law Australia | Tasmanian Dam Case. [online] Available at: http://envlaw.com.au/tasmanian-dam-case Resources [Accessed 19 Feb. 2019]. 2. High Court of Australia. (2019). Commonwealth v Tasmania ("Tasmanian Dam case") [1983] HCA 21; (1983) 158 CLR 1 (1 July 1983). [online] Available at: http://www7.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/HCA/1983/21.html [Accessed 19 Feb. 2019] 3. Aph.gov.au. (2019). Chapter 5 – Parliament of Australia. [online] Available at: https://www.aph.gov.au/parliamentary_business/committees/senate/legal_and_constitutional_affairs/completed_inquiries/pre1996/treaty/report /c05 [Accessed 20 Feb. 2019. GO TO 5. 31 to find details on this case] 1 The Constitutional Centre of Western Australia Updated September 2019 Year 10 High Court Decisions - Activity Commonly known MaboThe Alqudsi Case Case name of the case Official legal title AlqudsiMabo v vQueensland The Queen [2016](No 2) HCA[1992] 24 HCA 23; (1992) 175 CLR 1 (3 June 1992). Who are the parties Whoinvolved? are the parties involved? Key facts - Why did Keythis comefacts -to Why the did thisHigh come Court? to the High Court? Who won the case? Who won the case? What type of verdict Whatwas it? type of verdict wasWhat it? key points did Whatthe High key Court points make did thein this High case? Court make Hasin this there case? been a Haschange there in beenthe law a as changea result inof thethis law as adecision? result of this Whatdecision? is the name of Whatthis law? is the name of Recommendedthis law? 1. -
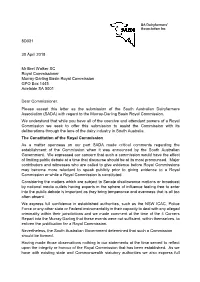
MDBRC Submission
SA Dairyfarmers’ Association Inc 8D031 30 April 2018 Mr Bret Walker SC Royal Commissioner Murray-Darling Basin Royal Commission GPO Box 1445 Adelaide SA 5001 Dear Commissioner, Please accept this letter as the submission of the South Australian Dairyfarmers Association (SADA) with regard to the Murray-Darling Basin Royal Commission. We understand that while you have all of the coercive and attendant powers of a Royal Commission we seek to offer this submission to assist the Commission with its deliberations through the lens of the dairy industry in South Australia. The Constitution of the Royal Commission As a matter openness on our part SADA made critical comments regarding the establishment of the Commission when it was announced by the South Australian Government. We expressed our concern that such a commission would have the effect of limiting public debate at a time that discourse should be at its most pronounced. Major contributors and witnesses who are called to give evidence before Royal Commissions may become more reluctant to speak publicly prior to giving evidence to a Royal Commission or while a Royal Commission is constituted. Considering the matters which are subject to Senate disallowance motions or broadcast by national media outlets having experts in the sphere of influence feeling free to enter into the public debate is important as they bring temperance and evenness that is all too often absent. We express full confidence in established authorities, such as the NSW ICAC, Police Force or any other state or Federal instrumentality in their capacity to deal with any alleged criminality within their jurisdictions and we made comment at the time of the 4 Corners Report into the Murray Darling that these events were not sufficient, within themselves, to enliven the justification for a Royal Commission. -

Human Rights Law and Racial Hate Speech Regulation in Australia: Reform and Replace?
HUMAN RIGHTS LAW AND RACIAL HATE SPEECH REGULATION IN AUSTRALIA: REFORM AND REPLACE? Dr. Alan Berman* TABLE OF CONTENTS I. INTRODUCTION ................................................................................. 46 II. INTERNATIONAL LEGAL OBLIGATIONS ............................................ 50 A. The Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights................ 50 B. The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ................................................ 56 C. Legislative Attempts to Implement International Treaty Obligations ................................................................................. 63 D. The Current “Racial Hatred” Legislative Landscape ............... 68 E. The Constitutional Position ....................................................... 70 F. Implementation of International Treaty Obligations by Other Western Democracies ...................................................... 75 III. FREE SPEECH JUSTIFICATIONS AND RACIST HATE SPEECH ............. 79 IV. EXISTING LAWS DO NOT FURTHER THE POLICIES OF RACIAL HATE SPEECH REGULATION ............................................................. 82 A. Commonwealth Laws ................................................................. 83 B. State and Territory Laws............................................................ 96 V. CONCLUSION .................................................................................. 101 * Associate Professor of Law, Charles -
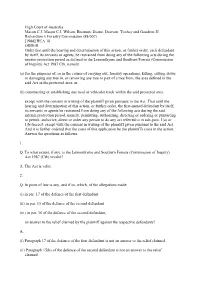
Richardson V Forestry Commission.Pdf
High Court of Australia Mason C.J. Mason C.J. Wilson, Brennan, Deane, Dawson, Toohey and Gaudron JJ. Richardson v Forestry Commission (88/007) [1988] HCA 10 ORDER Order that until the hearing and determination of this action, or further order, each defendant by itself, its servants or agents, be restrained from doing any of the following acts during the interim protection period as defined in the Lemonthyme and Southern Forests (Commission of Inquiry) Act 1987 Cth, namely: (a) for the purposes of, or in the course of carrying out, forestry operations, killing, cutting down or damaging any tree in, or removing any tree or part of a tree from, the area defined in the said Act as the protected area; or (b) constructing or establishing any road or vehicular track within the said protected area, except with the consent in writing of the plaintiff given pursuant to the Act. That until the hearing and determination of this action, or further order, the first-named defendant by itself, its servants or agents be restrained from doing any of the following acts during the said interim protection period, namely, permitting, authorizing, directing or ordering or purporting to permit, authorize, direct or order any person to do any act referred to in sub-pars. 1(a) or 1(b) hereof, except with the consent in writing of the plaintiff given pursuant to the said Act. And it is further ordered that the costs of this application be the plaintiff's costs in the action. Answer the questions as follows: 1. Q. To what extent, if any, is the Lemonthyme and Southern Forests (Commission of Inquiry) Act 1987 (Cth) invalid? A. -

Ebook As Diasporas Dos Judeus E Cristaos.Pdf
As Diásporas dos Judeus e Cristãos- -Novos de Origem Ibérica entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Estudos ORGANIZAÇÃO : José Alberto R. Silva Tavim Hugo Martins Ana Pereira Ferreira Ângela Sofia Benoliel Coutinho Miguel Andrade Lisboa Centro de História da Universidade de Lisboa 2020 Título As Diásporas dos Judeus e Cristãos-Novos de Origem Ibérica entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Estudos Organização José Alberto R. Silva Tavim, Hugo Martins, Ana Pereira Ferreira, Ângela Sofia Benoliel Coutinho e Miguel Andrade Revisão André Morgado Comissão científica Ana Isabel Lopez-Salazar Codes (U. Complutense de Madrid), Anat Falbel (U. Federal do Rio de Janeiro), Ângela Domingues (U. Lisboa), Beatriz Kushnir (Directora, Arq. Geral da Cidade do Rio de Janeiro), Blanca de Lima (U. Francisco de Miranda, Coro; Acad. Nac. de la Historia-Capítulo Falcón, Venezuela), Claude B. Stuczynski (Bar-Ilan U.), Cynthia Michelle Seton-Rogers (U. of Texas-Dallas), Daniel Strum (U. São Paulo), Daniela Levy (U. São Paulo), Edite Alberto (Dep. Património Cultural/C. M. Lisboa; CHAM, FCSH-UNL), Elvira Azevedo Mea (U. Porto), Eugénia Rodrigues (U. Lisboa), Hernán Matzkevich (U. Purdue), Joelle Rachel Rouchou (Fund. Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro), Jorun Poettering (Harvard U.), Maria Augusta Lima Cruz (ICS-U. do Minho; CHAM, FCSH, UNL), Maria Manuel Torrão (U. Lisboa), Moisés Orfali (Bar-Ilan U.), Nancy Rozenchan (U. de São Paulo), Palmira Fontes da Costa (U. Nova de Lisboa), Timothy D. Walker (U. Massachusetts Dartmouth) e Zelinda Cohen (Inst. do Património Cultural, Cabo Verde) Capa Belmonte, com Sinagoga Bet Eliahu. Fotografia de José Alberto R. -

The Portuguese Inquisition, a Inquisição Portuguesa, The
THE PORTUGUESE INQUISITION, The Portuguese Inquisition remains THE PORTUGUESE INQUISITION The case of Maria Lopes, burned at the stake in 1576 largely obscure. This book provides A INQUISIÇÃO PORTUGUESA, context and presents the tragic case of O caso de Maria Lopes, queimada na fogueira em 1576 !"#$"%&'()*+%,-)%.#*,%/'0"1%2#'0% the Azores burned at the stake. Ladinabooks NONFICTION Cover image by Kriszta Hernadi Porto, Portugal ISBN 978-0-9919946-0-1 Ladinabooks 90000 > Porto, Portugal www.ladinabooks.com www.ladinabooks.blogspot.ca [email protected] 9 780991 994601 Manuel Azevedo Fernanda Guimarães IV THE PORTUGUESE INQUISITION A INQUISIÇÃO PORTUGUESA Ladinabooks I 3$#*,%(456$*-)7%$1%89:;+%.#*,%(#$1,$1< =66%#$<-,*%#)*)#>)7%)?@)(,%2'#%,-)%A4',",$'1%'2%*-'#,%("**"<)*%2'#%,-)% (4#('*)*%'2%*,47B+%@#$,$@$*0%'#%#)>$)/C D'(B#$<-,%E%89:;%!"14)6%=F)>)7'%"17%3)#1"17"%G4$0"#H)* Ladinabooks I'#,'+%I'#,4<"6 ///C6"7$1"5''J*C@'0%% ///C6"7$1"5''J*C56'<*(',C@" 6"7$1"5''J*K<0"$6C@'0 3#'1,%@'>)#%"#,$*,L%M#$*F,"%N)#1"7$ D'>)#%7)*$<1%"17%,)?,%6"B'4,L%O"1B"%P"1,-'4#1'4, O#"1*6",'#*L%!"14)6%=F)>)7'+%=7)6$1"%I)#)$#"+%Q'H'%R)6<"7' I'#,4<4)*)%,#"1*@#$5)#L%3)#1"17"%G4$0"#H)* S7$,'#L%!"14)6%=F)>)7' Printed and bound in Canada ISBN 9780991994601 (pbk) 9780991994618 (ebook) 3'#,-@'0$1<%2#'0%&"7$1"5''J*L% The Portuguese Inquisition, the case of 12 yearold Violante Francesa, 1606. -

Imagereal Capture
THE HIGH COURT AND THE WORLD OF POLICY BY MICHAEL COPER* Being the last speaker of the day I suppose has advantages and disad vantages. One disadvantage is that, as I had anticipated, much of what I would have wished to say about the Franklin Dam case1 has been said -and well said -by earlier speakers. One advantage, however, is that I may now speak substantially without fear of contradiction - perhaps the "infallibility offinality", as it has sometimes been called,2 is not the exclusive province of the High Court! In any event, I will confine myself to some very general remarks -not so general, I hope, as to be trite, but general enough, at least, to put some of the points we have heard earlier today into perspective. Professor Zines' paper is entitled "The State of Constitutional Inter pretation" .3 My first thought was that this might be a new slogan for Tasmanian number plates - but in the light of the result of the Franklin Dam case I suppose that this would scarcely be appropriate! Professor Zines discusses one of the most fundamental and difficult of all of the problems of constitutional interpretation: what general principles are appropriate, and from whence are they derived. In a way, it is re markable that after eighty years' experience of judicial exegesis and, as Jacobs J was fond of adding, of judicial epexegesis,4 such fundamental issues should be so much in dispute. No doubt the dispute has been narrowed by the decision in the Engineers' case,5 but the permissibility of implications and their nature and content remain at the heart of the controversy. -

Annual Report 1938
THE LONDON COMMITTEE OF DEPUTIES OF THE BRITISH JEWS (FOUNDED IN 1760) GENERALLY KNOWN AS THE BOARD OF DEPUTIES OF BRITISH JEWS ANNUAL REPORT 1938 3 e o . -?-z & WOBURN HOUSE UPPER WOBURN PLACE LONDON, W.C.I 1939 3* 0. V2. £ FORM OF BEQUEST I bequeath to the LONDON COMMITTEE OF DEPUTIES OF THE BRITISH JEWS (generally known as the Board of Deputies of British Jews) the sum of £ free of duty, to be applied to the general purposes of the said Board and the receipt of the Treasurer for the time being of the said Board shall be a sufficient discharge for the same. • * CONTENTS PAGE List of Officers of the Board 4 List of former Presidents ... ... ... ... 5 Alphabetical List of Deputies ... ... ... ... & List of Congregations and Institutions represented on the Board 18 Committees ... ... ... ... ... ... ••• 25 Annual Report—Introduction ... ... ... ... 29 Law, Parliamentary and General Purposes Committee 34 Aliens Committee ... ... ... ... 44 Education Committee ... ... ... ... ... 46 Finance Committee ... ... ... ... ... 47 Foreign Appeals Committee ... ... ... 48 Palestine Committee ... ... ... ... ... 49 Shechita Committee ... ... ... ... ... 52 ־... ... ... Jewish Defence Committee -!53 Joint Foreign Committee ••• ••• 56 Accounts ... ... ... ... ... ... ... 73 Secretaries for Marriages ... ... ... ... 79 «MRY 10 1939 AMERICAN. COMJMttl _ LIBRARY Officers of ffje President: NEVILLE J. LASKI, K.C. Vice-Presidents : SIR ROBERT WALEY COHEN, K.B.E. Br. ISRAEL FELDMAN. Treasurer : M. GORDON LIVERMAN, J.P. Hon. Auditors : M. CASH. JOSEPH MELLER, O.B.E. Solicitor : CHARLES H. L. EMANUEL, M.A. Auditors : Messrs. JEFFREYS, HENRY, MARKS & DIAMOND Secretary : A. G. BROTMAN, B.Sc. All Communications should be addressed to THE SECRETARY at :— Woburn House, Upper Woburn Place, London, W.C.I. -

Museums, Monuments and Sites
Accommodation Alentejo Castro Verde Hotel A Esteva Hotel accommodation / Hotel / *** Address: Rua das Orquídeas,17780-000 Castro Verde Telephone: +351 286320110/8 Fax: +351 286320119 E-mail: [email protected] Website: http://www.aesteva.pt Estremoz Pousada Rainha Santa Isabel Hotel accommodation / Pousada Address: Largo D. Dinis - Apartado 88 7100-509 Estremoz Telephone: +351 268 332 075 Fax: +351 268 332 079 E-mail: [email protected] Website: http://www.pousadas.pt Évora Casa de SãoTiago Vitória Stone Hotel Tourism in a Manor House Hotel accommodation / Hotel / *** Address: Largo Alexandre Herculano, 2 - 7000 - 501 Address: Rua Diana de Liz, 5 7005-413 Évora ÉVORA Telephone: +351 266 707 174 Fax: +351 266 700 974 Telephone: 266702686 Fax: 226000357 E-mail: lui.cabeç[email protected] Website: http://www.albergariavitoria.com Golegã Casa do Adro da Golegã Tourism in the Country / Country Houses Address: Largo da Imaculada Conceição, 582150-125 Golegã Telephone: +351 96 679 83 32 E-mail: [email protected] Website: http://www.casadoadrodagolega.pt 2013 Turismo de Portugal. All rights reserved. 1/232 [email protected] Grândola Santa Barbara dos Mineiros Hotel Rural Tourism in the Country / Rural Hotels Address: Aldeia Mineira do Lousal - Av. Frédéric Vélge 7570-006 Lousal Telephone: +351 269 508 630 Fax: +351 269 508 638 E-mail: [email protected] Website: http://www.hotelruralsantabarbara.com Portalegre Rossio Hotel Hotel accommodation / Hotel / **** Address: Rua 31 de Janeiro nº 6 7300-211 Portalegre -

Compras Fado Tours
Leisure | Ocio | Lazer | Loisir WINERIES | BODEGAS| PRODUTORES DE VINHO |CHAIS 10% RENT A BIKE VIEGUINI BIKES & SCOOTERS RENTAL 20% TOMAZ DO DOURO Pç. Ribeira, 5 T. +351 222 081 935 2G P 10% MARINHO’S R. Alegria, 695 4H CHOCOLATES | CHOCOLATS R. Nova da Alfandega, T. +351 914 306 838 2G 20% 2G P 10% 3G 40% Nov-Mar; 10% Apr-Oct | Abr-Out | Avr-Oct QUINTA DO SEIXO Tabuaço, TURISDOURO R. Canastreiros, 40-42 T. +351 222 006 418 O CAÇULA Praça Carlos Alberto, 473 10% CHOCOLATARIA EQUADOR R. Sá Bandeira, 637 3H | R. Flores 298 2G 10% RENT A SCOOTER VIEGUINI BIKES & SCOOTERS RENTAL 10% 3G MUSEUMS AND MONUMENTS | MUSEOS Y MONUMENTOS | Valença do Douro Reservar visita | book visit | reserver visite - [email protected] O CÃO QUE FUMA R. Almada, 405 5% Bonbons / Sweets, sugar almonds | bombones, almendras de azúcar | bombons, R. Nova da Alfandega,7 T. +351 914 306 838 2G CRUISE | CRUCERO | CRUZEIRO | CROISIÈRE - DOURO MUSEUS E MONUMENTOS | MUSÉES ET MONUMENTS T. +351 254 732 800 Visita à adega | Visita a la bodega | Visit to the winery | Visite au chai 10% O ESCONDIDINHO R. Passos Manuel, 152 3H amêndoas | bombons, amandes couvertes de sucre CONFEITARIA ARCÁDIA 10% THE GETAWAY VAN Lowcost Motorhome rental, includes airport transfer | Alquiler de 20% ROTA DO DOURO Av. Diogo Leite, 438 | V.N. Gaia T. +351 223 759 042 D 1 FREE Gratis | Grátis | Gratuit ARQUEOSSÍTIO R. D. Hugo, 5 2G 10% QUINTA DE SANTA CRISTINA R. Santa Cristina, 80 Veade, Celorico de Basto 10% Cash | dinero | dinheiro | espèces 5% Card | tarjeta | cartão | carte R.