Foret Communale De Dimako
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cameroon : Adamawa, East and North Rgeions
CAMEROON : ADAMAWA, EAST AND NORTH RGEIONS 11° E 12° E 13° E 14° E N 1125° E 16° E Hossere Gaval Mayo Kewe Palpal Dew atan Hossere Mayo Kelvoun Hossere HDossere OuIro M aArday MARE Go mbe Trabahohoy Mayo Bokwa Melendem Vinjegel Kelvoun Pandoual Ourlang Mayo Palia Dam assay Birdif Hossere Hosere Hossere Madama CHARI-BAGUIRMI Mbirdif Zaga Taldam Mubi Hosere Ndoudjem Hossere Mordoy Madama Matalao Hosere Gordom BORNO Matalao Goboum Mou Mayo Mou Baday Korehel Hossere Tongom Ndujem Hossere Seleguere Paha Goboum Hossere Mokoy Diam Ibbi Moukoy Melem lem Doubouvoum Mayo Alouki Mayo Palia Loum as Marma MAYO KANI Mayo Nelma Mayo Zevene Njefi Nelma Dja-Lingo Birdi Harma Mayo Djifi Hosere Galao Hossere Birdi Beli Bili Mandama Galao Bokong Babarkin Deba Madama DabaGalaou Hossere Goudak Hosere Geling Dirtehe Biri Massabey Geling Hosere Hossere Banam Mokorvong Gueleng Goudak Far-North Makirve Dirtcha Hwoli Ts adaksok Gueling Boko Bourwoy Tawan Tawan N 1 Talak Matafal Kouodja Mouga Goudjougoudjou MasabayMassabay Boko Irguilang Bedeve Gimoulounga Bili Douroum Irngileng Mayo Kapta Hakirvia Mougoulounga Hosere Talak Komboum Sobre Bourhoy Mayo Malwey Matafat Hossere Hwoli Hossere Woli Barkao Gande Watchama Guimoulounga Vinde Yola Bourwoy Mokorvong Kapta Hosere Mouga Mouena Mayo Oulo Hossere Bangay Dirbass Dirbas Kousm adouma Malwei Boulou Gandarma Boutouza Mouna Goungourga Mayo Douroum Ouro Saday Djouvoure MAYO DANAY Dum o Bougouma Bangai Houloum Mayo Gottokoun Galbanki Houmbal Moda Goude Tarnbaga Madara Mayo Bozki Bokzi Bangei Holoum Pri TiraHosere Tira -

CAMEROON's FOREST ESTATE and WILDLIFE June 2011
MINISTRY OF FORESTRY CAMEROON'S FOREST ESTATE AND WILDLIFE June 2011 PROTECTED AREAS AND HUNTING ZONES 9°E 10°E 11°E 12°E 13°E 14°E 15°E 16°E Summary of Number and Area of Land Use Allocation within the National Forest Estate in 2011 Faro Benoué (1) (1) Permanent Forest Estate (PFE) Number Non Permanent Forest Estate (nPFE) Number Area Area N 1 Mbam et Djerem National Park 18 Bouba Ndjida National Park ° 2 Kimbi Wildlife Reserve 19 Faro National Park 8 Production Forests 169 7,613,134 Community Forests 314 1,015,536 N 3 Waza Logone National Park 20 Nki National Park ° 8 Forest Management Units 101 6,586,808 Reserved 27 50,036 4 Kalamaloue National Park 21 Monts Bakossi National Park 5 Mozogo Gokoro National Park 22 Kom National Park Allocated 87 5,545,425 Simple Management Plan 103 276,333 4 6 Lobéké National Park 23 Mengame Gorilla Sanctuary (4) CHAD Unallocated 14 1,041,383 Definitive Management Plan 184 689,167 7 Banyang-Mbo Wildlife Sanctuary 24 Kagwene Gorilla Sanctuary 8 Korup National Park 25 Takamanda National Park Forest Reserves 68 1,026,326 Sales of Standing Volume 49 114,042 9 Rumpi Hills Wildlife Sanctuary 26 Mefou National Park (6) Protected Areas 86 7,397,581 1,129,578 10 Campo Ma'an National Park 27 Ebo National Park 3 Total nPFE 11 Lac Ossa Wildlife Reserve 28 Dja Biosphere Reserve 5 National Parks 24 3,459,798 12 Douala Edea Wildlife Reserve 29 Tchabal Mbabo National Park Wildlife Reserves 5 715,456 Total National Forest Estate (NFE+nPFE) 16,140,293 NIGERIA 13 Santchou Wildlife Reserve 30 Ndongoré National Park 14 Boumba -

Proceedingsnord of the GENERAL CONFERENCE of LOCAL COUNCILS
REPUBLIC OF CAMEROON REPUBLIQUE DU CAMEROUN Peace - Work - Fatherland Paix - Travail - Patrie ------------------------- ------------------------- MINISTRY OF DECENTRALIZATION MINISTERE DE LA DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL Extrême PROCEEDINGSNord OF THE GENERAL CONFERENCE OF LOCAL COUNCILS Nord Theme: Deepening Decentralization: A New Face for Local Councils in Cameroon Adamaoua Nord-Ouest Yaounde Conference Centre, 6 and 7 February 2019 Sud- Ouest Ouest Centre Littoral Est Sud Published in July 2019 For any information on the General Conference on Local Councils - 2019 edition - or to obtain copies of this publication, please contact: Ministry of Decentralization and Local Development (MINDDEVEL) Website: www.minddevel.gov.cm Facebook: Ministère-de-la-Décentralisation-et-du-Développement-Local Twitter: @minddevelcamer.1 Reviewed by: MINDDEVEL/PRADEC-GIZ These proceedings have been published with the assistance of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in the framework of the Support programme for municipal development (PROMUD). GIZ does not necessarily share the opinions expressed in this publication. The Ministry of Decentralisation and Local Development (MINDDEVEL) is fully responsible for this content. Contents Contents Foreword ..............................................................................................................................................................................5 -

A Crispy Delicacy: Augosoma Beetle As Alternative Source of Protein in East Cameroon
Hindawi Publishing Corporation International Journal of Biodiversity Volume 2014, Article ID 214071, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/214071 Research Article A Crispy Delicacy: Augosoma Beetle as Alternative Source of Protein in East Cameroon F. J. Muafor,1,2 P. Levang,3,4 and P. Le Gall5,6 1 Living Forest Trust (LIFT), c/o BP 1857, Yaounde,´ Cameroon 2 Ministry of Forestry and Wildlife (MINFOF), BP 34430, Yaounde,´ Cameroon 3 Center for International Forestry Research (CIFOR), BP 2008, Yaounde,´ Cameroon 4 Institut de Recherche pour le Developpement´ (IRD), UMR 220 GRED, 911 avenue agropolis, BP 64501, 34394 Montpellier Cedex 5, France 5 Institut de Recherche pour le Developpement´ (IRD), UR 072, BP1857 Yaounde,´ Cameroon 6 Laboratoire Evolution, Genomes´ et Speciation,´ UPR 9034, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 91198 Gif-sur-Yvette Cedex, France et Universite´ Paris-Sud 11, 91405 Orsay Cedex, France Correspondence should be addressed to F. J. Muafor; [email protected] Received 4 October 2013; Accepted 2 November 2013; Published 28 January 2014 Academic Editor: Rafael Riosmena-Rodr´ıguez Copyright © 2014 F. J. Muafor et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Despite the fact that the exoskeleton of the Augosoma centaurus (Dynastinae) is hard and difficult to chew, this insect is often gathered in Eastern Cameroon for food in periods of availability. Nine ethnic groups in Eastern Cameroon were surveyed to understand the role of this insect in assuring food security, using quantitative and qualitative social science approaches. -
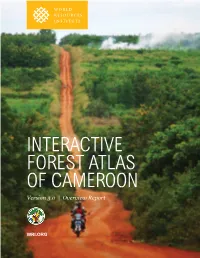
INTERACTIVE FOREST ATLAS of CAMEROON Version 3.0 | Overview Report
INTERACTIVE FOREST ATLAS OF CAMEROON Version 3.0 | Overview Report WRI.ORG Interactive Forest Atlas of Cameroon - Version 3.0 a Design and layout by: Nick Price [email protected] Edited by: Alex Martin TABLE OF CONTENTS 3 Foreword 4 About This Publication 5 Abbreviations and Acronyms 7 Major Findings 9 What’s New In Atlas Version 3.0? 11 The National Forest Estate in 2011 12 Land Use Allocation Evolution 20 Production Forests 22 Other Production Forests 32 Protected Areas 32 Land Use Allocation versus Land Cover 33 Road Network 35 Land Use Outside of the National Forest Estate 36 Mining Concessions 37 Industrial Agriculture Plantations 41 Perspectives 42 Emerging Themes 44 Appendixes 59 Endnotes 60 References 2 WRI.org F OREWORD The forests of Cameroon are a resource of local, Ten years after WRI, the Ministry of Forestry and regional, and global significance. Their productive Wildlife (MINFOF), and a network of civil society ecosystems provide services and sustenance either organizations began work on the Interactive Forest directly or indirectly to millions of people. Interac- Atlas of Cameroon, there has been measureable tions between these forests and the atmosphere change on the ground. One of the more prominent help stabilize climate patterns both within the developments is that previously inaccessible forest Congo Basin and worldwide. Extraction of both information can now be readily accessed. This has timber and non-timber forest products contributes facilitated greater coordination and accountability significantly to the national and local economy. among forest sector actors. In terms of land use Managed sustainably, Cameroon’s forests consti- allocation, there have been significant increases tute a renewable reservoir of wealth and resilience. -

Cameroun) (1992-1996)
Le Projet d’Aménagement Pilote Intégré de Dimako (Cameroun) (1992-1996) Dans ce document ont été rassemblées les contributions des différents acteurs du projet : Michel Jahiel, Blaise Bilak Garka, André Sieffert, Eric Forni, Marcelin Mékok, Luc Durrieu de Madron, Alain Pénelon, Luc Mendouga, Alain Karsenty, Albert Tsagué, Jean-Luc Jardin, Claude Ruth, Nicolas Méké, Adéle M'Benda et bien d'autres qu'il ne nous est pas possible de citer. Ce document a été mis en forme par Luc Durrieu de Madron, Alain Karsenty, Eric Loffeier et Jean-Michel Pierre. 1998 CIRAD-Forêt Campus International de Baillarguet BP 5035 34032 Montpellier cedex France PREFACE L’accès aux connaissances liées au patrimoine national comme international peut accélérer le processus de développement. De même, l’échange des savoirs rassemble ses acteurs et renforce l’organisation des travaux. Pour toutes ces raisons, synthétiser et diffuser l’information relève du mandat des actions de coopération. Depuis près de trente ans, le département forestier du Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) a réalisé de nombreuses recherches sur les écosystèmes forestiers humides de l’Afrique centrale et occidentale. Le projet Forafri, financé par le Fonds d’aide et de coopération (France), a été lancé en 1996 pour capitaliser ces acquis et les valoriser en les transmettant aux acteurs de la filière dans cette zone. Le Cifor (Center for international forestry research), responsable d’une action identique dans les pays anglophones, est associé à Forafri. La phase de capitalisation et de synthèse s’est concrétisée notamment par la rédaction de différents ouvrages, synthèses et publications. -

Augosoma Beetle As Alternative Source of Protein in East Cameroon
Hindawi Publishing Corporation International Journal of Biodiversity Volume 2014, Article ID 214071, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/214071 Research Article A Crispy Delicacy: Augosoma Beetle as Alternative Source of Protein in East Cameroon F. J. Muafor,1,2 P. Levang,3,4 and P. Le Gall5,6 1 Living Forest Trust (LIFT), c/o BP 1857, Yaounde,´ Cameroon 2 Ministry of Forestry and Wildlife (MINFOF), BP 34430, Yaounde,´ Cameroon 3 Center for International Forestry Research (CIFOR), BP 2008, Yaounde,´ Cameroon 4 Institut de Recherche pour le Developpement´ (IRD), UMR 220 GRED, 911 avenue agropolis, BP 64501, 34394 Montpellier Cedex 5, France 5 Institut de Recherche pour le Developpement´ (IRD), UR 072, BP1857 Yaounde,´ Cameroon 6 Laboratoire Evolution, Genomes´ et Speciation,´ UPR 9034, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 91198 Gif-sur-Yvette Cedex, France et Universite´ Paris-Sud 11, 91405 Orsay Cedex, France Correspondence should be addressed to F. J. Muafor; [email protected] Received 4 October 2013; Accepted 2 November 2013; Published 28 January 2014 Academic Editor: Rafael Riosmena-Rodr´ıguez Copyright © 2014 F. J. Muafor et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Despite the fact that the exoskeleton of the Augosoma centaurus (Dynastinae) is hard and difficult to chew, this insect is often gathered in Eastern Cameroon for food in periods of availability. Nine ethnic groups in Eastern Cameroon were surveyed to understand the role of this insect in assuring food security, using quantitative and qualitative social science approaches. -

Cameroon's 4Th-6Th Periodic Reports
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix- Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland ----------- ----------- Single Report comprising the 4th, 5th and 6thPeriodic Reports of Cameroon relating to the African Charter on Human and Peoples’ Rights and 1st Reports relating to the Maputo Protocol and the Kampala Convention Table of Contents LIST OF ACRONYMS AND ABBREVIATIONS ................................................................................. x GENERAL INTRODUCTION ............................................................................................................... 1 PART A: .................................................................................................................................................. 3 IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS ............................................................................................... 3 CONTAINED IN THE CHARTER ........................................................................................................ 3 CHAPTER 1: STRATEGIC, NORMATIVE AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK IN THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ............................................................ 4 Section 1: Adoption of the National Plan of Action for the Promotion and Protection of Human Rights (2015-2019).............................................................................................................................. 4 Section 2: Normative Framework ...................................................................................................... -

Environmental Governance in Africa Working Papers: Wp #10
WORKING PAPER SERIES EENVIRONMENTAL GGOVERNANCE IN AAFRICA THE DECENTRALIZED FORESTRY TAXATION SYSTEM IN CAMEROON: LOCAL MANAGEMENT AND STATE LOGIC by Patrice Bigombé Logo January 2003 WORLD RESOURCES INSTITUTE Institutions and Governance Program Series Editors Jesse C. Ribot Peter G. Veit Institutions and Governance Program World Resources Institute 10 G Street, N.E., Suite 800 Washington, D.C. 20002 USA [email protected] / [email protected] (202) 729-7600 ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN AFRICA WORKING PAPERS: WP #10 THE DECENTRALIZED FORESTRY TAXATION SYSTEM IN CAMEROON: LOCAL MANAGEMENT AND STATE LOGIC by Patrice Bigombé Logo January 2003 EDITORS World Resources Institute Jesse Ribot and Diana Conyers 10 G Street, NE COPY EDITOR Washington DC 20002 Florence Daviet www.wri.org ABSTRACT The study examines the changes in the local management of forestry revenue in South and East Cameroon resulting from the decentralized forestry taxation system introduced in 1994 and their political, socio-economic and ecological impact at the local level. The 1994 forestry reforms introduced new procedures for the access and local management of forestry revenue. Unfortunately, the decentralization process implemented in this context is authoritarian decentralization. Imposed from above and ignoring the real needs and expectations of the local communities, it retains many of the powers of the central State directly and through the rural councils and forestry fees management committees. It represents predatory and neo-paternalistic alliances between the central State, the decentralized bodies and the forestry fees management committees, and between the authorities of the central State, the local administration and local political figures. Efficient and transparent management of forestry revenue can only be guaranteed in a dynamic of democratic decentralization, in which powers over the local management of forestry revenue are devolved to local institutions and actors who are accountable to the local populations for the exercise of those powers. -

Forecasts and Dekadal Climate Alerts for the Period 11Th to 20Th August 2021
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland ----------- ----------- OBSERVATOIRE NATIONAL SUR NATIONAL OBSERVATORY LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ON CLIMATE CHANGE ----------------- ----------------- DIRECTION GENERALE DIRECTORATE GENERAL ----------------- ----------------- ONACC www.onacc.cm; [email protected]; Tel : (+237) 693 370 504 / 654 392 529 BULLETIN N° 89 Forecasts and Dekadal Climate Alerts for the Period 11th to 20th August 2021 th 11 August 2021 © NOCC August 2021, all rights reserved Supervision Prof. Dr. Eng. AMOUGOU Joseph Armathé, Director General, National Observatory on Climate Change (NOCC) and Lecturer in the Department of Geography at the University of Yaounde I, Cameroon. Eng. FORGHAB Patrick MBOMBA, Deputy Director General, National Observatory on Climate Change (NOCC). Production Team (NOCC) Prof. Dr. Eng. AMOUGOU Joseph Armathé, Director General, National Observatory on Climate Change (NOCC) and Lecturer in the Department of Geography at the University of Yaounde I, Cameroon. Eng. FORGHAB Patrick MBOMBA, Deputy Director General, National Observatory on Climate Change (NOCC). BATHA Romain Armand Soleil, PhD student and Technical staff, NOCC. ZOUH TEM Isabella, M.Sc. in GIS-Environment and Technical staff, NOCC. NDJELA MBEIH Gaston Evarice, M.Sc. in Economics and Environmental Management. MEYONG Rene Ramses, M.Sc. in Physical Geography (Climatology/Biogeography). ANYE Victorine Ambo, Administrative staff, NOCC. MEKA ZE Philemon Raïssa, Administrative staff, NOCC. ELONG Julien -

Situation Overview and Humanitarian Needs As of 10 June 2020, There Have Been Over 8,681 Confirmed COVID-19 Cases, with 208 Deaths (Fatality Rate: 2.4%)
CAMEROON: COVID-19 Situation Report – #12 29 May – 12 June 2020 Situation Overview and Humanitarian Needs As of 10 June 2020, there have been over 8,681 confirmed COVID-19 cases, with 208 deaths (fatality rate: 2.4%). Cases have been reported in all ten regions of the country though the majority remain in Central and Littoral regions. The crisis is accelerating. Situation in Numbers Since 1 May the number of cases has increased four-fold from 1,832 cases and since 21 May it has doubled from 4,288 cases. 8,681 COVID-19 UNICEF continues to assist the Government response as the sector co-lead for the Risk confirmed cases Communications and Community Engagement (RCCE) pillar. 208 deaths The Government announced that general education exams will take place from 30 June to 25 August 2020, for technical education from 20 July 2020 to end of August 2020. On June 1, schools reopened for 1,200,000 children due to take their final exams. UNICEF 5,800,000 has supported the respective ministries of primary and secondary education with hygiene Children affected materials allowing more than 402,000 students in 7,144 schools including 196,906 girls by COVID-19 and their teachers, to regularly wash their hands with soap. school closures UNICEF NGO partner Cameroon Red Cross (CRC) installed 245 handwashing stations US$ 24 M (Limbe-100; Buea-80, Maroua 65) in strategic areas including 2 isolations centres in funding required of Maroua and 14 at Health Centres in Bamenda, benefitting an estimated 174,255 which $5.3m individuals (69,512 men, 44,576 women, 33,323 boys and 26,844 girls) including 841 received people with disabilities. -

Plan Damenagement Version Revisee
MINISTERE SES FORETS REPUBLIQUE DU CAMEROUN ET DE LA FAUNE Paix – Travail – Patrie PLAN D’AMENAGEMENT Version révisée Mars 2006 70 TABLE DES MATIERES Table des matières………………………………………………………………………………………………………………..……….2-3 Liste des cartes……………………………………………………………….…………………………………………………………………4 Liste des tableaux………………………………………………………………..………………………………………………………..4 Liste des annexes……………………………………………………………………….…………………………………….…………….5 Introduction…………………………………………………………………………………….………………………….…………………6 1. Caractéristiques biophysiques de la forêt…………………………………………..………………….…………………7 1.1. Informations administratives………………………………………………………………..……………………………….7 1.1.1. Nom et situation administrative…………………………………………………………………………………………7 1.1.2. Superficie………………………………………………………………………………………………..………………………7 1.1.3. Situation géographique et limites……………………………………………………………………..……………..7 1.2. Facteurs écologiques……………………………………………………………………………………………………………9 1.2.1. Topographie……………………………………………………………………………………………………………………9 1.2.2. Climat…………………………………………………………………………………………………………………………….9 1.2.3. Géologie et pédologie……………………………………………………………………………………………….……10 1.2.4. Hydrographie……………………………………………………………………………………………..………….…….11 1.2.5. Végétation……………………………………………………………………………………………..……………..…….11 1.2.6. Faune…………………………………………………………………………………………………….……………….…….12 2. Environnement socioéconomique…………………………………………………………………………………..……..14 2.1. Méthodologie d’enquête………………………………………………………………………………………………...14 2.2. Résultats………………………………………………………………………………………………………………………….14 2.2.1. Caractéristiques démographiques…………………………………………………………………………………14