Les Longicornes (Cerambycidae)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nuevas Aportaciones Al Conocimiento De La Fauna De Coleópteros Saproxílicos (Coleoptera) Del Sistema Ibérico Septentrional, I
Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 46 (2010) : 321−334. NUEVAS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA DE COLEÓPTEROS SAPROXÍLICOS (COLEOPTERA) DEL SISTEMA IBÉRICO SEPTENTRIONAL, I: ROBLEDALES DEL VALLE MEDIO DEL IREGUA (SIERRA DE CAMEROS, LA RIOJA, ESPAÑA)* Ignacio Pérez-Moreno Universidad de La Rioja. Departamento de Agricultura y Alimentación. c/Madre de Dios, 51. 26006 Logroño (La Rioja, España) − [email protected] * Trabajo financiado a través de la convocatoria 2005 de ayudas para estudios científicos de temática riojana, del Instituto de Estudios Riojanos (Gobierno de La Rioja) Resumen: Durante el año 2006 se realizó un muestreo de la fauna de coleópteros saproxílicos presente en dos robledales lo- calizados en el valle medio del Iregua (Sistema Ibérico septentrional). En total, se han estudiado 697 ejemplares y se han iden- tificado 154 especies, pertenecientes a 39 familias (excepto Staphylinidae). La mayoría de las especies se obtuvieron median- te trapas tipo tubo y multiembudo. Teniendo en cuenta su preferencia por microhábitats específicos, dominan las especies que viven en el leño y en la corteza, seguidas de las especies que habitan en los cuerpos fructíferos de hongos lignícolas y las que frecuentan las cavidades que se forman en los troncos de los árboles añosos. Con respecto al tipo de grupo trófico, las espe- cies xilófagas son las más abundantes, seguidas de las depredadoras y micetófagas. La biodiversidad saproxílica de estos bosques se ha caracterizado por presentar una mayoritaria presencia de especies de distribución europea. Se han identificado algunas especies raras, poco conocidas o indicadoras de la calidad de los bosques. -

Arquivos Entomolóxicos, 24: 145-168
ISSN: 1989-6581 Gil et al. (2021) www.aegaweb.com/arquivos_entomoloxicos ARQUIVOS ENTOMOLÓXICOS, 24: 145-168 ARTIGO / ARTÍCULO / ARTICLE Preliminary catalogue of the entomofauna of Parque das Serras do Porto (Porto, Portugal) Francisco Gil 1, José Manuel Grosso-Silva 2 & Alexandre Valente 3 1 Rua Dr. Sérgio Vieira de Melo, 39, 3.º dir., 4420-623 S. Cosme, Portugal. e-mail: [email protected] 2 Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) / PRISC, Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto, Portugal. e-mail: [email protected] 3 Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Portugal. e-mail: [email protected] Abstract: The first catalogue of the insect fauna of the Parque das Serras do Porto (northern Portugal) is presented, including a compilation of literature records and new data mainly obtained in Couce (Valongo). The catalogue contains 210 species (101, or 48.1%, recorded for the first time from the area) spanning nine orders of the class Insecta, and is the first comprehensive list of the area’s entomofauna. Key words: Insecta, Protected Landscape, inventory, Parque das Serras do Porto, Porto, Portugal. Resumen: Catálogo preliminar de la entomofauna del Parque das Serras do Porto (Porto, Portugal). Se presenta el primer catálogo de la fauna de insectos del Parque das Serras do Porto (norte de Portugal), incluyendo una recopilación de registros bibliográficos y nuevos datos obtenidos mayoritariamente en Couce (Valongo). El catálogo contiene 210 especies (101, o 48.1%, registradas por primera vez de la zona) de nueve ordenes de la clase Insecta y constituye el primer listado exhaustivo de la entomofauna del área. -

Vincent Derreumaux
Palpares libelluloides - Envergure réelle : 100 à 120 mm - Photo : Vincent Derreumaux 98 Courrier scientifique du Parc naturel régional du Luberon et de la Réserve de biosphère Luberon-Lure, n° 14 - 2016, p. 98 à 126 Actualisation de la liste des insectes patrimoniaux pour la Réserve de biosphère Luberon-Lure 3LHUUH)5$3$ RÉSUMÉ L’auteur actualise la liste d’espèces présentée antérieurement en fonction de différents nouveaux éléments en y ajoutant 197 taxons, alors que 79 autres en sont retirés, le nombre total s’établissant alors à 705. Mots-clés : insectes, protection, espèces menacées, patrimoine, listes. TITLE Insect heritage for Biosphere reserve Luberon-Lure (Addenda) ABSTRACT The author updates the list of species previously presented according to various new elements by adding 197 new taxa, and by removing 79 taxa, the total number rising to 705. Keywords : insects, protection, endangered species, patrimony, lists. *(QWRPRORJLVWHPHPEUHGX&RQVHLOVFLHQWLÀTXHGX315/HWGHOD5%/XEHURQ/XUH²FROHRBHWBFLH#RUDQJHIU 99 Introduction un peu trop sévères et qu’il semblait préférable d’envisager parfois une présence potentielle même si elle n’était pas Dans le numéro 11 de la présente publication j’avais pré- formellement avérée, par exemple pour des taxons dont senté une liste d’espèces d’insectes dont la « valeur patri- l’aire connue de répartition nationale, voire européenne, moniale » pouvait être considérée comme attestée par leur englobe le territoire Luberon-Lure où leur biotope existe mention dans une des listes publiées qui étaient présentées. a priori. (Frapa, 2012) La démarche me semble encore d’actualité, À l’énumération des listes prises en considération, il même si les listes utilisées sont susceptibles de subir des convient d’ajouter celle établie par Masselot & Brulin changements importants. -

Os Nomes Galegos Dos Insectos 2020 2ª Ed
Os nomes galegos dos insectos 2020 2ª ed. Citación recomendada / Recommended citation: A Chave (20202): Os nomes galegos dos insectos. Xinzo de Limia (Ourense): A Chave. https://www.achave.ga /wp!content/up oads/achave_osnomesga egosdos"insectos"2020.pd# Fotografía: abella (Apis mellifera ). Autor: Jordi Bas. $sta o%ra est& su'eita a unha licenza Creative Commons de uso a%erto( con reco)ecemento da autor*a e sen o%ra derivada nin usos comerciais. +esumo da licenza: https://creativecommons.org/ icences/%,!nc-nd/-.0/deed.g . 1 Notas introdutorias O que cont n este documento Na primeira edición deste recurso léxico (2018) fornecéronse denominacións para as especies máis coñecidas de insectos galegos (e) ou europeos, e tamén para algúns insectos exóticos (mostrados en ám itos divulgativos polo seu interese iolóxico, agr"cola, sil!"cola, médico ou industrial, ou por seren moi comúns noutras áreas xeográficas)# Nesta segunda edición (2020) incorpórase o logo da $%a!e ao deseño do documento, corr"xese algunha gralla, reescr" ense as notas introdutorias e engádense algunhas especies e algún nome galego máis# &n total, ac%éganse nomes galegos para 89( especies de insectos# No planeta téñense descrito aproximadamente un millón de especies, e moitas están a"nda por descubrir# Na )en"nsula * érica %a itan preto de +0#000 insectos diferentes# Os nomes das ol oretas non se inclúen neste recurso léxico da $%a!e, foron o xecto doutro tra allo e preséntanse noutro documento da $%a!e dedicado exclusivamente ás ol oretas, a!ela"ñas e trazas . Os nomes galegos -

Longicornes De France – Atlas Préliminaire (Coleoptera : Cerambycidae & Vesperidae)
Longicornes de France – Atlas préliminaire (Coleoptera : Cerambycidae & Vesperidae) Julien TOUROULT, Valentina CIMA, Hervé BOUYON, Christophe HANOT, Arnaud HORELLOU & Hervé BRUSTEL Julien TOUROULT UMS PatriNat (AFB, CNRS, MNHN), case postale 41, 57 rue Cuvier, F-75231 Paris cedex 05 [email protected] Valentina CIMA UMS PatriNat (AFB, CNRS, MNHN), case postale 41, 57 rue Cuvier, F-75231 Paris cedex 05 [email protected] Hervé BOUYON Président d’ACOREP-France 73 avenue Joffre F-92250 La Garenne-Colombes [email protected] Christophe HANOT UMR 8079 UPSud - CNRS - AgroParisTech « Écologie, Systématique et Évolution » rue du Doyen André Guinier F-91400 Orsay [email protected] Arnaud HORELLOU UMS PatriNat (AFB, CNRS, MNHN), case postale 41, 57 rue Cuvier, F-75231 Paris cedex 05 [email protected] Hervé BRUSTEL Université de Toulouse, École d’Ingénieurs de Purpan, UMR INRA/INPT 1201 « Dynamique et écologie des paysages agriforestiers », 75 voie du Toec, boîte postale 57611, F-31076 Toulouse cedex 3 [email protected] Citation conseillée : TOUROULT J., CIMA V., BOUYON H., HANOT C., HORELLOU A. & BRUSTEL H. 2019. Longicornes de France – Atlas préliminaire (Coleoptera : Cerambycidae & Vesperidae). Supplément au bulletin d’ACOREP-France, Paris. 176 p. 1 Résumé. Cet ouvrage présente la distribution commentée des 250 espèces de longicornes de France métropolitaine (avec la Corse), pour la période 1970-2018. L’atlas est fondé sur la compilation et la synthèse de 137 000 données partagées dans l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN-SINP1), issues de 395 jeux de données et des citations d’environ 3 500 observateurs. Après validation des données et suppression des doublons, 102 300 données ont servi à établir les cartes de distribution par maille 10 x 10 km et les histogrammes de saisonnalité par décade pour les 81 Cerambycinae, 83 Lamiinae, 63 Lepturinae, 2 Necydalinae, 5 Prioninae, 12 Spondylidinae et 4 Vesperidae. -

33521162.Pdf
RÉPONSE DES COLÉOPTÈRES SAPROXYLIQUES À L’HÉTÉROGÉNÉITÉ DES SUBÉRAIES DANS LE MASSIF DES MAURES (FRANCE) Antoine BRIN*1& Hervé BRUSTEL* SUMMARY. — Saproxylic beetles’ response to cork-oak forests heterogeneity in the Massif des Maures (France). — Cork-oak stands are a major component of the “Massif des Maures” forests (France, Var). Depend- ing on fi re frequency, soil conditions and human uses, these forests present different forms. Even if Mediter- ranean landscapes have been shaped for a long time by fi re, such recurrent perturbation may affect several functional groups of organisms associated with old forests, such as saproxylics insects. Our aims were (i) to investigate species richness and composition of saproxylic beetle assemblages in different cork-oak stands, (ii) to estimate between stand complementarity and (iii) identify indicator species of each habitat. Three different types of cork-oak stands common in the “Massif des Maures”, representing an increasing gradient of canopy closing and ecosystem maturing, were investigated : a senescent stand associated with mature maquis, an adult stand with high maquis and an open adult stand with low maquis. Beetles were sampled from April to August in 2003 and 2004 using baited window traps. Our results showed that : (i) the three studied cork-oak stands can be considered as three different habitats regarding saproxylic beetle assemblages, (ii) the closed cork-oak stands support the highest cumulative species richness, (iii) abundances of ecological groups show signifi cant between- stands differences, (iv) each habitat supports remarkable species from a patrimonial point of view. RÉSUMÉ. — La subéraie est l’une des principales formations forestières du massif des Maures. -

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Errata
CATALOGUE OF PALAEARCTIC COLEOPTERA I. LÖBL & A. SMETANA ERRATA New taxa and new replacement names published within the Errata chapters of some volumes may have been overlooked, therefore they are here listed separately: Pterostichus gaturs Davies , nom. nov. [Carabidae, published in vol. 2, December 31, 2004] Pterostichus bhunetansis Davies , nom. nov. [Carabidae, published in vol. 2, December 31, 2004] Pterostichus bucciperis Davies , nom. nov. [Carabidae, published in vol. 2, December 31, 2004] Pterostichus parkwon Davies , nom. nov. [Carabidae, published in vol. 2, December 31, 2004] Pterostichus gonar Davies , nom. nov. [Carabidae, published in vol. 2, December 31, 2004] Pterostichus asinubas Davies, nom. nov . [Carabidae, published in vol. 2, December 31, 2004] Pterostichus cunibakus Davies , nom. nov. [Carabidae, published in vol. 2, December 31, 2004] Pterostichus setosicus Davies , nom. nov. [Carabidae, published in vol. 2, December 31, 2004] Cissidium matthewsi Johnson sp. nov . [Ptiliidae, published in vol. 4, June 30, 2007] Acrotrichis (A.) williamsi Johnson, sp. nov . [Ptiliidae, published in vol. 4, June 30, 2007] Cardiophorus gurjevae Cate, nom. nov . (for Cardiophorus gracilis Gurjeva, 1966, nec Cardiophorus gracilis (Wollaston, 1864) [Elateridae, published in vol. 6, February 22, 2010] Autosilis Kazantsev, gen. nov. type species Cantharis nitidula Fabricius, 1792 [Cantharidae, published in vol. 7, February 15, 2011] Blepephaeus puae Lin, nom. nov . (for Blepephaeus undulatus Pu, 1999 nec Blepephaeus undulatus (Pic, 1930) [Cerambycidae, published in vol. 7, February 15, 2011] Labidostomis centrisculpta kafiristanica Regalin & L. N. Medvedev, nom. nov. (for Labidostomis nuristanica afghanica Lopatin & Nesterova, 2007, nec L. nuristanica afghanica L. N. Medvedev, 1978) [Chrysomelidae, published in vol. 7, February 15, 2011] ERRATA for VOLUME 1 Sphaeriusidae p. -
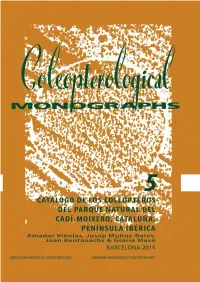
Documento 70,3
CATÁLOGO DE LOS COLEÓPTEROS DEL PARQUE NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ 1 2 AMADOR VIÑOLAS ET AL. COLEOPTEROLOGICAL MONOGRAPHS © Asociación Europea de Coleopterología ISSN: 2339-7799 (online edition) Legal Register: B-46.598-1998 Published by the Asociación Europea de Coleopterología Publication date: October 2014 Graphic design by Jesús del Hoyo Composition: Amador Viñolas CATÁLOGO DE LOS COLEÓPTEROS DEL PARQUE NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ 3 ÍNDICE Abstract ..........................................................................................................................5 Resumen .........................................................................................................................5 Resum ............................................................................................................................6 Introducción ...................................................................................................................6 Metodología empleada .................................................................................................10 Acrónimos de las colecciones depositarias de los especímenes estudiados ................12 Resultados y Discusión ................................................................................................12 Agradecimientos ..........................................................................................................14 Referencias ...................................................................................................................15 Anexo -

Ib Ero Dorcadium Lorquinii (A Utor: A. G. Maldonado)
Iberodorcadium lorquinii (Autor: A. G. Maldonado) Los Cerambícidos (Coleoptera: Cerambycidae) Antonio Verdugo Páez Héroes del Baleares, 10 – 3º B. 11100 San Fernando, Cádiz [email protected] RESUMEN Estudiamos las especies de coleópteros Cerambycidae registrados hasta el momento de Sierra Nevada. Se ofrecen sus referencias bibliográficas así como algunos datos sobre su distribución y biología. Se han identificado un total de cincuenta y nueve taxones de nivel especie, pertenecientes a seis distintas subfamilias, faltando únicamente, respecto de la fauna ibérica, representantes de la subfamilia Necydalinae Latreille, 1825. Palabras Clave: Coleoptera, Cerambycidae, Sierra Nevada, España. ABSTRACT In this work, the Coleoptera Cerambycidae recorded up to now in Sierra Nevada are studied. Their bibliographical references and, as well, distributional and bionomical data are offered. Fifty nine taxa at species level, belonging to six subfamilies, have been identified. Only the subfamily Necydalinae Latreille, 1825, present in the Iberian fauna, is not repre- sented in Sierra Nevada. Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Sierra Nevada, Spain. Los insectos de Sierra Nevada INTRODUCCIÓN Los primeros autores que empiezan a tratar sobre la fauna de cerambícidos ibéricos no aparecen hasta la segunda mitad del siglo XIX en que autores extranjeros (Dalman, Rosenhauer, Fairmaire, etc.) recorren el área de estudio describiendo nuevos táxones para la ciencia (o describen el material recogido por otros), como fue el mítico Dorcadion lorquinii, descrito por Fairmaire en 1855 de material procedente de la sierra. Algo más tarde, a finales del siglo XIX o principios del XX, surgen los autores españoles como Martínez de la Escalera, Pérez Arcas, Lauffer, etc. y sus contribuciones al estudio de los cerambícidos ibéricos, aportaciones que ya no cesarán de producirse. -
Actualización Del Catálogo De Longicornios De Marruecos
Revue de l’ Association Roussillonnaise d’ Entomologie - 2019 - Tome XXVIII (2) : 72 – 84. Actualización del catálogo de Longicornios de Marruecos Actualisation du catalogue des Longicornes du Maroc (Parte II / Partie II : Cerambycidae : Lepturinae, Vesperidae) par Sergi TRÓCOLI * Resumen. ― Se actualiza el catálogo de longicornios de Marruecos, con nuevas citas y localidades. Se revisan ejemplares tanto de colecciones privadas como públicas y se consulta la bibliografía hasta la fecha, comentando sinonimias y errores de determinación que se ponen al día. Palabras clave. ― Cerambycidae, Lepturinae, Vesperidae, Marruecos, Norte de África. Résumé. ― Le catalogue des longicornes du Maroc est actualisé, avec de nouvelles citations et localités. Des spécimens de collections privées et publiques sont examinés et la bibliographie publiée jusqu’à ce jour est consultée. Les synonymies et erreurs de détermination sont commentées et mises à jour. Mots clés. ― Cerambycidae, Lepturinae, Vesperidae, Maroc, Afrique du Nord. Abstract. ― The Moroccan longicorn catalog is updated, with new citations and locations. We review specimens of both private and public collections and consult the bibliography to date, commenting synonyms and determination errors, which are updated. Key words. ― Cerambycidae, Lepturinae, Vesperidae, Morocco, North of Africa. Introducción Introduction Se continúa con esta segunda parte, Cette seconde partie, consacrée à la sous-famille dedicada a la subfamilia Lepturinae y la Lepturinae et à la famille Vesperidae, continue la mise familia Vesperidae, la puesta al día del à jour du catalogue des longicornes du Maroc. La catálogo de longicornios de Marruecos. Se numérotation des espèces est poursuivie à partir du continua la numeración de especies a partir del dernier article précédemment publié, en commençant anterior artículo publicado, iniciando el listado la liste des Lepturinae à partir du numéro 16. -

Ecological Patterns Strongly Impact the Biogeography of Western Palaearctic Longhorn Beetles (Coleoptera: Cerambycoidea)
Org Divers Evol (2017) 17:163–180 DOI 10.1007/s13127-016-0290-6 ORIGINAL ARTICLE Ecological patterns strongly impact the biogeography of western Palaearctic longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycoidea) Francesco Vitali1,2 & Thomas Schmitt2,3,4 Received: 30 December 2015 /Accepted: 17 May 2016 /Published online: 6 June 2016 # Gesellschaft für Biologische Systematik 2016 Abstract We aim to unravel the biogeographic structuring of the Mediterranean region and underline the importance of western Palaearctic longhorn beetles with focus on the loca- Provence, Crimea and Crete as such refugia. Crete even might tion of different refugia, barriers to dispersal and postglacial be an area of old endemism. The Atlanto- and the Ponto- range expansions with their particular filters. The interaction Mediterranean regions are more strongly structured than as- of different ecological features with these structures is sumed in classical biogeography. Mediterranean assemblages analysed. The western Palaearctic was divided into 95 geo- are mostly composed of non-flying species, root feeders and graphic entities. We produced presence-only matrices for all species with small distributions not found outside their glacial 955 Cerambycoidea species autochthonous to this area and refugia. Tree feeders left their glacial retreats with their host derived species richness distributions and extracted faunal re- plants. These range dynamics result in biogeographic struc- gions and faunal elements by cluster analyses and principal tures with several dispersal barriers and filters composed of component analyses. Similar analyses were performed for mountains, sea straits and climatic conditions. sub-families and ecological groups. Longhorn beetles show a strong biogeographic structuring in the western Palaearctic. Keywords Biogeographic filters . -

(Insecta: Coleoptera E Hemiptera) Do Vale Do Rio Ferreira (Valongo) E Do Parque Oriental Da Cidade Do Porto Ao Longo De Um Ciclo Anual
Análise comparativa da entomofauna (Insecta: Coleoptera e Hemiptera) do vale do rio Ferreira (Valongo) e do Parque Oriental da Cidade do Porto ao longo de um ciclo anual Francisco Vilas Boas Gil Mestrado em Ecologia e Ambiente Departamento de Biologia 2019 Orientadores Doutor José Manuel Grosso Ferreira da Silva Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto Prof. Doutor Alexandre Carlos Nogueira Valente Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Todas as correções determinadas pelo júri, e só essas, foram efetuadas. O Presidente do Júri, Porto, ______/______/_________ FCUP iv Análise comparativa da entomofauna (Insecta: Coleoptera e Hemiptera) do vale do rio Ferreira (Valongo) e do Parque Oriental da Cidade do Porto ao longo de um ciclo anual Agradecimentos Ao Doutor José Manuel Grosso-Silva, por todo o apoio, amizade e tutoria que me ofereceu durante praticamente dois anos sem eu ter de pedir uma vez que fosse. Ao Professor Alexandre Valente, por todo o apoio dado de bom grado na elaboração desta dissertação e pela sua constante disponibilidade. À minha Mãe e ao meu Pai, pela paciência e disponibilidade dignas de santos, as quais foram de certeza levadas ao limite pelo seu primogénito. Aos Medievais e aos BioGordos, os melhores amigos que eu poderia alguma vez ter a sorte de encontrar, pelas saídas, comidas e bebidas que permitiram que eu fizesse as muito necessárias pausas durante o último ano. Ao Ed, esse libriano míope, que reacendeu em mim a paixão pelos insetos e pela natureza e sem o qual eu estaria, sem dúvida, ainda muito perdido.