MEMOIRE Thème
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
MÉMOIRE DE MASTER Science De La Nature Et De La Vie Sciences Agronomiques Pheoniciculture Et Valorisation Des Dattes
Université Mohamed Khider de Biskra Faculté des Sciences Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie Département des Sciences Agronomiques MÉMOIRE DE MASTER Science de la Nature et de la Vie Sciences Agronomiques Pheoniciculture et valorisation des dattes Réf. : …………………………………..… Présenté et soutenu par : Mme. Athamnia Amina Le : 03/07/2019 Thème : Contribution à l’étude de la valorisation des cultivars à faible valeur marchande « D’goule » dans la région des Ziban (Cas Sidi-Okba et Lioua) Jury : Mme. Mebrek N MAA Université de Biskra Président Mme. Deghiche -Diab N MAA Université de Biskra Rapporteur Mr. Khechai S MAA Université de Biskra Co-Rapporteur Mme. Saadi I MCB Université de Biskra Examinateur Année universitaire : 2018 - 2019 Dédicace A mes chers parents qui m'ont éclairé le chemin de la vie par leur grand soutien et leurs encouragements, par leurs dévouements exemplaires et les énormes sacrifices qu’ils m'ont consentis durant mes études et qui ont toujours aimé me voire réussir. Je Les remercie pour tout ce qu'ils mon fait À mon très chère marie qui n’a pas cessé de m’encourager et m’a poussé à poursuivre. Aussi mon cousin Laarbi qui me soutient pour terminer ce travail. À mon enfant Med Ali qui est toujours la fleur de ma vie Aussi mohamed et saida Mon frère Abdallah et ma sœur Khadidja et Mouna Aussi Djahida. À Mes tantes et mon oncle Et à toute ma famille, mes collègues et mes amies. Remerciements En premier lieu, je tiens à remercier notre Allah, pour le courage et la force qu'il nous a donné pour effectuer ce travail. -

Republique Algérienne Démocratique Et Populaire
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR & DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ MENTOURI FACULTÉ DES SCIENCES DE LA TERRE, DE GÉOGRAPHIE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE N° d'Ordre ……………… Série ............................ THESE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE DOCTORAT D'ÉTAT OPTION: URBANISME Présentée par : BENABBAS MOUSSADEK THÈME DEVELOPPEMENT URBAIN ET ARCHITECTURAL DANS L’AURES CENTRAL ET CHOIX DU MODE D’URBANISATION Sous la direction du: Pr BOUDRAA AHMED Jury d'Examen Président: S. KERADA M.C Université de Constantine Rapporteur: A. BOUDRAA Pr Université de Batna Examinateur: B. AMRI M.C Université de Batna Examinateur: S. CHAOUCHE M.C Université de Constantine Soutenue, Le 09 Juillet 2012 A la mémoire de ma Grande mère Remerciements Je tiens tout d'abord a remercier mon directeur de thèse, Boudraa Ahmed, Professeur au département des sciences sociologiques, section des sciences sociales, Université El hadj Lakhdar, Batna, pour avoir accepter de m'accompagner tout au long de ce projet de thèse, pour sa confiance, son amitié et son soutien. Merci à Amri Brahim, Kerada Salah-Eddine et Chaouche Salah pour avoir accepter de faire partie du jury de cette thèse. Pour leurs conseils et leur amitié, je remercie entre autre Aourra Ali, Zemmouri Nour Eddine, et Metmer Med Laid. Merci a Marc Cote pour m'avoir donné le temps d’entretiens, d'orientations durant mes séjours de stage à Aix-en Provence et des éléments importants pour la compréhension du contexte que j'ai eu l'occasion d'étudier. Mes remerciements les plus sincères, s'adressent au personnel, gestionnaire du département d'architecture de Constantine, surtout, Mme Safieddine Rouag Djamila, chargée de la post graduation. -

Apports De La Geophysique Pour La Determination De L'extension Des Aquiferes De La Region De Biskra
Journal Algérien des Régions Arides N° 07 - 2008 APPORTS DE LA GEOPHYSIQUE POUR LA DETERMINATION DE L’EXTENSION DES AQUIFERES DE LA REGION DE BISKRA. N.SEDRATI*, Nora BOUCHAHM*, Warda CHAIB*, Assia REZEG*, Rabea SLIMANI*, Lallahoum BENAOUDA * et Larbi DJABRI**. *Chercheurs CRSTRA. Bp 1682 Biskra 07000 **Université de Annaba. Département de Géologie. RESUME: Le travail constitue une contribution à la détermination des aquifères et de leurs extensions afin de proposer un mode de gestion des eaux à la ville de Biskra face à la demande en eau et aux effets des changements climatiques et anthropiques (construction des barrages). La méconnaissance des aquifères (extension, lithologie et sollicitations) peut dérouter les gestionnaires de la ressource en eau. Aussi avons nous exploité les résultats des études géophysiques, géologiques et hydrogéologiques réalisées au niveau de la wilaya de Biskra. Ces dernières ont montré que le sous sol de la zone d’étude recèle trois réservoirs aquifères (Quaternaire, Mio-Pliocène et Eocène), situés à diverses profondeurs, aux compositions lithologiques différentes qui compliquent la mise en évidence de leurs relations hydrauliques. La répartition des ouvrages de captage et les quantités d’eau extraites diffèrent d’un niveau à un autre. Nous avons déterminé avec exactitude la position des niveaux aquifères dans leurs environnements géologiques et lithologiques, ce qui permettra de choisir l’implantation future des forages d’eau. Mots clés : Biskra, changements climatiques, géophysique, hydrogéologie, aquifère, débit. ABSTRACT THE CONRIBUTIONS OF THE GEOPHYSIC TO DETERMINE THE EXPANSION OF THE AQUIFERS IN THE REGION OF BISKRA. The present work is a contribution to the determination of the aquifers and their expansions in order to carry out a method of water management in the city of Biskra facing the water demand and the effects of climatic and anthropogenic changes (construction of weirs). -

Palmier Dattier. Cochenille Blanche, Infestation, Prédateurs, Echelle D'iperti
Recherche Agronomique (1999), 5, 1-10 INRAA IMPACT OF THE ENTOMOPHAGOUS FAUNA ON THE Parlatoria Blanchardii TARG POPULATION IN THE BISKRA REGION Part 1 s. MOHAMMEDI' and A. SALHI- 1 - D.SA. de Biskra 2 - S.R.P.V. Filiache - Biskra. Abstract : Date palni tree is facing many problems and constraints snch as water stress, excess of salinity, deseases, pests, etc... Among the most important pests Parlatoria blanchardii communly known as the white cochineal is spread in Biskra région. Aims ofthis study were to measure its spread, to identify its natural predators and to measure there impact on this pest. Iperti's scale vim iised to measure overrun ofParlatoria blanchardii on date palms. Most predators ofthis pest living in the study area were identified and there impact measured. Results show that spread of Parlatoria blanchardii is not uniform ail over the study area. More over a close rela- tionship wasfound between it's spread and those ofpredators siich as, Cybocephaliis palmanum and Pharoscvmus semislobu.sus. Key words : Date palm tree, White cochineal, Spread, Predators, îperti scale. Résumé : Le palmier dattier est confronté à de nombreux problèmes et contraintes tels que le déficit hydrique, les excès de salinité, les maladies, les insectes nuisibles, etc... Parmi ces derniers, Parlatoria blanchardii Targ communément appelée la Cochenille blanche est répandue au niveau de la région de Biskra. Les objectifs de cette étude visent une évaluation de Vinfestation des palmeraies de la wilaya de Biskra par la Cochenille blanche, l'identification de ses prédateurs naturels et leur impact. L'échelle d'Iperti a été utilisée pour mesurer les taux d'infestation par Parlatoria hlnnchardii. -

Date Palm Genetic Resources and Cultivation
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية University of Mohamed Khider Biskra Faculty of Exact Sciences and Natural and Life Sciences Department of Agronomic Sciences MASTER MEMORY Natural and life Science agronomic Sciences Réf. : …………………………………..… Presented by : latrache hayatte Theme : Survey on date palm (P, dactylifera L,) genetic resources in mountain groves (Ain Zaatout, Biskra Jury : Mr. HADJEB Ayoub M.C.A. University of Biskra President Mme. BEDJAOUI Hanane M.C.B. University of Biskra Rapporteur Mr. Farhi camellia M.C.A. University of Biskra Examinateur Acadimic year : 2019 - 2020 Acknowledgement Page First of all, I thank God for giving me life and strength. To do this work. Praise be to God, Lord of the Worlds, Most Merciful. The work of this graduation note is the fruit of group work. Here I would like to thank all the people who helped me in any way. First of all, I would like to express my sincere gratitude for the thesis of my teacher, Madame. Bedjaoui Hanan she is a passionate and dedicated scholar with the training and success of her students. Many thanks for your support, your unwavering confidence. I express my gratitude to Dr. Hadjeb Ayoub, it's honored to me that he accept the presidency of this committee. I would like to express my deepest gratitude and thanks to Miss. Farahi Camellia who had the honor to agree to be a reviewer for this work. For my mom whose support has always been essential in my life, she always knows to be there at the right time. My friend, she's an amazing mom. -

La Couverture Sanitaire Dans La Wilaya De Biskra
La couverture sanitaire dans la wilaya de Biskra Pr. Larbi ABID La wilaya de Biskra est située au centre-est de l'Algérie dans la région des Aurès aux portes du désert du Sahara. Le chef-lieu de la wilaya est la ville de Biskra, située à 115 km au sud-ouest de Batna, à 222 km au nord de Touggourt et 400 km environ au sud-est d’Alger. Elle est limitée au nord par la wilaya de Batna, à l'est par la wilaya de Khenchela, à l'ouest par les wilayas de Msila et Djelfa et au sud par les wilayas d’Ouargla et El Oued. La superficie totale de la wilaya est de 20 986 km², la population est estimée à 849 671 habitants (en 2014), soit une densité de 39,5 habitants/Km2. Le climat de la wilaya de Biskra est de type saharien sec, la pluviométrie est de 120 à 150 mm/an. La température moyenne est de 20,8 degrés C°. La wilaya compte 12 daïras : 1 – Biskra, 2 – Djamourah, 3 - El-Kantara, 4 - M’Chounech ; 5 - Sidi-Okba ; 6 - Zeribet El-Oued ; 7 – Ourlel ; 8 – Tolga ; 9 - Ouled-Djellal ; 10 - Sidi-Khaled ; 11 – Foughala ; 12 – Loutaya. La wilaya de Biskra dispose de deux barrages fontaine de la gazelle à Loutaya et Foum El-Gharza à sidi Okba ,8150 forages et 4 544 puis d’eau. L'économie de la wilaya est surtout axée sur l'agriculture avec la culture des dattes, la wilaya dispose d'un patrimoine estimé de 4,1 millions de palmiers-dattiers. -

The Sand Filterers
1 The sand filterers Majnoun, the passionate lover of Leila, wandering in the desert, was seen one day filtering sand in his hands. “What are you looking for?” He was asked. “I am looking for Leila.” “How can you expect to find such a pure pearl like Leila in this dust?” “I look for Leila everywhere”, replied Majnoun, “hoping to find her one day, somewhere.” Farid Eddin Attar, as reported by Emile Dermenghem, Spiritual Masters’ Collection. 2 Introduction Whatever judgment passed in the future on Mostefa Ben Boulaid, Bachir Chihani or Adjel Adjoul, a place in the mythical Algerian revolution will be devoted to them. Many controversies will arise concerning the nature of this place. As for me, I only hope to be faithful to their truth. To achieve this, I think time has come to unveil the history of the Aures- Nememcha insurrection and rid it of its slag, reaching deep in its genuine reality which makes it fascinating. The events told here go from November 1st, 1954 to June 1959. They depict rather normal facts, sometimes mean, often grandiose, and men who discover their humanity and whose everyday life in the bush is scrutinized as if by a scanner. As it is known, it is not easy to revive part of contemporary History, particularly the one concerning the Aures Nememcha insurrection of November 1954. I have started gleaning testimonies in 1969, leaving aside those dealing with propaganda or exonerating partiality. I have confronted facts and witnesses, through an unyielding search for truth, bearing in mind that each witness, consciously or not, is victim of his own implication. -
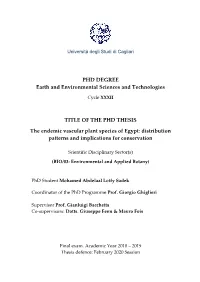
Schema Frontespizio Teso Dottorato
Università degli Studi di Cagliari PHD DEGREE Earth and Environmental Sciences and Technologies Cycle XXXII TITLE OF THE PHD THESIS The endemic vascular plant species of Egypt: distribution patterns and implications for conservation Scientific Disciplinary Sector(s) (BIO/03- Environmental and Applied Botany) PhD Student Mohamed Abdelaal Lotfy Sadek Coordinator of the PhD Programme Prof. Giorgio Ghiglieri Supervisor Prof. Gianluigi Bacchetta Co-supervisors: Dotts. Giuseppe Fenu & Mauro Fois Final exam. Academic Year 2018 – 2019 Thesis defence: February 2020 Session Table of Contents TABLE OF CONTENTS General introduction 1 Study area 3 Research objectives 6 References 7 CHAPTER I- Critical checklist of the endemic vascular plants of Egypt 10 1. Introduction 11 2. Materials and methods 12 3. Results 13 3.1 . Floristic analysis of the egyptian exclusive flora 13 3.2. Distribution of the exclusive endemic vascular flora of Egypt 14 4. Discussion 16 5. Conclusion 21 6. References 27 CHAPTER II- Biogeographical characterization of Egypt based on environmental 31 features and endemic vascular plants distribution 1. Introduction 32 2. Materials and methods 34 2.1. Study area 34 2.2. Datasets and environmental clustering 35 2.3. Biogeographic regionalization 37 3. Results 38 3.1. Environmental clusters 38 3.2. Biogeographical sectors and subsectors of Egypt 39 4. Discussion 40 5. Conclusion 45 6. References 46 CHAPTER III- Using MaxEnt modeling to predict the potential distribution of 52 the endemic plant Rosa arabica Crep. in Egypt 1. Introduction 53 2. Materials and methods 54 2.1. Study area and target species 54 2.2. Data source and variables selection 56 2.3. -

A L G E R I a N Cultural Tour
ALGERIAN CULTURAL TOUR March 4th to March16th 2020 Plan a departure the 3rd March from the U.S. for an arrival the 4th 13 DAYS & 12 NIGHTS Private Mini-Bus – 19 places *1 Tour Guide + *1 Logistics Responsible Hotels 3*** to 5***** Meals according to program: 12 breakfasts & 10 diners (exclusion: la Gazelle d’Or) Allow an additional $150–200 for meals not included. 2200 USD/1950€ excluding flights tickets Travel itinerary Amel Tafsout Born in Algeria, Amel Tafsout (‘Hopes of Spring’ in Arabic) is one of the finest champions of North African traditional and contemporary Maghreb Dance and has mesmerized audiences worldwide. Raised among the finest traditional dancers and musicians in Algeria, Amel has dedicated her life not only to raising awareness about her dance culture but also to facilitating dialogue and building cultural bridges with regard to Arab-North African women. Fluent in five languages, Amel lectures, teaches, performs and conducts anthropological research. She is the founder of Banat As Sahra (Germany) and The Tafsoutettes (England) and has performed with a wide range of music orchestras from Latin Jazz to North African. Amel’s articles relating to dance, cultural traditions and women of the Maghreb have been published in academic and popular magazines. Inanna Iraqi Dance Festival in June 2018 in Estonia gave Amel an Award of acknowledgment and appreciation for her longstanding contributions in Arabic dance and its heritage. Riwaya Travel Travelers from all over the world have always dreamed to discover new regions, to integrate new cultures and to share their wonderful stories. For them, this is not just a hobby, it’s a life purpose. -

LIVESTOCK in RURAL PIEDMONT REGIONS of ALGERIA Introduction
Biotechnology in Animal Husbandry 35 (2), 199-208 , 2019 ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun UDC 636.03 https://doi.org/10.2298/BAH1902199B LIVESTOCK IN RURAL PIEDMONT REGIONS OF ALGERIA Bengouga Khalila, Lahmadi Salwa, Zeguerou Reguia, Maaoui Moufida, Halis Youcef Center of Scientific and Technical Research on arid regions CRSTRA, BP n° 1682 R.P 07000 Biskra- Algeria Corresponding Author: Bengouga Khalila, e-mail [email protected] Original scientific paper Abstract: A livestock survey conducted during 2013/2015 as part of a CRSTRA project in 4 villages situated at North east Biskra and south Batna in Algeria. These regions are located at elevation ranging around 250-831m asl, experiencing arid and semi-arid Mediterranean climate. Respondents of 86 families demonstrated that livestock is an integral part of the region’s mixed farming systems. Low livestock numbers per most households at present reflect the self- consumption breeding mode adapted in these regions. Currently, farmers focus on four main livestock types; goat, sheep, chicken and bee keeping in two regions, it is the case of Beni Souik and Branis , while Maafa includes beyond these types, turkey and pigeon whereas Ain Zaatout includes duck and swine beside the previous livestock types. In the same context; goat ranked first in the four regions, goat and sheep secondly then goat and poultry with goat combined to sheep and poultry in third place. Thus; most families use a combination of grazing, agriculture sub-products and industrial products for the nutrition of their livestock. Families keep livestock as source of milk, butter, wool or hair, leather and other products that are strongly used as nutritional, weaving supply or stocking covering resources for the family members or friends and in some cases for sell to seekers of animal products of indigenous territory origins. -

Aba Nombre Circonscriptions Électoralcs Et Composition En Communes De Siéges & Pourvoir
25ame ANNEE. — N° 44 Mercredi 29 octobre 1986 Ay\j SI AS gal ABAN bic SeMo, ObVel , - TUNIGIE ABONNEMENT ANNUEL ‘ALGERIE MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL Abonnements et publicité : Edition originale .. .. .. .. .. 100 D.A. 150 DA. Edition originale IMPRIMERIE OFFICIELLE et satraduction........ .. 200 D.A. 300 DA. 7 9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER (frais d'expédition | tg}, ; 65-18-15 a 17 — C.C.P. 3200-50 ALGER en sus) Edition originale, le numéro : 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars. — Numéros des années antérleures : suivant baréme. Les tables sont fourntes gratul »ment aux abonnés. Priére dé joindre les derniéres bandes . pour renouveliement et réclamation. Changement d'adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANGAISE) SOMMAIRE DECRETS des ceuvres sociales au ministére de fa protection sociale, p. 1230. Décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux siéges & pourvoir pour l’élection a l’Assemblée fonctions du directeur des constructions au populaire nationale, p. 1217. , ministére de la formation professionnelle et du travail, p. 1230. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général da la planification Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux et de. la gestion industrielle au ministére de fonctions du directeur de la sécurité sociale et lindustrie lourde,.p. -
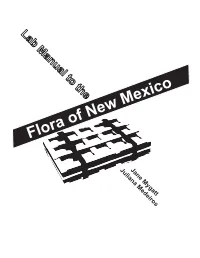
Flora-Lab-Manual.Pdf
LabLab MManualanual ttoo tthehe Jane Mygatt Juliana Medeiros Flora of New Mexico Lab Manual to the Flora of New Mexico Jane Mygatt Juliana Medeiros University of New Mexico Herbarium Museum of Southwestern Biology MSC03 2020 1 University of New Mexico Albuquerque, NM, USA 87131-0001 October 2009 Contents page Introduction VI Acknowledgments VI Seed Plant Phylogeny 1 Timeline for the Evolution of Seed Plants 2 Non-fl owering Seed Plants 3 Order Gnetales Ephedraceae 4 Order (ungrouped) The Conifers Cupressaceae 5 Pinaceae 8 Field Trips 13 Sandia Crest 14 Las Huertas Canyon 20 Sevilleta 24 West Mesa 30 Rio Grande Bosque 34 Flowering Seed Plants- The Monocots 40 Order Alistmatales Lemnaceae 41 Order Asparagales Iridaceae 42 Orchidaceae 43 Order Commelinales Commelinaceae 45 Order Liliales Liliaceae 46 Order Poales Cyperaceae 47 Juncaceae 49 Poaceae 50 Typhaceae 53 Flowering Seed Plants- The Eudicots 54 Order (ungrouped) Nymphaeaceae 55 Order Proteales Platanaceae 56 Order Ranunculales Berberidaceae 57 Papaveraceae 58 Ranunculaceae 59 III page Core Eudicots 61 Saxifragales Crassulaceae 62 Saxifragaceae 63 Rosids Order Zygophyllales Zygophyllaceae 64 Rosid I Order Cucurbitales Cucurbitaceae 65 Order Fabales Fabaceae 66 Order Fagales Betulaceae 69 Fagaceae 70 Juglandaceae 71 Order Malpighiales Euphorbiaceae 72 Linaceae 73 Salicaceae 74 Violaceae 75 Order Rosales Elaeagnaceae 76 Rosaceae 77 Ulmaceae 81 Rosid II Order Brassicales Brassicaceae 82 Capparaceae 84 Order Geraniales Geraniaceae 85 Order Malvales Malvaceae 86 Order Myrtales Onagraceae