Fontaine L'évêque
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
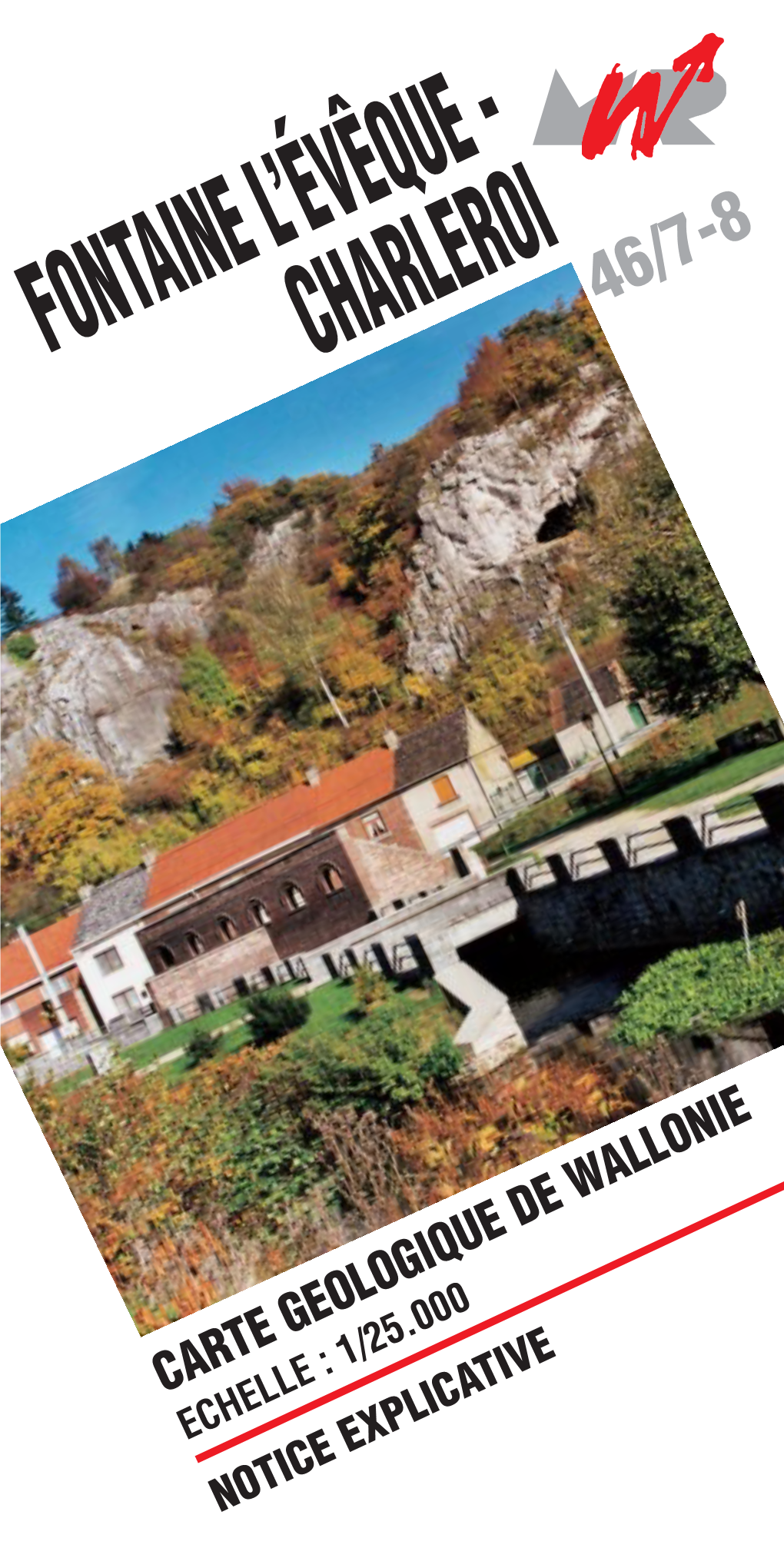
Load more
Recommended publications
-

Charleroi Métropole Un Schéma Stratégique 2015-2025
CETTE PUBLICATION A ÉTÉ RÉALISÉE PAR CHARLEROI BOUWMEESTER CHARLEROI MÉTROPOLE EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE CHARLEROI UN SCHÉMA STRATÉGIQUE UN SCHÉMA STRATÉGIQUE 2015-2025 Charleroi CHARLEROI MÉTROPOLE Bouwmeester UN SCHÉMA STRATÉGIQUE 2015-2025 INTRODUCTION 6 MUSÉE DES BEAUX-ARTS 188 SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ DE LOGEMENT LA SAMBRIENNE 192 FEDER 2014-2020 CHARLEROI DISTRICT CRÉATIF 196 CONTEXTE SPÉCIFIQUE 20 PÔLE DES GRD CONFÉRENCES ET EVENT 198 CHARLEROI MÉTROPOLE 22 PALAIS DES EXPOSITIONS 200 BASSIN DE VIE 24 PALAIS DES BEAUX-ARTS 206 ALAIS DES CONGRÈS 208 CAMPUS SCIENCES, ARTS ET MÉTIERS 210 OUTILS DU PROJET URBAIN 28 BPS22 212 PROJET DE TERRITOIRE 30 CITÉ DES MÉTIERS 220 CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 32 CENTRE UNIVERSITAIRE 222 PROJET 36 DESIGN INNOVATION 224 PLAN D’INTENSIFICATION URBAINE 38 LES ESPACES PUBLICS 230 PLAN D’INTENSIFICATION PAYSAGÈRE 40 INTENSIFICATION LINÉAIRE 44 ACTIVATION DE LA SAMBRE 45 DISTRICT NORD 240 RÉNOVATION DES CENTRES URBAINS 46 AÉROPORT ET EXTENSION 242 CRÉATION DE SYSTÈMES PAYSAGERS 47 PARC SCIENTIFIQUE DE L’AÉROPÔLE 244 NOUVEAUX QUARTIERS 48 PARCS D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES CHARLEROI-AIRPORT I ET CHARLEROI-AIRPORT II 246 ÉCHELLES DE DENSITÉ 49 CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE OPÉRATIONNEL VOO 248 CHARTES URBANISTIQUES 52 ORES 252 IDENTITÉ GRAPHIQUE DE CHARLEROI 56 CHARLEROI BIG FIVE 66 DISTRICT EST 254 CHARLEROI BOUWMEESTER 72 CAMPUS SANTÉ DES VIVIERS 256 RÉNOVATION DE LA PLACE CHANTRAINE À GILLY 264 ZACC ROUTE BASSE-SAMBRE 266 PROJETS PAR DISTRICTS 76 RÉFORME DES MAISONS CITOYENNES 78 DISTRICT SUD 270 DISTRICT -

Télécharger Le Livre CHARLEROI METROPOLE Éd.2018
CETTE PUBLICATION A ÉTÉ RÉALISÉE PAR CHARLEROI BOUWMEESTER CHARLEROI MÉTROPOLE EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE CHARLEROI UN SCHÉMA STRATÉGIQUE UN SCHÉMA STRATÉGIQUE Charleroi Bouwmeester CHARLEROI MÉTROPOLE UN SCHÉMA STRATÉGIQUE INTRODUCTION 6 Introduction de Paul Magnette 8 Introduction de Georgios Maïllis CARTE D'IDENTITÉ 12 L'aire métropolitaine 18 La ville 22 L'histoire PROJET DE VILLE 32 Le projet de territoire 48 La mobilité 54 Les chartes 58 L'image 66 La restructuration évènementielle 72 La culture LES DISTRICTS 84 Le District Centre 196 Le District Est 218 Le District Sud 234 Le District Ouest 258 Le District Nord ANNEXES 271 Le discours des 350 ans de la Ville 286 Le plan CATCH L’ŒUVRE "365 " PRODUITE DANS LE CADRE DE LA BIENNALE ASPHALTE ARTISTE : LAB[AU] PHOTOGRAPHE : LESLIE ARTAMONOW CHARLEROI MÉTROPOLE UN SCHÉMA STRATÉGIQUE C’est un bruissement qui commence à faire En terme de logements, la capacité à générer Well beyond the city limits, the news is In terms of housing, it is a priority to ensure écho, et qui s’étend bien au delà des frontières de l’habitat de qualité pour tous se pose en priori- starting to spread : something’s happening in that everyone has a quality place to live. Ambi- régionales. Quelque chose se passe à Charleroi. té. L’objectif est ambitieux : 400 logements par an Charleroi. tious goals have been set : 400 accommodations Au cours de l’année 2017, nous avons franchi pendant les 30 prochaines années. Un challenge In 2017, a significant milestone was achie- per year, over the next 30 years. -
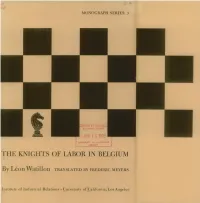
JUN. 15 1959 UNIVERSITY of Va.AFO:RNIA Rkke.1-Y
MONOGRAPH SERIES: 3 NcTITlTtE OF I N D1.A.IA RT-ON5' tUVLs.RY JUN. 15 1959 UNIVERSITY Of vA.AFO:RNIA rkKE.1-Y THE KNIGHTS OF LABOR IN BELGIUM By Leon Watillon TRANSLATED BY FREDERIC MEYERS Institute of Industrial Relations . University oftCalifornia, Los Angeles" THE KNIGHTS OF LABOR IN BELGIUM IQ. 4. it lb. THE KNIGHTS OF LABOR IN BELGIUM) By Leon Watillon. Translated and with an introduction by Frederic Meyers, INSTITUTE OF INDUSTRIAL RELATIONS 1 UNIVERSITY OF LCALIFORNIA - LOS ANGELES r- COPYRIGHT, 1959, BY THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Industrial Relations Monographs of the Institute of Industrial Relations No. i. Due Process on the Railroads: Revised Edition, by Joseph Lazar No. 2. Right-to-Work Laws: A Study in Conflict, by Paul Sultan No. 3. The Knights of Labor in Belgium, by Leon Watillon. Translated and with an introduction by Frederic Meyers Copies of this publication may be purchased for $1.50 each from the INSTITUTE OF INDUSTRIAL RELATIONS ioo Business Administration-Economics Building University of California Los Angeles 24, California Foreword The Institute of Industrial Relations is pleased to offer, as the third in its monograph series, The Knights of Labor in Belgium, by Leon Watillon, which has been translated by Professor Frederic Meyers. This series is intended to include studies of medium length and will receive a distinctive cover treatment to set them apart from the Institute's other publications. The Knights of Labor in Belgium sheds light on a little-known episode in the history of the American labor organization. Ameri- can labor historians, if we are to judge by their writings, have been unaware of the interesting and important activities of the Order in Belgium. -

Osons Ensemble !
N° 22 FÉVRIER 2016 JOURNAL INTERNE D’IGRETEC Une année 2015 riche en réalisations et en projets futurs : OSONS ENSEMBLE ! Left Side Business Park Présentation du Contrôle Moteurs Tête à tête avec notre Président DANS CE NUMÉRO… 3 Composition du Conseil d’Administration FÉVRIER 2016 4 Tête à tête avec Philippe Van Cauwenberghe, Président d’IGRETEC 5 IGRETEC a 70 ans ! 6 SOLEO, phase 2 terminée ! 7 60 mois de « In House » : coup d’œil dans le rétro !!! 8 Présentation d’un métier : Contrôle Moteurs 10 Iso 9001: et de 5 : objectif atteint ! 10 Le passage à l’impôt des sociétés : une révolution pour les intercommunales 11 Réduction de dépenses énergétiques pour nos communes 12 Un nouveau virage pour la communication au sein d’IGRETEC 13 Station d’épuration d’Ham-sur-Heure 14 Sécurité et aménagement réalisés sur certains sites d’exploitation Osons ensemble 15 Évolution du Service Exploitation des ouvrages d’assainissement « Les erreurs sont les portes de la découverte. » James Joyce 16 GMAO : kesako ? À l’approche des 70 ans d’IGRETEC, il est bon de se rappeler la contribution de 16 Réhabilitation du pertuis de Soleilmont notre intercommunale notamment dans les domaines de l’énergie, de l’eau et 17 Left Side Business Park du développement économique de notre région. 18 Les 12 travaux du bureau d’études Petit rappel toujours utile à l’heure où certains rêvent encore de sacrifi er le modèle immobilières intercommunal sous prétexte de concurrence déloyale avec le secteur privé. 20 Plans d’investissements communaux Dans ce contexte, nous continuerons plus que jamais à mettre au service de 20 Parc de Monceau nos associés et de notre région le savoir-faire de 300 collaborateurs aux com- 21 Le projet global Phenix du programme pétences multiples. -

Warg01 0001 Ra20 Uk
IDENTIFICATION Name Warehouses Estates Belgium (WEB for short) Legal form Partnership limited by shares (SCA for short) Statut Public Regulated Property Company (SIRP of SIR for short) Registered office 29 avenue Jean Mermoz, B-6041 Gosselies (Belgium) Phone +32 71 259 259 Fax +32 71 352 127 E-mail [email protected] Website www.w-e-b.be Entreprise number BE0426.715.074 LEI 549300JTAJHL7MXIM284 Date of incorporation1 04 January 1985 under the name « Temec » Date of admission to Euronext 01 October 1998 Date of approvalas SIR 13 January 2015 Duration Unlimited Share capital €10.000.000 Number of actions 3,166,337 ISIN code BE0003734481 Cotation Euronext Brussels Effective Managers Mr Laurent WAGNER, CEO Ms Caroline WAGNER, CAO Mr Antoine TAGLIAVINI, CFO Mr Laurent VENSENSIUS, CTO Manager W.E.B. Property Services Plc (WEPS Plc for short) Closing date 31 December Property Expert CBRE represented by Mr Pieter PAEPEN2 Auditor PwC represented by Mr Damien WALGRAVE3 Types of properties Commercial, logistics buildings and offices Fair value €297 412 5284 Déclaration Mr Claude DESSEILLE, as Chairman of the Board of Directors, Ms Valérie WAGNER, asDirector and ex-Chairwoman of the Board of Directors, Ms Caroline WAGNER and Mr Laurent WAGNER, as Executive Directors and Effective Managers, Messrs Daniel WEEKERS, Jean-Jacques CLOQUET and Jacques PETERS, as Independent Directors as well as Messrs Antoine TAGLIAVINI (CFO) and Laurent VENSENSIUS (CTO), as Effective Managers of Warehouses Estates Belgium SCA (hereinafter “WEB SCA”) having its registered office -

Liste Des S.A.I
EXTRAIT DU CATALOGUE LISTE DES INSTITUTIONS AGREES ET SUBSIDIEES ARRETEE AU 17/09/2021 Dénomination - Adresse Sexe - Age Capacité Handicaps Subventionnée/Agréée (C) / CS Adultes BRABANT WALLON MAH427 L' ENTRE-TEMPS H -F 6 - 20 10 10 Mme KADJO MARIE-ROSE 0 Rue de la Station,42 1332 GENVAL Tel: 02/346 77 30 Fax: 02/344 16 67 MAH424 LE CHEMIN (IMP PROV BRAB) H -F 6 - 20 14 14 Mr LECLERCQ Grégory 0 Rue Demulder, 10b 1400 NIVELLES Tel: 067/493 400 MAH404 LE CERF VOLANT H -F 6 - 20 4 4 Mme VAN LANDSCHOOT Dominique 0 Rue du Soleil Levant, 5 1420 BRAINE-L'ALLEUD Tel: 02/384.44.80 Fax: 02/387.05.35 17/09/2021 1 Dénomination - Adresse Sexe - Age Capacité Handicaps Subventionnée/Agréée (C) / CS Adultes HAINAUT MAH430 LE FIL DE SOI H -F 6 - 20 45 45 Mme POUPE Julie 0 rue de la Régence 6-8 6000 CHARLEROI Tel: 071/205 630 MAH442 SAI MOSAÏQUE - RENE THONE H -F 6 - 20 57 57 MARCINELLE 0 Mme DARIO Dominique rue E.Tumelaire, 96-98 6000 CHARLEROI Tel: 071/276 760 MAH441 DIALOGUE- René THONE H -F 6 - 20 46 46 Mme GERMEAU Gwendoline 0 Rue de Beaumont, 266 6030 MARCHIENNE-AU-PONT Tel: 071 29 19 29 MAH443 SAI ECOLE CLINIQUE - TOUT EN H -F 6 - 20 32 32 COULEURS 0 Mme CORNET Dagmar rue de la Paix 102 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Tel: 071/41 13 18 MAH355 ITINERAIRES H -F 6 - 20 23 23 Mr BRUYNDONCKX Christophe 0 Rue de Lodelinsart, 97 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Tel: 071/42 28 20 MAH369 L'ETRIER H -F 6 - 20 26 26 Mme VERDONCK Fabienne 0 Chaussée de Trelon 1A 6460 CHIMAY Tel: 060/21 54 24 Fax: 060/21 54 28 17/09/2021 2 Dénomination - Adresse Sexe - Age Capacité Handicaps -

Des Nouvelles Infrastructures D'accueil
N° 20 JUIN 2013 JOURNAL INTERNE D’IGRETEC DES NOUVELLES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL L’intercommunale développe et rénove constamment les infrastructures destinées aux entreprises. « IN HOUSE » Les trois écoles et « Sainte-Philomène » Nouveauté, la cellule « études énergétiques » JUIN 2013 DANS CE NUMÉRO… 3 IGRETEC DOPE LE MORAL DES MANAGERS ! EXPO PHOTOS : « ÉCLATS DE VIE EN BORDS DE SAMBRE » MIDIS DU MANAGEMENT : UNE MÉDAILLE D’ARGENT ! 4 UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE POUR LE SITE DE L’ABBAYE D’AULNE Faire d’IGRETEC un champion de la prévention ! JT DE L’ANIMATION ÉCONOMIQUE- TOURISME : UN PROJET En Belgique, chaque semaine, 2 personnes décèdent des suites d’un accident DES RÉSEAUX LOCAUX ! de travail. En mars dernier, lors d’une banale tournée d’inspection des ou- 5 UNE PREMIÈRE NATIONALE vrages d’épuration, un de nos collègues a failli perdre la vie. Pas de séquelles À L’AÉROPOLE ! physiques mais une grosse frayeur… et un éveil des consciences. Non, nous IGRETEC SOUTIENT LE NOUVEAU ne sommes pas à l’abri d’un accident grave. Plus globalement, tout lieu de tra- CLUB D’ENTREPRISES DE JUMET ! vail peut être le théâtre d’accidents, y compris dans les bureaux où le risque CHALLENGE ELA : TOUS ENSEMBLE apparaît comme plus anodin, il est bel et bien présent : un tiroir resté ouvert, POUR LUTTER CONTRE LA MALADIE ! un escalier glissant, des fardes en équilibre instable… Alors, oui, une remise 6 UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE en question de notre manière d’appréhender la sécurité au sein de l’intercom- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE munale est nécessaire. DE NOTRE RÉGION L’ECOPOLE EN CHANTIER Les accidents de travail ne sont pas une fatalité : ils peuvent être évités si les SMART PARK : CONSOMMER mesures adéquates sont prises à temps. -

Immo Development V�3.0
IMMO DEVELOPMENT V3.0 FOCUS 5e ÉLÉMENT AUX PARCS SOLAIRE EIXAMPLE XII IDENTITY CARD LA SAMBRIENNE EST UNE SOCIÉTÉ DE LOGEMENTS DE SERVICE PUBLIC (SLSP) AGRÉÉE PAR LA SOCIÉTÉ WALLONNE DU LOGEMENT (SWL) ET NÉE EN JUIN 2013 DE LA FUSION DES CINQ SLSP DE CHARLEROI. Avec un patrimoine qui approche les 10.000 logements Ses principales missions immobilières sont : et dépasse les 2.000 garages, elle représente 10 % des • Superviser la conception et la réalisation de logements publics wallon et 10 % des logements des nouveaux projets immobiliers communes sur lesquelles elle est implantée : Charleroi • Pérenniser les constructions existantes par la et Gerpinnes. mise en place de programmes d’entretien La Sambrienne est un acteur de terrain incontournable • Développer la standardisation de nouveaux de la politique communale du logement. concepts constructifs Elle occupe près de 200 personnes au service de ses locataires et candidats-locataires. CHIFFRES CLÉS 523 MILLIONS€ 38,5 MILLIONS€ TOTAL DU BILAN 9.717 CHIFFRE D’AFFAIRE LOGEMENTS 9 CHANTIERS / 126 MILLIONS€ 2.708 11,1 MILLIONS€ RÉNOVATION 2017 > 2024 GARAGES RÉCEPTIONNÉS 28 MILLIONS€ 160 MILLIONS€ 87% INVESTISSEMENT EN 2015 POTENTIEL CONSTRUCTION TAUX OCCUPATION 4 CHANTIERS / 60 HA 815 MILLIONS€ 139 LOGEMENTS RÉSERVE FONCIÈRE VALEUR ESTIMÉE PATRIMOINE RÉCEPTIONNÉS CONTACT Direction Immobilière Allée des Saules 4 - 6031 Charleroi Tél. : 071 / 272 051 Photo couverture : © BOB 361 2 IMMO DEVELOPMENT V3.0 Vous trouverez au fi l de ces quelques pages une mise en évidence de nos projets majeurs. Le montage d’un projet immobilier représente par nature un investissement conséquent en terme de temps et de fi nancement. -

Charleroi – Belgium - « Porte Ouest » C O M P E T I T I O N B R I E F
Europan 15 Charleroi – Belgium - « Porte Ouest » C o m p e t i t i o n b r i e f _____________________________________________________________________________________________ 1 Europan 15 Competition brief Charleroi- Belgium Productive cities Contents Charleroi – « Porte Ouest » of the city Bibliography p 3 Sites issues p 4 Site particularities regarding the organization of the competition p 7 Territorial context Historical context p 8 Geographical et territorial context p 9 The Municipal Mobility Plan p 10 Landscape context p 11 City projects p 12 Cultural context p 15 Strategic site Definition of the strategic site’s perimeter p 16 Le West District p 17 Project site Definition of the project site’s perimeter p 18 Regulatory context p 21 Master plan p 21 Landscape issues p 22 Soft Mobility p 22 The « invariables” and “variables” of the lanscape p 24 « Carsid »map equipment p 26 Economic data Correlation with the Europan topic 15 « Productive cities » p 28 Socio-cultural data Context and social interaction of the project p 28 _____________________________________________________________________________________________ 2 Europan 15 Competition brief Charleroi- Belgium Productive cities Bibliography “Charleroi Métropole - Un schéma stratégique” (a strategic outline). Written by the Charleroi Bouwmeester (chief architect) in partnership with the City of Charleroi January 2018. The references to this work are annotated in “1” in the briefing document. “Charleroi Métropole - Un schéma stratégique 2015 -2025” (a strategic outline for 2015 – 2025). Written under the supervision of M. G. Maillis, Charleroi Bouwmeester (chief architect). The references to this work are annotated in “2” in the briefing document. « Charleroi - Patrimoine & développement »(heritage &development) Study of the potential of the industrial heritage of the West Gate March 2015 The references to this work are annotated in “3” in the briefing document. -

Schéma De Structure Communal : Ville De Charleroi
Schéma de structure communal résumé non technique Ville de Charleroi architecture recherche urbanisme Équipe L’équipe du Schéma de Structure communal de la Ville de Charleroi se compose des personnes suivantes : Pour le bureau COOPARCH-RU Pascal Simoens, architecte et urbaniste, administrateur-délégué, codirection de l’étude. Mati Paryski, ingénieur architecte, administratrice et directrice du département urbanisme, codirection de l’étude ; Christian Frisque, architecte et urbaniste, codirection de l’étude (rapport d’options) et consultant sénior ; Frans Uyttebrouck, urbaniste, (direction d’étude pour la synthèse, le diagnostic, la base des options) Cédric Bazet-Simoni, urbaniste, (direction d’étude pour le rapport d’inventaire) ; Guillaume Servonnat, géographe urbaniste, assistant d’étude, direction et coordination de la cartographie (rapport d’inventaire) ; Paul-Hervé Lavessière, géographe urbaniste, assistant d’étude (diagnostic synthétique, rapport d’options, cartographie) Johan Totain, urbaniste, assistant d’étude (cartographie) Alexandra Bory, architecte et urbaniste, assistante d’étude (rapport d’inventaire) ; Amandine Billon, urbaniste, assistante d’étude ; Consultants externes : Jean-François Husson, bureau CIFOP pour les fi nances communales ; Anne-Marie Sauvat, du bureau EOLE pour les aspects paysages ; Laurent Rousseau, du bureau EGIS pour les aspects mobilité ; Bruno Sinn, du bureau SPIRE, pour les aspects programmation urbaine ; Le bureau MWP pour les aspects communication ; M. Castiaux pour les aspects juridiques (futur -

Andreas Tschersich Charleroi, 20/11/2005
08 09 20 An dreas Tschersich ----------------------------------------------------- 12 10 37 06 07, 34, 48 27 13 32 Charleroi, 20/11/2005 60 -------------------------------------------------------------- 23 17 21 25 24 36 02 52 40 35 43 04 11 46 26 30 01 58 14 56 28 19 05 18 47 38 31 53 59 49 33 51 29 50 42 22 03 44 57 54 15 55 41 16 39 45 01 Route Latérale, 02 Place Albert 1er, Dampremy, 03 Place des Tramways, 04 Rue Général de Gaulle/Rue Paul Barré, 05 Rue Latérale, 06 Rue de la Cha- Charleroi ist nicht eine Stadt wie jede andere. Es ist eine Charleroi eine der hochindustrialisiertesten Europas. Der pelle, 07 Metrostation Dampremy, 08 Rue Jean Jaurés/Rue Léopold Gendarme, 09 Rue Paul Pastur/Rue Callewaert, 10 Ruelle Sainte-Barbe, 11 Friedhof, industrialisierte Gegend, eine von Hunderttausenden von Kohleabbau, die Hochöfen und Fabrikschlote verfärbten Dampremy, 12 Rue Pirenne/Rue Jean Jaurès, 13 Rue Paul Janson, 14 Quai de l‘Industrie, 15 Rue de Chatelet/Rue Yvonne Vieslet, 16 Place Albert 1er, 17 Rue Arbeitern und Hunderten von Patrons bearbeitete Land- das Pays de Charleroi zum Pays noir, zum Schwarzen Land. Baudy/Rue Paul Barré, 18 Charleroi-Brüssel-Kanal, 19 Route de Mons, 20 Rue Paul Pastur/Rue Callewaert, 21 Rue Paul Barré/Rue Paul Janson, 22 Quai de Sambre, 23 Rue Paul Janson/Ruelle Sainte-Barbe, 24 Place Albert 1er, Dampremy, 25 Metrostation Dampremy, 26 Rue Général de Gaulle, 27 Rue Paul schaft – in Westeuropa vergleichbar einzig mit der Städte- Noch heute zeugen 139 im Revier verstreute hohe Schutt- Janson, 28 Route de Mons, 29 Place de la Digue, 30 Rue Général de Gaulle/Rue Joseph Wauters, 31 Sambre, 32 Rue Paul Janson/Metrostation Dampremy, landschaft des Ruhrpotts. -

CHARLEROI IC 05-07-27 Tilly S61S1 S61 OTTIGNIES - CHARLEROI-ZUID - NAMEN - JAMBES
Antwerpen Brussel S61 Brussel Nijvel 73 74 Villers- Ottignies 74 Perwin 73 60 60 Seneffe Obaix-Buzet Buzet Rèves 73 64 64 64 365a 74 73 60 Villers-la-Ville S-treinen Frasnes-lez-Gosselies Liberchies Mellet CHARLEROI IC 05-07-27 Tilly S61S1 S61 OTTIGNIES - CHARLEROI-ZUID - NAMEN - JAMBES 65 65 Ligny Thiméon 60-365a WEEKDIENST 74 65 Viesville Faubourg M3 S62 S62 LUTTRE - LA LOUVIÈRE-ZUID - CHARLEROI-ZUID 09/2018 Godarville Gouy- de Bruxelles 17 67 73 710 lez-Piéton 64 64 S62 S62 50 Fleurus 51 Bruyerre Aéropole S63 ERQUELINNES - CHARLEROI-ZUID 50 51 62-68 S63 41 Manage 61-63 S62 Luttre 86 Rue du A S64 COUVIN - CHARLEROI-ZUID Chemin de Fer S64 86 60-365aM3 Pont-à-Celles Calvaire Jumet- Léopold M3 Brulotte 67 Courcelles-Motte Carrosse BSCA S61 IC 01-03 IC-TREINEN 85 85 50 Emailleries 61 51 17 City Nord 710 63 Jumet- Chaussée S62 Madeleine Ransart IC 05-07-27 11 28 de Fleurus 67 A 41 60 62-68 11 68 62 43 83 61 62 67 28 63 64 11 Metro Roux 65 67 28 68 365a Dépôt TEC Chapelle-lez-Herlaimont 61 82 43-83 Rue 18 61 82 Berteau Lodelinsart M1S1 M1 ANDERLUES - CHARLEROI 91 S61 Trazegnies Chaussée de Gilly 18 63 M2 ANDERLUES - CHARLEROI La Louvière-Centrum 82 Jumet Gohyssart 11 M2 Puissant 710 82 51 41 Saint-Antoine 710 M3 GOSSELIES - CHARLEROI 85-86 M3 91 63 Marie Curie S61 710 82 M4 M4 GILLY SOLEILMONT - CHARLEROI Souvret 43-83 Deschassis A 17 710 173 68 Morlanwelz Piéton La Planche 28 Forchies 50 Carnières 173 M4 Sacré 18 41 154 710 S62 S62 Soleilmont Bergen IC 19-25 IC 19-25 IC 19-25 Madame Piges Beaux-Arts 50 158 Waterloo Doornik 14 Bus Dépôt TEC