La Réforme Ferroviaire
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
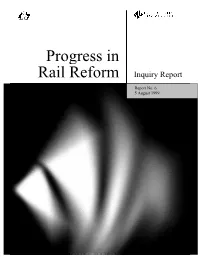
Progress in Rail Reform Inquiry Report
Progress in Rail Reform Inquiry Report Report No. 6 5 August 1999 Commonwealth of Australia 1999 ISBN 0 646 33597 9 This work is subject to copyright. Apart from any use as permitted under the Copyright Act 1968, the work may be reproduced in whole or in part for study or training purposes, subject to the inclusion of an acknowledgment of the source. Reproduction for commercial use or sale requires prior written permission from AusInfo. Requests and inquiries concerning reproduction and rights should be addressed to the Manager, Legislative Services, AusInfo, GPO Box 1920, Canberra, ACT, 2601. Publications Inquiries: Media and Publications Productivity Commission Locked Bag 2 Collins Street East Melbourne VIC 8003 Tel: (03) 9653 2244 Fax: (03) 9653 2303 Email: [email protected] General Inquiries: Tel: (03) 9653 2100 or (02) 6240 3200 An appropriate citation for this paper is: Productivity Commission 1999, Progress in Rail Reform, Inquiry report no. 6, AusInfo, Canberra. The Productivity Commission The Productivity Commission, an independent Commonwealth agency, is the Government’s principal review and advisory body on microeconomic policy and regulation. It conducts public inquiries and research into a broad range of economic and social issues affecting the welfare of Australians. The Commission’s independence is underpinned by an Act of Parliament. Its processes and outputs are open to public scrutiny and are driven by concern for the wellbeing of the community as a whole. Information on the Productivity Commission, its publications and its current work program can be found on the World Wide Web at www.pc.gov.au or by contacting Media and Publications on (03) 9653 2244. -

Victrack Access Arrangement May 2012
Level 2, 35 Spring St Melbourne 3000, Australia Telephone +61 3 9651 0222 +61 1300 664 969 Facsimile +61 3 9651 3688 VICTRACK ACCESS ARRANGEMENT DRAFT DECISION MAY 2012 An appropriate citation for this paper is: Essential Services Commission, VicTrack Access Arrangement, Draft Decision, May 2012. © Essential Services Commission. This publication is copyright. No part may be reproduced by any process except in accordance with the provisions of the Copyright Act 1968 and the permission of the Essential Services Commission. CHAIRPERSON’S INTRODUCTION The Rail Management Act 1996 (RMA) sets out a rail access regime that applies to providers of declared rail infrastructure. The RMA prescribes that the Commission is responsible for administering the rail access regime. VicTrack is the operator and access provider for declared rail track and sidings predominantly within the Dynon precinct. Under the RMA, VicTrack must at all times have an approved access arrangement in place. Access arrangements encourage competition and efficiency in the rail freight industry by allowing access seekers (i.e. freight operators) to negotiate access to certain declared infrastructure provided by access providers (i.e. VicTrack) in order to enable them to compete in markets where competition is dependent on such access. The access arrangement is mainly used by freight operators to access VicTrack’s declared rail tracks and sidings within three designated precincts so that freight operators can store their wagons, repair their locomotives and load and unload freight on and from trains. On 5 March 2012, the Commission received an application from VicTrack to renew its access arrangement. On 9 March 2012, the Commission published a notice regarding VicTrack’s application and undertook a stakeholder consultation process whereby key stakeholders and the public were invited to make a submission regarding the application. -

Telecommunications Installation Telecommunications
PUBLIC Telecommunications Installation Telecommunications Document information HPCM Ref: D/17/15285 Approval Date: 17/08/2018 Review Date: 17/08/2019 Security class: Public PUBLIC Document review and approval record Date Change/review Date of Version Author or reviewer Approver authorised details review/update and accepted Senior Fibre Network 1.4-2.7 Early versions Architect, Technology and June 02-26 July 11 Strategic Planning Workflow process Previous version, consultant/Technical Writer, 3.0 3 Aug11 superseded by 3C Technology and Strategic Planning Workflow process Changes requested by consultant/Technical Writer, 19 March-10 April 3A-3C the stakeholders Technology and Strategic 12 Planning Workflow process consultant/Technical Writer, 3D APPROVED VERSION 16 April 12 Technology and Strategic Planning Workflow process consultant/Technical Writer, 3E APPROVED VERSION 18 April 12 Technology and Strategic Planning Network Architect, 3F APPROVED VERSION Technology and Strategic 10 August 12 Planning RRL Alliance Interface 3G R1.0 Draft Rewrite 6th August 2013 Manager Added clearance of CSR to boundary fencing and a better definition of moisture barrier copper RRL Alliance Interface 3G R1.1 Nov. 2014 cabling, spoil placement, Manager marker post and pit data spreadsheet template, pit types, etc., etc. Note- Previous document TS-SP 013 Installation & NEW DOCUMENT Maintenance has been split CREATED to TS-SP 013 Installation & TS-SP 351 Maintenance HPE CM No: D/17/15285 Review Date: 17/08/2019 Doc No: TS-SP 013 v6 Approval Date: 17/08/2018 Doc Title: Telecommunications Installation Page 2 of 85 PUBLIC PUBLIC Date Change/review Date of Version Author or reviewer Approver authorised details review/update and accepted Split TS-SP 013 into 2 docs – TS-SP 013 Installation & TS-SP 351 Maintenance Re-formatted document to 4.0 new template (for new Andrew Elam 12/10/2015 version) Updated document content Document updated with 5.0 new VicTrack brand. -

RAILWAY REFORM 2027En.Fm Page 1 Wednesday, June 21, 2000 10:30 AM
rail gb ok prepa 26/12/00 17:34 Page 1 RAILWAY REFORM EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS TRANSPORT 2027en.fm Page 1 Wednesday, June 21, 2000 10:30 AM © OECD, 2001. © Software: 1987-1996, Acrobat is a trademark of ADOBE. All rights reserved. OECD grants you the right to use one copy of this Program for your personal use only. Unauthorised reproduction, lending, hiring, transmission or distribution of any data or software is prohibited. You must treat the Program and associated materials and any elements thereof like any other copyrighted material. All requests should be made to: Head of Publications Division Public Affairs and Communication Directorate 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France. RAILWAY REFORM Regulation of Freight Transport Markets EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT (ECMT) The European Conference of Ministers of Transport (ECMT) is an inter-governmental organisation established by a Protocol signed in Brussels on 17 October 1953. It is a forum in which Ministers responsible for transport, and more specifically the inland transport sector, can co-operate on policy. Within this forum, Ministers can openly discuss current problems and agree upon joint approaches aimed at improving the utilisation and at ensuring the rational development of European transport systems of international importance. At present, the ECMT’s role primarily consists of: – helping to create an integrated transport system throughout the enlarged Europe that is economically and technically efficient, meets the highest possible safety and environmental standards and takes full account of the social dimension; – helping also to build a bridge between the European Union and the rest of the continent at a political level. -

3Urjuhvv Lq 5Dlo 5Hirup
3URJUHVVLQ 6XSSOHPHQWWR 5DLO5HIRUP ,QTXLU\5HSRUW $Q$VVHVVPHQWRIWKH 3HUIRUPDQFHRI $XVWUDOLDQ5DLOZD\V WR 1RYHPEHU Commonwealth of Australia 1999 ISBN 1 74037 090 2 This work is subject to copyright. Apart from any use as permitted under the Copyright Act 1968, the work may be reproduced in whole or in part for study or training purposes, subject to the inclusion of an acknowledgment of the source. Reproduction for commercial use or sale requires prior written permission from AusInfo. Requests and inquiries concerning reproduction and rights should be addressed to the Manager, Legislative Services, AusInfo, GPO Box 1920, Canberra, ACT, 2601. Publications Inquiries: Media and Publications Productivity Commission Locked Bag 2 Collins Street East Melbourne VIC 8003 Tel: (03) 9653 2244 Fax: (03) 9653 2303 Email: [email protected] General Inquiries: Tel: (03) 9653 2100 or (02) 6240 3200 An appropriate citation for this paper is: Productivity Commission 1999, An Assessment of the Performance of Australian Railways, 1990 to 1998, Supplement to Inquiry Report Progress in Rail Reform, AusInfo, Canberra, November. The Productivity Commission The Productivity Commission, an independent Commonwealth agency, is the Government’s principal review and advisory body on microeconomic policy and regulation. It conducts public inquiries and research into a broad range of economic and social issues affecting the welfare of Australians. The Commission’s independence is underpinned by an Act of Parliament. Its processes and outputs are open to public scrutiny and are driven by concern for the wellbeing of the community as a whole. Information on the Productivity Commission, its publications and its current work program can be found on the World Wide Web at www.pc.gov.au or by contacting Media and Publications on (03) 9653 2244. -
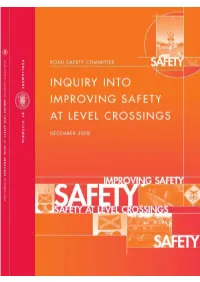
Inquiry Into Improving Safety at Level Crossings
Road Safety Committee Inquiry into Improving Safety at Level Crossings December 2008 Date of adoption 11 December 2008 Inquiry into Improving Safety at Level Crossings Report of the Road Safety Committee on the Inquiry into Improving Safety at Level Crossings ORDERED TO BE PRINTED Victorian Government Printer 2008 Parliamentary Paper No. 170 Session 2006-2009 Parliament of Victoria Road Safety Committee Subject Vehicle Safety ISBN – 978-0-9751534-6-8 Table of Contents Committee Members .................................................................................i The Road Safety Committee ...................................................................iii Terms of Reference ..................................................................................v Chair’s Foreword ....................................................................................vii Executive Summary .................................................................................xi Recommendations .................................................................................xiii Abbreviations and Definitions ..............................................................xix Chapter 1 - Introduction ...................................................................1 Background ...............................................................................................1 The Inquiry ................................................................................................2 Terms of Reference ....................................................................................2 -
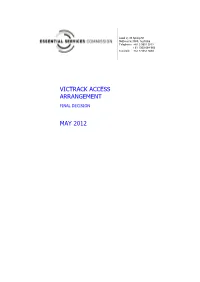
Victrack Access Arrangement May 2012
Level 2, 35 Spring St Melbourne 3000, Australia Telephone +61 3 9651 0222 +61 1300 664 969 Facsimile +61 3 9651 3688 VICTRACK ACCESS ARRANGEMENT FINAL DECISION MAY 2012 An appropriate citation for this paper is: Essential Services Commission, VicTrack Access Arrangement, Final Decision, May 2012. Essential Services Commission. This publication is copyright. No part may be reproduced by any process except in accordance with the provisions of the Copyright Act 1968 and the permission of the Essential Services Commission. CHAIRPERSON’S INTRODUCTION The Rail Management Act 1996 (RMA) sets out a rail access regime that applies to providers of declared rail infrastructure. The RMA prescribes that the Commission is responsible for administering the rail access regime. VicTrack is the operator and access provider for declared rail track and sidings predominantly within the Dynon precinct. Under the RMA, VicTrack must at all times have an approved access arrangement in place. Access arrangements encourage competition and efficiency in the rail freight industry by allowing access seekers (i.e. freight operators) to negotiate access to certain declared infrastructure provided by access providers (i.e. VicTrack) in order to enable them to compete in markets where competition is dependent on such access. The VicTrack access arrangement is mainly used by freight operators to access VicTrack’s declared rail tracks and sidings within two designated precincts so that freight operators can store their wagons, repair their locomotives and load and unload freight on and from trains. On 5 March 2012, the Commission received an application from VicTrack to renew its access arrangement. On 9 March 2012, the Commission published a notice regarding VicTrack’s application and undertook a stakeholder consultation process whereby submissions regarding the application were invited. -

Level Crossing Strategy Council, Yearly Report 2012/13
Transport for NSW Level Crossing Strategy Council, Yearly Report 2012/13 December 2013 Contents Glossary 3 1. Year in Review: 2012/13 4 1.1. Agency Level Crossing Activities 4 2. Level Crossings in New South Wales 6 2.1. Level Crossing Strategy Council 6 2.2. Level Crossing Communication Working Group 6 2.3. Level Crossing Improvement Program 7 2.4. New LCIP Funding Model 7 2.5. Level Crossing Closures 7 2.6. Level Crossing Incident Data 8 3. Level Crossing Improvement Program 2012/13 (LCIP) - Infrastructure Works 11 3.1. Major Works Completed 11 3.2. Development Work Undertaken 15 3.3. Minor Works 16 4. Level Crossing Improvement Program 2012/13 (LCIP) - Awareness and Enforcement Campaigns 17 4.1. Level Crossing Motorist Awareness Campaign 17 4.2. Level Crossing Awareness and Enforcement Campaigns 18 5. Level Crossing Improvement Program 2012/13 (LCIP) - ALCAM Development and Data Collection 20 5.1. National ALCAM Development 20 5.2. NSW ALCAM Data Collection 20 6. Level Crossing Improvement Program 2012/13 (LCIP) – New Technology 21 6.1. Trial of Low Cost Level Crossing Warning Devices 21 6.2. Development of the Level Crossing Finder 22 7. Level Crossing Improvement Program 2012/13 (LCIP) - Strategy and Policy Development 23 7.1. TfNSW Level Crossing Policies 23 7.2. RMS Level Crossing Guidelines 23 8. LCSC Agency Level Crossing Initiatives 25 8.1. RailCorp Level Crossing Initiatives 25 8.2. ARTC Level Crossing Initiatives 28 8.3. CRC Level Crossing Initiatives 28 9. Interface Agreements 30 10. Funding for Level Crossings in NSW 32 Appendix A: Total LCIP 2012/13 Expenditure 34 Appendix B: Expenditure on Level Crossing Upgrades in NSW Funded through the Level Crossing Improvement Program and by Rail and road Agencies 2007/08 – 2012/13 36 Front Cover “Don’t rush to the other side” campaign poster, Transport for New South Wales. -

Review of the Victorian Rail Access Regime Final Report Volume Ii: Detailed Analysis and Discussion of Issues
Level 2, 35 Spring St Melbourne 3000, Australia Telephone +61 3 9651 0222 +61 1300 664 969 Facsimile +61 3 9651 3688 REVIEW OF THE VICTORIAN RAIL ACCESS REGIME FINAL REPORT VOLUME II: DETAILED ANALYSIS AND DISCUSSION OF ISSUES FEBRUARY 2010 An appropriate citation for this paper is: Essential Services Commission 2010, Review of the Victorian Rail Access Regime Final Report: Volume II Analysis and Discussion of Issues , February. Essential Services Commission. This publication is copyright. No part may be reproduced by any process except in accordance with the provisions of the Copyright Act 1968 and the permission of the Essential Services Commission. STRUCTURE OF THE FINAL REPORT The Commission’s final report on its review of the Victorian rail access regime is set out in three volumes: • Volume I sets out the Commission’s findings and recommendations to the Minister for Finance. • This volume provides a comprehensive explanation of the Commission’s analysis and its findings on each part of the terms of reference. It elaborates on the reasoning behind its recommendations and discusses responses received from stakeholders and notes some of the wider issues raised. • The third volume comprises supplementary material set out as appendices to the report. The appendices provide background information and more technical analysis related to the review. Essential Services Commission Review of the Victorian Rail Structure of the Final Report 3 Victoria Access Regime ESSENTIAL SERVICES COMMISSION REVIEW OF THE VICTORIAN CHAIRPERSON’S 4 VICTORIA -
Melbourne to Bendigo and Echuca Railway 3
Engineers Australia Engineering Heritage Victoria Nomination for Recognition under the Engineering Heritage Australia Heritage Recognition Program for the Goldfields Railways - Melbourne, Bendigo & Echuca Railway May 2012 2 Cover Photograph Malmsbury Viaduct has been in continuous railway service for 150 years. It was completed in October 1860, two years before the opening of the Melbourne to Bendigo Railway in October 1862. The train is a V/Line class N diesel-electric locomotive hauling an N type carriage set on its way south to Melbourne. The white concrete structure in the lower right hand corner of the photograph is the aqueduct from Malmsbury Reservoir to Bendigo which passes under the viaduct beside the Coliban River. It should be noted that the viaduct now carries only a single Irish Broad Gauge (5’3”) track although it carried two tracks for most of its life. This image was taken from the Malmsbury Botanic Gardens, downstream from the viaduct, probably in 2007 or 2008. Heritage Recognition Program Goldfield Railways - Melbourne to Bendigo and Echuca Railway 3 TABLE OF CONTENTS PAGE 1 Introduction 5 2 Heritage Award Nomination Letter 7 3 Heritage Assessment 8 3.1 Basic Data 8 3.1.1 Item Name: 8 3.1.2 Other/Former Names: 8 3.1.3 Location: 8 3.1.4 Address: 9 3.1.5 Suburb/Nearest Town: 9 3.1.6 State: 9 3.1.7 Local Govt. Area: 9 3.1.8 Owner: 9 3.1.9 Current Use: 10 3.1.10 Former Use: 10 3.1.11 Designer: 10 3.1.12 Maker/Builder: 10 3.1.13 Year Started: 10 3.1.14 Year Completed: 10 3.1.15 Physical Description: 10 3.1.16 Physical Condition: -

Proposal December 1999 Contents
The Railway Heritage Centre of Victoria (Newport Workshops) Proposal December 1999 Contents Project Description Executive summary ................................................................................................................. 1 1. Preface .................................................................................................................................... 2 2. Background ........................................................................................................................... 3 3. The opportunity ................................................................................................................... 6 4. The benefits ........................................................................................................................ 12 5. The formal proposal (request) .................................................................................... 13 6. A suggested way ahead .................................................................................................. 14 7. Acknowledgements .......................................................................................................... 18 Illustrations Appendix A: Inspection of Buildings Appendix B: Project Plan – RHCV Establishment Appendix C: Proposed Tour Itineraries Project Description • Executive summary and preface • Background • Opportunity • Benefits • Proposal Centre of Victoria A proposal for the establishment of a Railway Heritage Centre at Newport Workshops Executive summary The redevelopment of -

Victrack Annual Report 2006 – 2007 Contents
VICTRACK ANNUAL REPORT 2006 – 2007 CONTENTS 2006-07 Highlights 2 Members of the Board and Board Committees 30 Report from the Chair 4 Executive Team and Organisation Structure 31 Report from the Chief Executive 6 Corporate Governance 32 Improving and Managing Victoria’s Rail Assets 8 Statutory Information 34 Driving Commmercial Services 12 Financial Performance 36 Delivering Innovative Property Solutions 14 Statutory Statement 37 Developing Victoria’s Rail Capacity 18 Independent Audit Report 38 Preserving Victoria’s Rich Rail Heritage 20 Victorian Rail Track Financial Report 40 Supporting Environmental Sustainability 24 Disclosure Index 72 Managing and Developing Our People 28 LETTER TO THE MINISTER 20 September 2007 The Hon Lynne Kosky MP Minister for Public Transport and the Arts Level 26, 80 Collins Street Melbourne Victoria 3000 Dear Minister, I have much pleasure in submitting the Annual Report for VicTrack for the period of 1 July 2006 to 30 June 2007 for your presentation to Parliament. Yours sincerely Elana Rubin Chair Cover image courtesy of Department of Infrastructure. Authorised and produced by VicTrack, GPO Box 1681, Melbourne, Vic, 3001 Printed by John Herrod & Associates, 46 Lexton Road, Box Hill, Vic, 3128 Designed by Blenheim Design Partners, www.blenheimdesign.com.au DELIVERING VALUE FOR VICTORIANS VicTrack is a commercially driven and socially responsible organisation that protects and adds value to Victoria’s public transport infrastructure and land. It manages around $50 million worth of projects each year on behalf of the Victorian community. Victorian Rail Track (VicTrack) was created on 1 April 1997 under The majority of these assets are leased to the Director of Public Section 8 of the Rail Corporations Act 1996.