Daniel Roth, Organiste Et Compositeur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

For Immediate Release
CONTACT: Kirsti Pugsley PHONE: 774-801-2021 EMAIL: [email protected] DANIEL ROTH, ONE OF THE LEADING FRENCH ORGAN VIRTUOSOS TO PERFORM ON THE E.M. SKINNER ORGAN AT THE CHURCH OF THE TRANSFIGURATION, ORLEANS, MA FOR IMMEDIATE RELEASE: ORLEANS – Widely acclaimed as one of the leading French organ virtuosos, Daniel Roth from Paris, will be performing a concert as guest organist at the Church of the Transfiguration, Rock Harbor, Orleans, on Thursday, March 30th. Mr. Roth has held numerous prestigious positions throughout his career including being appointed Titular Organist at St. Sulpice in Paris, where his predecessors were Charles-Marie Widor, Marcel Dupré and Jean-Jacques Grunenwald. He was also the Artist-in- Residence at the National Shrine of the Immaculate Conception in Washington, D.C., and has had an extensive teaching career. Mr. Roth is a graduate of the Paris Conservatory where he studied with Rolande Falcinelli and Maurice Duruflé. He has won several competitions, among them the Grand Prix de Chartres in 1971 for both interpretation and improvisation. Daniel Roth will perform on the “overwhelmingly breathtaking” E.M. Skinner Organ at the Church of the Transfiguration. This powerful instrument, restored by Nelson Barden of Boston, is comprised of seventeen different Twentieth Century E.M. Skinner organs, and is the only organ in the world with its particular surround- sound configuration. Consistent with the artwork in the Church, the rich variety of sounds and voices it can create give it the ability to “speak” a multitude of musical languages in prayer and praise to God. The concert will be held on Thursday, March 30th at 7:30pm at the Church of the Transfiguration, Rock Harbor, Orleans, MA. -

Daniel Roth Organist, Saint-Sulpice, Paris
Daniel Roth Organist, Saint-Sulpice, Paris friday, april 24, 2015 at 7:30pm olrbrooklyn.org/organ-recitals-in-new-york-city facebook.com/kilgen5163 jan pieterszoon sweelinck (1562-1621) Chromatic Fantasia johann sebastian bach (1685-1750) Aria Seht, was die Liebe tut (Transcription: J. E. Berthier) from Cantata Ich bin ein guter Hirt, BWV 85 (I am the Good Shepherd) See, what His love hath wrought! My Jesus holds with kindly care His Flock securely in his keeping And on the cross’s branch hath poured out For them his precious blood. césar franck (1822-1890) Allegretto from Symphony in D (Transcription: Daniel Roth) felix mendelssohn-bartholdy (1809-1847) Overture from Paulus (Transcription: W. T. Best) daniel roth (b. 1942) Improvisation intermission daniel roth From Livre d ’orgue pour le Magnificat IV Et misericordia X Gloria louis vierne (1870-1937) Pièces de fantaisie, Op. 51, no. 2 Andantino Symphonie no. 2, Op. 20 Scherzo Symphonie no 4, Op. 32 Romance Final In Memoriam Odile Roth June 9, 1939 - March 9, 2015 daniel roth Daniel Roth is widely acclaimed as one of the leading French organ virtuosos. Renowned for his brilliant interpretations of organ literature and for his thrilling improvisations which are regularly included in his concert programs, Daniel Roth has concertized extensively throughout Europe, Great Britain, The United States, Scandinavia, Japan and Korea. A former student at the Paris Conservatory, his teachers include Marie-Claire Alain and Maurice Duruflé. He is the winner of several competitions, among them the Grand Prix de Chartres in 1971 for both interpretation and improvisation. -

Église Saint-Sulpice, Paris Samedi 16 Novembre 2019
« Il faut bien se rendre compte que la musique peut avoir un pouvoir immense : Église Saint-Sulpice, Paris elle peut nous émouvoir au plus profond de nous-mêmes, nous procurer de grandes Samedi 16 novembre 2019, 20h joies, nous arracher à des situations très dramatiques, nous réconforter… Ainsi, l’interprète a une grande Concert-présentation responsabilité vis-à-vis de ses contemporains. Les mélomanes attendent de lui qu’il leur fasse partager Daniel Roth, Grand chœur l’enthousiasme pour une œuvre en leur Entretiens avec faisant découvrir ses grandes richesses. Il a aussi la mission d’amener à la musique Pierre-François Dub-Attenti & Christophe Zerbini des personnes qui de prime abord n’y sont pas sensibles. Cela ne peut se faire qu’en s’investissant totalement. Cette foi dans la musique est un bien considérable qu’il s’agit de cultiver, d’entretenir et de préserver quelles Éditions Hortus que soient les circonstances. Comme le disait Widor : « Faites sentir votre personnalité, votre émotion, donnez de votre cœur, on vous écoutera » ! Le plus grand ennemi de l’interprète, c’est la routine ! Il ne faut pas hésiter à changer des éléments importants de la technique de jeu en fonction des recherches musicologiques. Mais il est vrai que cela dépend du tempérament de l’interprète. Certains ont la souplesse de faire ces modifications, alors que d’autres par idéologie, restent fidèles à un Maître ou à une École. On ne passe jamais assez de temps à la recherche de tous les détails que comprend une œuvre musicale, ceux indiqués par le compositeur et ceux qui sont sous-entendus. -

Saint-Sulpice Church, Paris French Horn and Organ Concert
AROSS: Association for the standing of Saint- Sulpice Cavaillé-Coll organs Saint-Sulpice Church, Paris The Church of St. Sulpice houses two exceptional instruments th constructed by the acclaimed organ builder Aristide Cavaillé-Coll (1811- Sunday 26 , May 2019 1899). With thoroughly preserved tonal and aesthetic designs, the choir organ (1858) and main organ (1862) are irreplaceable, serve as testimonies to the builder's art, and represent hallmarks of the organ French horn and organ world. Charged with the public promotion of these instruments, the concert “Association pour le rayonnement des orgues Aristide Cavaillé-Coll de l’église Saint-Sulpice, à Paris” (AROSS) organizes each year a series of concerts featuring international concert organists, choirs, orchestras, and other ensembles. For the 2019 season, AROSS has invited famous organists worldwide (Spain, Japan, Germany…). A narrator and choirs will also be featured, and of course, improvisation. The organization of concerts, which must cover the costs of honoraria, transportation, lodging of the artists, communications, etc., as well as the upkeep of the organs, amount to considerable expense. This is why we are counting on your generosity to help us in those projects. How to follow us? Website : www.aross.fr Facebook : www.facebook.com/orguesulpice Twitter : www.twitter.com/orguesstsulpice Daniel Roth Next recital Titular organist Sunday 16th, June 2019 4PM: organ recital by Mami Sakato, titular organist at Himonya Catholic Church (Tokyo). Bach, Franck, Saint-Saëns, & Widor, Dupré, Duruflé, Puig-Roget, and Daniel Roth. Félix Roth Horn player, student at the CNSM of Paris The artists Daniel Roth is also well known for his brillant improvisations which are regularly included in his concerts programs. -
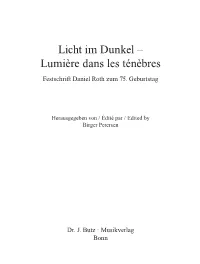
Licht Im Dunkel – Lumiè Re Dans Les Ténè Bres
Licht im Dunkel – Lumiè re dans les ténè bres Festschrift Daniel Roth zum 75. Geburtstag Herausgegeben von / Édité par / Edited by Birger Petersen Dr. J. Butz Musikverlag Bonn FS_Roth.indb 3 07.09.2017 09:58:00 Inhalt – Contenu – Contents Vorwort .......................................................... 9 Préface ........................................................... 10 Foreword ......................................................... 11 Geleitwort ........................................................ 12 Avant-Propos ...................................................... 13 Preface ........................................................... 14 Aufs tz e ssais ssay s PETER REIFENBERG Im Stil der „Panégyrique“ – aus lebendiger Tradition Gegenwart meistern und Zukunft gestalten. Daniel Roth, Botschafter der Orgel von St. Sulpice ........................ 17 PIERRE CHEVREAU Mulhouse, Albert Schweitzer und die elsässische Orgel von 1803 bis 1981 ..... 35 HANS STEINHAUS Die Orgel von Saint-Sulpice und ihre Organisten. Bekanntes und Verstreutes in Wort und Bild ............................. 51 YANNICK MERLIN Daniel Roth und die Orgeln von Sacré-Cœ ur und Saint-Sulpice .............. 67 GILLES CANTAGREL In Saint-Sulpice, mit Widor und Schweitzer .............................. 81 WOLFRAM ADOLPH „Gespräche einer Seele mit sich selbst “ Aspekte der Musikerpersönlichkeit Albert Schweitzers .................... 89 VINCENT WARNIER Daniel Roth und Marie-Claire Alain: Chronik einer Freundschaft und Feier eines humanistischen Ideals .......... -

Messe Solennelle 2:18 Edward Schaefer, Soloist Dir
DISC NUMBER 1 DISC NUMBER 2 Mass of the Catechumens 9. Colle" 1:13 Mass of the Faithful 12. Improvisation: Dialogue 2:03 Edward Schaefer, soloist Nasard et Bourdon Grand Orgue, Daniel Roth 1. Bells of Saint-Sulpice 4:30 10. Epistle (1 Corinthians: 5. 7-8) 1. Salutation & Offertory Verse 1:48 Charles Barbier, soloist 13. Confiteor 1:20 2. Le matin de Pâques 4:17 Terra tremuit (Ps. 75. 9, 10) Edward Schaefer, soloist Hervé Lamy, soloist Improvisation on Vidi Aquam 11. Graduel: Hæc Dies (Ps. 117. 24, 1) 2:51 Chœur Grégorien de Paris, and Resurrexi (Introit) Chœur Grégorien de Paris, 14. Free Improvisation 1:12 Grand Orgue, Daniel Roth dir. Thibaut Marlin dir. Thibaut Marlin Grand Orgue, Daniel Roth Orgue de Chœur, Eric Lebrun 12. Improvisation based on Hæc Dies 1:00 2. Improvisation based on 3:48 15. Communion Verse (I Cor. 5. 7,8) 1:57 3. Vidi Aquam 3:45 Grand Orgue, Daniel Roth Terra tremuit Chœur Grégorien de Paris, Chœur Grégorien de Paris, Grand Orgue, Daniel Roth dir. Thibaut Marlin JACOBUS GALLUS (1550-1591) dir. Thibaut Marlin 16. Communion Improvisation 2:50 13. Alleluia: Alleluia, in resurre!ione 1:51 GIOVANNI GABRIELI (1555-1612) based on 4. Dialogue 1:31 tua Christe 3. Jubilate Deo 5:22 Pascha Nostrum Edward Schaefer, soloist Chœur d’Oratorio de Paris, Chœur d’Oratorio de Paris, (Communion Verse) Chœur Grégorien de Paris, dir. Jean Sourisse dir. Jean Sourisse Grand Orgue, Daniel Roth dir Thibaut Marlin LOUIS VIERNE 14. Sequence: Vi!imae Paschali 3:52 4. Salutation and Preface 3:09 17. -
Musique À St. Sulpice
John Sheppard Ensemble JohnDaniel Sheppard Roth, Ensemble Orgel JohnBernhardDaniel Sheppard Roth,Schmidt, Ensemble Orgel Leitung BernhardDaniel Schmidt,Roth, Orgel Leitung Bernhard Schmidt, Leitung MusiqueMusique à à St.Musique Sulpice à St.St. SulpiceSulpice Fr., 19.05.2017 Sa., 20.05.2017 Stiftskirche Stuttgart Kilianskirche Heilbronn Fr.,19:00 19.05.2017 Uhr Sa.,18:00 20.05.2017 Uhr Fr.,Stiftskirche 19.05.2017 Stuttgart KilianskircheSa., 20.05.2017 Heilbronn 19:00So., 21.05.2017 Uhr 18:00So., 25.06.2017 Uhr StiftskircheHerz-Jesu-Kirche Stuttgart Freiburg St.Kilianskirche Sulpice Paris Heilbronn 19:00 Uhr 18:00 Uhr So.,18:00 21.05.2017 Uhr So.,16:00 25.06.2017 Uhr Herz-Jesu-Kirche(Konzerteinführung Freiburg St. Sulpice Paris So.,18:00mit 21.05.2017 Daniel Uhr Roth und 16:00So., Uhr 25.06.2017 Herz-Jesu-Kirche(KonzerteinführungJohannes Adam, BZ, Freiburg um 17:00 Uhr)St. Sulpice Paris 18:00mit DanielUhr Roth und 16:00 Uhr (KonzerteinführungJohannes Adam, BZ, um 17:00 Uhr) mit Daniel Roth und Johannes Adam, BZ, um 17:00 Uhr) Programm Daniel Roth (*1942) In manus tuas Charles-Marie Widor (1844-1937) Surrexit a mortuis op. 23,3 Georges Schmitt (1821-1900) Regina cæli laetare Charles-Marie Widor (1844-1937) Regina cæli laetare op. 18,2 Louis-James-Alfred Lefébure-Wély (1817-1869) Sortie en sol mineur Daniel Roth (*1942) Dignare me, o Jesu Charles-Marie Widor (1844-1937) Psaume LXXXIII op. 23,1 Jean-Jacques Grunenwald (1911-1982) Preces Daniel Roth (*1942) Ego sum panis vitae Georges Schmitt (1821-1900) O salutaris hostia Marcel Dupré (1886-1971) Quatre Motets op. -

Le Pédagogue
Le pédagogue Pierre-François Dub-Attenti (pf) : Saint-Sulpice, mai 2007 : comme souvent, la messe de 12h05 a pris du retard. Pas question pour autant d’« expédier » le postlude: la musique pour les fidèles avant tout ! Tant pis, il faudra courir jusqu’au métro et dans les couloirs de la gare de l’Est. Vous saluez les personnes présentes à la console, attrapez votre valise dans le salon Widor et descendez quatre à quatre les escaliers, laissant le soin à Hervé Lussigny d’éteindre les moteurs de l’orgue et de fermer la tribune. Ce dimanche, vous vous rendiez pour la dernière fois à la Musikhochschule de Francfort, mettant ainsi fin à plus de trente ans d’enseignement (et de trajets) vers Marseille, Strasbourg, Sarrebruck et donc Francfort. Depuis ce jour pourtant, on ne peut pas vraiment dire que vous soyez « à la retraite », pour autant que ce mot puisse avoir un sens pour ceux qui sont animés par la passion de transmettre. Il n’est qu’à vous entendre analyser (tout en jouant) une Toccata de Mufat par exemple ou bien signaler avec bienveillance à un organiste de pas- sage les accents indiqués par Vierne dans sa Toccata pour le constater… Chez vous, l’émerveillement est constant et le partage permanent… Les étudiants qui participent aux académies de San Sebastian ou aux masterclasses que vous animez ont la chance de continuer à béné- ficier de vos conseils et la participation à des jurys de concours vous donne l’occasion de garder un lien, si primordial pour vous, avec les jeunes générations. -

DANIEL ROTH Biography
DANIEL ROTH Biography Daniel Roth has been widely acclaimed as one of the leading French organ virtuosos, and has held several prestigious positions as an artist and teacher. At age twenty he made his debut at the organ of the Basilique du Sacré Coeur in Paris, as assistant to his teacher Madame Falcinelli. He later succeeded her as Titular Organist, a post he held until 1985 when he was appointed Titular Organist at St. Sulpice, the famous Paris church where his predecessors were Charles- Marie Widor, Marcel Dupré and Jean-Jacques Grunenwald. From 1974 to 1976 Daniel Roth held the position of Artist-in-Residence of the National Shrine of the Immaculate Conception in Washington DC. Upon his return to France, he resumed his teaching position at the Conservatory of Marseille, which he held until 1979 when he was appointed to the Conservatory of Strasbourg, a post he filled for nine years. From 1988 until summer, 1995, Mr. Roth taught at the Musikhochshule in Saarbrücken. He now is Professor of Organ at the Musikhochschule in Frankfurt am Main, succeeding Edgar Krapp and Helmut Walcha. A former student at the Paris Conservatory, his teachers have included Marie-Claire Alain and Maurice Duruflé. Daniel Roth has won several competitions, among them the Grand Prix de Chartres in 1971 for both interpretation and improvisation. He has concertized extensively in Europe, Great Britain, Scandinavia, Japan and Korea. He has made many tours of the United States and Canada since 1977. In addition to his regular tours, he has come to North America on several occasions as guest artist for various conventions: the Third International Congress of Organists (Washington DC and Philadelphia), the national convention of the Royal Canadian Daniel Roth Biography, Page 2 College of Organists (Montreal) and the national convention of The American Guild of Organists held in Detroit. -

Orgel-Meisterkurs Mit
Anmeldung bitte bis spätestens 1. September 2019. Orgel-Meisterkurs mit Hiermit melde ich mich für den Meisterkurs mit Daniel Roth Daniel Roth verbindlich an. Name Symphonische Straße PLZ, Ort französische Telefon Mailadresse Orgelmusik Die Kursgebühr von 80 Euro werde ich bis 15. September 2019 überweisen auf das Konto der Stiftergemeinschaft Justinuskirche Frankfurter Volksbank IBAN: DE06 5019 0000 0000 6537 05 BIC: FFVBDEFF Unterschrift Bitte die Anmeldung an diese Adresse schicken: Stiftergemeinschaft Justinuskirche z.H. Manuel Braun Postfach 80 04 28 65904 Frankfurt oder Mail Stiftergemeinschaft Justinuskirche e.V. Frankfurt am Main-Höchst [email protected] www.justinuskirche.de M.Bitsch, Begleitung der Klavier- Klasse H. Puig Roget, Orgel-und-Im- Orgel-Meisterkurs mit Daniel Roth provisation-Klasse Rolande Falcinelli. Danach Studien zur Alten Musik Symphonische französische Orgelmusik und Vorbereitung auf internationale (C. Frank, C. M. Widor, L. Vierne etc.) Wettbewerbe mit Marie-Claire Alain: fünf Preise, darunter Prix de haute exécution et d’improvisation des am 7. Oktober 2019 Amis de l’Orgue-Paris 1966, Premier Grand Prix de Chartres, Interpréta- in der Kirche Mutter vom Guten Rat tion, Improvisation 1971. Bruchfeldstraße 51, 60528 Frankfurt Seit diesen Jahren macht Daniel Roth international Karriere als Kon- zertorganist, Solist bei berühmten Die aktuelle Disposition der Albiez-Orgel Orchestern, er hält Meisterkurse, Konferenzen, wirkt als Jurymitglied I. Manual, III. Manual, Daniel Roth, weltweit als einer der bei Wettbewerben. Zahlreiche Rückpositiv C-a´´´ Schwellwerk C-a´´´ führenden französischen Orgelvir- Rundfunk- und Fernsehaufnahmen Quintade 8´ Bourdon 16´ tuosen bekannt, hat als Interpret (Filmportrait ZDF, 3sat, BBC, Rick Principal 4´ Suavial 8´ wie als Lehrer verschiedene pres- Steeve, USA, video film Dallas, Octav 2´ Praestant 4´ tigeträchtige Positionen einge- Texas), Schallplatten-, CD-Aufnah- Scharff 3f. -

DANIEL ROTH Biography
Download as a Word doc DANIEL ROTH Biography Daniel Roth has been widely acclaimed as one of the leading French organ virtuosos, and has held several prestigious positions as an artist and teacher. At age twenty he made his debut at the organ of the Basilique du Sacré Coeur in Paris, as assistant to his teacher Madame Falcinelli. He later succeeded her as Titular Organist, a post he held until 1985 when he was appointed Titular Organist at St. Sulpice, the famous Paris church where his predecessors were Charles- Marie Widor, Marcel Dupré and Jean-Jacques Grunenwald. A former student at the Paris Conservatory, his teachers have included Marie-Claire Alain and Maurice Duruflé. Daniel Roth has won several competitions, among them the Grand Prix de Chartres in 1971 for both interpretation and improvisation. From 1974 to 1976 Daniel Roth held the position of Artist-in-Residence of the National Shrine of the Immaculate Conception in Washington DC. Upon his return to France, he resumed his teaching position at the Conservatory of Marseille, which he held until 1979 when he was appointed to the Conservatory of Strasbourg, a post he filled for nine years. From 1988 until the summer of 1995, Mr. Roth taught at the Musikhochshule in Saarbrücken; he then served as Professor of Organ at the Musikhochschule in Frankfurt am Main, succeeding Edgar Krapp and Helmut Walcha, until his retirement in 2007. Renowned for his brilliant interpretations of organ literature and for his thrilling improvisations which are regularly included in his concert programs, Daniel Roth has concertized extensively throughout Europe, Great Britain, The United States, Scandinavia, Japan and Korea. -

DANIEL ROTH Biography
DANIEL ROTH Biography Daniel Roth has been widely acclaimed as one of the leading French organ virtuosos, and has held several prestigious positions as an artist and teacher. At age twenty he made his debut at the organ of the Basilique du Sacré Coeur in Paris, as assistant to his teacher Madame Falcinelli. He later succeeded her as Titular Organist, a post he held until 1985 when he was appointed Titular Organist at St. Sulpice, the famous Paris church where his predecessors were Charles- Marie Widor, Marcel Dupré and Jean-Jacques Grunenwald. From 1974 to 1976 Daniel Roth held the position of Artist-in-Residence of the National Shrine of the Immaculate Conception in Washington DC. Upon his return to France, he resumed his teaching position at the Conservatory of Marseille, which he held until 1979 when he was appointed to the Conservatory of Strasbourg, a post he filled for nine years. From 1988 until the summer of 1995, Mr. Roth taught at the Musikhochshule in Saarbrücken; he then served as Professor of Organ at the Musikhochschule in Frankfurt am Main, succeeding Edgar Krapp and Helmut Walcha, until his retirement in 2007. A former student at the Paris Conservatory, his teachers have included Marie-Claire Alain and Maurice Duruflé. Daniel Roth has won several competitions, among them the Grand Prix de Chartres in 1971 for both interpretation and improvisation. He has concertized extensively in Europe, Great Britain, Scandinavia, Japan and Korea. He has made many tours of the United States and Canada since 1977. In addition to his regular tours, he has come to North America on several occasions as guest artist for various conventions: the Third International Congress of Organists (Washington DC and Philadelphia), the national convention of the Royal Canadian Daniel Roth Biography, page 2 College of Organists (Montreal) and the national convention of The American Guild of Organists held in Detroit.