Internationales
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tulips Q99 Home Hardware Tulip Bulbs
MAGRATH TRADING CO. STORE NEWS PHONES: OFFICE 758-3033 GROCERIES 758-3535 DRY GOODS 758-3252 HARDWARE 758-3065 UPSTAIRS & STORE NEWS 758-6377 STORE HOURS: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday & Saturday 8 a.m. to 6 p.m. THURSDAY, OCTOBER 5, 1989 .............. MAGRATH, AT .BERTA. ****************************************************************************************** ***jk**************************************************************************************I HARDWARE DEPARTMENT THANKSGIVING TULIPS Q99 HOME HARDWARE TULIP BULBS. 50 Pack. REG 9.99 . E49 HOME HARDWARE DAFFODILS. 20 Pack. REG. $7.49 .. W ASSORTED Fertilize COFFEE MUGS Earthenware Coffee Mugs in assorted This Fall! designs. WEED ’n FEED REGULAR $1. HOME HARDWARE WEED 'N FEED FOR FALL. 6-8-12 - for your Fall Fertilizing needs. REG. 5" FALL SPECIAL. $6.99 MR- FARMER FALL FENCING NEEDS Rodenticides We have HALLMAN Electric Fencers 120 volt. £499 & 129" We also stock BEE 12 volt and 120 volt fencers as well. ************ . WE STOCK 6 ft. STEEL POSTS 50 ft. SNOW ■ FENCE. *********** WE STOCK BAR BAIT, WAR FARIN AS WELL AS A GOOD SELECTIONOF MEN’S GOOD SUPPLY OF MOUSE TRAPS. RUBBER BOOTS I The mice are moving in. Be ready for their ********** i influx - and eliminate them as quickly as Worm your horse for Fall. possible. EQUALAN Paste Horse Wormer. i ******************* ; WE HAVE A GOOD SELECTION OF HEAT TAPES - to keep your pipes from freezing. Alber*a Federation of Women United for Fabrics Families nnounce their Conference '89 "You Can make a Difference" October 27t.h FINAL SALE NYLON T R I C 0 T & 28th at the Mayfield Inn in Edmonton. Guest Speakers include Claire Hoy - 108" wide - Shades of Vanilla, Journalist and Political Commentator, Burgandy, White, Royal, Mint,. -

I – Les Relations Extérieures Du Canada »
Article « I – Les relations extérieures du Canada » Hélène Galarneau et Manon Tessier Études internationales, vol. 21, n° 3, 1990, p. 565-588. Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/702704ar DOI: 10.7202/702704ar Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents scientifiques depuis 1998. Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : [email protected] Document téléchargé le 13 février 2017 10:33 Chronique des relations extérieures du Canada et du Québec Hélène GALARNEAU et Manon TESSIER* I - Les relations extérieures du Canada (avril à juin 1990) A — Aperçu général Ce trimestre de printemps était encore l'occasion de nombreuses réunions internationales que ce soit celles, récurrentes, du FMI, de la Banque mondiale et de l'OTAN ou celles, ponctuelles, tenues dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Si un trait commun unissait ces rencontres multilatérales, c'est bien celui de l'adaptation aux nouvelles réalités européen nes et de ses répercussions sur les alliances militaires ou sur l'économie inter nationale. -
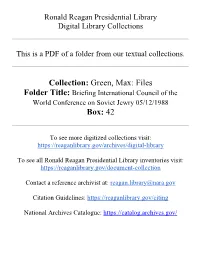
Collection: Green, Max: Files Box: 42
Ronald Reagan Presidential Library Digital Library Collections This is a PDF of a folder from our textual collections. Collection: Green, Max: Files Folder Title: Briefing International Council of the World Conference on Soviet Jewry 05/12/1988 Box: 42 To see more digitized collections visit: https://reaganlibrary.gov/archives/digital-library To see all Ronald Reagan Presidential Library inventories visit: https://reaganlibrary.gov/document-collection Contact a reference archivist at: [email protected] Citation Guidelines: https://reaganlibrary.gov/citing National Archives Catalogue: https://catalog.archives.gov/ WITHDRAWAL SHEET Ronald Reagan Library Collection Name GREEN, MAX: FILES Withdrawer MID 11/23/2001 File Folder BRIEFING INTERNATIONAL COUNCIL & THE WORLD FOIA CONFERENCE ON SOVIET JEWRY 5/12/88 F03-0020/06 Box Number THOMAS 127 DOC Doc Type Document Description No of Doc Date Restrictions NO Pages 1 NOTES RE PARTICIPANTS 1 ND B6 2 FORM REQUEST FOR APPOINTMENTS 1 5/11/1988 B6 Freedom of Information Act - [5 U.S.C. 552(b)] B-1 National security classified Information [(b)(1) of the FOIA) B-2 Release would disclose Internal personnel rules and practices of an agency [(b)(2) of the FOIA) B-3 Release would violate a Federal statute [(b)(3) of the FOIA) B-4 Release would disclose trade secrets or confidential or financial Information [(b)(4) of the FOIA) B-8 Release would constitute a clearly unwarranted Invasion of personal privacy [(b)(6) of the FOIA) B-7 Release would disclose Information compiled for law enforcement purposes [(b)(7) of the FOIA) B-8 Release would disclose Information concerning the regulation of financial Institutions [(b)(B) of the FOIA) B-9 Release would disclose geological or geophysical Information concerning wells [(b)(9) of the FOIA) C. -
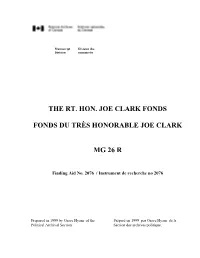
Complete Fa.Wpd
Manuscript Division des Division manuscrits THE RT. HON. JOE CLARK FONDS FONDS DU TRÈS HONORABLE JOE CLARK MG 26 R Finding Aid No. 2076 / Instrument de recherche no 2076 Prepared in 1999 by Grace Hyam of the Préparé en 1999 par Grace Hyam de la Political Archival Section. Section des archives politique. Table of Contents File lists, by series and sub-series: Pages R 1 MEMBER OF PARLIAMENT SERIES R 1-1 Member of Parliament, 1972-1976, Correspondence Sub-series .......... 1-22 R 1-2 Member of Parliament, 1972-1976, Subject files Sub-series ............ 23-45 R 1-3 Member of Parliament, 1983-1984, Sub-series ....................... 46-51 R 2 LEADER OF THE OPPOSITION, 1976-1979, SERIES R 2-1 Correspondence Sub-series ............................... 52-264 R 2-2 Subject Files Sub-series................................. 265-282 R 2-3 Staff - Jim Hawkes Sub-series............................ 283-294 R 2-4 Joe Clark Personal Sub-series ............................ 295-296 R 2-5 Staff - Ian Green Sub-series.............................. 297-301 R 2-6 Staff - Bill Neville Sub-series ............................ 302-304 R 3 PRIME MINISTER’S OFFICE SERIES R 3-1 PMO Correspondence Sub-series ......................... 305-321 R 3-2 PMO Correspondence - Indexes Sub-series ................. 322-323 R 3-3 PMO Subject files Sub-series ............................ 324-331 R 3-4 PMO Staff - Lorne Fox Sub-series ........................ 332-335 R 3-5 PMO Staff - Adèle Desjardins Sub-series................... 336-338 R 3-6 PMO Staff - Marjory LeBreton Sub-series .................. 339-341 R 3-7 PMO Communications Sub-series......................... 342-348 R 4 LEADER OF THE OPPOSITION, 1980-1983, SERIES R 4-1 Correspondence Sub-series ............................. -

Composition Récente Du Corps Politique C-7 L
COMPOSITION RÉCENTE DU CORPS POLITIQUE C-7 L'honorable J. Robert Howie, 4 juin 1979 L'honorable WUUam Hunter McKnight, 17 septembre L'honorable Steven Eugène Paproski, 4 juin 1979 1984 L'honorable Ronald Huntington, 4 juin 1979 L'honorable Rév. Walter FrankUn McLean, 17 sep L'honorable Michael Holcombe WUson, 4 juin 1979 tembre 1984 L'honorable Renaude Lapointe, 30 novembre 1979 L'honorable Thomas Michael McMillan, 17 septembre L'honorable Stanley Howard Knowles, 30 novembre 1984 1979 L'honorable Patricia Carney, 17 septembre 1984 L'honorable Hazen Robert Argue, 3 mars 1980 L'honorable André Bissonnette, 17 septembre 1984 L'honorable Gerald Augustine Regan, 3 mars 1980 L'honorable Suzanne Biais-Grenier, 17 septembre 1984 L'honorable Mark R. MacGuigan, 3 mars 1980 L'honorable Benoît Bouchard, 17 septembre 1984 L'honorable Robert PhiUip Kaplan, 3 mars 1980 L'honorable Andrée Champagne, 17 septembre 1984 L'honorable James Sydney Fleming, 3 mars 1980 L'honorable Michel Côté, 17 septembre 1984 L'honorable WUliam H. Rompkey, 3 mars 1980 L'honorable James Francis Kelleher, 17 septembre 1984 L'honorable Pierre Bussières, 3 mars 1980 L'honorable Robert E. J. Layton, 17 septembre 1984 L'honorable Charles Lapointe, 3 mars 1980 L'honorable Marcel Masse, 17 septembre 1984 L'honorable Edward C. Lumley, 3 mars 1980 L'honorable Barbara Jean McDougaU, 17 septembre L'honorable Yvon Pinard, 3 mars 1980 1984 L'honorable Donald J. Johnston, 3 mars 1980 L'honorable Gerald Stairs Merrithew, 17 septembre 1984 L'honorable Lloyd Axworthy, 3 mars 1980 L'honorable Monique Vézina, 17 septembre 1984 L'honorable Paul Cosgrove, 3 mars 1980 L'honorable Maurice Riel, 30 novembre 1984 L'honorable Judy A. -

Women As Executive Leaders: Canada in the Context of Anglo-Almerican Systems*
Women as Executive Leaders: Canada in the Context of Anglo-Almerican Systems* Patricia Lee Sykes American University Washington DC [email protected] *Not for citation without permission of the author. Paper prepared for delivery at the Canadian Political Science Association Annual Conference and the Congress of the Humanities and Social Sciences, Concordia University, Montreal, June 1-3, 2010. Abstract This research identifies the obstacles and opportunities women as executives encounter and explores when, why, and how they might engender change by advancing the interests and enhancing the status of women as a group. Various positions of executive leadership provide a range of opportunities to investigate and analyze the experiences of women – as prime ministers and party leaders, cabinet ministers, governors/premiers/first ministers, and in modern (non-monarchical) ceremonial posts. Comparative analysis indicates that the institutions, ideology, and evolution of Anglo- American democracies tend to put women as executive leaders at a distinct disadvantage. Placing Canada in this context reveals that its female executives face the same challenges as women in other Anglo countries, while Canadian women also encounter additional obstacles that make their environment even more challenging. Sources include parliamentary records, government documents, public opinion polls, news reports, leaders’ memoirs and diaries, and extensive elite interviews. This research identifies the obstacles and opportunities women as executives encounter and explores when, why, and how they might engender change by advancing the interests and enhancing the status of women. Comparative analysis indicates that the institutions, ideology, and evolution of Anglo-American democracies tend to put women as executive leaders at a distinct disadvantage. -

I- Les Relations Extérieures Du Canada »
Article « I- Les relations extérieures du Canada » Hélène Galarneau Études internationales, vol. 19, n° 4, 1988, p. 703-724. Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/702420ar DOI: 10.7202/702420ar Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. Érudit offre des services d'édition numérique de documents scientifiques depuis 1998. Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : [email protected] Document téléchargé le 13 février 2017 08:51 CHRONIQUE DES RELATIONS EXTERIEURES DU CANADA ET DU QUÉBEC Hélène GALARNEAU* I — Les relations extérieures du Canada (juillet à septembre 1988) A — Aperçu général Le premier ministre canadien se rendait à New York en septembre où il participait cette année à l'ouverture de la nouvelle session de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'attribution du prix Nobel de la paix aux Casques bleus, le jour même du passage de M. Mulroney à l'ONU, tombait à point pour le Canada, qui a encore accepté à deux reprises cette année, en avril et en août, de participer à de nouvelles missions de paix en Afghanistan et à la frontière irano-iraquienne, et qui fait campagne par ailleurs pour obtenir à l'automne un siège au Conseil de Sécurité. -

Do Development Minister Characteristics Affect Aid Giving?
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Fuchs, Andreas; Richert, Katharina Working Paper Do Development Minister Characteristics Affect Aid Giving? Discussion Paper Series, No. 604 Provided in Cooperation with: Alfred Weber Institute, Department of Economics, University of Heidelberg Suggested Citation: Fuchs, Andreas; Richert, Katharina (2015) : Do Development Minister Characteristics Affect Aid Giving?, Discussion Paper Series, No. 604, University of Heidelberg, Department of Economics, Heidelberg, http://dx.doi.org/10.11588/heidok.00019769 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/127421 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von -
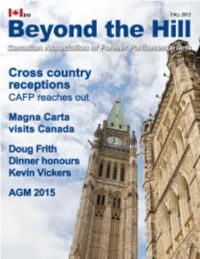
Beyond the Hill Fall15.Pdf
Muskoka Reception Muskoka, Ontario, Aug 30 - Sept 1, 2015 Photos by Susan Simms and Gina Chambers Relaxing on the Hon. Paul and Sandra Hellyer’s dock during the CAFP reception in Muskoka. Ed Harper, Nanette Zwicker and Hon. Trevor Hon. Peter Milliken examines a beautiful John and Julia Murphy at Muskoka Boat Eyton at Dr. Bethune Interpretation Centre. handmade canoe. & Heritage Centre Ron and Marlene Catterall, Carol Shepherd and Serge Ménard. Norwegian Ambassador Mona Brother at Little Norway Memorial. Page 2 Beyond the Hill • Fall 2015 Beyond the Hill • Fall 2015 Page 3 Beyond the Hill Canadian Association of Former Parliamentarians Volume 12, Issue No. 1 FALL 2015 CONTENTS Reception in Vancouver 26 Regional Meeting in Muskoka 2 Photo by Susan Simms Photos by Susan Simms and Gina Chambers It Seems to me: Social media has CAFP News 4 the power to change everything 27 How the President sees it 5 By Dorothy Dobbie By Hon. Andy Mitchell Magna Carta turns 800 28 Executive Director’s Report 6 By Harrison Lowman By Jack Silverstone Former MP takes on leadership of Distinguished Service Award 7 Alberta’s Wildrose Party 30 Story by Scott Hitchcox, By Hayley Chazan photos by Harrison Lowman Prayer Breakfast still strong after 50 years 31 CAFP Memorial Service 8 By Scott Hitchcox Story by Harrison Lowman, photos by Neil Valois Photography Where are they now? 32 By Hayley Chazan, Scott Hitchcox Chief Willie Littlechild brings Truth and and Harrison Lowman Reconciliation to the AGM 10 By Scott Hitchcox Former B.C. Premier awarded Courage Medal 34 By Hayley Chazan All good news at this year’s AGM 12 Story by Scott Hitchcox How it works 35 AGM Policy Conference 16 By Hon. -

Ÿþm Icrosoft W
Southern Africa Southern Africa Vol. 4No. 3 December 1988 M uIroney& South Africa Rescuing Credibility? Canadian Policy Towards South Africa COSATU The Year in Retrospect Bushand Botha New Tactics for Southern Africa price: $3. 00 C&2xAg M REPORT Southern Africa REPORT is produced 5 times a year by a volunteer collective of the Toronto Committee for the Liberation of Southern Africa (TCLSAC), 427 Bloor St. W. Toronto, M5S lX7 Tel. (416) 967-5562 Submissions, suggestions and help in production are welcome and invited. ISSN 0820-5582 SAR is a member of the Canadian Periodical Publisher's Association. Subscriptions Annual TCLSAC membership and Southern Africa Report subscription rates are as follows: SUBSCRIPTION: Individual (1 year) . ... $15.00 Individual (2 years) . $30.00 Institution ... ........ $30.00 MEMBERSIIP: (includes subscription) Regular (Canada) ....... $30.00 Unemployed Student ... ......... $15.00 Senior $50.00 Sustainer . to $300.00 Overseas add $5.00 December 1988 Contents Editorial Opportunism Knocks ... .............. Rescuing Credibility? Canadian Policy Towards South Africa, 1988 . South Africa Confidential: Document Underscores Canadian Backsliding .... 9 An Interview with Stephen Lewis ................ COSATU, 1988 The Year in Retrospect .............. Truth and Consequences: South Africa's Churches on the Front Line ........ The Rushdie Controversy ..... Anthropology: In the Service of Apartheid . Bush and Botha: New Tactics for Southern Africa .......... 20 . ......... 26 Upbeat Organizing Downunder .... ............ -

Yukon Chronology 1897-1999
THE YUKON'S CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS VOLUME 1 THE YUKON CHRONOLOGY (1897 - 1999) The Yukon Chronology (Second Edition) Copyright ©Steven Smyth, 1991, 1999 ALL RIGHTS RESERVED ISBN 0-9698723-1-3 Printed in Canada Published by Clairedge Press Whitehorse, Yukon 1999 © ALL RIGHTS RESERVED Cover design and artwork Douglas Bell and Mary Prudden DEDICATION To my parents, Ronald and Evelyn Smyth, without whom this book would not be possible. Steven Smytll Contents Forward Patrick L. Michael, Clerk of the Yukon v. Legislative Assembly Preface vi. Introd uction Steven Smyth 1. Code 3. Prelude 4. Chronology 5. Selected Bibliography 278. The Author: Biographical Note 281. v FORWARD It was my privilege, in 1991, to pen the foreword to the two-volume set of the Tile Yukon's Constih,tional Foundations. I said of the set "There is little doubt that it will stand as an essential reference source for anyone with an interest in the Yukon's constitution al past, present, or future." And it has. A wide variety of people from both inside and outside the Yukon, including scholars, politicians, students, history buffs and reporters, have sought and found the information they were looking for in this work. Steven Smyth has now done us the additional service of updating and revising his Yukon CllronologJJ which was first published as Volume 1 of TlIJ! Yukon's Constitutional Foundations. The corrections and additions to the original chronology are, of course, encouraged and appreciated. The greatest commendation, however, is reserved for the effort to extend its coverage from December of 1990 to June of 1999. -
I – Les Relations Extérieures Du Canada Hélène Galarneau
Document generated on 09/28/2021 9:01 a.m. Études internationales I – Les relations extérieures du Canada Hélène Galarneau Volume 18, Number 2, 1987 URI: https://id.erudit.org/iderudit/702170ar DOI: https://doi.org/10.7202/702170ar See table of contents Publisher(s) Institut québécois des hautes études internationales ISSN 0014-2123 (print) 1703-7891 (digital) Explore this journal Cite this article Galarneau, H. (1987). I – Les relations extérieures du Canada. Études internationales, 18(2), 405–423. https://doi.org/10.7202/702170ar Tous droits réservés © Études internationales, 1987 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ CHRONIQUE DES RELATIONS EXTÉRIEURES DU CANADA ET DU QUÉBEC Hélène GALARNEAU* I — Les relations extérieures du Canada (janvier à mars 1987) A — Aperçu général Le gouvernement canadien poursuivait au cours de l'hiver ses efforts contre l'apartheid, notamment en manifestant son appui aux doléances exprimées par les dirigeants de six pays africains, dont trois de la ligne de front, lors de la visite du premier ministre Mulroney au Zimbabwe et au Sénégal. L'intérêt marqué du gouvernement pour le développement de liens serrés avec l'Asie ne se démentait guère non plus lors des trois derniers mois, comme en témoignaient le voyage du secrétaire d'État aux Affaires extérieures, M.