Vue Panoramique
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Januar Februar
brezpla~ni izvod po{tnina pla~ana pri po{ti 1106 ljubljana kinote~nik 2011 2012 januar-februar Rainer Werner Fassbinder retrospektiva ostanite {e naprej z nami Televizijskim ogledom in uvidom sledi {e ob{irnej{a, po skoraj dvajsetletnem "Televizija! Vzgojiteljica, mati, ljubica." doma~em zamolku toliko glasnej{a retrospektiva nem{kega scenarista, dramatika, Homer Simpson igralca, producenta in re`iserja Rainerja Wernerja Fassbinderja, ki bo prinesla "Za film bi rad pomenil to, kar Shakespeare pomeni za gledali{~e, Marx za {tirideset projekcij dvajsetih filmov plus – kot je pri ve~jih retrospektivah spet v politiko in Freud za psihologijo: nekdo, za komer ni~ ne ostane isto." navadi – zajeten kinote~ni katalog, posve~en avtorju. Kdor je Fassbinderja `e Rainer Werner Fassbinder gledal, ga bo pri{el pogledat spet (retrospektiva, mimogrede, prina{a kup , letnik XII, {tevilka 5–6, januar-februar 2012 naslovov, ki v Sloveniji {e nikoli niso bili predvajani na velikem platnu). Kdor Kaj imata skupnega televizija in Rainer Werner Fassbinder razen tega, da je prva Fassbinderja {e ni gledal, pa ima v Kinoteki rezerviran abonma ne samo pri radikalno posegla v tok navad in obna{anja 20. stoletja, drugi pa ni~ manj predmetu filma, pa~ pa tudi na podro~ju ob~utljivih to~k evropske zgodovine radikalno v tok filmske zgodovine istega stoletja? Poleg dejstva, da je Fassbinder dvajsetega stoletja, brezkompromisnega politi~nega udejstvovanja, eti~nega pribli`no tretjino svojega enormnega opusa posnel prav za televizijo, ju tokrat anga`maja in njemu pripadajo~ega dogodka ljubezni. dru`i tudi skupen nastop v januarsko-februarskem programu Kinoteke. Retrospektiva se bo iz januarja prelila v februar, ta pa se sklepa z mnogo manj ali Tega na samem pragu novega leta odpiramo z ob{irno, tematsko retrospektivo, prav ni~ "kanoni~no", a zato ni~ manj "pou~no" retrospektivo, ki bo predstavila ki smo jo poimenovali Ekrani na platnu in v sklopu katere raziskujemo, na kak{ne pet filmov Reze Mirkarimija, mlaj{ega cineasta iranskega rodu. -

Master Class with George R.R. Martin: Selected Filmography 1 The
Master Class with George R.R. Martin: Selected Filmography The Higher Learning staff curate digital resource packages to complement and offer further context to the topics and themes discussed during the various Higher Learning events held at TIFF Bell Lightbox. These filmographies, bibliographies, and additional resources include works directly related to guest speakers’ work and careers, and provide additional inspirations and topics to consider; these materials are meant to serve as a jumping-off point for further research. Please refer to the event video to see how topics and themes relate to the Higher Learning event. Films and Television Series mentioned or discussed during the master class Game of Thrones (2011-2013). 2 seasons, 20 episodes. Creators: David Benioff and D.B. Weiss, U.S.A. Airs on HBO. Production Co.: HBO / Television 360 / Grok! Studio / Generator Entertainment / Bighead Littlehead / Embassy Films. The Twilight Zone (1959-1964). 5 seasons, 156 episodes. Creator: Rod Sterling, U.S.A. Originally aired on CBS. Production Co.: Cayuga Productions / CBS. Captain Video and His Video Rangers (1949-1955). 7 seasons, number of episodes unknown. Creator: James Caddiga, U.S.A. Originally aired on DuMont Television Network. Production Co.: DuMont Television Network. Rocky Jones, Space Ranger (1954). 2 seasons, 39 episodes. Creator: Roland D. Reed, U.S.A. Originally aired on DuMont Television Network. Production Co.: Roland Reed Productions / Space Ranger Enterprises. Tom Corbett, Space Cadet (1950-1955). 4 seasons, number of episodes unknown. Creator: unknown, U.S.A. Originally aired on CBS (1950), ABC (1951-1952), DuMont Television Network (1953-1954), and NBC (1954-1955). -

Navigating the Videogame
From above, from below: navigating the videogame A thesis presented by Daniel Golding 228306 to The School of Culture and Communication in partial fulfilment of the requirements for the degree of Bachelor of Arts (Honours) in the field of Cultural Studies in the School of Culture and Communication The University of Melbourne Supervisor: Dr. Fran Martin October 2008 ABSTRACT The study of videogames is still evolving. While many theorists have accurately described aspects of the medium, this thesis seeks to move the study of videogames away from previously formal approaches and towards a holistic method of engagement with the experience of playing videogames. Therefore, I propose that videogames are best conceptualised as navigable, spatial texts. This approach, based on Michel de Certeau’s concept of strategies and tactics, illuminates both the textual structure of videogames and the immediate experience of playing them. I also regard videogame space as paramount. My close analysis of Portal (Valve Corporation, 2007) demonstrates that a designer can choose to communicate rules and fiction, and attempt to influence the behaviour of players through strategies of space. Therefore, I aim to plot the relationship between designer and player through the power structures of the videogame, as conceived through this new lens. ii TABLE OF CONTENTS ABSTRACT ii ACKNOWLEDGEMENTS iv CHAPTER ONE: Introduction 1 AN EVOLVING FIELD 2 LUDOLOGY AND NARRATOLOGY 3 DEFINITIONS, AND THE NAVIGABLE TEXT 6 PLAYER EXPERIENCE AND VIDEOGAME SPACE 11 MARGINS OF DISCUSSION 13 CHAPTER TWO: The videogame from above: the designer as strategist 18 PSYCHOGEOGRAPHY 18 PORTAL AND THE STRATEGIES OF DESIGN 20 STRUCTURES OF POWER 27 RAILS 29 CHAPTER THREE: The videogame from below: the player as tactician 34 THE PLAYER AS NAVIGATOR 36 THE PLAYER AS SUBJECT 38 THE PLAYER AS BRICOLEUR 40 THE PLAYER AS GUERRILLA 43 CHAPTER FOUR: Conclusion 48 BIBLIOGRAPHY 50 iii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my supervisor, Dr. -

Uk Films for Sale in Cannes 2009
UK FILMS FOR SALE IN CANNES 2009 Supported by Produced by 1234 TMoviehouse Entertainment Cast: Ian Bonar, Lyndsey Marshal, Kieran Bew, Mathew Baynton Gary Phillips Genre: Drama Rés. Du Grand Hotel 47 La Croisette, 6Th Director: Giles Borg Floor Producer Simon Kearney Tel: +33 4 93 38 65 93 Status : Completed [email protected] Home Office Tel: +44 20 7836 5536 Synopsis Ardent musician Stevie (guitar, vocals) endures a day-job he despises and can't find a girlfriend but... at least he has his music! With friend Neil (drums) he's been kicking around for a while not achieving much but when the pair of misfits team-up with the more-experienced Billy (guitar) and his cute pal Emily (bass) the possibility they might be on to something really good presents itself. For Stevie this is the opportunity he's been waiting for with the band and just maybe... Emily too! 13 Hrs TEyeline Entertainment Cast: Isabella Calthorpe, Gemma Atkinson, Tom Felton, Joshua Duncan Napier-Bell Bowman Lerins Stand R10 Genre: Horror Tel: +33 4 92 99 33 02 Director: Jonathan Glendening [email protected] Writer: Adam Phillips Home Office Tel: +44 20 8144 2994 Producer Nick Napier-Bell, Romain Schroeder, Tom Reeve Status : Post-Production Synopsis A full moon hangs in the night sky and lightning streaks across dark storm clouds. Sarah Tyler returns to her troubled family home in the isolated countryside, for a much put-off visit. As the storm rages on, Sarah, her family and friends shore up for the night, cut off from the outside world. -

Film Soleil 28/9/05 3:35 Pm Page 2 Film Soleil 28/9/05 3:35 Pm Page 3
Film Soleil 28/9/05 3:35 pm Page 2 Film Soleil 28/9/05 3:35 pm Page 3 Film Soleil D.K. Holm www.pocketessentials.com This edition published in Great Britain 2005 by Pocket Essentials P.O.Box 394, Harpenden, Herts, AL5 1XJ, UK Distributed in the USA by Trafalgar Square Publishing P.O.Box 257, Howe Hill Road, North Pomfret, Vermont 05053 © D.K.Holm 2005 The right of D.K.Holm to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permission of the publisher. Any person who does any unauthorised act in relation to this publication may beliable to criminal prosecution and civil claims for damages. The book is sold subject tothe condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated, without the publisher’s prior consent, in anyform, binding or cover other than in which it is published, and without similar condi-tions, including this condition being imposed on the subsequent publication. A CIP catalogue record for this book is available from the British Library. ISBN 1–904048–50–1 2 4 6 8 10 9 7 5 3 1 Book typeset by Avocet Typeset, Chilton, Aylesbury, Bucks Printed and bound by Cox & Wyman, Reading, Berkshire Film Soleil 28/9/05 3:35 pm Page 5 Acknowledgements There is nothing -

From Synthespian to Convergence Character: Reframing the Digital Human in Contemporary Hollywood Cinema by Jessica L. Aldred
From Synthespian to Convergence Character: Reframing the Digital Human in Contemporary Hollywood Cinema by Jessica L. Aldred A thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Affairs in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Cultural Mediations Carleton University Ottawa, Ontario © 2012 Jessica L. Aldred Library and Archives Bibliotheque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du 1+1 Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-94206-2 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-94206-2 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par I'lnternet, preter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distrbute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre imprimes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

La Mamelle and the Pic
1 Give Them the Picture: An Anthology 2 Give Them The PicTure An Anthology of La Mamelle and ART COM, 1975–1984 Liz Glass, Susannah Magers & Julian Myers, eds. Dedicated to Steven Leiber for instilling in us a passion for the archive. Contents 8 Give Them the Picture: 78 The Avant-Garde and the Open Work Images An Introduction of Art: Traditionalism and Performance Mark Levy 139 From the Pages of 11 The Mediated Performance La Mamelle and ART COM Susannah Magers 82 IMPROVIDEO: Interactive Broadcast Conceived as the New Direction of Subscription Television Interviews Anthology: 1975–1984 Gregory McKenna 188 From the White Space to the Airwaves: 17 La Mamelle: From the Pages: 87 Performing Post-Performancist An Interview with Nancy Frank Lifting Some Words: Some History Performance Part I Michele Fiedler David Highsmith Carl Loeffler 192 Organizational Memory: An Interview 19 Video Art and the Ultimate Cliché 92 Performing Post-Performancist with Darlene Tong Darryl Sapien Performance Part II The Curatorial Practice Class Carl Loeffler 21 Eleanor Antin: An interview by mail Mary Stofflet 96 Performing Post-Performancist 196 Contributor Biographies Performance Part III 25 Tom Marioni, Director of the Carl Loeffler 199 Index of Images Museum of Conceptual Art (MOCA), San Francisco, in Conversation 100 Performing Post-Performancist Carl Loeffler Performance or The Televisionist Performing Televisionism 33 Chronology Carl Loeffler Linda Montano 104 Talking Back to Television 35 An Identity Transfer with Joseph Beuys Anne Milne Clive Robertson -
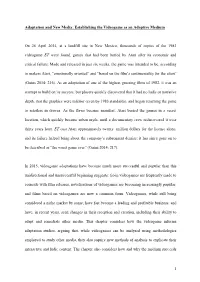
Adaptation and New Media: Establishing the Videogame As an Adaptive Medium
Adaptation and New Media: Establishing the Videogame as an Adaptive Medium On 26 April 2014, at a landfill site in New Mexico, thousands of copies of the 1983 videogame ET were found, games that had been buried by Atari after its economic and critical failure. Made and released in just six weeks, the game was intended to be, according to makers Atari, “emotionally oriented” and “based on the film’s sentimentality for the alien” (Guins 2014: 216). As an adaptation of one of the highest grossing films of 1982, it was an attempt to build on its success, but players quickly discovered that it had no ludic or narrative depth, that the graphics were inferior (even by 1983 standards), and began returning the game to retailers in droves. As the flaws became manifest, Atari buried the games in a secret location, which quickly became urban myth, until a documentary crew rediscovered it over thirty years later. ET cost Atari approximately twenty million dollars for the license alone, and its failure helped bring about the company’s subsequent demise; it has since gone on to be described as “the worst game ever” (Guins 2014: 217). In 2015, videogame adaptations have become much more successful and popular than this unidirectional and unsuccessful beginning suggests: tie-in videogames are frequently made to coincide with film releases, novelisations of videogames are becoming increasingly popular, and films based on videogames are now a common form. Videogames, while still being considered a niche market by some, have fast become a leading and profitable business, and have, in recent years, seen changes in their reception and creation, including their ability to adapt and remediate other media. -

Machinima As Digital Agency and Growing Commercial Incorporation
A Binary Within the Binary: Machinima as Digital Agency and Growing Commercial Incorporation A thesis presented to the faculty of the College of Fine Arts of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts Megan R. Brown December 2012 © 2012 Megan R. Brown. All Rights Reserved 2 This thesis titled A Binary Within the Binary: Machinima as Digital Agency and Growing Commercial Incorporation by MEGAN R. BROWN has been approved for the School of Film and the College of Fine Arts by Louis-Georges Schwartz Associate Professor of Film Studies Charles A. McWeeny Dean, College of Fine Arts 3 ABSTRACT BROWN, MEGAN R., M.A., December 2012, Film Studies A Binary Within the Binary: Machinima as Digital Agency and Growing Commercial Incorporation (128 pp.) Director of Thesis: Louis-Georges Schwartz. This thesis traces machinima, films created in real-time from videogame engines, from the exterior toward the interior, focusing on the manner in which the medium functions as a tool for marginalized expression in the face of commercial and corporate inclusion. I contextualize machinima in three distinct contexts: first, machinima as historiography, which allows its minority creators to articulate and distribute their interpretation of national and international events without mass media interference. Second, machinima as a form of fan fiction, in which filmmakers blur the line between consumers and producers, a feature which is slowly being warped as videogame studios begin to incorporate machinima into marketing techniques. Finally, the comparison between psychoanalytic film theory, which explains the psychological motivations behind cinema's appeal, applied to videogames and their resulting machinima, which knowingly disregard established theory and create agency through parody. -

Bernadette Ščasná MA Thesis
TALLINN UNIVERSITY SCHOOL OF HUMANITIES Bernadette Ščasná "IT´S A-ME, ANOTHER BAD REVIEW!": ASSESSING THE PERCEIVED FAILURE OF THE VIDEO GAME ADAPTATIONS BASED ON THE CINEMATIC ADAPTATIONS OF SUPER MARIO BROS. AND MAX PAYNE MA Thesis Supervisor: Teet Teinemaa, PhD Tallinn 2020 “I hereby confirm that I am the sole author of the thesis submitted. All the works and conceptual viewpoints by other authors that I have used, as well as data deriving from sources have been appropriately attributed.” 2 Acknowledgements I would like to thank my supervisor Teet Teinemaa, PhD for all the guidance and support during the writing process of this thesis. His feedback and recommendations were always very useful in shaping this thesis into its final form. 3 Table of Contents Introduction ......................................................................................................................... 6 Chapter 1: Theoretical Framework ................................................................................. 11 1.1 Introduction to the Relationship Between Video Games and Films ............................. 11 1.2 The Differences and Similarities Between Video Games and Films ............................ 14 1.3 The New Analytical Tools for Approaching Films Based on Video Games .................16 1.4 The Concepts for the Analysis of the Relationship Between Video Games and Film ........................................................................................................................ 18 1.4.1 Vividness of Experience and its Effects -

Play the Game in the Opening Scene
Issue 04 – 2015 Journal –Peer Reviewed ENRICO GANDOLFI Kent State University Play the game [email protected] & ROBERTO SEMPREBENE Luiss “Guido Carli” in the opening scene [email protected] A multidisciplinary lens for understanding (video)ludic movies, including Super Mario Bros., Resident Evil and Scott Pilgrim vs. the World ABSTRACT The aim of this article is to create a multidisciplinary tool concerning the pas- sage from the medium of videogames to cinema. According to concepts taken from Media Studies, Cultural Studies, Semiotics and Game Studies, we will explore the multiple dimensions and the related connections that occur in the flm linearization of digital interaction: production issues, narrative and aesthetic elements, heuristics and mechanics in-game and on the big screen, and so on. The framework will be tested through three paradigmatic case studies: Super Mario, Resident Evil, and Scott Pilgrim vs. the World. The overall intent is to give scholars, and also practitioners, a holistic perspective on this peculiar type of crossmedia process, pointing out virtuous productive strategies as ruinous ones. KEYWORDS: ludic movies, Super Mario, Resident Evil, Scott Pilgrim vs. the World, multidisciplinary approach Enrico Gandolf & Roberto Semprebene http://www.gamejournal.it/4_gandolf_semprebene/ 37 Issue 04 – 2015 Play the game in the opening scene 1.INTRODUCTION In recent years movies and digital games have become increasingly intercon- nected. The variety of transposition and infuences from both sides has implied a strong plurality of forms and hybridizations. Digital entertainment has be- come a recurrent example of Hollywood trends only recently; the consequence is a heterogeneous landscape of products with a mixed value, from international co-production like Scott Pilgrim vs. -

Proquest Dissertations
Licensed to shill: How video and computer games tarnished the silver screen Item Type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Ruggill, Judd E. Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 30/09/2021 07:23:18 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/280772 LICENSED TO SHILL: HOW VIDEO AND COMPUTER GAMES TARNISHED THE SILVER SCREEN by Judd Ethan Ruggill Copyright © Judd Ethan Ruggill 2005 A Dissertation Submitted to the Faculty of the GRADUATE INTERDISCIPLINARY PROGRAM IN COMPARATIVE CULTURAL AND LITERARY STUDIES In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY WITH A MAJOR IN MEDIA ARTS In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2 00 5 UMI Number: 3158216 Copyright 2005 by Ruggill, Judd Ethan All rights reserved. INFORMATION TO USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleed-through, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. UMI UMI Microform 3158216 Copyright 2005 by ProQuest Information and Learning Company. All rights reserved.