Paysage Multicoques
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
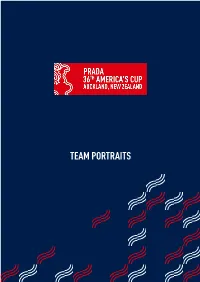
Team Portraits Emirates Team New Zealand - Defender
TEAM PORTRAITS EMIRATES TEAM NEW ZEALAND - DEFENDER PETER BURLING - SKIPPER AND BLAIR TUKE - FLIGHT CONTROL NATIONALITY New Zealand HELMSMAN HOME TOWN Kerikeri NATIONALITY New Zealand AGE 31 HOME TOWN Tauranga HEIGHT 181cm AGE 29 WEIGHT 78kg HEIGHT 187cm WEIGHT 82kg CAREER HIGHLIGHTS − 2012 Olympics, London- Silver medal 49er CAREER HIGHLIGHTS − 2016 Olympics, Rio- Gold medal 49er − 2012 Olympics, London- Silver medal 49er − 6x 49er World Champions − 2016 Olympics, Rio- Gold medal 49er − America’s Cup winner 2017 with ETNZ − 6x 49er World Champions − 2nd- 2017/18 Volvo Ocean Race − America’s Cup winner 2017 with ETNZ − 2nd- 2014 A class World Champs − 3rd- 2018 A class World Champs PATHWAY TO AMERICA’S CUP Red Bull Youth America’s Cup winner with NZL Sailing Team and 49er Sailing pre 2013. PATHWAY TO AMERICA’S CUP Red Bull Youth America’s Cup winner with NZL AMERICA’S CUP CAREER Sailing Team and 49er Sailing pre 2013. Joined team in 2013. AMERICA’S CUP CAREER DEFINING MOMENT IN CAREER Joined ETNZ at the end of 2013 after the America’s Cup in San Francisco. Flight controller and Cyclor Olympic success. at the 35th America’s Cup in Bermuda. PEOPLE WHO HAVE INFLUENCED YOU DEFINING MOMENT IN CAREER Too hard to name one, and Kiwi excelling on the Silver medal at the 2012 Summer Olympics in world stage. London. PERSONAL INTERESTS PEOPLE WHO HAVE INFLUENCED YOU Diving, surfing , mountain biking, conservation, etc. Family, friends and anyone who pushes them- selves/the boundaries in their given field. INSTAGRAM PROFILE NAME @peteburling Especially Kiwis who represent NZ and excel on the world stage. -
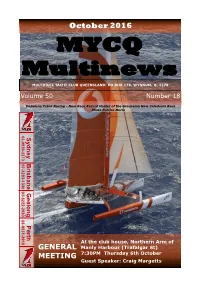
October 2016
October 2016 MULTIHULL YACHT CLUB QUEENSLAND: PO BOX 178, WYNNUM. Q. 4178 Volume 50 Number 18 Vodafone Frank Racing - New Race Record Holder of the Groupama New Caledonia Race Photo Patrice Morin 02 Sydney Brisbane Geelong Perth Geelong Brisbane Sydney - 9939 - 2273 07 2273 - 3203 - 1330 03 - 5222 - 2930 082930 - 9331 - 3910 3910 At the club house, Northern Arm of GENERAL Manly Harbour (Trafalgar St) MEETING 7:30PM Thursday 6th October Guest Speaker: Craig Margetts 2 Monthly Events 8-9th October St Helena Cup 15-16th October Spring Series Passage Series Combined Clubs Races 13 & 14 23rd October Triangles 29th-30th October Mooloolaba Weekend Commodore’s Comment By Bruce Wieland SPRING SERIES The new MYCQ Spring Series kicks off this coming weekend. The first leg is the St Helena Cup, followed by two very innovative courses the following weekend featuring optional simultaneous starts at either north or south of the river. The northern and southern courses overlap so both fleets will cross paths several times. The concept of these courses is the brainchild of Past Commodore Richard Jenkins and promises to be a lot of fun. The final weekend of the Spring Series will include the MCC triangles on Sunday the 23rd October. For the cruisers, THERE ARE SHORTENED COURSES, so find a crew and come sailing with the race fleet! OMR VIDEO The edited video of the OMR Review Committee information meeting is finally completed and is now available on the MYCQ website. Thanks to Sean for capturing the essence of the meeting, but a big thanks also to the OMR Committee members Alasdair Noble, Mike Hodges and Geoff Cruse for their easily understood presentation detailing the amendments to the OMR Rule. -
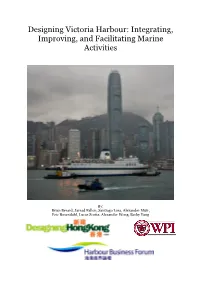
Designing Victoria Harbour: Integrating, Improving, and Facilitating Marine Activities
Designing Victoria Harbour: Integrating, Improving, and Facilitating Marine Activities By: Brian Berard, Jarrad Fallon, Santiago Lora, Alexander Muir, Eric Rosendahl, Lucas Scotta, Alexander Wong, Becky Yang CXP-1006 Designing Victoria Harbour: Integrating, Improving, and Facilitating Marine Activities An Interactive Qualifying Project Report Submitted to the Faculty of WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Bachelor of Science In cooperation with Designing Hong Kong, Ltd., Hong Kong Submitted on March 5, 2010 Sponsoring Agencies: Designing Hong Kong, Ltd. Harbour Business Forum On-Site Liaison: Paul Zimmerman, Convener of Designing Hong Kong Harbour District Submitted by: Brian Berard Eric Rosendahl Jarrad Fallon Lucas Scotta Santiago Lora Alexander Wong Alexander Muir Becky Yang Submitted to: Project Advisor: Creighton Peet, WPI Professor Project Co-advisor: Andrew Klein, WPI Assistant Professor Project Co-advisor: Kent Rissmiller, WPI Professor Abstract Victoria Harbour is one of Hong Kong‟s greatest assets; however, the balance between recreational and commercial uses of the harbour favours commercial uses. Our report, prepared for Designing Hong Kong Ltd., examines this imbalance from the marine perspective. We audited the 50km of waterfront twice and conducted interviews with major stakeholders to assess necessary improvements to land/water interfaces and to provide recommendations on improvements to the land/water interfaces with the goal of making Victoria Harbour a truly “living” harbour. ii Acknowledgements Our team would like to thank the many people that helped us over the course of this project. First, we would like to thank our sponsor, Paul Zimmerman, for his help and dedication throughout our project and for providing all of the resources and contacts that we required. -

All at Sea Southeast
SOUTHEAST FISHING TOURNAMENT PREVIEW HOW TO BUILD A ROD ALL AT SEA SOUTHEAST Inside: Youth Summer Camps Memorial Day in ST. MICHAELS SAVED by the Beacon Campaign MAY 2015 FREE ANYTHING H ANYTIME H ANYWHERE ANYTHING H ANYTIME H ANYWHERE Our extensive line of marine products, global distribution channels and prompt service has become the first choice amoung Captains, Engineers, Owners, and Charter Management Companies — worldwide. • New Build & Refit • Interior • Bunkering • Engineering • Dive/Water Sports • Yacht Agent • Deck • Safety • Concierge Services • Provisions • Logistics/Storage • Caribbean Mega Yacht Program www.yachtchandlers.com Yacht Chandlers Ft. Lauderdale Yacht Chandlers Store Yacht Chandlers SARL Main Office Lauderdale Marine Center Galerie du Port 3738 SW 30th Ave 2001 SW 20th St. #101 30 Rue Lacan Ft. Lauderdale, FL 33312 Ft. Lauderdale, FL 33315 06600 Antibes, France P: (954) 761-3463 P: (954) 463-4162 P: +33 (0)4 93 33 98 21 [email protected] [email protected] [email protected] Yacht Chandlers St.Thomas Yacht Chandlers N.V. Castaways Bar 5302 Yacht Haven Grande The Yacht Club at Isle de Sol The Yacht Club at Isle de Sol Suite 105 Simpson Bay, St. Maarten Simpson Bay, St. Maarten St. Thomas, VI 00802 Dutch Caribbean Dutch Caribbean P: (340) 779-2248 P: +1 (721) 587-3506 P: +1 (721) 587-3506 [email protected] [email protected] [email protected] and yes, even here ANYTHING H ANYTIME H ANYWHERE ANYTHING H ANYTIME H ANYWHERE Our extensive line of marine products, global distribution channels and prompt service has become the first choice amoung Captains, Engineers, Owners, and Charter Management Companies — worldwide. -

Yacht Brokerage Épisode 16 Autumn 2015
Yacht Brokerage Épisode 16 Autumn 2015 137ft “QUEEN NEFERTITI”, p. 11 Summary w Editorial . .2 w Brokerage News ............3 w Brokerage Index .......... 13 w Racing . 17 w Racing Index ............... 18 w Charter ....................... 19 w Central Agency Charter Fleet Update .... 21 w Charter Index .............. 27 w Upcoming Events ......... 31 w BGYB Contact .............. 32 BROKERAGE RACING SANSSOUCI STAR, p. 13 Simply click on photos to get more information CHARTER Ocean Saphire, p. 3 SALE, CHARTER & MANAGEMENT Also specialised in Transoceanic charter www.bernard-gallay.com Yacht Brokerage w EDITORIAL w © Alpina Watches - Carlo Borlenghi Swan 82 “Alpina” Photo Richard Sprang The Yacht Market Overview Bernard Gallay Sales – Despite the difficulties of the (nominated for the 2014 European Yacht of the include 88ft VITA DOLCE, 78ft SOUTHERN STAR, uncertain economic climate, the close of year), BGYB looks forward to a long and fruitful Ice 62 CANTELOUP VIII, Outremer 5X NO LIMIT and 2014 proved fruitful for BGYB. We marked collaboration with this innovative builder. finally, the Ultim 70 Trimaran ULTIM EMOTION (ex. GITANA 11), one of the first maxi trimarans avail- the second half of the year with numerous Our more recent activity likewise reflects BGYB’s able for private charter. Having won numerous sales, such as those of 105ft M/Y Classic position at the forefront of yacht brokerage, races in the last decade, ULTIM EMOTION has SPREZZATURA, M/Y Morgan 70 MATHIGO, with the sales of the S/Y Maxi 88 DEMOISELLES, established an exceptional racing pedigree and S/Y Swan 65 CASSIOPEIA and S/Y Racing 60ft Sloop GHEO, Lagoon 57 S/ Cat PLACE TO BE will be available to compete in a host of prestig- Imoca 60 DCNS. -

2016 Press Kit
2016 Press Kit Realteam Built around the crew which claimed the D35 championship and the Bol d’Or in 2012, Realteam is a professional sailing structure. The core team is essentially made up of former young talents from the Geneva Regatta Training Centre (CER). This outfit offers a true steppingstone for these top-level sportspeople and, beyond that, for sailing sports in Switzerland by capitalising on existing assets and opening up new horizons and challenges. In 2014, Realteam became an internationally recognized team after their 3rd place in the Extreme Sailing Series. Led by skipper Jérôme Clerc, this unique project in Switzerland ambitions to race in the D35 class, but also to start, as of Mai, the GC32 Racing Tour and the Swiss Flying Phantom Series onboard new foiling cats! The Team Esteban Garcia: Realteam Founder, D35 Helm (1970), Swiss Founder and chairman of Realstone Holding SA Group, Esteban Garcia has engaged in sailing competition in 2009 in the Copa del Rey in Palma de Mallorca, he won with Realstone-TP52-Matador. Passionate about sailing, he has supported the CER team since 2011. After an amazing winning season in 2012, he founded Realteam Sailing in 2013. Jérôme Clerc: Skipper (1980), Swiss Jérôme Clerc was the director of the Geneva Regatta Training Center, for 4 years. In 2012 he led his D35 team to victory just two years after they formed. In 2013, together with Esteban Garcia, he created Realteam. Denis Girardet: Tactician Loic Forestier: Helm&Trimmer (1975), Swiss (1986), Swiss Jeff Kerleguer: Technical manager Cédric Schmidt: Trimmer (1975), French (1988), Swiss Bruno Barbarin: Tactician Rémi Aeschimann: Bowman (1980), French (1992), Swiss Thierry Wasem: Trimmer&Bowman (1982), Swiss 1 Décision 35 (D35) Designed by Sébastien Schmidt in 2004, the Decision 35 (D35) is a demanding boat exclusively meant for competition. -

The 45Th Annual
presents the 45th Annual 2017 TO BENEFIT NANTUCKET COMMUNITY SAILING 2017 Welcome to the 14th Nantucket Race Week and the 45th Opera House Cup Regatta brought to you by Nantucket Community Sailing, the Nantucket Yacht Club and the Great Harbor Yacht Club. We are thrilled to have you with us for an unparalleled week of competitive sailing for all ages and abilities, complemented by a full roster of social events, and to share the beauty of Nantucket and her waters with you. Thank you for coming! This program celebrates the winners and participants from last year’s Nantucket Race Week and the Opera House Cup Regatta. We also try to give you everything you need to know about this year’s racing and social events. We are excited to welcome a tremendous fleet of boats, including the stately ELEONORA, the first ever schooner class for the Nantucket Regatta and Opera House Cup, the Wianno Seniors who first visited Nantucket for the Nantucket Regatta in the 1930s, and the beautiful classics who will be on display to the public for the 4th Classic Yacht Exhibition. In addition, we are honored to have such a talented group of sailors of all ages, ranging from our young Opti racers to the seasoned big-boat competitors. We are grateful to our celebrity tactician guests for donating their time and expertise for the IOD Celebrity Invitational. You will also learn about Nantucket Community Sailing and its services to the community. NCS’s mission is to provide Nantucket youth with affordable access to sailing with scholarships and free community outreach programs. -

CRUISING CAT with America’S Cup Pedigree
Inspired by AC cat designs, aggressive deck styling and a high overall power to weight ratio should make the MC260 a potent racer as well as cruiser. Photo courtesy Kevin Green CRUISING CAT with America’s Cup pedigree Catamarans have never been cooler, reports target boat speed greater than True Carbon finishes on work surfaces adds panache as KEVIN GREEN, as we can see from the busy Wind Speed when reaching in four knots well as weight saving in the lightweight boat. international scene, where the Extreme 40’s, plus). (above left) AC 45’s and D35’s are taking centre stage Galley half way down yet part of the open plan Living space saloon combines function and minimalist design on amid the backdrop of the upcoming America’s the MC260. (above centre and right) 2 Cup cat-fest. The MC 60 is a semi-custom boat so the interior can be tailored to owners’ needs, a major selling point for discerning O IT’S NO SURPRISE THAT cruising sailors, I think. Accommodation in these fast boats are inspiring this first boat comprises of four double performance cruising cabins equally sized between the hulls. board, the forward storage locker can be catamarans such as Interestingly, the forward cabin is set up 2 transformed into a crew cabin with a McConaghy’s MC 60. The with bunk beds, with the option of SSydney boat builder is forging ahead in 50 x 50cm entrance hatch on deck and a transforming the lower bunk into a portlight on the inside of the hull for its new foray into catamaran building 140cm wide double. -

Yacht Brokerage
Yacht Brokerage Autumn 2013 BAIA MARE, p. 4 Summary w Editorial . .2 w Brokerage News ............3 w Brokerage Index ............8 w Racing . 11 w Racing Index ............... 12 w Charter ....................... 13 w Racing Charter ............ 14 w Central Agency Charter Fleet Update .... 15 w Package Charter .......... 17 w Charter Index .............. 19 w ......... 23 Upcoming Events Épisode 13 w BGYB Contact .............. 24 Groupe Bel, p. 11 BROKERAGE RACING CHARTER © Gilles Martin-Raget SALE, CHARTER & MANAGEMENT Also specialised in Transoceanic charter www.bernard-gallay.com Yacht Brokerage w EDITORIAL w Photo Richard Sprang 2013 in review Bernard Gallay n general, 2013 has thus far proved to flourish year on year in terms of sales has doubled its fleet and now boasts Ito be a tough year for the Brokerage brokerage and charter. We are proud to yachts such as the164ft Classic MY HALAS, market. However, with a great deal of announce the central agency signings of SY Wally 100 DARK SHADOW, SY SW 94 RS hard work and effort, BGYB has produced several boats including 60ft SY GROUPE BEL, WINDFALL, SY Swan 82 ALPINA and the an increased number of sales compared 100ft MY SPREZZATURA, 60ft SY PARADOX 160ft SY Royal Huissman DWINGER. Equally to that of 2012. A positive first eight and 84ft SY LADY SAIL. impressive is the duplication of the number months allows us to believe that the year Carefully following the market during the of charter bookings since last year and we will end well and that we will continue to sales process and adapting the price to are negotiating even more central agency achieve a healthy amount of sales during suit the trends is the secret to success in signings as we speak. -

Download Episode
Yacht Brokerage Spring 2016 Dona del Mare, p. 6 Summary w Editorial . .2 w Brokerage News ............3 w Brokerage Index .......... 10 w Racing Index ............... 14 w Charter ....................... 15 w Charter Index .............. 23 w ......... 27 Upcoming Events Épisode 17 w .............. 28 BGYB Contact Photo: Blue Iprod Photo: Queen Nefertiti, p. 7 Simply click on photos to get more information BROKERAGE RACING CHARTER Stergann II, p. 21 SALE, CHARTER & MANAGEMENT Also specialised in Transoceanic charter www.bernard-gallay.com Yacht Brokerage w EDITORIAL w SW 102RS Farfalla, Courtesy of Southern Wind Shipyard Courtesy of Southern SW 102RS Farfalla, SW 102RS “Farfalla”, p.18 Photo Richard Sprang The Yacht Market Overview Bernard Gallay Having broken our yearly sales record some The Palma Superyacht Show 2016, for example, May 2016 will welcome the BGYB Open Day Sail, months before the close of 2015, the eventual will see BGYB exhibit S/Y 147ft MARI-CHA III, which takes place once every three years, and is end of the year was celebrated here at BGYB, as S/Y 97ft CELANDINE and S/Y 86ft BENIGUET. These a fantastic opportunity for journalists, photogra- we confirmed a final count of 24 sales. Although are some of the most prestigious vessels on the phers, and charter brokers to visit twelve of our extremely happy with this success, it has been market and will be sure to generate much interest, Central Agency charter yachts. achieved through various skills and expertise and ahead of the remaining events of 2016. The work This year we also have the pleasure of being it is this combination of which the BGYB sales and activity of the Sales department, proven in the Central Agent for charter of several yachts team are most proud. -

Extreme Sailing Series
ACT 2 - MUSCAT, 20 - 22 MARCH RACE VILLAGE INFORMATION THE WAVE, MUSCAT ACT 2: MUSCAT 6 1 > AL SEEB 3 2 9 4 8 18TH NOVEMBER STREET 5 RACECOURSE 7 MUSCAT < ALMOUJ GOLF COURSE TRY SAILING ALMOUJ GOLF COURSE RACECOURSE MAP KEY 1 RED BULL SKATE PARK 4 SHUTTLE FOR TRY SAILING 7 KIDS ZONE 2 CAR PARKING 5 VIEWING PLATFORM 8 TRY GOLF THE AWARD WINNING GLOBAL 3 FOOTBALL TOURNAMENT6 TRY SAILING 9 LAND ROVER EXPERIENTIAL ZONE EXTREME SAILING SERIES RACE VILLAGE ACTIVITIES FOOTBALL TOURNAMENT RED BULL SKATE PARK Enter your own team to compete for the top prize Obstacles, ramps, railings… Available for all IS BACK IN MUSCAT of OMR 500! There are 36 places available. skaters and roller bladders. Come and join us To register your team, please call 91395518. for a weekend of fun! THE WAVE, MUSCAT - AL MOUJ GOLF, 11 AM - 6 PM TRY SAILING FOOD STALLS Sailing is a fun and easy sport and teaches A selection of your favorite food and beverage HOST VENUE PARTNER LOCAL EVENT PARTNERS HOST VENUE SUPPLIERS transferable skills, such as teamwork, leadership retailers, will be on hand, to provide you and the and problem solving. Space is limited so be sure family with a delicious variety throughout the day. you register your interest on site! TRY GOLF A mini version of golf designed specifically for SERIES PARTNERS SERIES SUPPLIERS KIDS ZONE A variety of fun activities will be on offer for young children. Grab a club and enjoy something children including bouncy castles and face new! painting. Come and enjoy the fun! ABOUT THE EXTREME 3 WELCOME MESSAGE 4 1 BOOM MARK CAMERON Horizontal pole which extends along the bottom JAGUAR LAND ROVER GLOBAL of the mainsail, and helps pull the sails in and out. -

Design & Performance of a Wind and Solar-Powered Autonomous Surface Vehicle
DESIGN & PERFORMANCE OF A WIND AND SOLAR-POWERED AUTONOMOUS SURFACE VEHICLE by Patrick Forde Rynne A Thesis Submitted to the Faculty of The College of Computer Science and Engineering in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Florida Atlantic University Boca Raton, Florida December 2008 ABSTRACT Author: Patrick Forde Rynne Title: Design & Performance of a Wind and Solar-Powered Autonomous Surface Vehicle Thesis Advisor: Dr. Karl von Ellenrieder Degree: Master of Science Year: 2008 The primary objective of this research is the development a wind and solar- powered autonomous surface vehicle (WASP) for oceanographic measurements. This thesis presents the general design scheme, detailed aerodynamic and hydrodynamic aspects, sailing performance theory, and dynamic performance validation measurements obtained from a series of experiments. The WASP consists of a 4.2 meter long sailboat hull, a low-Reynolds number composite wing, a 2000 Watt-hour battery reservoir, a system of control actuators, a control system running on an embedded microprocessor, a suite of oceanographic sensors, and power regeneration from solar energy. The vehicle has a maximum speed of five knots and weighs approximately 350 kilograms. Results from four oceanographic missions that were conducted in the Port Everglades Intracoastal Waterway in Dania Beach Florida are presented. Water temperature, salinity and oxidation-reduction measurements recorded during these missions are also discussed. iii The combination of a mono-hull and solid wing in an autonomous system is a viable design for a long-range ocean observation platform. The results of four near-shore ocean observation missions illustrate the initial capabilities of the design.