Notice Explicative
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Nouvelle Carte Cantonale De La Haute-Marne À Compter De Mars 2015
15 - Canton de SAINT-DIZIER-3 VILLIERS CHANCENAY EN-LIEU PERTHES BETTANCOURT-LA FERREE HALLIGNICOURT 14 - Canton de SAINT-DIZIER-2 SAINT SAINT DIZIER DIZIER LANEUVILLE AU-PONT CHAMOUILLEY MOESLAINS Nouvelle carte cantonale de la Haute-Marne VALCOURT SAINT DIZIER ROCHES 13 - Canton de SAINT SUR-MARNE à compter de mars 2015 DIZIER-1 NARCY ECLARON HUMBECOURT EURVILLE BRAUCOURT BIENVILLE SAINTE-LIVIERE PREZ-SUR FONTAINES ALLICHAMPS MARNE SUR-MARNE TROISFONTAINES BAYARD LA-VILLE SUR SOMMEVILLE VILLIERS MARNE AUX-BOIS GOURZON LOUVEMONT CHEVILLON BRAUCOURT ATTANCOURT AVRAINVILLE FLORNOY 8 - Canton de EURVILLE-BIENVILLE PAROY RACHECOURT SUR SUR-MARNE SAULX DROYES FRAMPAS MAGNEUX PLANRUPT SOMMANCOURT BREUIL OSNE SUR-MARNE LE-VAL SAUDRON VOILLECOMTE CUREL EFFINCOURT WASSY BROUSSEVAL MAIZIERES VALLERET CHATONRUPT AUTIGNY-LE PUELLEMONTIER SOMMERMONT PETIT PANSEY MONTREUIL MONTIER FAYS AUTIGNY GILLAUME EN-DER SUR-BLAISE LE-GRAND VAUX-SUR DOMBLAIN LANEUVILLE THONNANCE-LES MONTREUIL ECHENAY CIRFONTAINES 17 - Canton de WASSY A-REMY BLAISE VECQUEVILLE JOINVILLE SUR EN-ORNOIS SOMMERMONT THONNANCE AINGOULAINCOURT LONGEVILLE BAILLY-AUX RACHECOURT GUINDRECOURT SUR-LA ROBERT CEFFONDS FORGES SUZEMONT AUX-ORMES HARMEVILLE LAINES MAGNY SUZANNECOURT DOULEVANT LE-PETIT SOULAINCOURT VILLE-EN NOMECOURT JOINVILLE SAILLY BLAISOIS POISSONS BRESSONCOURT THILLEUX LEZEVILLE MORANCOURT LANEUVILLE LOUZE DOMMARTIN RUPT AU-BOIS LE-FRANC NONCOURT GERMAY SUR-LE MERTRUD THONNANCE BROUTHIERES SAUVAGE MATHONS RONGEANT COURCELLES LES-MOULINS MAGNY SUR-BLAISE SAINT ROZIERES FRONVILLE -

Dossier Derog Carriere Fouvent
NEOMYS – Centre Ariane 240 rue de Cumène – 54 230 NEUVES-MAISONS Tél. : 03 83 23 36 92 – E-mail : [email protected] SIRET : 432 117 315 00023 – APE : 913E Entreprise SAS BONGARZONE PROJET DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION D'UNE CARRIERE A FOUVENT-SAINT-ANDOCHE (70) Demande d’autorisation exceptionnelle portant sur des spécimens d’espèces animales protégées Délaissé périphérique ouest (Photo : J. Piquet) NEOMYS – Juin 2013 Projet de renouvellement et d’extension de carrière (Fouvent-Saint-Andoche - 70). Neomys – Juin 2013 NEOMYS Entreprise SAS BONGARZONE PROJET DE RENOUVELLEMENT ET D’EXTENSION D'UNE CARRIERE A FOUVENT-SAINT-ANDOCHE (70) Demande d’autorisation exceptionnelle portant sur des spécimens d’espèces animales protégées Coordination de l’étude Jérôme PIQUET - Neomys Rédaction Delphine PABST – Cirse Environnement & Marie-Julia GOUBOT - GEONESS (présentation et justification du projet) Jérôme PIQUET - Neomys NEOMYS – Juin 2013 Projet de renouvellement et d’extension de carrière (Fouvent-Saint-Andoche - 70). 2 Neomys – Juin 2013 Sommaire OBJET DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DE DESTRUCTION ................................................... 7 1ERE PARTIE : JUSTIFICATION ET PRESENTATION DU PROJET ................................................... 8 I. PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE ............................................................................................ 8 I.1. Localisation géographique du projet .................................................................................................................. 8 I.2. -

La Guerre De 10 Ans (1634-1644) a Ray Sur Saone Lavoncourt Et Les Villages Voisins
LA GUERRE DE 10 ANS (1634-1644) A RAY SUR SAONE LAVONCOURT ET LES VILLAGES VOISINS Nous avons déjà beaucoup parlé de la guerre de 10 ans. D’anciens documents trouvés dans les archives du château de Ray permettent de compléter sur un plan très local les différentes informations que l’on en avait. Le général Weimar, allié des français, avait donné rendez vous à ses troupes à Dampierre sur Salon le 13 juin 1636. Le 19 juin, Champlitte était assiégé par 8 000 hommes de pied, 5 000 chevaux et 19 pièces de canon. Il lui fallu payer 30 000 écus et donner en otage 6 de ses bourgeois pour échapper à la destruction. Les troupes de Weimar se séparèrent à Membrey. Les français pillèrent, brûlèrent et massacrèrent les habitants de Lavoncourt, deux ou trois réussirent à s’échapper pour se réfugier dans les carrières alentours Du château fort de Lavoncourt, construit sur les bords de la Gourgeonne par Henri de Vergy, il ne reste aujourd’hui plus rien qu’un amas de pierres recouvert de terre formant une élévation d’environ cinq mètres appelée la Motte. Le second groupe tenta de forcer le gué de Savoyeux, défendu par les dragons de Mercy qui avait rangé ses troupes près de Ferrières les Ray. C’est à Recologne que Weimar passa la Saône, Mercy fut mis en déroute après 4 batailles acharnées. 1 800 chevaux étaient tombés au combat, 1 000 prisonniers furent faits. Peu après, la courtine du château de Ray se trouva transpercée par 50 volées de canon. -
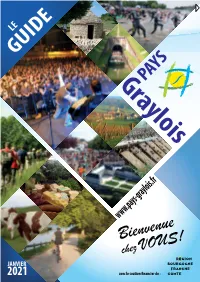
Guide D'accueil
www.pays-graylois.fr Haute-Marne L a J o u a n n e Côte d’Or aône S La La © IGN - BDCARTHAGE ® 0 10 km on gn L’O Jura Doubs SOMMAIRE P6-7 Autres numéros utiles P22-23 LES MAIRIES & LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES LES ÉTUDES NOTARIALES LES BAILLEURS SOCIAUX Habitat 70 est le premier bailleur social du 1 rue de l’Europe département. La structure gère un patrimoine de près 70100 GRAY de 12.000 logements loués à des ménages contre un 03 84 96 13 70 loyer modéré, sous conditions de ressources. www.habitat70.fr Vous êtes peut-être éligible à une prime 8, rue Jean Mourey 70180 DAMPIERRE-SUR-SALON d’installation pouvant 03.84.67.13.74 atteindre 5.000 €. [email protected] * sous conditions d’éligibilité et dans la limite des crédits disponibles LES AGENCES IMMOBILIÈRES De nombreuses agences immobilères sont à l’écoute de votre projet. DES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ « Logements Pour Tous » est un dispositif destiné à favoriser l’autonomie des personnes à mobilité réduite. Il s’agit d’une prime pour la réalisation de travaux, permettant l’aménagement d’un logement (neuf ou ancien) pour créer une unité UN PROJET DE de vie adaptée (ex : circulation et manœuvre d’un fauteuil roulant, remplacement d’une baignoire par RÉNOVATION une douche à fond plat, accessibilité des installations ÉNERGÉTIQUE ? électriques…). POUR PLUS D’INFORMATIONS 03.84.75.38.56 FAIRE, c’est le service public qui vous guide [email protected] dans vos travaux de rénovation énergétique. www.faire.gouv.fr DES STRUCTURES POUR VOUS ACCOMPAGNER LOCALEMENT Structure de conseils personnalisés en amont [email protected] 03 84 92 15 29 de vos projets : travaux les plus pertinents, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30 choix des professionnels, équipements et Permanence un mercredi par mois dans matériaux adaptés, solutions de nancements,.. -

Boucle Des Plages
Champlitte La Haute-Saône à Vélo Delain Achey Denèvre Montot i DAMPIERRE- » à voir sur et autour de la boucle » SUR-SALON RIGNY CHARGEY-lès-GRAY DAMPIERRE-SUR-SALON Autet - Retable de l’église Saint-Étienne - 6 calvaires dont un de 1539 - Mairie-lavoir (1828) - Eglise romane - Ferme de la Marquise, élevage de bisons en plein air - Ancienne commanderie Rigny Vars - Maison et statue de Charles-Maurice Couyba, GRAY - Fontaines-lavoirs Oyrières poète et homme politique - Ville fleurie AUTREY-lès-GRAY AUTET - Ancien château (Musée Baron Martin) - Eglise Saint-Didier Beaujeu, Saint Vallier- - Plage - Eglise Basilique Notre-Dame Auvet et la Pierrejux et Quitteur Chapelotte Montureux-et- - Château - Hôtel de Ville VARS Prantigny - La ville haute de Gray - Calvaire croix du Bachelier BEAUJEU, ST-VALLIER- - Musée de l’Espéranto Chargey-lès-Gray Autrey- PIERREJUX ET QUITTEUR OYRIÈRES Ecluse sur la Sâone lès-Gray - Eglise Notre Dame de l’Assomption et son vitrail - Fontaine-lavoir Rigny - Mairie-lavoir ARC-lès-GRAY - Donjon - Lavoirs - Maison de l’Orangerie - Parc Lamugnière : l’Art Nouveau MONTOT ACHEY - Maison Espagnole de la 3ème République - Ensemble du village - Eglise Arc-lès-Gray Services GRAY Alimentation générale Dampierre-sur-Salon, Arc-lès-Gray, Gray Licence SCAN 100® n° 2011-CISE29-10 ©IGN - FRANCE 2011 Boulangerie - Dampierre-sur-Salon, Arc-lès-Gray, Chargey-lès-Gray, reproduction interdite pâtisserie Gray, Oyrières, Beaujeu-St-Vallier-Pierrejux et Quitteur Tabac-presse Dampierre-sur-Salon, Arc-lès-Gray, Gray OFFICES DE TOURISME CONSEIL GÉNÉRAL -Rue de la République DE LA HAUTE-SAÔNE Gray Dampierre-sur-Salon Boucherie-charcuterie Dampierre-sur-Salon, Gray 70600 CHAMPLITTE Direction de l’Aménagement Café Dampierre-sur-Salon, Arc-lès-Gray, Gray, Rigny, Tél. -

Les Boucles Cyclables Véloroute V50 « Charles Le Téméraire »
Véloroute V50 « Charles le Téméraire » Traversant la Haute-Saône sur 140 kilomètres, la véloroute Charles le Téméraire vous fera découvrir des paysages uniques le long des rives de Saône. Empruntez les anciens che- mins de halage et laissez-vous charmer par les petits villages de caractère, les châteaux et sites remarquables ponctuant l’itinéraire. Protez-en également pour faire connais- sance avec les usagers de la voie d’eau : promeneurs, pêcheurs et plaisanciers ! The Charles Téméraire cycle-route Crossing 140 kilometers of the Haute-Saône,the Charles Téméraire cycle route lets you discover the unique scenery along the banks of the Saône. Take the old towpaths and let yourself be charmed by the little villages, the chateaus and unforgettable sights which punctuate the route. Take the opportunity,also, to meet the oth- er river and canal-users: hikers,sher- légende men and boaters! Tourist Information Oce Characteristic Comtoise Hamlet Location vélos Bicycle hire Bicycle repairs Accès Wi-Fi Wi-Fi available Distributeur de billets Cash distributer Bar / Restaurant Bar restaurant Chauvirey-le-Vieil Commerces Business or shop Pharmacie Chemist Hébergement vélos Accommodation Boucles cyclables Leffond Confracourt Champlitte Vesoul Recologne-lès-Ray Gray 6 Boucle des verriers 41 km Les boucles cyclables 1 Boucle d’Amance 44 km Aménagées par le Conseil général de Haute-Saône, les 21 boucles cyclables empruntent des routes à faible circulation. Jalonnées dans les 2 sens, 13 Boucle des vanniers 33 km elles vous permettront de découvrir en toute sécurité les richesses du département ! Retrouvez le détail de chacune des boucles dans les 2 Boucle de Saint-Valère 22 km ches pratiques disponibles dans les Ofces de Tourisme et auprès des prestataires de la vallée de la Saône. -

Contribution À La Connaissance De La Flore De Haute-Saône Matériaux Pour Un Inventaire De La Flore Vasculaire De Haute-Saône (2)
Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne, 3, 2005 – Société Botanique de Franche-Comté Contribution à la connaissance de la flore de Haute-Saône Matériaux pour un inventaire de la flore vasculaire de Haute-Saône (2) par Jean-Christophe Weidmann, avec la participation de C. Brun, M. Demesy, Y. Ferrez, P. Henriot, H. Pinston, A. Piguet, J.-M. Royer et P. Viain. J.-C. Weidmann, Villa Saint Charles, 9 rue Paul Dubourg, F-25720 Beure Courriel : [email protected] Résumé – L’article présente des données complémentaires à celles de FERREZ (2003) et ajoute plusieurs plantes nouvellement découvertes ou redécouvertes pour le département de Haute-Saône. Mots-clés : Haute-Saône, inventaire floristique. Introduction retrouvées récemment. Quelques comm. pers.). Cet arbre n’était pas espèces sont présentées en raison de connu par les anciens floristes. Cet article fait suite à celui de FERREZ la méconnaissance actuelle qui les (2003) et se place dans la lignée de caractérise pour le département. ● Actaea spicata L. ceux de PIGUET (1995) et FILET (1996a ; Cette renonculacée est observée à 1997b ; 2003). Nous présentons ici Les espèces sont traitées par ordre Saulnot (environs du hameau de les données les plus remarquables de alphabétique. Un « ✤ » indique Corcelles) dans le canton d’Héri- la flore vasculaire récoltées depuis celles traitées dans l’Atlas des espè- court. R.L. la signalaient dans cette 1997 au cours de sorties libres et ces rares ou protégées de Franche- localité et les environs d’Héricourt plus occasionnellement au cours Comté. Un « _ » signale les espè- (Couthenans, Chavanne) et de de travaux de stage universitaire ces traitées par FERREZ (2003). -

Annuaire Des Communes Et Intercommunalités Du Département De La Haute-Marne
Direction de la citoyenneté et de la légalité Annuaire des communes et intercommunalités du département de la Haute-Marne Version communicable Mise à jour au 25 août 2020 . 1/ Coordonnées des communes . Po5. Tot. Commune Arr. Adresse CP Civ Maire Tél. Mairie Courriel mairie Horaires du secrétariat EPCI-FP "$"$ Mardi 3 1343$-1*4 CA de Ageville 317 C Grande rue !"3#$ M u% U'(CHE) $3."!.31.7*.$+ [email protected] Jeudi 3 *41!-1"4 /endredi 3 *41!-1"4 Chaumont Aigremont "$ ) Grand rue !"#$$ M 'o.ert LEFAI/RE $3."!.0$.1!.17 mairie-lariviere-arnoncourt,1anadoo.-r Jeudi 3 1$-1"4 CCSF 1* rue du Général )undi 3 134-174 Aillianville 1+7 C !"7$$ M Phili55e LE'6&7 $3."!.31.!+.73 [email protected] CCMR (alme Jeudi 3 *4-114#! rue 6livier de Aingoulaincourt 13 (8 !""3$ M Paul DA/I8 $3."!.!!.0".07 mairie.aingoulaincourt,orange.-r Jeudi 3 *43$-1$43$ CC92C /é:in 2ean-Michel Ai:anville 3* C " rue de l;église !"1"$ M $+.*$.7$.+!.03 mairie..u<ieres,1anadoo.-r Mardi 3 1343$-1#43$ CC3F &ERBE' Mardi 3 1#43$-1043$ CA de (aint- Allicham5s 3!1 (8 Place du 1#-2uillet !"13$ $3."!.!!.$7.7$ commune-d-allic4amps,orange.-r Jeudi 3 1#43$-1043$ 8i:ier Am.onville *# (8 7 Grande rue !"11$ M Hu.ert LESE&' $3."!.$".#3.#0 [email protected] Jeudi 3 04-1"4 CC92C )undi 3 *43$-1"4 = 1343$-1*4 Andelot- 3+ rue 8ivision Marie-France Mardi 3 *43$-1"4 = 1343$-1*4 **$ C !"7$$ Mme $3."!.01.33.31 mairie.andelot,1anadoo.-r Mercredi 3 *43$-1"4 = 1343$-1*4 CCMR Blanc4eville )eclerc 26FF'6@ Jeudi 3 *43$-1"4 = 1343$-1*4 /endredi 3 *43$-1143$ Andill%-en-Bassigny 1$0 -

Bus-Vesoul-Gray.Pdf
GRAY CULMONT-CHALINDREY Culmont-Chalindrey Gray VESOUL GRAY Vesoul Gray N’oubliez pas de vous reporter aux renvois. N’oubliez pas de vous reporter aux renvois. N’oubliez pas de vous reporter aux renvois. N’oubliez pas de vous reporter aux renvois. CULMONT- GRAY VESOUL GRAY Numéro de circulation 33621 33619 33623 33625 33631 Numéro de circulation 33622 33628 33634 33632 33636 CHALINDREY Numéro de circulation 33561 33563 33565 33567 Numéro de circulation 33562 33568 33564 33566 é ilit Jours de circulation Lun à Lun à Lun à Jours de circulation Lun à Lun, Mar Jours de circulation Mar à Lun à Lun à Lun à Jours de circulation Lun à Lun à Lun à Lun à b ib Sam* Jeu* Mer* Lun* Ven* *Sauf jours fériés Ven* Ven* Ven* *Sauf jours fériés Sam* Jeu, Ven* *Sauf jours fériés Ven* Sam* Ven* Ven* *Sauf jours fériés Ven* Sam* Ven* Jeu* Renvois Renvois guichet distributeur accessibilité 3 1 3 2 guichet distributeur accessibilité 3 Renvois Renvois guichet distributeur accessibilité 1 2 3 3 4 3 guichet distributeur accessibilité 3 4 3 3 Chargey- Chalindrey Vesoul (Lycée Haberges) 12.10 18.10 GRAY (Gare Routière) 05.56 08.14 12.07 17.07 Noidans- Arc-les-Gray QQQCULMONT-CHALINDREY (SNCF) 06.20 GRAY (Gare Routière) 07.30 12.05 17.05 18.05 18.05 les-Gray Vesoul (Lycée Belin) 12.15 18.15 Gray (Centre radiologique) (X) les-Vesoul Chalindrey (République) 06.21 Gray (Tilleuls) 12.15 17.15 18.15 18.15 QQQVESOUL (SNCF) 06.20 12.30 12.30 18.30 Gray (ZAC Gray Sud) (X) Vesoul (rue Parmentier) 06.23 12.33 12.33 18.33 Gray (Tilleuls) 06.06 08.24 12.17 1717 Chalindrey (Verdun) -

Les Conseillers Communautaires Communauté De Communes Des 4 Rivières
Les Conseillers Communautaires Communauté de Communes des 4 Rivières COMMUNES Prénom Nom Titre CC4R ACHEY Claude BOURRIER Maire Conseiller communautaire titulaire ACHEY Serge MARCEAUX 1er Adjoint Conseiller communautaire suppléant ARGILLIÈRES Bernard THIERRY Maire Membre du Bureau ARGILLIÈRES Jacques BUFFET 1er Adjoint Conseiller communautaire suppléant AUTET Jean-Pierre FOUQUET Maire Conseiller communautaire titulaire AUTET Michel MAUCLAIR 1er Adjoint Conseiller communautaire suppléant BEAUJEU Alain BERTHET Maire Conseiller communautaire titulaire BEAUJEU Denis PARRA 1er Adjoint Conseiller communautaire titulaire BEAUJEU Roland FASSENET 2ème Adjoint 3ème Vice-Président BEAUJEU Sylvie BOUVERET Maire délégué de Quitteur Membre du Bureau BEAUJEU Jean-Michel PHILIPPE Conseiller Municipal Conseiller communautaire titulaire BROTTE-LÈS-RAY Pierre PATÉ Maire Conseiller communautaire titulaire BROTTE-LÈS-RAY Maurice BIDON 1er Adjoint Conseiller communautaire suppléant CHAMPLITTE Gilles TEUSCHER Maire 1er Vice-Président CHAMPLITTE Philippe MARTARESCHE 1er Adjoint Membre du Bureau CHAMPLITTE Daniel GODARD 2ème Adjoint Conseiller communautaire titulaire CHAMPLITTE Christian GUILLAUME 3ème Adjoint Conseiller communautaire titulaire CHAMPLITTE Nicole CLERGET 5ème Adjointe Conseiller communautaire titulaire CHAMPLITTE Jean-Marc ANGELOT Maire délégué de Leffond Membre du Bureau CHAMPLITTE Agathe BONNET Conseillère Municipale Conseiller communautaire titulaire CHAMPLITTE Chantal VOISIN Maire délégué de Margilley Conseiller communautaire titulaire CHAMPLITTE -

DDRM De La Haute Saône
PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS Édition 2013 Préface Des événements récents ont montré que la France n'est pas à l'abri de Dépourvu de caractère réglementaire, non opposable aux tiers, il situations exceptionnelles notamment climatiques, qui peuvent avoir de constitue la contribution des services de l'État à la connaissance de lourdes conséquences sur la vie humaine et sur l'environnement. l'aléa et il est destiné à partager l'information avec les élus, les acteurs du terrain et les citoyens pour une meilleure prévention des risques. L'information préventive sur les risques majeurs est un droit inscrit dans le code de l'environnement qui dispose dans son article L.125-2 que "les La version 2013 dresse un état des lieux des risques majeurs dans le citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils département en fonction des connaissances actuelles et des données sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de collectées régulièrement par les services. sauvegarde qui les concernent. " Consultable dans chaque mairie et sur le site Internet de la préfecture, il Plus récemment, la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 Août constitue également l'un des principaux outils pour le maire dans 2004 place le citoyen au cœur de la sécurité civile. l'élaboration de son document d'information communale sur les risques majeurs (DICRIM) et de son plan communal de sauvegarde (PCS). Cela signifie qu'il est essentiel que chaque citoyen développe une véritable culture des risques. -

Fiche Horaire Ligne : 03 14 - CHAMPLITTE - DAMPIERRE/SALON
Fiche Horaire Ligne : 03_01 - MERCEY - DAMPIERRE/SALON Validité à partir du 04/09/2017 Itinéraire : Ligne scolaire Itinéraires 03-01A1 Commune Point d'arrêt lmmjv--- MERCEY SUR SAONE Village 07:21 MOTEY SUR SAONE Village 07:24 SEVEUX La Vaivre 07:27 SAVOYEUX Village 07:37 AUTET Foyer comtois 07:44 DAMPIERRE SUR SALON Collège 07:50 Transporteur : 33 places DANH TOURISME Direction des Mobilités du Quotidien | Unité Territoriale de la Haute-Saône | Espace 70 - 4A Rue de l'industrie 70000 Vesoul | Tél: 03.84.95.78.80 | Mél: [email protected] Fiche Horaire Ligne : 03_01 - MERCEY - DAMPIERRE/SALON Validité à partir du 04/09/2017 Itinéraire : Ligne scolaire Itinéraires 03-01R1 03-01R1 Commune Point d'arrêt --m----- lm-jv--- DAMPIERRE SUR SALON Collège 12:10 17:10 AUTET Foyer comtois 12:16 17:16 SAVOYEUX Village 12:23 17:23 SEVEUX La Vaivre 12:33 17:33 MOTEY SUR SAONE Village 12:36 17:36 MERCEY SUR SAONE Village 12:39 17:39 Transporteur : 33 places DANH TOURISME Direction des Mobilités du Quotidien | Unité Territoriale de la Haute-Saône | Espace 70 - 4A Rue de l'industrie 70000 Vesoul | Tél: 03.84.95.78.80 | Mél: [email protected] Fiche Horaire Ligne : 03_02 - VEREUX - DAMPIERRE/SALON Validité à partir du 04/09/2017 Itinéraire : Ligne scolaire Itinéraires 03-02A1 Commune Point d'arrêt lmmjv--- VEREUX Eglise 07:16 Gare 07:18 BEAUJEU ST VALLIER PIERREJUX St Vallier 07:27 Mairie 07:30 Pierrejux 07:34 Quitteur école 07:37 AUTET Village 07:43 DAMPIERRE SUR SALON Collège 07:50 Transporteur : 63 places DANH TOURISME Direction des Mobilités