Françoise Bonardel Gilbert Durand / Henry Corbin : Un Pacte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pedagogy of Welcoming: Reflections on the Poetics of Space by Bachelard
ENSAIO DOI: https://doi.org/10.24933/horizontes.v39i1.1229 Pedagogy of welcoming: reflections on the poetics of space by Bachelard William Gustavo Machado 1 Gabriel Kafure da Rocha 2 Introduction The present work is developed around the issue of welcoming in education; more specifically, based on the studies of imagination by the philosopher Gaston Bachelard (1884 – 1962), this is a philosophical reflection with the intention of opening up to the new, to the possibilities that may derive from this process of imagination of the function of dwelling. Therefore, as usual in philosophy, the work developed is a bibliographic review supported by practical examples of education, namely, reflections from a philosopher, interweaving with others from the same or other areas to re-think principles. Through this research, it is understood that philosophizing about an attachment pedagogy, with regard to its role of receiving the child-being in the world, is fundamental and, perhaps, an endless exercise, given that cultures move, in time and space, and the beings that come into the world always present unique demands. In this view, the work The Poetics of Space (Originally published in 1957) by Gaston Bachelard is used to support the philosophical exercise that here treads on such insecure and fertile grounds as that of the imaginary, imagination, and dreams. The psychosociality of non-formal education spaces Starting from the idea of welcoming to opening as pedagogical possibilities, Bachelard shows himself to be a philosopher who can be understood -

Gilbert Durand's Imaginaireand Mark Johnson's Image Schemata
GESTALT THEORY, DOI 10.2478/gth-2019-0020 © 2019 (ISSN 2519-5808); Vol. 41, No. 2, 217–230 Original Contributions - Originalbeiträge Benito García-Valero Bridging Heterodox Views on Language and Symbols: Gilbert Durand’s Imaginaire and Mark Johnson’s Image Schemata Introduction In recent decades, there has been a great deal of progress in the research concerning our brain and how it ‘images’ reality. The fact that ‘imaging’ may also be at the core of logic or language, traditionally considering purely abstract and conceptual tools, transforms images into a form of knowledge. In this sense, there are some important theories on the study of images and imagination that have not yet been linked to embodied cognition. This paper analyzes Gilbert Durand’s1 anticipa- tions to Mark Johnson’s theories about imagination and the formation of mean- ingful structures because, to my mind, the theoretical ground of Durand’s model is of great importance in analyzing literature (and other arts) within a cognitive frame, to which Durand would have unconsciously contributed. For the purposes of this paper, I am using a comparative methodology that will contrast Durand’s anthropological thesis about symbolism and Johnson’s cognitive approach to language. The aim of this comparison is twofold: first, to show that the use of different terms to study the same phenomena does not alter commonly accepted positions in important theories regarding human representative tools and second, to bridge concepts from different research fields in the structural analysis of the roots of human language and symbolic representation. These aims are based on the rediscovery of Durand’s contributions of the physical and perceptual basis of meaning and symbolization processes. -

Gilbert Durand Ou Le Discours De La Mythode
Philosophie Philosophie à mes chats. Contre certains spiritualistes aux arguments bas Gilbert Durand (1921-2012) de plafond, écoutons aussi les matérialistes. Comme vous, « je ne sais ni lire ni écrire » ; mais je me soigne. J’indique simple- ou le discours de la mythode ment qu’il existe d’autres médecines, à côté de la marchandise Hommage au maître de l’imaginaire spirituellement correcte. Par Frédéric Vincent L’histoire veut qu’à l’heure de la mort du très très vieux Démocrite, sa sœur – alors qu’on était en pleins préparatifs des Thesmophories, fête religieuse de grande importance – se enio loci ignoto » : telle penchant vers son frère, lui exprima le désir qu’il voulût bien « Gest l’inscription que l’on attendre la fin des cérémonies pour décider (comme seul un sage peut observer sur la stèle surplom- saurait le faire) de passer de l’autre côté du monde. Profondément bant la tombe d’Olga Föbe- respectueux des obligations religieuses de sa cité, Démocrite se Kapteyn, fondatrice du célèbre fit apporter chaque matin des pains chauds. Respirant de temps cercle Eranos à Ascona (Suisse), en temps leur fumet, le bonhomme se maintint en vie et, les et qui rappelle que les lieux sont trois jours sacrés s’étant écoulés, se laissa enfin glisser vers le bien souvent habités par des néant d’où l’on ne revient pas. génies inconnus ou méconnus. Certes, Eranos compte en son Eliade, Durand et Corbin à Eranos Pour qu’une histoire soit vraie, il suffit d’y croire. À défaut, on sein les illustres Corbin, Jung, dira que tout est symbole. -

Hakl-Eranos-Chap.-Henry-Corbin.Pdf
THE HEYDAY BEGINS 161 and Radin always remained in friendly contact, although Radin was very critical ofJung's literary "excursions" into anthropology. Already in the 1920s Paul Radin had earned high praise from recognized experts uch as Marcel Mauss and John Dewey. In the context of Eranos, what made Radin tand out from his more "esoteric" Eranos colleagues was his skepticism and his thor ough rationalism. 54 This must naturally have brought him into conflict with Olga Probe, whose hyper-energetic "mystic-obsessive" character was not at all to his taste. 55 But all of this was outweighed by his jovial personality. Eliade described Radin as always laughing and endowed with an enormous belly. He reported that the previous year his wife had one night seen a "likeable" dragon in the garden of the Casa Gabriella, but that he had not returned.56 Stanley Diamond, editor of the Festschrift for Radin's seventieth birthday, even wrote: "[Radin] has a sorcerer's charm, undimmed by age; he bewitches:'57 It was not without reason that he contributed to the volume entitled Der Gottliche Schelm (The .:ii vine rascal). 58 His life's journey also took him to the universities of Michigan, Berkeley, and Brandeis. Always his goal was to remain independent. In addition to his other activi j es he acted as an adviser to Mary Mellon and later to the Bollingen Foundation. From :952 to 1956 he lived in Lugano. Henry Corbin and Sufism : must now speak in greater detail about Henry Corbin,59 who attended Eranos every -car between 1949 and 1978.60 His influence on Eranos can hardly be overestimated and ...:i.rnlved many of the participants, including Mircea Eliade, whom he first brought to :=.:-anos as a speaker, Gilbert Durand, Antoine Faivre, David Miller, and the archetypal ~;ychologist and Jung pupil James Hillman. -

MYTH-HERMENEUTICS of HOLLYWOODIAN FILMS ACCORDING to the IMAGINARY of DOI 10.11606/Issn.2525-3123
MYTH-HERMENEUTICS OF HOLLYWOODIAN FILMS ACCORDING TO THE IMAGINARY OF DOI 10.11606/issn.2525-3123. gis.2021.175852 GILBERT DURAND ORCID ROGÉRIO GONÇALVES DE CARVALHO https://orcid.org/0000-0002-5390-3102 Independent researcher, Sao Paulo, SP, Brazil ABSTRACT This text aims to present an anthropological interpretation of the imaginary of cinema, specifically in films mostly produced in Hollywood. To this end, we will apply a mythological hermeneutics developed by the anthropologist Gilbert Durand, which configures KEYWORDS three archetypal imaginary structures that serve as a Cinema; Anthropology of kind of guide. The itinerary must follow the imaginary the imaginary; regimes thought by Durand, which are the diurnal Myth- regime of heroic structure, the nocturnal regime hermeneutics; Imaginary regimes; of mystical structure and the nocturnal regime of Gilbert Durand. synthetic or dramatic structure. INTRODUCTION Cinema is one of the most current languages to fuel our imagination in the universe of the arts. If, on the one hand, it inspires and dynamizes imagery already explored in other arts, on the other hand, it uses an open discursive strategy for many possibilities of anthropological interpretation. For this purpose, we use very specific hermeneutics, called “myth-herme- neutics”. In particular, the mythology of Gilbert Durand brings to the horizon of interpretation the imaginary connected to the symbolic and archetypal aspect. In a sense, Durand created a “guide” of the anthropological 1 São Paulo, v. 6, n.1: e-175852, 2021 imagination that contributes to understanding some basic structures that are repeated in the diversity of cultural products, including the cinema. In The Anthropological Structures of the Imaginary, Durand (2002) pres- ents the imaginary subjected to two regimes related to time: the diurnal regime of the image and the nocturnal regime of the image. -

Del Caos Al Microcosmos... Gilbert Durand Marius
DEL CAOS AL MICROCOSMOS... ...del Caos a la Societat de la Informació... ...del Caos a l’ordre de la Biblioteca… ...del Big Bang a la Ciència del 2004... ...dels quatre elements a la Creació... simbologia mitologia tradició imaginari mites, relats, llegendes, folklore, antropologia, història de les religions, místics, heterodoxos, visionaris, utopistes ... Tots els estudis dels actes humans, quotidians i rituals, o bé de caire espiritual i de transcendència són el suport de la CIÈNCIA DE L’HOME i les arrels culturals per entendre les cultures universals. La Biblioteca guarda aquest patrimoni bibliogràfic, espiritual i immaterial. Exposició bibliogràfica de l’obra de: GILBERT DURAND MARIUS SCHNEIDER JUAN EDUARDO CIRLOT Barcelona, 14 de juliol a 8 de setembre de 2004 1 DEL CAOS AL MICROCOSMOS: Simbologia, Mitologia, Tradició i Imaginari Exposició bibliogràfica de l’obra de GILBERT DURAND, MARIUS SCHNEIDER I JUAN-EDUARDO CIRLOT DATES: Febrer-abril 2004 (Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona). A càrrec del B.R.I. (Barcelona Recerques de l’Imaginari) 14 de juliol al 8 de setembre del 2004 (Biblioteca de Catalunya). A càrrec de M. Prat. Presentació: Carles Duarte. GUIA GENERAL ESPAI ZERO a) Pòster b) Taula informativa VITRINA 1 Antecedents GILBERT DURAND. França Els Centres de Recerca de l’Imaginari. Difusió i recerques de l’obra de Gilbert Durand i col·legues VITRINA 2 Vida cultural a Barcelona : 1940-1960 MARIUS SCHNEIDER (1903-1982) JUAN-EDUARDO CIRLOT (1916-1973) VITRINA 3 Aplicacions Jules Verne (1828-1905). Obres VITRINA 4 Aplicacions Jules Verne (1828-1905). Estudis VITRINA 5-6 Recerques diverses a Catalunya i Espanya *** 2 ESPAI ZERO a) Pòster de La creació d’Adam de Miquel Àngel El testimoni d’aquest gravat a l’Exposició no és tant de tipus confessional, sinó com de tipus històric. -

Léon Marie Gilbert Durand Est Né En 1921, À Chambéry, En Savoie, Au Pied Des Alpes.Il Enseignera Au Lycée De Cette Ville Puis À L’Université De Grenoble II
Léon Marie Gilbert Durand est né en 1921, à Chambéry, en Savoie, au pied des Alpes.Il enseignera au lycée de cette ville puis à l’Université de Grenoble II. Il se méritera le titre de professeur émérite des universités. Après avoir été emprisonné par la Gestapo pour sa participation à la Résistance (il sera d’ailleurs décoré de très nombreux honneurs tout au long de sa vie), le jeune Durand s’inscrit aux cours de son maître,qui deviendra son grand ami, Gaston Bachelard. Une fois diplômé, son activité littéraire devient prolifique (plus de 400 références à son CV). Il proposera sa théorie sur les structures anthropologiques de l’imaginaire dès 1960 et en élaborera les applications tout le reste de sa vie, en collaboration avec quelques centaine de chercheurs regroupés en plus d’une cinquantaine de Centres de recherche sur l’imaginaire (CRI) répartis sur tous les continents. À compter des années 70, Gilbert Durand se concentre davantage sur une mythodologie qui donne des clés d’interprétation à de grands cycles culturels. Avec des collègues, il fonde plusieurs publications scientifiques sur les problématiques liées à l’imaginaire, comme Les cahiers internationaux du symbolisme, Les cahiers de l’Université de Saint-Jean-de-Jérusalem , Les Cahiers de l'Imaginaire et tout récemment Les Cahiers européens de l’Imaginaire , tandis qu’il écrit dans de nombreuses autres revues. Sa présence assidueau Cercle Eranos (juste après le décès de Karl Jung) ou en d’autres colloques internationaux lui a permis de côtoyer les intellectuels de grandes renommées, tels Henry Corbin, Edgard Morin, James Hillman, Mircea Eliade, Paul Ricoeur ; puis des hommes de sciences comme Pauli, Schrödinger, Holton, Knoll, Pietschmann, Sambursky ; ou encore d’autres chercheurs comme Cazenave, Charron, Nicolescu, Bohm, Capra, Costa de Beauregard.. -
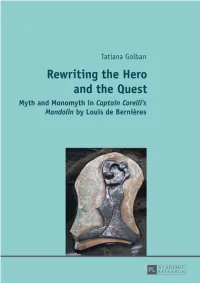
Rewriting the Hero and Quest. Myth and Monomyth in Caption Corelli's
Introduction Louis de Bernières’ book Captain Corelli’s Mandolin (1994) is a work which uses myth, in general, and the monomyth of the hero and the quest, in particular, as a medium to represent human existence in a postmodern world. Through the examination of the mythical restructuring as shaped by de Bernières, emerges the assumption that his work creates a distinctive depiction of reality, characteristic to postmodern literature. Although the purpose of our study is not the integration of Louis de Bernières’ novel into any of the postmodern experimental trends, we should mention that the emphasis of the author upon the transformation of myth, as well as his continuous tendency to deconstruct and then to reconstruct semantically the key components of the mythical models, may be qualified as postmodern. The postmodernity or post- modern period includes both traditional, realistic literature and experimental, inno- vative literary practice which is referred to as postmodernism, and it is claimed that de Bernières is not a realist but rather postmodernist by approaching reality through myth. He is also an author of magical realism, yet Captain Corelli’s Mandolin is neither a realistic novel nor a text of magical realism, and, in the case of this work, the British novelist is not a traditional, concerned with reality and socially concerned writer, and not exactly an experimental postmodernist, but definitely postmodern. In order to avoid the possible entrapment in a mythical situation or into an archetypal pattern, the writer uses a well-known prototype with the aim of rethink- ing myth and monomyth in an original way, as a result of which the known and predictable situation and archetypal character are changed and come to denote new meanings. -

Gillbert Durand Method)
Vol.13/No.42/Dec 2016 Received 2014/02/25 Accepted 2015/02/01 To Study the Place of Imagination and Myth in Coffee House Painting (Gillbert Durand Method) Najibeh Rahmani * Safar Ali Shabani Khatib** Abstract Coffee house painting that is among few remained folk arts in Iran was originated from the public national and religious attitudes in Qajar era. These paintings are supported by the imagination and the myth, which are rooted in the intellectual talent and the collective spirit. The imagination constitutes the formal motif of the paintings as well as national and religious myths constitute the content motifs of the works, which are rooted in the Iranian rich culture and collective spirit. Coffee house painting that was founded by the artists who didn’t go to the school was according to the imagination and myth-oriented bases somehow the painters called this style as imagination-drawing and stated that its relationship with the imagination was the source of creating their works. Myth-oriented (drawing the national and religious myths) is also considered as one of the important elements of this art and the confrontation between the good and evil forces forms its main concept; these contrasting manifestations are hidden in the unconscious ego of the artist who didn’t go to the school and can be decoded by Gillbert Durand’s nocturnal regime and diurnal regime theory. Gillbert Durand knows that these conflicting manifestations are related to the unconscious ego of the human and his fear of the unknown death universe that is imposed by the time on the human; this case can be examined about the artists who were drawing the pictures in terms of their imagination and were painting their imagination without education spontaneously. -

Literary Imagination: Criticism and Research - Micéala Symington
COMPARATIVE LITERATURE: SHARING KNOWLEDGES FOR PRESERVING CULTURAL DIVERSITY - Vol. I - Literary Imagination: Criticism and Research - Micéala Symington LITERARY IMAGINATION: CRITICISM AND RESEARCH Micéala Symington Université de La Rochelle, France, France Keywords: Imagination, literature, criticism, image, symbol, Comparative Literature Contents 1. Introduction 2. The Romantic movement 3. Literature, Imagination and Literary Symbol: The Imagination as a Means of Highlighting or Constructing Symbols 4. Literature, Imagination and Image: How the Imagination is linked to the Representation of the Absent Object 5. Imagination, imaginary and anthropology 6. The Imaginary and Mythcriticism 7. Psychoanalysis 8. Imagination and critical power (the Surrealists). 9. Imagination and cultural codes. 10. Imagination and transgression, imagination and reading. Glossary Bibliography Summary In this chapter, I examine how contemporary literary criticism (in particular, comparatist criticism) examines the question of the relationship between literature and the imagination. Different approaches to the notion of “literary imagination” within the Comparative Literature tradition may then be identified. 1. Introduction According to Seamus Heaney, poetry is the "imagination pressing back against the pressure of reality": the imagination is at the heart of poetical endeavour. The characterization of literary imagination is however a complex process, which calls on variousUNESCO extra-literary elements and a simple– EOLSSfocus on what is called the “critique de l’imaginaire” will not suffice. For although the work of G. Bachelard, J.-P. Richard or Gilbert Durand is clearly of central importance, research on the literary imagination has taken many formsSAMPLE and espouses radically differentCHAPTERS critical approaches. It might be argued that the criticism of consciousness known as the Geneva School is just as much a critical approach which is founded on the idea of literary imagination as is the “critique de l’imaginaire”. -

Social Sciences ANTHROPOLOGICAL
Supplement No. 2/2015 Social Sciences ANTHROPOLOGICAL STRUCTURES OF THE RELIGIOUS IMAGINARY IN SANDU TUDOR’S NORM – POEM The Akatist of Our Allpious Father St. Demetrius The New, Keeper of oxen in Basarabov Carmen CIORNEA1 ABSTRACT: THE PRESENT STUDY PRESENTS SOME ASPECTS OF THE LITURGICAL COMPOSITION - THE AKATIST OF OUR ALLPIOUS FATHER ST. DEMETRIUS THE NEW, KEEPER OF OXEN IN BASARABOV –AND IT IS BASED ON THE ASSUMPTION THAT THE GREATNESS OF LITERATURE MUST BE DETERMINED BY THE „DIALOGUE” WITH DIVINITY. THE POETRY SEARCH A REFERENCE POINT IN THE TRANSCENDENT AND THE MOST SEQUENCES IN THE AKATIST OF SANDU TUDOR IS IMPOSED BY THE GRAVITY OF EMOTION, BY PURITY AND THE ARDOUR OF THE FEELING. THE PATHS CREATED BY MYSTICAL AND ICONIC ANTHROPOLOGY DEVELOPED IN ITS AKATISTS REQUIRE A THOROUGH UNDERSTANDING, COHERENT WITH THE CHURCH TRADITION AND THE CHRISTIAN VISION OF THE DYNAMICS OF ITS TRANSFORMATION INTO WORDS. KEYWORDS: SANDU TUDOR, POETRY, AKATIST, THEOLOGY, LITHERATURTHEOLOGIE, THEOPOSIE, ANTHROPOLOGY. INTRODUCTION The paper “Anthropological structures of the religious imaginary in Sandu Tudor’s norm-poem” focuses on a segment of Romanian literature less discussed, namely, Sandu Tudor’s religious poetry seen from the viewpoint of iconic anthropology structure, of coagulation of religious images in his first liturgical composition - The Akatist of Our Father St. Allpious Demetrius The New, Keeper of oxen in Basarabov - in theological epistema. Structural analytical method applied in our research was designed to track the main nucleous religious pictures, images related to the archetype, constitutive chronotop, myth, but the intention was also to emphasise some significant ideas on the reflection of some mystical images in his poetic work. -

O Imaginário Em Lima De Freitas E José De Guimarães. Entre a Arte E a Educação
O Imaginário em Lima de Freitas e José de Guimarães. Entre a Arte e a Educação Alberto Filipe Araújo, Cátia Assunção & Lígia Rocha Universidade do Minho, Portugal1 Introdução A compreensão do imaginário artístico da Obra de Lima de Freitas e de José Guimarães é um desafio tanto exigente como estimulante porque requer um tríplice esforço: o conhecimento aprofundado dos trabalhos picturais, esculturais e escritos dos pintores; o conhecimento do imaginário durandiano (que é aqui a nossa posição epistemológica) e, finalmente, o domínio hermenêutico adequado – e pensamos na mitanálise (Gilbert Durand) no sentido que lhe confere Alberto Filipe Araújo – para fazer o recenseamento das imagens, recorrentes, ou não, que tecem os seus trabalhos nos seus mais variados registos. Às perguntas: que fazer com as imagens diagnosticadas? O que é que elas representam? Qual o alcance do seu significado simbólico e educacional? De que modo são essas imagens recebidas e sentidas pelo púbico? De que modo contribui a leitura hermenêutica dos seus trabalhos para uma estética da recepção orientada pelos valores mítico-simbólicos e educacionais? Os autores do presente estudo encontram-se naturalmente entre a arte e a educação. Para realizarmos o nosso objectivo, dividiremos a nossa conferência em duas partes: Na primeira falaremos da natureza do imaginário, não esquecendo, contudo, que se trata aqui de um imaginário particular, enquanto na segunda parte nos debruçaremos sobre o tipo de imaginário que habita na Obra de Lima de Freitas (1927- 1998) e de José de Guimarães (n.1939). Na conclusão preocupar-nos-emos em melhor compreender o sentido de Missão mítico-simbólica que anima o trabalho criativo e 1 Este estudo foi realizado no âmbito do Projecto Educação e Imaginário inscrito no Centro de Investigação em Educação (CIEd) do Instituto de Educação da Universidade do Minho (Braga – Portugal).