Sites Et Paysages
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Departement De La Haute-Saone
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE Actualisation Avril 2011 S O M M A I R E 1. Présentation du document et de son utilisation 1.1 - Note introductive 1.2 - Fiche modèle 2. Informations générales sur le risque sismique 2.1 - Le phénomène sismique 2.2 - L’aléa sismique 2.3 - La vulnérabilité 2.4 - L’évaluation du risque sismique 2.5 - Les outils de gestion du risque sismique 2.6 - Les responsabilités des acteurs en matière de prévention du risque sismique 3. Cadre réglementaire et technique de la prévention du risque sismique 3.1 - L’architecture générale des textes législatifs, réglementaires et techniques 3.2 - Le zonage réglementaire sismique de la France 3.3 - Les règles de construction parasismique 3.4 - Le scénario de risque sismique 3.5 - Le PPRN-sismique 3.6 - La gestion de crise 3.7 - Le « plan séisme » Références Glossaire Liens utiles 1.Note introductive 1.1 Note introductive au classeur de communication sur la prévention du risque sismique Dans le cadre du programme national de prévention du risque sismique dit Le classeur de communication est constitué de fiches synthétiques pré - « Plan Séisme » lancé en 2005 et de l’évolution réglementaire en cours en sentant les principes nationaux et permettant une adaptation au contexte matière de prévention de ce risque, le Ministère de l'Ecologie, du Dévelop - local ainsi que d’un CD-Rom comportant notamment la version électro - pement durable, des Transports et du Logement a souhaité lancer une nique du classeur. action de communication à destination des préfectures par le biais du présent classeur et de documents associés. -

Horaires Transports Scolaires MOLLANS
Fiche Horaire Ligne : 11_0509 - RP MOLLANS - ARPENANS + Pomoy Validité à partir du 04/09/2017 Itinéraire : Ligne scolaire Itinéraires 11-0509A1 11-0509A1 Commune Point d'arrêt lm-jv--- lm-jv--- POMOY Village 08:10 13:10 Salle Polyvalente 08:11 13:11 MOLLANS Ecole Primaire 08:16 13:16 ARPENANS Ecole maternelle 08:23 13:23 MOLLANS Ecole Primaire 08:30 13:30 Transporteur : SARL TARD Michel et Fils 33 places sous-traité à SARL DU GARAGE BOSCHUNG Horaires ARPENANS et MOLLANS : LM JV : 08 h 30 - 11 h 30 * 13 h 30 - 16 h 30 Direction des Mobilités du Quotidien | Unité Territoriale de la Haute-Saône | Espace 70 - 4A Rue de l'industrie 70000 Vesoul | Tél: 03.84.95.78.80 | Mél: [email protected] Fiche Horaire Ligne : 11_0509 - RP MOLLANS - ARPENANS + Pomoy Validité à partir du 04/09/2017 Itinéraire : Ligne scolaire Itinéraires 11-0509R1 11-0509R1 Commune Point d'arrêt lm-jv--- lm-jv--- MOLLANS Ecole Primaire 11:35 16:35 ARPENANS Ecole maternelle 11:42 16:42 MOLLANS Ecole Primaire 11:49 16:49 POMOY Salle Polyvalente 11:54 16:53 Village 11:55 16:54 Transporteur : SARL TARD Michel et Fils 33 places sous-traité à SARL DU GARAGE BOSCHUNG Horaires ARPENANS et MOLLANS : LM JV : 08 h 30 - 11 h 30 * 13 h 30 - 16 h 30 Direction des Mobilités du Quotidien | Unité Territoriale de la Haute-Saône | Espace 70 - 4A Rue de l'industrie 70000 Vesoul | Tél: 03.84.95.78.80 | Mél: [email protected] Fiche Horaire Ligne : 11_23 - MOLLANS - LURE Validité à partir du 04/09/2017 Itinéraire : Ligne scolaire Nota : A Itinéraires 11-23A1 Commune Point d'arrêt -

Dépliant En Balade.Indd
EN BALADE AVEC PAPI & MAMIE UN AMOUR D’ESCAPADE POUR DÉCOUVRIR Écomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles 206, Le Petit Fahys à Fougerolles / 03 84 49 52 50 Ouvert du 15 février au 15 novembre, tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h. En juillet et août : tous les jours de 11h à 19h. Tarifs : 5 € /adulte, 3 € /enfant (de 6 à 16 ans). Parc animalier de Fougerolles / Saint-Valbert Découvrez les animaux du parc à travers une balade en pleine nature (cerfs, chamois, daims, lamas...) ! Bornes pédagogiques et panneaux d’explication. Ouvert : avril, mai et juin (samedis, dimanches et jours fériés), juillet et août (tous les jours), septembre et octobre (samedis, dimanches et jours fériés) de 14h à 18h. Dernier billet délivrés à 17h15. Si alerte orange (orages et vents violents), le parc est fermé au public. Tarif : 2€, moins de 12 ans : 1€, gratuit pour les moins de 5 ans / Forfait famille (2 adultes / 2 enfants et plus) : 5€ Programme des animations à l’Offi ce de Tourisme. Balade en forêt et parc à gibier En marchant ou en courant, venez-vous amuser dans la forêt du Banney ou des 7 chevaux à Luxeuil-les- Bains. De nombreux parcours vous attendent avec des aires de jeux pour les enfants. Au Banney, rendez visite aux sangliers et aux cerfs sika (petits cerfs originaires du Japon) dans le parc à gibier. Balade à vélo Louez un vélo et partez à la découverte d’un territoire surprenant accompagné de vos enfants. L’Offi ce de Tourisme vous propose de la location de vélo (VTC ou à assistance électrique) mais aussi : une remorque enfant, un porte bébé et des vélos enfants… Renseignements auprès de l’Offi ce de Tourisme de Luxeuil-les- Bains et de Fougerolles. -

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE Emplacement Des
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE Ambiévillers VOSGES Passavant -la-Rochère Pont Emplacement des Tours -du-Bois Selles aéro-réfrigérantes en activité Bousseraucourt La Basse Aillevillers-et-Lyaumont -Vaivre Alaincourt Fontenois-la-Ville La Montagne ( S3IC au 20 novembre 2014) Vougécourt Fleurey Montcourt -lès- Jonvelle Demangevelle Vauvillers St-Loup La Vaivre La Rosière Betoncourt Corre Montdoré Mailleroncourt Bourbévelle -St-Pancras -St-PancrasDampvalley Fougerolles La Longine Bouligney -St-Pancras Magnoncourt Ranzevelle Hurecourt Cuve Corravillers Aisey Girefontaine Corbenay Villars-le-Pautel -et- St-Loup Richecourt Ormoy Polaincourt -sur-Semouse St-Bresson Beulotte-St-Laurent Melincourt Amont-et-Effreney -et-Clairefontaine Anjeux Blondefontaine Saponcourt Jasney Raddon Anchenoncourt La Pisseure St-Valbert Amage Fontaine-lès-Luxeuil -et-Chapendu Esmoulières Betaucourt -et-Chazel Barges Magny Ste-Marie Raincourt Ainvelle -en-Chanois -lès-Jussey Dampierre-lès-Conflans Froideconche Faucogney Haut-du-Them-Château-Lambert Hautevelle Contréglise Plainemont -et-la-Mer Vernois Senoncourt St-Rémy Breuchotte -sur-Mance Cendrecourt Tartécourt Francalmont Servance Rosières La Voivre Cemboing La Proiselière Betoncourt -sur- Venisey Bourguignon Briaucourt Mance Montureux Cubry Bassigney -et-Langle -sur-Mance -lès- Les Fessey Miellin -lès-Baulay -lès- Ormoiche Luxeuil-les-Bains La Bruyère St-Marcel Conflans Plancher-les-Mines Jussey Faverney Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire Menoux Buffignécourt Conflans-sur-Lanterne Esboz-Brest Vitrey St-Sauveur Écromagny -

Cartographie 2020 Des Travaux Sncf
Vittel Principaux travaux 2020 26 M€ investis dans la Haute-Saône 52 88 Épinal Arches HAUTE-MARNE VOSGES Colombey-lès-Choiseul 1 M€ Remiremont 9,9 M€ 3,6 M€ Confortement du tunnel Mise en câbles de la ligne aérienne Modernisation de la voie de Fontaine-lès-Luxeuil (70) entre Culmont-Chalindrey (52) et Lure (70) entre Aillevillers-et-Lyaumont et Citers (70) 900 K€ Modernisation de 6 passages à niveau : Andilly Aillevillers-et-Lyaumont 2 à La Chapelle-lès-Luxeuil, 1 à Citers, 2 à Quers et 1 à Adelans-et-le-Val-de-Bithaine Langres Jussey 5 M€ 255 k€ (montantipsum investi dans le 70) : Fontaine-lès-Luxeuil Culmont- Modernisation de la voie dans Remplacement de câbles Chaudenay d'alimentation de Héricourt (70) Chalindrey le secteur de Genevreuille (70) Luxeuil-les-Bains à Argiésians (90) La Chapelle- : Lès-Luxeuil Port-d’Atelier-Amance Giromagny Citers : Quers: Adelans-et-le- : Port-sur-Saône Creveney Val-de-Bithaine : Bas-Évette : La Creuse Lure Belfort 4 M€ :Coulevon Modernisation de la voie entre Port-d’Atelier-Amance et La Creuse (70) Vesoul 420 K€ Argiésians Confortement d’ouvrage d’art à Creveney (70) Héricourt Autet 455 K€ 70 Confortement de la tranchée Lorem ipsum HAUTE-SAÔNE de Coulevon (70) Montbéliard Voujeaucourt Gray Clerval L'Isle-sur- le-Doubs Mirebeau 525 K€ (montant réparti sur 5 départements) 190 K€ (montant investi dans le 70) Mise en conformité de câbles Mise en place de la fibre optique enterrés sur la LGV Rhin-Rhône Baume-les-Dames entre Clerval (25) et Belfort (90) de Villers-lès-Pots (21) à Petit-Croix (90) 21 CÔTE-D’OR -

Communes Concernées Le 4 Septembre 2018 9H00 Devant La Mairie De Chemilly CHEMILLY VAUCHOUX
Feuille1 PLANNING DES REUNIONS DE CONCERTATION Communes concernées Le 4 septembre 2018 9h00 devant la mairie de Chemilly CHEMILLY VAUCHOUX Le 4 septembre 2018 14h00 devant la mairie de Pontcey PONTCEY MONTIGNY-LES-VESOUL CHARIEZ Le 10 septembre 2018 à 9h00 9h00 devant la mairie de Echenoz la Méline ANDELARRE ANDELARROT ECHENOZ-LA-MELINE Le 10 septembre 2018 à 14h00 14h00 devant la mairie de Vellefaux ECHENOZ LE SEC VELLEFAUX LA DEMIE Le 11 septembre 2018 9h00 devant la mairie de Mont le Vernois BOURSIERES MONT-LE-VERNOIS Le 11 septembre 2018 14h00 devant la mairie de Velle le Chatel BAIGNES CLANS VELLE-LE-CHATEL Le 18 septembre 2018 9h00 devant la mairie de Vaivre et Montoille VAIVRE-ET-MONTOILLE NOIDANS-LES-VESOUL Le 18 septembre 2018 14h00 devant la mairie de Pusey PUSEY Le 20 septembre 2018 9h00 devant la mairie de Pusy Epenoux CHARMOILLE PUSY-ET-EPENOUX Le 20 septembre 2018 14h00 devant la mairie d’Auxon AUXON COULEVON COMBERJON VILLEPAROIS Page 1 Feuille1 Le 25 septembre 2018 9h00 devant la mairie de Frotey les Vesoul VESOUL FROTEY-LES-VESOUL Le 25 septembre 2018 14h00 devant la mairie de Colombe les Vesoul QUINCEY DAMPVALLEY-LES-COLOMBE COLOMBE-LES-VESOUL Le 2 octobre 2018 9h00 devant la mairie de Colombier COLOMBIER Le 2 octobre 2018 14h00 devant la mairie de Flagy FLAGY VAROGNE Le 4 octobre 2018 9h00 devant la mairie de la Villeneuve LA VILLENEUVE-BELLENOYE-ET-LA-MAIZE Le 4 octobre 2018 14h00 devant la mairie de Mailleroncourt Charette MAILLERONCOURT-CHARETTE SERVIGNEY Le 8 octobre 2018 9h00 devant la mairie du Val Saint Eloi -
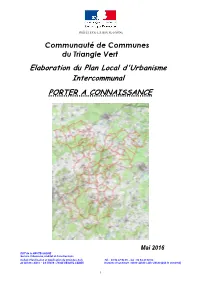
Elaboration Du Plan Local D'urbanisme Intercommunal PORTER a CONNAISSANCE
PRÉFÈTE DE LA HAUTE-SAÔNE Communauté de Communes du Triangle Vert Elaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal PORTER A CONNAISSANCE Mai 2016 DDT de la HAUTE-SAONE Service Urbanisme, Habitat et Constructions Cellule Planification et Application du Droit des Sols Tél. : 03 63.37.92.00 – fax : 03 63.37.92.02. 24 bld des Alliés – CS 50389 - 70014 VESOUL CEDEX Horaires d'ouverture : 9h00–11h30 / 14h–16h30 (16h le vendredi) 1 2 SOMMAIRE PREAMBULE......................................................................................................................................................5 1ÈRE PARTIE.....................................................................................................................................................7 PLU : CONTEXTE GENERAL ET EVOLUTIONS ................................................... ............................................ 7 ► LE CONTEXTE GENERAL..........................................................................................................................................7 ► LES EVOLUTIONS LEGISLATIVES DE 2009 A 2014..................................................................................................7 ■ Une meilleure prise en compte des objectifs de développement durable...................................................................................8 ■ L’évaluation environnementale..................................................................................................................................................8 ■ Les contrôles accrus.................................................................................................................................................................8 -

Guide De Pêche De Haute-Saône
01 Le Mot du Président 09 Les Plans d’eau www.peche-haute-saone.com es 54 A.A.P.P.M.A. de la Haute Saône 02 Organigramme de la fédération 10 Cartographie des parcours de pêche L 03 Les 54 A.A.P.P.M.A. 11 Parcours carpe de nuit 03 04 Cartes de pêche 2019 12 Labellisation “hébergement pêche” AAPPMA PRESIDENTS (ES) PARCOURS DE PECHE GARDES PARTICULIERS COMMUNES / DISTRIBUTEURS DE CARTES DE PECHE AAPPMA PRESIDENTS (E) PARCOURS DE PECHE GARDES PARTICULIERS COMMUNES / DISTRIBUTEURS DE CARTES DE PECHE protection du milieu aquatique de Haute-Saône de aquatique milieu du protection 05 Réciprocités EHGO - CHI - URNE 13 Les Ateliers Pêche Nature AUBRY Jean-Luc - 06.30.07.26.38 Camping du Lagon Vert – Route de Besançon – 03.84.31.73.16 Fédération départementale de pêche et de et pêche de départementale Fédération Renaud LATRONCHETTE BOUVARD Claude – 06.33.64.26.75 COMTE André – 7 Rue de la Fontaine du Douis – 03.84.31.75.39 MARNAY 06.07.87.06.79 Ognon et plan d’eau de « Marnay » / MARNAY 06 Périodes d’ouvertures de la pêche 14 Les réserves quinquennales et temporaires AILLEVILLERS Sébastien BEUGNOT DORNIER Pascal - 06.32.94.46.75 Office du Tourisme – 21 Place Hôtel de Ville – 03.84.31.90.91 06.06.70.75.10 Augronne, Semouse, Combeauté et Vieille Rivière MISSLIN Jean-Marc - 03.84.49.00.66 Tabac Duchêne - 2 Rue Henry Duhaut - 03.84.94.12.80 AILLEVILLERS ET LYAUMONT [email protected] CORBENAY Quincaillerie – 1 Avenue de Marnay – 03.84.31.75.78 Sommaire Heures légales de pêche Réglementation [email protected] CHRISTOPHE Florent - 06.60.66.30.03 -

Liste Des 336 Communes Éligibles Au Dégrèvement De 25% Sur Les Surfaces Classées Terre
Liste des 336 communes éligibles au dégrèvement de 25% sur les surfaces classées Terre ACHEY BUCEY-LES-GY DENEVRE ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE BUCEY-LES-TRAVES ECHENOZ-LA-MELINE AILLEVANS BUSSIERES ECHENOZ-LE-SEC AILLONCOURT BUTHIERS ECUELLE AMBLANS-ET-VELOTTE CALMOUTIER EHUNS ANCIER CEMBOING ESMOULINS ANDELARRE CENANS ESSERTENNE-ET-CECEY ANDELARROT CERRE-LES-NOROY ETRELLES-ET-LA-MONTBLEUSE ANDORNAY CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX ETUZ ANGIREY CHAMBORNAY-LES-PIN FAHY-LES-AUTREY APREMONT CHAMPLITTE FEDRY ARBECEY CHAMPTONNAY FERRIERES-LES-RAY ARC-LES-GRAY CHAMPVANS FERRIERES-LES-SCEY ARGILLIERES CHANCEY FILAIN AROZ CHANTES FLEUREY-LES-LAVONCOURT ARPENANS LA CHAPELLE-LES-LUXEUIL FONDREMAND ARSANS LA CHAPELLE-SAINT-QUILLAIN FONTENOIS-LES-MONTBOZON ATHESANS-ETROITEFONTAINE CHARCENNE FOUVENT-SAINT-ANDOCHE ATTRICOURT CHARGEY-LES-GRAY FRANCHEVELLE AULX-LES-CROMARY CHARIEZ FRANCOURT AUTET CHARMES-SAINT-VALBERT FRAMONT AUTHOISON CHASSEY-LES-SCEY FRASNE-LE-CHATEAU AUTOREILLE CHATENEY FREDERIC-FONTAINE AUTREY-LES-CERRE CHATENOIS FRESNE-SAINT-MAMES AUTREY-LES-GRAY CHAUMERCENNE FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE CHAUVIREY-LE-CHATEL FROIDETERRE AVRIGNEY-VIREY CHAUVIREY-LE-VIEIL FROTEY-LES-LURE LES AYNANS CHAUX-LA-LOTIERE FROTEY-LES-VESOUL BAIGNES CHEMILLY GENEVREUILLE BARD-LES-PESMES CHENEVREY-ET-MOROGNE GENEVREY BARGES CHEVIGNEY GERMIGNEY LA BARRE CHOYE GEZIER-ET-FONTENELAY LES BATIES CINTREY GOUHENANS BATTRANS CIREY GOURGEON BAUDONCOURT CITERS GRANDECOURT BAY CITEY GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT BEAUJEU-SAINT-VALLIER- CLAIREGOUTTE GRAY PIERREJUX-ET-QUITTEUR -

VESOUL (Lot 21)
REALISATION DE DIAGNOSTICS PARTENARIAUX TERRITORIAUX FLASH « EMPLOIS COMPETENCES » BASSIN DE VESOUL (Lot 21) EMPLOI TERRITOIRES ORGANISATIONS RAPPORT FINAL – 28.12.2020 www.terredavance.com | Paris • Lyon • Toulouse | 06 85 11 26 29 [email protected] LOCALISATION DU BASSIN La liste des communes du bassin d’emploi figure en annexe 4 PAGE 2 RAPPEL DU PÉRIMÈTRE PAGE 3 LE BASSIN DE VESOUL EN RÉSUMÉ PAGE 4 INDICATEURS CLEFS : BASSIN DE VESOUL / REGION 55 611 ACTIFS / 4,4 % DES ACTIFS DE LA RÉGION NOMBRE D’HEURES D’ACTIVITÉ TAUX DE CHÔMAGE 26 228 SALARIÉS PRIVÉS / 3,9 % PARTIELLE AUTORISÉES 2EME TRIMESTRE 2020 DES SALARIÉS DE LA RÉGION 1ER AU 3E TRIMESTRE 2020 SECTORISATION DE L’EMPLOI 6,3% / 6,4% SALARIE (2019) 24 963/ 569 081 Industrie Construction dont 70,4% au premier trimestre Commerce Services Région NOMBRE DE DEMANDEURS PART DES SALARIÉS D’EMPLOI (ABC) Bassin CONCERNÉS PAR L’ACTIVITÉ SEPTEMBRE 2020 PARTIELLE 4,2 % DU CHÔMAGE 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1ER AU 3E TRIMESTRE 2020 9 396 / RÉGIONAL 2 545 ETABLISSEMENTS / 3,7 % DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION 99,4% /87,7% SECTORISATION DU TISSU ECONOMIQUE (2019) EVOLUTION DEMANDE Industrie Construction NB D’INDEMNISATIONS/NB DE D’EMPLOI (ABC) Commerce Services DEMANDES D’AUTORISATION FÉVRIER/SEPTEMBRE 2020 2020, DÉPARTEMENT Région 91,1% des étbs/ 91,9% +754/ + 16 410 Bassin 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21,0% des heures/ 24,5% +8,7% / + 7,9 % PAGE 5 UN BASSIN RURAL, AVEC UNE POPULATION EN CROISSANCE • UNE POPULATION EN CROISSANCE FORTE DE 18% DEPUIS 1968 (HAUTE-SAÔNE +12%, BFC +14%) DANS UN -

Projet D'arrêté Cadre Interdépartemental BFC 2021
PRÉFET DE LA COTE-D’OR PRÉFET DU DOUBS PRÉFET DU JURA PRÉFET DE LA NIÈVRE PRÉFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE PRÉFET DE LA HAUTE- SAÔNE PRÉFET DE L’YONNE PRÉFET DU TERRITOIRE-DE-BELFORT Liberté Égalité Fraternité Arrêté cadre interdépartemental n°2021 zzz-yyy relatif à la mise en place des principes communs de vigilance et de gestion de la ressource en eau en période d’étiage en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE VU la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.211-3 à L.213.3, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, L.214-7, L.214-18, L.215-1 à L.215-13, R.211-66 à R.211-70 et R214-1 à R.214-56 ; VU le code du domaine public fluvial et notamment les articles 25, 33 et 35 ; VU le code civil et notamment les articles 640 et 645 ; VU le code de la santé publique et notamment les articles R.1321-1 à R.1321-66 ; VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.2212-5 et l’article L.2215-1 relatif aux pouvoirs du représentant de l’État dans un département en matière de police ; VU le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ; VU la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse ; VU les SDAGE Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie en vigueur ; VU l’arrêté n° 2015103-0014 du 13 avril 2014 -

Chambre D'agriculture De Haute-Saône – FRDR681 – La
Chambre d’agriculture de Haute-Saône – FRDR681 – La Colombine 03/12/2020 Type de masse d’eau ESU Code masse d’eau FRDR681 Nom masse d’eau La Colombine Station de la mesure ayant La Colombine à Colombotte (06412200) conduit au projet de zonage et P90 = 31 mg/l mais seulement 4 analyses sur la campagne, les trois autres code de la station de mesure inférieures à 7 mg/l au maximum Nombre de communes proposées 19 au classement V1 Liste des communes proposées Adelans-et-le-Val-de-Bithaine, Calmoutier, Châteney, Châtenois, Colombe-lès- au classement Vesoul, Colombotte, Comberjon, Creveney, Dambenoit-lès-Colombe, Dampvalley- (NB : indiquer avec « * » les lès-Colombe, Frotey-lès-Vesoul, Genevreuille, Genevrey, La Creuse, Montcey, communes proposées au titre d’une Pomoy, Quincey, Saulx, Velleminfroy autre masse d’eau) Type d’argumentaire ☐ Compartimentation de la masse d’eau souterraine pour circonscrire la zone (NB : cocher la ou les cases contaminée concernées : ☑ ) ☐ Origine non agricole certaine de la pollution (pollution ponctuelle d’origine domestique, autre) – Origine : préciser l’origine ici. ☐ Absence de contamination par les nitrates d’origine agricole pour les secteurs dont l’occupation des sols est majoritairement urbaine, forestière ou avec une SAU très faible ☑ Autre : prélèvement non représentatif Communes dont le retrait du A compléter (facultatif) – classement est proposé NB : certaines communes peuvent rester classées au titre d’autres masses d’eau. Argumentaire pour modifier le L’une des rares ME ESU pour lesquelles il n’y a pas la série complète de mesures – projet de classement soumis à seulement 4 mesures sur la période, dont 1 seule supérieure à 18 mg/ l en janvier concertation 2019.