Chimay-Couvin.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
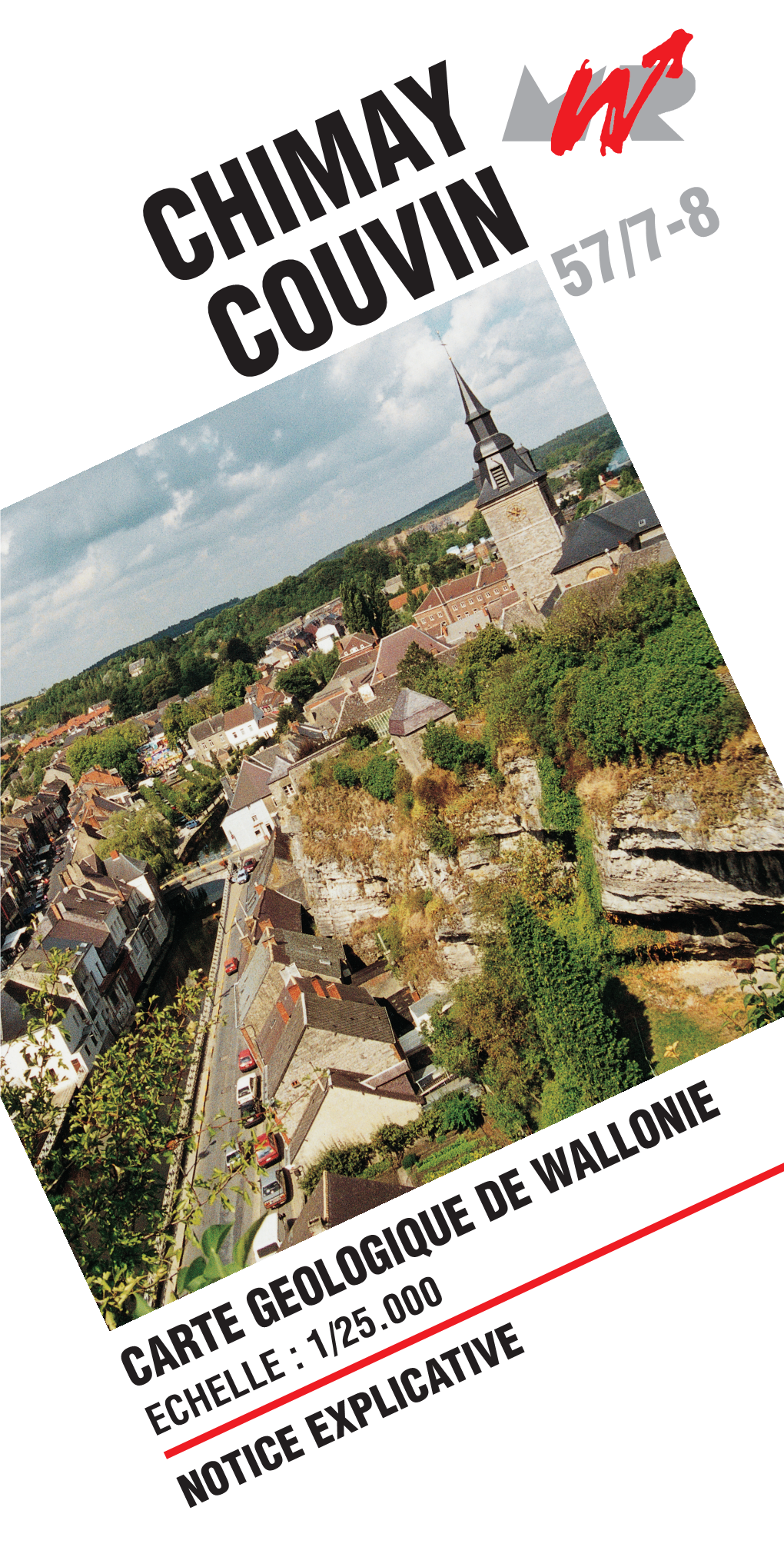
Load more
Recommended publications
-
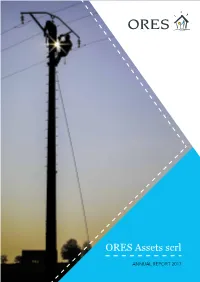
ORES Assets Scrl
ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 1 TABLE OF ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 CONTENTS I. Introductory message from the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer p.4 II. ORES Assets consolidated management report p.6 Activity report and non-financial information p.6 True and fair view of the development of business, profits/losses and financial situation of the Group p.36 III. Annual financial statements p.54 Balance sheet p.54 Balance sheet by sector p.56 Profit and loss statement p.60 Profit and loss statement by sector p.61 Allocations and deductions p.69 Appendices p.70 List of contractors p.87 Valuation rules p.92 IV. Profit distribution p.96 V. Auditor’s report p.100 VI. ORES scrl - ORES Assets consolidated Name and form ORES. cooperative company with limited liability salaries report p.110 VII. Specific report on equity investments p.128 Registered office Avenue Jean Monnet 2, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium. VIII. Appendix 1 point 1 – List of shareholders updated on 31 December 2017 p.129 Incorporation Certificate of incorporation published in the appen- dix of the Moniteur belge [Belgian Official Journal] on 10 January 2014 under number 14012014. Memorandum and articles of association and their modifications The memorandum and articles of association were modified for the last time on 22 June 2017 and published in the appendix of the Moniteur belge on 18 July 2017 under number 2017-07-18/0104150. 2 3 networks. However, it also determining a strategy essen- Supported by a suitable training path, the setting up of a tially hinged around energy transition; several of our major "new world of work" within the company should also pro- business programmes and plans are in effect conducted to mote the creativity, agility and efficiency of all ORES’ active succeed in this challenge with the public authorities, other forces. -

Brachiopoda) in the Les Valisettes Formation (Late Frasnian of the Philippeville Anticlinorium, Southern Belgium)
bulletin de l'institut royal des sciences naturelles de belgique sciences de la terre, 74: 35-44, 2004 bulletin van het koninklijk belgisch instituut voor natuurwetenschappen aardwetenschappen, 74: 35-44, 2004 The genus Iowatrypa Copper, 1973 (Brachiopoda) in the Les Valisettes Formation (late Frasnian of the Philippeville Anticlinorium, southern Belgium). by Bernard MOTTEQUIN Mottequin, B., 2004. - The genus Iowatrypa Copper, 1973 (Brachio¬ 1973. Costatrypa''% highest occurrence is less than 1 m poda) in the Les Valisettes Formation (late Frasnian of the Philippeville below the base of the Matagne Formation at position Anticlinorium, southern Belgium). Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Sciences de la Terre, 74: 35-44, eight meters higher than the level previously reported 1 pl., 4 figs., 1 table, Bruxelles-Brussel, March 31, 2004. - ISSN 0374- by Godefroid & Helsen (1998, p. 266, fig. 21). 6291. The dominant atrypids of the Les Valisettes Formation include species of the genera Iowatrypa and Costatrypa. Less abundant are species of the genera Spinatrypa (Spi- Abstract natrypa) Stainbrook, 1945, Desquamatia (Desquama- tia) Alekseeva, 1960, and A new species of the genus Iowatrypa Copper, 1973 [/. philippevil- possibly Waiotiypa Balinski, lensis n. sp. (Pseudogruenewaldtiinae)] is described from the late 1997. Spinatrypina Rzhonsnitskaya, 1964 may also be Frasnian (Upper Palmatolepis rhenana Zone) Les Valisettes Formation present in the massive reddish-pinkish limestone mounds (Philippeville Anticlinorium). developed within the formation but requires further in¬ Key-words: Brachiopods. Atrypida. Late Frasnian. Systematic pa- vestigation to confirm its occurrence. laeontology. All figured and measured specimens are stored at the Royal Belgian Institute of natural Sciences at Brussels, where they are numbered IRScNB al 1993 - a 12001. -

Cm Conclusions Report
European CM Investment Complaints ,I Bank Mechanism Route E42o Frasnes-lez-Couvin - Brly RTE Project Complaint SG/E/2o14/o2 Belgium Complaints Mechanism - Complaints Mechanism - Complaints Mechanism - Complaints Mechanism CONCLUSIONS REPORT 13 December 2018 EIB Complaints Mechanism Prepared by Complaints Mechanism Damir Petrovic Complaints Officer Alfredo Abad Deputy Head of Division Sonja Derkum Head of Division Complaints Mechanism External Distribution Complainant Borrower/Promoter Internal Distribution Management Committee Secretary General Inspector General Relevant EIB departments Confidentiality waived: Yes1 1 In his email sent on 19 August 2015, the complainant waived the tight to confidentiarty requested in the complaint submitted on 22 January 2014. 2 Route E420 Frasnes-Iez-Couvin - Braly RTE The EIB Complaints Mechanism The EIB Complaints Mechanism is designed to provide the public with a tool enabling alternative and pre-emptive resolution of disputes in cases in which members of the public feel that the EIB Group has done something wrong, i.e. if they consider that the EIB has committed an act of maladministration. When exercising the right to lodge a complaint against the EIB, any member of the public has access to a two-tier procedure, one internal — the Complaints Mechanism Division (EIB-CM) — and one external — the European Ombudsman (EO). Complainants that are not satisfied with the EIB-CM’s reply have the opportunity to submit a confirmatory complaint within 15 days of receipt of that reply. In addition, complainants who are not satisfied with the outcome of the procedure before the EIB-CM and who do not wish to make a confirmatory complaint have the right to lodge a complaint of maladministration against the EIB with the EQ. -

2005 - BELGIUM (Walloon Region)
Inf.EUROBATS.AC10.22 Division de la Nature et de Forêts Direction de la Nature Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES (BELGIUM) REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON BATS - 2005 - BELGIUM (Walloon Region) - Direction de la Nature – Division de la Nature et de Forêts – Avenue Prince de Liège, 15 – 5100 JAMBES (BELGIUM) – Tél. : 081/33.58.83 – Fax : 081/33.58.22 – E-mail : [email protected] 2 A. GENERAL INFORMATION Party : The Agreement was signed by the government of the Walloon Region the 16 February 1995. The date of ratification by Belgium Federal Government is the 14 may 2003. Date of final report : april 2005. Period covered by report : march 2004 – april 2005. Competent authority : in part, the Ministry of the Walloon Region Division de la Nature et de Forêts Direction de la Nature Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES (BELGIUM) Tél. : 00 32 (0)81 33.58.83 Fax : 00 32 (0)81 33.58.22 E-mail : [email protected] B. STATUS OF BATS WITHIN THE WALLONIAN TERRITORY There are 20 species of bat resident in the Walloon Region. Different species find their extension limits on this territory. This fact means that the geographical position is strategic to follow the sense of the general dynamic of those species population : - to the north: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis emarginatus ; - to the south: Myotis dasycneme. The territory is situated on the migration route at least for Myotis dasycneme, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula 1. Summary details of the species : Situation similar to the report of the year 2000. -

Vos Zones De Police En Province De Namur
Vos zones de police en province de Namur : Place du Théâtre, 5 - 5000 NAMUR Zone de police de NAMUR Tél. : 081/24.66.11 www.polnam.be Chaussée de Tirlemont, 105 - 5030 GEMBLOUX Zone de police ORNEAU-MEHAIGNE Tél. : 081/62.05.40 (Eghezée, Gembloux, La Bruyère) www.policelocale.be/orneau-mehaigne Zone de police des ARCHES Avenue Reine Elisabeth, 29 - 5300 ANDENNE (Andenne, Assesse, Fernelmont, Gesves, Tél. : 085/82.36.00 Ohey) www.policedesarches.be Zone de police ENTRE SAMBRE ET MEUSE Route de Bambois, 2 - 5070 FOSSES-LA-VILLE (Floreffe, Fosses-La-Ville, Mettet, Tél. : 071/26.28.00 Profondeville) www.policeentresambreetmeuse.be Rue Saint Martin, 18- 5060 SAMBREVILLE Zone de police SAMSOM Tél. : 071/26.08.00 (Sambreville, Sombreffe) www.policesamsom.be Rue Thibaut, 4 - 5190 JEMEPPE S/SAMBRE Zone de police JEMEPPE S/SAMBRE Tél. : 071/78.71.01 www.policejemeppe.be Rue du Couvent, 23 - 5650 WALCOURT Zone de police FLOWAL Tél. : 071/66.24.00 (Florennes, Walcourt) www.flowal.be Zone de police HOUILLE-SEMOIS Rue de Dinant, 36 - 5575 GEDINNE (Beauraing, Bièvre, Gedinne, Tél. : 061/24.24.00 Vresse S/Semois) www.houillesemois.be Avenue de la Libération, 52 - 5560 COUVIN Zone de police des 3 VALLEES Tél. : 060/31.02.02 (Couvin, Viroinval) www.police3vallees.be Quai J-B. Culot, 24 - 5500 DINANT cole Albert Jacquard de Namur - Lauréat du concours d’idées 2012 «Prévenez le cambriolage» organisé sous l’égide du Gouverneur de la Province de Namur. Zone de police HAUTE MEUSE É Tél. : 082/67.68.10 (Anhée, Dinant, Hastière, Onhaye, Yvoir) users.skynet.be/hautemeuse Rue de Behogne, 28 - 5580 ROCHEFORT Zone de police LESSE ET LHOMME Tél. -

Biodégradables Réglementaires
Points de vente des sacs PMC et biodégradables réglementaires Entité Enseigne Téléphone Adresse Livraison CP Localité Andenne Au Petit Oubli 081/74 73 64 Rue Isidore Parmentier, 273 5300 SCLAYN Andenne Chez Géraldine & Sébastien 081/58 82 36 Rue de Gramptinne, 38 5300 THON-SAMSON Andenne Colruyt 085/84 13 07 Rue de la Papeterie, 4 5300 ANDENNE Andenne Courthéoux 085/82 62 58 Rue de la Station, 63 5300 SEILLES Andenne Match 085/84 93 30 Avenue Roi Albert, 17 5300 ANDENNE Andenne Red Market 081/61 38 44 Avenue Roi Albert, 135a 5300 ANDENNE Andenne Régie Sportive Communale Andennaise 085/849520 Square Mélin, 14 5300 ANDENNE Andenne SPAR 085/82 56 21 Rue de Petit-Waret, 167c 5300 ANDENNE Andenne Trafic 085/84 19 10 Rue Albert Ier, 15 5300 ANDENNE Anhée A la Gourmandise 082/67 98 23 Place Docteur Jacques, 10 5520 ANTHEE Anhée Intermarché 082/713 984 Chaussée de Dinant, 127 5537 ANHEE Anhée Le Panier Garni 071/798 798 Rue d'Arbre, 7 5537 BIOUL Anhée Les Milles et Une Chose 082/71 30 06 Rue Grande, 36 5537 ANHEE Anhée Louis Delhaize 071/79 83 99 Rue de Rouillon, 20/2 5537 BIOUL Anhée Patisserie Pierret 082/61 26 01 Place communale, 24 5537 ANHEE Assesse Chez Hugo 083/65 57 87 Rue de Crupet, 19a 5330 MAILLEN Assesse Intermarché 083/66 05 70 Rue Melvin Wilson, 3 5330 ASSESSE Cerfontaine Boucherie - Epicerie des Barrages 071/63 40 45 Rue Royale, 92 5630 Silenrieux Cerfontaine Droguerie Buchet 071/64 40 79 Place de l'Eglise, 6a 5630 Cerfontaine Cerfontaine Louis Delhaize - Chez Catherine 071/64 32 57 Rue de l'Horloge, 169 5630 Senzeille Ciney AD -

Charleroi-Sud
sncb Travaux sur votre trajet Des travaux seront effectués par Infrabel. La carte montre où ces travaux pourraient influencer votre voyage. Charleroi-Sud Couvin Bus de remplacement Charleroi-Sud - Couvin Du lundi 20 au dimanche 26 août 2018 Quels trains ? trains L Charleroi-Sud - Couvin Que faire ? Les trains L sont remplacés par des bus entre Charleroi-Sud et Couvin (dans les deux sens). Attention! Les bus ne desserviront pas la gare de Beignée durant toute la période. Les 25 et 26 août, les bus ne s’arrêteront pas à Pry. Le samedi 25 août à partir de 17h et durant toute la journée du dimanche 26 août, les bus ne s’arrêteront pas à Yves-Gomezée. Afin de connaître les dernières mises à jour, consultez régulièrement le planificateur de voyage sur sncb.be, votre app SNCB ou contactez le 02 528 28 28. 14/08/2018 FR-08013 BNX-45M-24202 sncb Travaux sur votre trajet Des travaux seront effectués par Infrabel. Charleroi-Sud - Couvin Du lundi 20 au dimanche 26 août 2018 Gare de Charleroi-Sud Arrêts de bus - Charleroi-Sud: devant la gare - Jamioulx: devant la gare - Ham-sur-Heure: près de la gare, Chemin d’Hameau - Cour-sur-Heure: Rue de la Station à 50m de la gare - Berzée: Rue du Faubourg à 150m de la gare - Pry: au carrefour Souvenir étangs - Walcourt: devant la gare - Yves-Gomezée: Rue Voyau au bout du sentier donnant accès au quai - Philippeville: devant la gare - Mariembourg: “Chez l’Fagne” Chaussée de Philippeville - Couvin: devant la gare Google map: https://bit.ly/2zC77K0 Horaires des bus £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ -

Sedimentology and Magnetic Susceptibility of the Couvin Formation (Eifelian, South Western Belgium): Carbonate Platform Initiation in a Hostile World
GEOLOGICA BELGICA (2007) 10/1-2: 47-67 SEDIMENTOLOGY AND MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF THE COUVIN FORMATION (EIFELIAN, SOUTH WESTERN BELGIUM): CARBONATE PLATFORM INITIATION IN A HOSTILE WORLD Cédric MABILLE & Frédéric BOULVAIN (8 figures and 2 plates) Pétrologie sédimentaire, Département de Géologie, Bat. B20, Université de Liège, Sart-Tilman, B-4000 Liège E-mail : [email protected], [email protected] ABSTRACT. The Eifelian of Belgium is mainly characterised by a mixed siliciclastic-carbonate sedimentation on a ramp profile. In this context, the Couvin Formation is the more important and remarkable exception. It represents a carbonate platform initiation in a hostile environment. This work is mainly based on the stratotype, corresponding to two stratigraphic sections located in Couvin, along the southern border of the Dinant Synclinorium. These sections are the Eau Noire and Falaise de l’Abîme sections. Unfortunately, they are discontinuous. To allow a better understanding of the sedimentary dynamics, the data are complemented by a shorter but continuous section located in Villers-la-Tour (3.5 km West of Chimay). Petrographic study leads to the definition of 14 microfacies which are integrated in a palaeogeographical model. It corresponds to a platform setting where the reef complex is mainly constituted by an accumulation of crinoids, stromatoporoids and tabulate corals. The microfacies evolution is interpreted in terms of bathymetrical variations. It shows a general shallowing-upward trend encompassing the vertical succession of fore-reef settings, reef development, back-reef and then lagoon environment. This interpretation is supported by trends in mean magnetic susceptibility data, providing a better understanding of the sedimentary dynamics. -

Fluorescent Minerals from Belgian Localities
Fluorescent minerals from Belgian localities In the collection of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences Richard Loyens [email protected] Antwerp, 2014 translation Vic Vanrusselt Being a collector of Belgian minerals and having a special interest in fluorescence, I went on a personal quest to find out how many different species of fluorescent minerals can be found within the borders of the country I call home, Belgium. As a member of the MKA and the FMS, I, armed with my trusty UV light, had the privilege of investigating other people’s collections up close. However, the total number of fluorescent species I ended up with was rather low. Moreover, the number of species that these people had personally collected was also very limited, even though the literature clearly stated that several more species were to be – or once had been – found in Belgium. That is why I hatched the idea to make a complete list of Belgian mineral species that (could) exhibit fluorescence. It would only be a matter of finding an extensive collection to do my fluorescence research on. That is when the RBINS’ collection came into view. In 1991, I contacted Professor R. Van Tassel, who at that time was associated with the mineralogy department of that institute. Professor Van Tassel referred me to Michel Deliens, the then curator of the institute’s mineral collection. After a few meetings and after explaining to him what I wanted to achieve, I myself, together with a few of my fellow “fluorescence aficionados”, got permission to do our research on the RBINS’ collection of Belgian minerals. -

Hulpverleningszones Van Belgïe Zones De Secours De Belgique 11/2017 ESSEN HOOGSTRATEN
Hulpverleningszone Brandweer Zone Taxandria Brandweer Rand Zone Antwerpen Hulpverleningszone 1 Hulpverlenings- Hulpverleningszone zone Waasland Hulpverleningszone Meetjesland Brandweer zone Noord-Limburg Kempen Hulpverlenings- zone Centrum Hulpverlenings- Hulpverleningszone zone Oost Rivierenland Brandweerzone Midwest Brandweerzone Brandweer Hulpverlenings- Hulpverleningszone Oost-Limburg Westhoek zone West Hulpverleningszone Zuid-Oost Zuidwest Hulpverleningszone Hulpverleningszone DBDMH Oost Vlaamse Ardennen Brussel Hulpverleningszone SIAMU Fluvia Bruxelles Zone de secours Zone de secours Zone de secours du Brabant wallon de Hesbaye Liège Zone 2 Wallonie Picarde IILE-SRI Zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau Zone de secours Zone de secours Hainaut-Centre Zone de secours HEMECO Zone de NAGE secours Zone de secours 5 Zone de secours Val de Warche Amblève Lienne Hainaut-Est (ZS5 W.A.L.) Sambre Zone DG Zone de secours DINAPHI Zone de secours de Luxembourg Hulpverleningszones van Belgïe Zones de secours de Belgique 11/2017 ESSEN HOOGSTRATEN BAARLE-HERTOG WUUSTWEZEL RAVELS KALMTHOUT MERKSPLAS Brandweer Zone Hulpverleningszone Rand RIJKEVORSEL STABROEK Taxandria BRECHT ARENDONK TURNHOUT KAPELLEN OUD- BRASSCHAAT BEERSE TURNHOUT VOSSELAAR MALLE RETIE SCHOTEN SCHILDE Brandweer Zone ZOERSEL LILLE ANTWERPEN DESSEL KASTERLEE Antwerpen WIJNEGEM ZWIJNDRECHT VORSELAAR WOMMELGEM ZANDHOVEN MOL BORSBEEK RANST Brandweer zone MORTSEL BOECHOUT GROBBENDONK HERENTALS GEEL BALEN EDEGEM OLEN Kempen NIJLEN HOVE HERENTHOUT HEMIKSEM MEERHOUT AARTSELAAR LINT -

Page 1 G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN
G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1 . FEBRUAR 1964 AUSGABE IN DEUTSCHER SPRACHE 7. JAHRGANG Nr. 18 INHALT EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT VERORDNUNGEN Verordnung Nr . 7/64/EWG der Kommission vom 29 . Januar 1964 zur Fest legung der Liste der Gemeinden innerhalb der beiderseits der gemeinsamen Grenze zwischen Frankreich und den angrenzenden Mitgliedstaaten fest gelegten Grenzzonen 297/64 Anlage : I. Französisch-belgisches Grenzgebiet : A. Belgische Gemeinden 298/64 B. Französische Gemeinden 304/64 II . Französisch-luxemburgisches Grenzgebiet : A. Luxemburgische Gemeinden 314/64 B. Französische Gemeinden 314/64 III . Französisch-deutsches Grenzgebiet : A. Deutsche Gemeinden 317/64 B. Französische Gemeinden 322/64 IV. Französisch-italienisches Grenzgebiet : A. Italienische Gemeinden 330/64 B. Französische Gemeinden 331/64 3 8083 * — STUDIEN — REIHE ÜBERSEEISCHE ENTWICKLUNGSFRAGEN Nr. 1/1963 — Der Kaffee-, Kakao- und Bananenmarkt der EWG Die im Auftrag der Kommission entstandene Arbeit stammt vom ,, Inra Europe Marketing Research Institute", einem Zusammenschluß verschiedener Forschungs institute des EWG-Raums (Divo-Frankfurt , NSvS-Den Haag, Sema-Paris , Sirme Mailand, Sobemap-Brüssel), und gibt einen Überblick über die augenblickliche Marktlage sowie die voraussichtliche Entwicklung der nächsten Jahre . Die Erzeugnisse, die hier behandelt werden, Kaffee, Kakao, Bananen, stellen einen großen Teil der Exporterlöse der Entwicklungsländer . Die Kommission hat sich entschlossen, diese Arbeit zu veröffentlichen , da sie glaubt, daß sie für öffentliche wie private Stellen in der EWG und den assoziierten Staaten von einigem Interesse sein dürfte. Der Bericht behandelt Einfuhr und Durchfuhr, Verarbeitung, Absatz und Preis bildung und die Ergebnisse einer Verbraucher-Umfrage . Ein Ausblick auf die Ver brauchsentwicklung bis 1970 beschließt das Ganze . Das Werk (226 Seiten , 50 Diagramme) ist in den vier Sprachen der Gemeinschaft erschienen . -

Projet De Centre 2016-2020
Santé Scolaire Centre PMS/Service PSE de Florennes-Couvin Projet de Centre 2016-2020 Maison Provinciale du Mieux-Être : 18, rue Gérard de Cambrai 12, ruelle Cracsot 5620 FLORENNES 5660 COUVIN Tél.081/776 830 Tél. 081/776 822 Fax 071/685 015 Fax 060/346 590 [email protected] [email protected] Contenu 1. INTRODUCTION ....................................................................................................................................................................................... 3 2. LES MISSIONS PMS/PSE ........................................................................................................................................................................... 5 2.1. Les missions PMS ................................................................................................................................................................................ 5 2.2. Les missions PSE .................................................................................................................................................................................. 5 2.3. Nos caractéristiques ............................................................................................................................................................................ 5 3. COMPOSITION DE L’EQUIPE .................................................................................................................................................................... 6 3.1. Présentation de l’équipe