Diagnostic De La Zone Srl
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hymenoptera, Chalcidoidea) from Morocco
Arxius de Miscel·lània Zoològica, 17 (2019): 145–159 ISSN:Kissayi 1698– et0476 al. New records for a catalogue of Chalcididae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Morocco K. Kissayi, S. Benhalima, F. Bentata, M. Labhilili, A. Benhoussa Kissayi, K., Benhalima, S., Bentata, F., Labhilili, M., Benhoussa, A., 2019. New records for a catalogue of Chalcididae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Morocco. Arxius de Miscel·lània Zoològica, 17: 145–159, Doi: https://doi.org/10.32800/amz.2019.17.0145 Abstract New records for a catalogue of Chalcididae (Hymenoptera, Chalcidoidea) from Morocco. Three species of Chalcididae (Hymenoptera, Chalcidoidea) were newly recorded from Mo- rocco during a study carried out in the Maâmora forest between 2012 and 2014: Hockeria bifasciata (Walker, 1834), H. mengenillarum (Silvestri, 1943) and Proconura decipiens (Masi, 1929). P. decipiens (Masi, 1929) stat. rev. will be removed from synonymy with P. nigripes (Fonscolombe, 1832). This study includes bibliographical research and revision of specimens deposited in the National Museum of Natural History, Scientific Institute of Rabat (Morocco). Twenty–six species and fourteen genera belonging to the family Chalcididae (Hymenoptera, Chalcidoidea) are now catalogued from Morocco. Data published through GBIF (Doi: 10.15470/nochzr) Key words: Hymenoptera, Chalcididae, New data, Maâmora, Morocco Resumen Nuevos registros para un catálogo de Chalcididae (Hymenoptera, Chalcidoidea) de Marrue- cos. Se han registrado tres nuevas especies de Chalcididae (Hymenoptera, Chalcidoidea) en Marruecos, a partir de un estudio realizado en el bosque de Maâmora entre 2012 y 2014: Hockeria bifasciata (Walker, 1834), H. mengenillarum (Silvestri, 1943) y Proconura decipiens (Masi, 1929). P. decipiens (Masi, 1929) stat. rev. dejará de considerarse sinóni- mo de P. -

Chapitre VI La Ville Et Ses Équipements Collectifs
Chapitre VI La ville et ses équipements collectifs Introduction L'intérêt accordé à la connaissance du milieu urbain et de ses équipements collectifs suscite un intérêt croissant, en raison de l’urbanisation accélérée que connaît le pays, et de son effet sur les équipements et les dysfonctionnements liés à la répartition des infrastructures. Pour résorber ce déséquilibre et assurer la satisfaction des besoins, le développement d'un réseau d'équipements collectifs appropriés s'impose. Tant que ce déséquilibre persiste, le problème de la marginalisation sociale, qui s’intensifie avec le chômage et la pauvreté va continuer à se poser La politique des équipements collectifs doit donc occuper une place centrale dans la stratégie de développement, particulièrement dans le cadre de l’aménagement du territoire. La distribution spatiale de la population et par conséquent des activités économiques, est certes liée aux conditions naturelles, difficiles à modifier. Néanmoins, l'aménagement de l'espace par le biais d'une politique active peut constituer un outil efficace pour mettre en place des conditions favorables à la réduction des disparités. Cette politique requiert des informations fiables à un niveau fin sur l'espace à aménager. La présente étude se réfère à la Base de données communales en milieu urbain (BA.DO.C) de 1997, élaborée par la Direction de la Statistique et concerne le niveau géographique le plus fin à savoir les communes urbaines, qui constituent l'élément de base de la décentralisation et le cadre d'application de la démocratie locale. Au recensement de 1982, était considéré comme espace urbain toute agglomération ayant un minimum de 1 500 habitants et qui présentait au moins quatre des sept conditions énumérées en infra1. -

Pauvrete, Developpement Humain
ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISSARIAT AU PLAN PAUVRETE, DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DEVELOPPEMENT SOCIAL AU MAROC Données cartographiques et statistiques Septembre 2004 Remerciements La présente cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social est le résultat d’un travail d’équipe. Elle a été élaborée par un groupe de spécialistes du Haut Commissariat au Plan (Observatoire des conditions de vie de la population), formé de Mme Ikira D . (Statisticienne) et MM. Douidich M. (Statisticien-économiste), Ezzrari J. (Economiste), Nekrache H. (Statisticien- démographe) et Soudi K. (Statisticien-démographe). Qu’ils en soient vivement remerciés. Mes remerciements vont aussi à MM. Benkasmi M. et Teto A. d’avoir participé aux travaux préparatoires de cette étude, et à Mr Peter Lanjouw, fondateur de la cartographie de la pauvreté, d’avoir été en contact permanent avec l’ensemble de ces spécialistes. SOMMAIRE Ahmed LAHLIMI ALAMI Haut Commissaire au Plan 2 SOMMAIRE Page Partie I : PRESENTATION GENERALE I. Approche de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l’inégalité 1.1. Concepts et mesures 1.2. Indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité au Maroc II. Objectifs et consistance des indices communaux de développement humain et de développement social 2.1. Objectifs 2.2. Consistance et mesure de l’indice communal de développement humain 2.3. Consistance et mesure de l’indice communal de développement social III. Cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social IV. Niveaux et évolution de la pauvreté, du développement humain et du développement social 4.1. Niveaux et évolution de la pauvreté 4.2. -

Contribution À La Mesure De L'effet De L'innovation
Contribution à la mesure de l’effet de l’innovation sociale sur le développement territorial durable : Cas des projets sociaux dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra, Maroc Driss El Ghoufi To cite this version: Driss El Ghoufi. Contribution à la mesure de l’effet de l’innovation sociale sur le développement territorial durable : Cas des projets sociaux dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra, Maroc. Economies et finances. Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc), 2019. Français. tel-02936971 HAL Id: tel-02936971 https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02936971 Submitted on 21 Sep 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITE CADI AYYAD FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES MARRAKECH Centre des Etudes Doctorales : Droit, Economie et Gestion Laboratoire de recherche : Innovation, Responsabilité et Développement Durable (INREDD) THESE DE DOCTORAT EN : SCIENCES ECONOMIQUES CONTRIBUTION A LA MESURE DE L’EFFET DE L’INNOVATION SOCIALE SUR LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE Cas des projets sociaux dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra Par Driss EL GHOUFI Présentée et soutenue publiquement le 13/06/2019 Sous la direction du Professeur Fatima ARIB Jury : Mr. -

M a Is O N C O M M U N a Le C a Ïd a T G E N D a Rm E Rie Ro Y a Le A
Nombre Existence Nombre d'équipements des équipements d'équipements et services administratifs socio-culturels sanitaires Commune rurale Caïdat Code Géographique Souk Souk hebdomadaire Pharmacie Foyer féminin Infirmier privé Bureau deBureau poste Maison de jeunes Dispensaire rural Maison communale Mécanicien dentiste Gendarmerie royale Agence de crédit agricole Centre de santé communal Centre de travaux agricoles 066. Aousserd Aghouinite 066.03.03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aousserd 066.03.05 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bir Gandouz 066.05.03 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tichla 066.03.07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zoug 066.03.09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391. Oued Ed-Dahab Bir Anzarane 391.05.01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 El Argoub 391.09.01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gleibat EL Foula 391.05.03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imlili 391.09.03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mijik 391.05.05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oum Dreyga 391.05.07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/160 La commune Nombre d'établissements est Réseaux d'enseignement et de accessible d'infrastructure formation par Commune rurale Train Lycée Collège Autocar de développement ? Grand taxi Autre moyen Réseau d'électricité Réseau d'eau potable Ecole primaire satellite Ecole primaire centrale professionnelle publique Ecole coranique ou Msid Réseau d'assainissement La commune dispose-t-elle d'un plan Ecole primaire autonome Etablissement de formation 066. -

Télécharger Le Document
CARTOGRAPHIE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL MULTIDIMENSIONNEL NIVEAU ET DÉFICITS www.ondh.ma SOMMAIRE Résumé 6 Présentation 7 1. Approche méthodologique 8 1.1. Portée et lecture de l’IDLM 8 1.2. Fiabilité de l’IDLM 9 2. Développement, niveaux et sources de déficit 10 2.1. Cartographie du développement régional 11 2.2. Cartographie du développement provincial 13 2.3. Développement communal, état de lieux et disparité 16 3. L’IDLM, un outil de ciblage des programmes sociaux 19 3.1 Causes du déficit en développement, l’éducation et le niveau de vie en tête 20 3.2. Profil des communes à développement local faible 24 Conclusion 26 Annexes 27 Annexe 1 : Fiabilité de l’indice de développement local multidimensionnel (IDLM) 29 Annexe 2 : Consistance et méthode de calcul de l’indice de développement local 30 multidimensionnel Annexe 3 : Cartographie des niveaux de développement local 35 Annexes Communal 38 Cartographie du développement communal-2014 41 5 RÉSUMÉ La résorption ciblée des déficits socio-économiques à l’échelle locale (province et commune) requiert, à l’instar de l’intégration et la cohésion des territoires, le recours à une cartographie du développement au sens multidimensionnel du terme, conjuguée à celle des causes structurelles de son éventuel retard. Cette étude livre à cet effet une cartographie communale du développement et de ses sources assimilées à l’éducation, la santé, le niveau de vie, l’activité économique, l’habitat et les services sociaux, à partir de la base de données «Indicateurs du RGPH 2014» (HCP, 2017). Cette cartographie du développement et de ses dimensions montre clairement que : - La pauvreté matérielle voire monétaire est certes associée au développement humain, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’identifier les communes sous l’emprise d’autres facettes de pauvreté. -

MPLS VPN Service
MPLS VPN Service PCCW Global’s MPLS VPN Service provides reliable and secure access to your network from anywhere in the world. This technology-independent solution enables you to handle a multitude of tasks ranging from mission-critical Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), quality videoconferencing and Voice-over-IP (VoIP) to convenient email and web-based applications while addressing traditional network problems relating to speed, scalability, Quality of Service (QoS) management and traffic engineering. MPLS VPN enables routers to tag and forward incoming packets based on their class of service specification and allows you to run voice communications, video, and IT applications separately via a single connection and create faster and smoother pathways by simplifying traffic flow. Independent of other VPNs, your network enjoys a level of security equivalent to that provided by frame relay and ATM. Network diagram Database Customer Portal 24/7 online customer portal CE Router Voice Voice Regional LAN Headquarters Headquarters Data LAN Data LAN Country A LAN Country B PE CE Customer Router Service Portal PE Router Router • Router report IPSec • Traffic report Backup • QoS report PCCW Global • Application report MPLS Core Network Internet IPSec MPLS Gateway Partner Network PE Router CE Remote Router Site Access PE Router Voice CE Voice LAN Router Branch Office CE Data Branch Router Office LAN Country D Data LAN Country C Key benefits to your business n A fully-scalable solution requiring minimal investment -

Download Download
BORN IN THE MEDITERRANEAN: Alicia Vicente,3 Ma Angeles´ Alonso,3 and COMPREHENSIVE TAXONOMIC Manuel B. Crespo3* REVISION OF BISCUTELLA SER. BISCUTELLA (BRASSICACEAE) BASED ON MORPHOLOGICAL AND PHYLOGENETIC DATA1,2 ABSTRACT Biscutella L. ser. Biscutella (5 Biscutella ser. Lyratae Malin.) comprises mostly annual or short-lived perennial plants occurring in the Mediterranean basin and the Middle East, which exhibit some diagnostic floral features. Taxa in the series have considerable morphological plasticity, which is not well correlated with clear geographic or ecologic patterns. Traditional taxonomic accounts have focused on a number of vegetative and floral characters that have proved to be highly variable, a fact that contributed to taxonomic inflation mostly in northern Africa. A detailed study and re-evaluation of morphological characters, together with recent phylogenetic data based on concatenation of two plastid and one nuclear region sequence data, yielded the basis for a taxonomic reappraisal of the series. In this respect, a new comprehensive integrative taxonomic arrangement for Biscutella ser. Biscutella is presented in which 10 taxa are accepted, namely seven species and three additional varieties. The name B. eriocarpa DC. is reinterpreted and suggested to include the highest morphological variation found in northern Morocco. Its treatment here accepts two varieties, one of which is described as new (B. eriocarpa var. riphaea A. Vicente, M. A.´ Alonso & M. B. Crespo). In addition, the circumscriptions of several species, such as B. boetica Boiss. & Reut., B. didyma L., B. lyrata L., and B. maritima Ten., are revisited. Nomenclatural types, synonymy, brief descriptions, cytogenetic data, conservation status, distribution maps, and identification keys are included for the accepted taxa, with seven lectotypes and one epitype being designated here. -

Section 5 Région Du Gharb-Chrarda–Bni Hssen
Section 5 Région du Gharb-Chrarda–Bni Hssen 259 Section 5- Région du Gharb-Chrarda– Bni Hssen Introduction La région du Gharb-Chrarda-Beni Hssen se situe dans la partie Nord-Ouest du Royaume. Elle est limitée à l’Ouest par l’Océan Atlantique, au Nord par la région de Tanger-Tétouan, à l’Est par les deux régions de Taza-Al Hoceima-Taounate et de Fès-Boulemane, et au Sud par les régions de Meknès-Tafilalet et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër. Elle s’étend sur environ 8.805 km² , soit près de 1,23% de la superficie du Maroc. Sa population, estimée à 1.625.082 (6,2% de la population nationale) se distribue, selon le dernier découpage administratif, à travers deux provinces (Kénitra et Sidi Kacem), comprenant 12 municipalités, 61 communes rurales et une communauté urbaine. S’agissant du milieu naturel, on constate que la région se caractérise par un climat méditerranéen tempéré. Les précipitations annuelles moyennes sont de 600 mm dans les zones côtières et montagneuses, et diminuent à mesure qu’on se dirige vers le Sud-Est, où elles ne dépassent guère 450 mm. Les pluies enregistrées sont concentrées dans la période allant de fin novembre à fin mars. Les températures sont tempérées par le voisinage maritime et varient de 13° pendant l’hiver à 26° pendant l’été (les températures citées sont des moyennes saisonnières). Durant les périodes du chergui, on enregistre néanmoins des valeurs proches de 50°. 260 La région du Gharb-Chrarda-Beni Hssen dispose de ressources hydriques considérables, estimées à 6,75 milliards de m3, dont la partie réservée à l’irrigation est de 3,5 milliards de m3. -
![Rur@Lités : ISSN 2260-3727 Hewlett-Packard Company [Choisir La Date] 1](https://docslib.b-cdn.net/cover/1199/rur-lit%C3%A9s-issn-2260-3727-hewlett-packard-company-choisir-la-date-1-1211199.webp)
Rur@Lités : ISSN 2260-3727 Hewlett-Packard Company [Choisir La Date] 1
Numéro 4 – 2014 Revue électronique du laboratoire de Géographie « RURALITES » de l’Université de Poitiers Numéro spécial coordonné par : Moulay-Driss EL JIHAD et Daniel PEYRUSAUBES doctorant Rur@lités : ISSN 2260-3727 Hewlett-Packard Company [Choisir la date] 1 Sommaire Page ► Moulay-Driss EL JIHAD et Daniel PEYRUSAUBES Le Gharb : un territoire à l’épreuve du changement climatique ................................ 2 ► Aissa ELBOUZIDI, Mohammed LAATIRIS et Ahmed Mouhyiddine MOULINE Présentation du milieu physique de la côte atlantique du Gharb : paysages, potentiel hydrique, sol et végétation ............................................................... 4 ► Moulay-Driss EL JIHAD, Daniel PEYRUSAUBES et Aissa EL BOUZIDI Sécheresses saisonnières et changement climatique dans le Gharb ........................... 14 ► Hassan BENAOUDA et Thami DAIBOUN Changements climatiques et prises de décision en agriculture pluviale .................... 26 ► Ahmed EL KEHAL Mutations économiques et spatiales du littoral atlantique de la Région du Gharb-Chrarda-Béni-Hssen ..................................................................................... 36 ► Ahmed EL KEHAL et Michel DESSE Le littoral du Gharb: littoralisation, adaptation, adaptabilité .................................... 46 Document de couverture : Merja Zerga (lagune bleue) à Moulay Bousselham (nord-ouest du Gharb). Cliché M-D. EL JIHAD, juin 2014. Rur@lités, numéro 4 - année 2014 Laboratoire RURALITES, MSHS, Université de Poitiers 2 Le Gharb : un territoire à l’épreuve du changement -
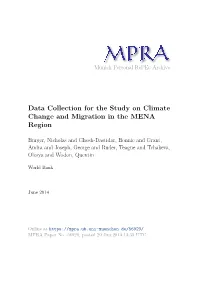
Data Collection for the Study on Climate Change and Migration in the MENA Region
Munich Personal RePEc Archive Data Collection for the Study on Climate Change and Migration in the MENA Region Burger, Nicholas and Ghosh-Dastidar, Bonnie and Grant, Audra and Joseph, George and Ruder, Teague and Tchakeva, Olesya and Wodon, Quentin World Bank June 2014 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/56929/ MPRA Paper No. 56929, posted 29 Jun 2014 13:35 UTC Data Collection for the Study on Climate Change and Migration in the MENA Region Nicholas Burger, Bonnie Ghosh-Dastidar, Audra Grant, George Joseph, Teague Ruder, Olesya Tchakeva, and Quentin Wodon June 2014 This paper is forthcoming in: Wodon, Q., A. Liverani, G. Joseph and N. Bougnoux, 2014 editors, Climate Change and Migration: Evidence from the Middle East and North Africa, Washington, DC: The World Bank. Abstract A large part of this study is based on data collected in 2011 in five focus countries of the MENA region. In addition, other existing data sources were used as well, as documented in the various chapters that follow, but this need not be discussed in this chapter. This chapter documents the process followed and some of the choices made for new data collection, both quantitative and qualitative, for the study on climate change and migration in the MENA region. After a brief introduction, we explain the nature of the household survey questionnaire, what it enables us to document, as well as some of its limits. Next, we explain how the household survey sites were selected and how the samples were constructed in each of the five focus countries. We also provide a few comments on the challenges encountered during survey implementation. -

ETUDE D'impact SUR L'environnement Etude LGV Kenitra -Tanger
Etude LGV Kenitra -Tanger ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT Maître d’Ouvrage Direction Projets LGV Groupement de Bureaux d’Etudes Mandataire du Groupement Sous-traitant du Groupement A 3 8 7 L G V K T 0 I E N 0 0 0 2 C 5 Code affaire Projet Tronçon Phase Discipline Type document Emetteur N° document Indice 143 Type d'ouvrage Localisation N° page Nom du fichier : A387-LGVKT-0-APS-IEN-TRAP-SCID-0002-C4.doc Sous-traitant du Groupement Mandataire du Groupement Etude LGV Kenitra-Tanger APPROBATION ET MISE A JOUR DES DOCUMENTS C5 07-07-2010 R. EL OUAFI Mise à jour suite aux remarques du CNEIE C4 17-06-2010 R. EL OUAFI Mise à jour suite aux remarques du CNEIE C3 11-03-2010 Mise à jour suite à revue interne C2 25-jan-09 A MEKKAOUI M. ATTOU D. CHAZELLE Mise à jour suite à revue interne C1 18-jan-09 A MEKKAOUI M. ATTOU Mise à jour suite à réunion avec la CNEIE B3 29-oct-09 A MEKKAOUI M. ATTOU Observations de SYSTRA B2 28-oct-09 A MEKKAOUI M. ATTOU Modification du projet par SYSTRA B1 13-oct-09 A MEKKAOUI M. ATTOU Observations de INEXiA et de SYSTRA A4 13-fev-09 A MEKKAOUI M. ATTOU Modification du projet par SYSTRA A3 12-fev-09 A MEKKAOUI M. ATTOU Modification du projet par SYSTRA A2 27-dec-08 A MEKKAOUI M. ATTOU Modification du projet par SYSTRA A1 21-oct-08 A MEKKAOUI M. ATTOU Indice Date Etabli Vérifié Validation BE Visa MOE Description A387-LGVKT-0-APS-IEN-TRAP-SCID-0002-C5 Page 2 / 143 Sous-traitant du Groupement Mandataire du Groupement Etude LGV Kenitra-Tanger SOMMAIRE 1 PREAMBULE _________________________________________________________________________