Carlo Santulli
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Curbing the Threat to Venezuela from Violent Groups
A Glut of Arms: Curbing the Threat to Venezuela from Violent Groups Latin America Report N°78 | 20 February 2020 Headquarters International Crisis Group Avenue Louise 235 • 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 • Fax: +32 2 502 50 38 [email protected] Preventing War. Shaping Peace. Table of Contents Executive Summary ................................................................................................................... i I. Introduction ..................................................................................................................... 1 II. Armed Groups, Crime and the State ................................................................................ 4 A. Guerrillas ................................................................................................................... 4 B. Colectivos ................................................................................................................... 7 C. Paramilitaries ............................................................................................................. 11 D. Criminal Groups ........................................................................................................ 12 III. Armed Groups in a Political Agreement .......................................................................... 16 IV. Conclusion ........................................................................................................................ 18 APPENDICES A. Map of Venezuela ............................................................................................................ -

Venezuela INDIVIDUALS
CONSOLIDATED LIST OF FINANCIAL SANCTIONS TARGETS IN THE UK Last Updated:25/03/2021 Status: Asset Freeze Targets REGIME: Venezuela INDIVIDUALS 1. Name 6: AMOROSO 1: ELVIS 2: EDUARDO 3: n/a 4: n/a 5: n/a. DOB: 04/08/1963. POB: Caracas, Venezuela a.k.a: HIDROBO AMOROSO Nationality: Venezuelan National Identification no: V-7659695 Address: Venezuela.Position: Second Vice President of the National Constituent Assembly Other Information: (UK Sanctions List Ref):VEN0029 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Former First and Second Vice-President of the non-recognised National Constituent Assembly (ANC). Lead the non-recognised ANC, signing the ‘law against hatred’, justifying the removal of a legally-elected opposition governor and banning Juan Guaido from running for any public office. (Gender):Male Listed on: 30/06/2020 Last Updated: 31/12/2020 Group ID: 13844. 2. Name 6: BENAVIDES TORRES 1: ANTONIO 2: JOSE 3: n/a 4: n/a 5: n/a. DOB: 13/06/1961. Nationality: Venezuelan Address: Caracas, Venezuela.Position: Chief Distrito Capital Government until January 2018.Former General Commander of the Bolivarian National Guard (GNB) until 21 June 2017 Other Information: (UK Sanctions List Ref):VEN0003 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (Further Identifiying Information):Former General Commander of the Bolivarian National Guard (GNB) until 21 June 2017 (UK Statement of Reasons):Chief of the Capital District (Distrito Capital) Government until January 2018.General Commander of the Bolivarian National Guard until 21 June 2017.Involved in repression of civil society and democratic opposition in Venezuela, and responsible for serious human rights violations committed by the Bolivarian National Guard under his command.His actions and policies as General Commander of the Bolivarian National Guard, including the Bolivarian National Guard taking the lead in the policing of civilian demonstrations and publically advocating that military courts should have jurisdiction over civilians, have undermined the rule of law in Venezuela. -

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER El 07 De Enero
Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER El 07 de enero de 2020, fue recibido en esta Sala Constitucional escrito presentado por el ciudadano ENRIQUE OCHOA ANTICH, titular de la cédula de identidad V-4.632.450, contentivo de la acción de amparo constitucional “(…) de mi derecho constitucional a la participación política y la representación consagrado en el artículo 62 de la Constitucion (sic)…”. En la misma fecha, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo. En sentencia n° 0001 de fecha 13 de enero de 2020, esta Sala Constitucional se declaró competente para conocer la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano ENRIQUE OCHOA ANTICH, contra la Asamblea Nacional y, particularmente, respecto “a los Diputados Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega, por un lado y a los Diputados Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, por otro lado, quienes pretenden cumplir funciones de integrantes de sendas Juntas Directivas de la Asamblea Nacional”, y ordenó notificar a los Diputados que dicen integrar la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional elegida, el 05 de enero de 2020, a saber: Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega, a los fines de que en el lapso de cinco (5) días siguientes a su notificación, en la forma requerida en el cardinal 3 del artículo 91 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, remitieran a esta Sala informe sobre el acto parlamentario de conformación de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el quórum de la sesión, tanto el de instalación como el de la aprobación de la Directiva, lo cual deberán soportar con copia certificada del acta y demás actuaciones vinculadas con la información requerida, so pena de incurrir en la sanción señalada en el artículo 122 eiusdem. -

Continuing Political Crisis in Venezuela
AT A GLANCE Continuing political crisis in Venezuela One year after Juan Guaidó's self-proclamation as interim President of Venezuela, the political crisis affecting the country is far from over, as shown by the government's latest failed attempt to neutralise the opposition forces in the National Assembly. The legislative election announced by Nicolas Maduro for 2020 will not improve the country's political situation unless it is accompanied by a free and fair presidential election. The government tries to control the National Assembly On 5 January 2020, when the National Assembly was due to elect its President for the last year of the current legislature, members of the National Guard prevented opposition MPs, including Juan Guaidó, from entering the Legislative Palace. In the session, held without the required quorum and ridden with irregularities, MPs loyal to the government elected Luis Parra, a former member of the Primero Justicia (Justice First) opposition party who had been expelled for alleged corruption and later became an ally of Maduro. To counter this 'parliamentary coup,' the opposition MPs held a parallel session in the premises of the El Nacional newspaper, where they re-elected Guaidó by a wide margin – 100 MPs out of the 167 that make up the National Assembly. The Maduro government, despite having its tactics clearly exposed to the public through the live media coverage, immediately recognised Parra. However, the parliamentary coup was strongly condemned by the United States – which imposed sanctions on Parra and six other politicians, the Organisation of American States (OAS), the Lima Group, the International Contact Group (ICG), and the EU. -

Represión, Justicia Y Derecho En La Venezuela De Hoy (2013-2019) (Repression, Justice and Law in Today’S Venezuela (2013-2019))
Represión, justicia y derecho en la Venezuela de hoy (2013-2019) (Repression, justice and law in today’s Venezuela (2013-2019)) OÑATI SOCIO-LEGAL SERIES, VOLUME 10, ISSUE 4 (2020), 789-833: INVESTIGATIONS – INVESTIGACIONES – IKERLANAK DOI LINK: HTTPS://DOI.ORG/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1132 RECEIVED 14 SEPTEMBER 2019, ACCEPTED 07 JANUARY 2020 VICTORIA CAPRILES∗ ANDREA SANTACRUZ∗ ROGELIO PÉREZ-PERDOMO∗ Resumen Este trabajo se refiere al uso de la represión y del sistema de justicia en Venezuela durante la presidencia de Nicolás Maduro (2013-2019). En la primera parte se analiza el fenómeno de la represión, cuantificando y explicando los actos represivos y el análisis del papel del aparato de justicia en la misma. En la segunda parte hay un estudio de trece casos que ilustran la manera como procede dicha represión. Después, se analiza cómo estas acciones pueden calificarse de violaciones de los derechos humanos y aun como crímenes de lesa humanidad. Finalmente, se teoriza sobre el significado del derecho y de la profesión jurídica en un régimen político que ha violado las normas constitucionales y ha conducido al país una emergencia humanitaria compleja. Palabras clave Venezuela; represión; justicia; derechos humanos; crímenes de lesa humanidad Este artículo forma parte de una serie de investigaciones llevadas a cabo por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y fue auspiciado por el Decanato de Investigación y Desarrollo Académico de la misma Universidad. Agradecemos a la estudiante de Derecho Mariangelina Socorro por la ayuda brindada como asistente de investigación. ∗ Victoria Capriles es abogada, magíster en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica (Oñati) y candidata a doctora en ciencia política de la Universidad Simón Bolívar (Caracas). -

Official Journal of the European Union
Official Journal L 205 I of the European Union Volume 63 English edition Legislation 29 June 2020 Contents II Non-legislative acts REGULATIONS ★ Council Implementing Regulation (EU) 2020/897 of 29 June 2020 implementing Regulation (EU) 2017/2063 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela . 1 DECISIONS ★ Council Decision (CFSP) 2020/898 of 29 June 2020 amending Decision (CFSP) 2017/2074 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela . 6 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period. EN The titles of all other acts are printed in bold type and preceded by an asterisk. 29.6.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union L 205 I/1 II (Non-legislative acts) REGULATIONS COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/897 of 29 June 2020 implementing Regulation (EU) 2017/2063 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Regulation (EU) 2017/2063 of 13 November 2017 concerning restrictive measures in view of the situation in Venezuela (1), and in particular Article 17(1) thereof, Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Whereas: (1) On 13 November 2017, the Council adopted Regulation (EU) 2017/2063. (2) On 21 December 2019, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy (the ‘High Representative’) issued a declaration on behalf of the Union which mentioned that the decision of the Venezuelan Supreme Court and the non-recognised Constituent Assembly to strip four members of the National Assembly of their constitutionally granted parliamentary immunity was a serious violation of the constitutional provisions, the rule of law and the democratic principle of separation of powers. -

Mensaje Anual a La Nación Del Presidente Nicolás Maduro Moros 2 Mensaje Anual a La Nación
Nicolás Maduro Moros DebemosDebemos pensarpensar comocomo paíspaís Mensaje anual a la Nación del presidente Nicolás Maduro Moros 2 Mensaje anual a la Nación Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Ciudadano secretaria sírvase informar si hay Rodríguez Muy buenas tardes a todas las hono- quórum. rables diputadas, a todos los honorables diputa- dos, a los representantes del cuerpo diplomático Secretaria de la Asamblea Nacional, Rosal- presentes hoy aquí, a los invitados especiales, go- ba Gil Hay quórum ciudadano Presidente bernadoras, gobernadores, alcaldesas, alcaldes, pueblo de Venezuela que hoy concurre a este Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge recinto en un día y hora histórico, día de recu- Rodríguez Se abre la sesión. Ciudadana secreta- peración, día de rescate, y en apretado resumen ria sírvase dar lectura al orden del día. día de respeto profundo a la letra contenida en el libro del pueblo, en el libro de Dios, la Consti- Secretaria de la Asamblea Nacional, Rosal- tución de la República Bolivariana de Venezuela. ba Gil Orden del día. Mensaje anual por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presi- Saludamos, y nos acompañan el día de hoy dente constitucional de la República Bolivaria- aquí, a la presidenta y jefa del Poder Electoral, na de Venezuela, jefe de Estado, de Gobierno, y Indira Alfonzo. comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Na- cionales Bolivarianas. De acuerdo y de confor- Al presidente del Tribunal Supremo de Jus- midad con lo establecido en el Artículo 237 de ticia y cabeza del Poder Judicial, magistrado la Constitución de la República Bolivariana de Maikel Moreno. Venezuela. Es todo presidente. -
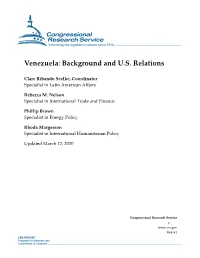
Background and US Relations
Venezuela: Background and U.S. Relations Clare Ribando Seelke, Coordinator Specialist in Latin American Affairs Rebecca M. Nelson Specialist in International Trade and Finance Phillip Brown Specialist in Energy Policy Rhoda Margesson Specialist in International Humanitarian Policy Updated March 12, 2020 Congressional Research Service 7-.... www.crs.gov R44841 SUMMARY R44841 Venezuela: Background and U.S. Relations March 12, 2020 Venezuela remains in a deep crisis under the authoritarian rule of Nicolás Maduro of the United Socialist Party of Venezuela. Maduro, narrowly elected in 2013 after the death of Hugo Chávez Clare Ribando Seelke, (president, 1999-2013), began a second term on January 10, 2019, that is widely considered Coordinator illegitimate. Since January 2019, Juan Guaidó, president of Venezuela’s democratically elected, Specialist in Latin opposition-controlled National Assembly, has sought to form a transition government to serve American Affairs until internationally observed elections can be held. The United States and 57 other countries [email protected] recognize Guaidó as interim president, but he has been unable to wrest Maduro from power and Rebecca M. Nelson has faced increased danger since returning home from a January-February 2020 tour, which Specialist in International included a meeting with President Trump. Some observers believe that National Assembly Trade and Finance elections due this year might start an electoral path out of the current stalemate. [email protected] Venezuela’s economy has collapsed. The country is plagued by hyperinflation, severe shortages Phillip Brown of food and medicine, and a dire humanitarian crisis. In April 2019, United Nations officials Specialist in Energy Policy estimated that 90% of Venezuelans were living in poverty. -

LA FÓRMULA PERFECTA PARA APUNTALAR LA DICTADURA Asedio a La Asamblea Nacional De Venezuela
LA FÓRMULA PERFECTA PARA APUNTALAR LA DICTADURA Asedio a la Asamblea Nacional de Venezuela Enero 2020 La fórmula perfecta para apuntalar la dictadura Asedio a la Asamblea Nacional de Venezuela AN: Asamblea Nacional ANC: Asamblea Nacional Constituyente CEPAZ: Centro de Justicia y Paz CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos CPI: Corte Penal Internacional GLOSARIO CRBV: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela DGCIM: Dirección General de Contrainteligencia Militar FAES: Fuerza de Acciones Especiales GNB: Guardia Nacional Bolivariana LOTTT: Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras OEA: Organización de Estados Americanos ONAPRE: Oficina Nacional de Presupuesto SEBIN: Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional TSJ: Tribunal Supremo de Justicia UIP: Unión Inter-Parlamentaria Mundial 2 La fórmula perfecta para apuntalar la dictadura Asedio a la Asamblea Nacional de Venezuela Resumen Ejecutivo.................................................................................... 4 Capítulo I Desmantelamiento de la Asamblea Nacional.............................................. 7 ÍNDICE Capítulo II Patrones de persecución................................................................................ 20 Capítulo IIII Conclusiones ................................................................................................... 34 3 Resumen Ejecutivo Desde el año 2015, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) ha elaborado tres informes en los que da cuen- ta de las reiteradas y sistematizadas prácticas de -

General Country of Origin Information Report Venezuela 2020
General Country of Origin Information Report Venezuela 2020 Date June 2020 Page 1 of 112 General Country of Origin Information Report Venezuela 2020 | Publication details City The Hague Assembled by Country of Origin Information Reports Section (DAF/AB) Page 2 of 112 General Country of Origin Information Report Venezuela 2020 | Table of Contents Publication details ............................................................................................2 Table of Contents ............................................................................................3 Introduction ....................................................................................................5 1 Political and security situation .................................................................... 6 1.1 Political development and society ......................................................................6 1.1.1 The Maduro government ..................................................................................6 1.1.2 The current (political) balance of power ..............................................................8 1.2 The security situation .......................................................................................9 1.2.1 The security situation, focusing on certain areas in particular ................................9 1.3 Freedom of movement ................................................................................... 12 1.3.1 Travel restrictions ......................................................................................... -

Inter-American Comission on Human Rights Resolution 14/2020
INTER-AMERICAN COMISSION ON HUMAN RIGHTS RESOLUTION 14/2020 Precautionary Measure No. 1205-19 Relatives of the journalist Roberto Deniz Machin regarding Venezuela February 5, 2020 Original: Spanish I. INTRODUCTION 1. On December 19, 2019, the Inter-American Commission on Human Rights (hereinafter “the Inter- American Commission”, “the Commission” or “the IACHR”) received a request for precautionary measures filed by Ana Bejarano Ricaurte1 (hereinafter “the applicants” or “the applicant”) urging the IACHR to request that the Bolivarian Republic of Venezuela (hereinafter “Venezuela” or “the State”) take the necessary measures to protect the rights to life and personal integrity of the identified family groups of Roberto Deniz Machin2, Ewald Carlos Scharfenberg Echegaray3 and Joseph Poliszuk Halle4, as well as those of such journalists, members of the website Armando.Info. According to the request, the proposed beneficiaries are in a situation of risk in Venezuela, due to the exercise of their right to freedom of expression. 2. In accordance with Article 25 of the Rules of Procedure, the Commission requested information from the State on January 15, 2020, without having received any response to date. On February 1, 2020, the representatives submitted additional information. 3. Upon analyzing the submissions of fact and law by the applicants, the Commission considers that the information presented proves prima facie that the rights to life and personal integrity of the relatives of Roberto Deniz Machin are at risk. Consequently, in accordance with Article 25 of the Rules of Procedure, the Commission requests that Venezuela: a) take the necessary measures to protect the rights to life and personal integrity of the identified relatives of Mr. -

Venezuela: Freedom in the World 2021 Country Report | Freedom H
ENGLISH ESPAÑOL FREEDOM IN THE WORLD 2021 Venezuela 14 NOT FREE /100 Political Rights 1 /40 Civil Liberties 13 /60 LAST YEAR'S SCORE & STATUS 16 /100 Not Free Global freedom statuses are calculated on a weighted scale. See the methodology. Overview Venezuela’s democratic institutions have deteriorated since 1999, but conditions have grown sharply worse in recent years due to harsher crackdowns on the opposition and the ruling party relying on widely condemned elections to control all government branches. The authorities have closed off virtually all channels for political dissent, restricting civil liberties and prosecuting perceived opponents without regard for due process. The country’s severe humanitarian crisis has left millions struggling to meet basic needs, and driven mass emigration. Key Developments in 2020 • In January, the ruling United Socialist Party of Venezuela (PSUV) attempted to undercut the legitimacy of Juan Guaidó, the interim president backed by the democratic opposition, by engineering the election of Luis Parra as National Assembly president. Military forces barred opposition members from entering the chamber to participate in the vote, and the Constitutional Chamber of the Nicolás Maduro-aligned Supreme Tribunal of Justice (TSJ) ratified Parra’s election in May. • Tightly controlled National Assembly elections went forward in December despite an opposition boycott, leading to a new body with a ruling-party majority. The old opposition-led legislature in response extended its own term, in an attempt to keep control of the legislative branch. At the end of the year, Venezuela had rival presidents and legislatures, with Maduro firmly in control and the democratic opposition severely weakened.