Stoner, Blues for the Red
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PERFORMED IDENTITIES: HEAVY METAL MUSICIANS BETWEEN 1984 and 1991 Bradley C. Klypchak a Dissertation Submitted to the Graduate
PERFORMED IDENTITIES: HEAVY METAL MUSICIANS BETWEEN 1984 AND 1991 Bradley C. Klypchak A Dissertation Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY May 2007 Committee: Dr. Jeffrey A. Brown, Advisor Dr. John Makay Graduate Faculty Representative Dr. Ron E. Shields Dr. Don McQuarie © 2007 Bradley C. Klypchak All Rights Reserved iii ABSTRACT Dr. Jeffrey A. Brown, Advisor Between 1984 and 1991, heavy metal became one of the most publicly popular and commercially successful rock music subgenres. The focus of this dissertation is to explore the following research questions: How did the subculture of heavy metal music between 1984 and 1991 evolve and what meanings can be derived from this ongoing process? How did the contextual circumstances surrounding heavy metal music during this period impact the performative choices exhibited by artists, and from a position of retrospection, what lasting significance does this particular era of heavy metal merit today? A textual analysis of metal- related materials fostered the development of themes relating to the selective choices made and performances enacted by metal artists. These themes were then considered in terms of gender, sexuality, race, and age constructions as well as the ongoing negotiations of the metal artist within multiple performative realms. Occurring at the juncture of art and commerce, heavy metal music is a purposeful construction. Metal musicians made performative choices for serving particular aims, be it fame, wealth, or art. These same individuals worked within a greater system of influence. Metal bands were the contracted employees of record labels whose own corporate aims needed to be recognized. -

5-Stepcoordination Challenge Pat Travers’ Sandy Gennaro Lessons Learned Mike Johnston Redefining “Drum Hero”
A WILD ZEBRA BLACK FADE DRUMKIT FROM $ WIN DIXON VALUED OVER 9,250 • HAIM • WARPAINT • MIKE BORDIN THE WORLD’S #1 DRUM MAGAZINE APRIL 2014 DARKEST HOUR’S TRAVIS ORBIN BONUS! MIKE’S LOVES A GOOD CHALLENGE 5-STEPCOORDINATION CHALLENGE PAT TRAVERS’ SANDY GENNARO LESSONS LEARNED MIKE JOHNSTON REDEFINING “DRUM HERO” MODERNDRUMMER.com + SABIAN CYMBAL VOTE WINNERS REVIEWED + VISTA CHINO’S BRANT BJORK TELLS IT LIKE IT IS + OLSSON AND MAHON GEAR UP FOR ELTON JOHN + BLUE NOTE MASTER MICKEY ROKER STYLE AND ANALYSIS NICKAUGUSTO TRIVIUM LEGENDARYIT ONLYSTARTS BEGINS TO HERE.DESCRIBE THEM. “The excitement of getting my first kit was like no other, a Wine Red 5 piece Pearl Export. I couldn’t stop playing it. Export was the beginning of what made me the drummer I am today. I may play Reference Series now but for me, it all started with Export.” - Nick Augusto Join the Export family at pearldrum.com. ® CONTENTS Cover and contents photos by Elle Jaye Volume 38 • Number 4 EDUCATION 60 ROCK ’N’ JAZZ CLINIC Practical Independence Challenge A 5-Step Workout for Building Coordination Over a Pulse by Mike Johnston 66 AROUND THE WORLD Implied Brazilian Rhythms on Drumset Part 3: Cô co by Uka Gameiro 68 STRICTLY TECHNIQUE Rhythm and Timing Part 2: Two-Note 16th Groupings by Bill Bachman 72 JAZZ DRUMMER’S WORKSHOP Mickey Roker Style and Analysis by Steve Fidyk EQUIPMENT On the Cover 20 PRODUCT CLOSE˜UP • DW Collector’s Series Cherry Drumset • Sabian 2014 Cymbal Vote Winners • Rich Sticks Stock Series Drumsticks • TnR Products Booty Shakers and 50 MIKE JOHNSTON Little Booty Shakers by Miguel Monroy • Magnus Opus FiBro-Tone Snare Drums Back in the day—you know, like ve years ago—you 26 ELECTRONIC REVIEW had to be doing world tours or making platinum records Lewitt Audio DTP Beat Kit Pro 7 Drum to in uence as many drummers as this month’s cover Microphone Pack and LCT 240 Condensers star does with his groundbreaking educational website. -

Dead Master's Beat Label & Distro October 2012 RELEASES
Dead Master's Beat Label & Distro October 2012 RELEASES: STAHLPLANET – Leviamaag Boxset || CD-R + DVD BOX // 14,90 € DMB001 | Origin: Germany | Time: 71:32 | Release: 2008 Dark and weird One-man-project from Thüringen. Ambient sounds from the world Leviamaag. Black box including: CD-R (74min) in metal-package, DVD incl. two clips, a hand-made booklet on transparent paper, poster, sticker and a button. Limited to 98 units! STURMKIND – W.i.i.L. || CD-R // 9,90 € DMB002 | Origin: Germany | Time: 44:40 | Release: 2009 W.i.i.L. is the shortcut for "Wilkommen im inneren Lichterland". CD-R in fantastic handmade gatefold cover. This version is limited to 98 copies. Re-release of the fifth album appeared in 2003. Originally published in a portfolio in an edition of 42 copies. In contrast to the previous work with BNV this album is calmer and more guitar-heavy. In comparing like with "Die Erinnerung wird lebendig begraben". Almost hypnotic Dark Folk / Neofolk. KNŒD – Mère Ravine Entelecheion || CD // 8,90 € DMB003 | Origin: Germany | Time: 74:00 | Release: 2009 A release of utmost polarity: Sudden extreme changes of sound and volume (and thus, in mood) meet pensive sonic mindscapes. The sounds of strings, reeds and membranes meet the harshness and/or ambience of electronic sounds. Music as harsh as pensive, as narrative as disrupt. If music is a vehicle for creating one's own world, here's a very versatile one! Ambient, Noise, Experimental, Chill Out. CATHAIN – Demo 2003 || CD-R // 3,90 € DMB004 | Origin: Germany | Time: 21:33 | Release: 2008 Since 2001 CATHAIN are visiting medieval markets, live roleplaying events, roleplaying conventions, historic events and private celebrations, spreading their “Enchanting Fantasy-Folk from worlds far away”. -

Spiritual Reality Or Obsession
Spiritual Reality or Obsession WATCHMAN NEE Christian Fellowship Publishers, Inc. New York Copyright ©1970 Christian Fellowship Publishers, Inc. New York All Rights Reserved ISBN 0-435008-41-1 Available from the Publishers at: 11515 Allecingie Parkway Richmond, Virginia 23235 PRINTED IN U.S.A. CONTENTS 1 Spiritual Reality: What It Is 5 2 Spiritual Reality: Its Relationships 23 3 Spiritual Reality: How to Enter In 35 4 Obsession: What It Is 43 5 Obsession: Causes and Deliverance 53 Scripture quotations are from the American Standard Version (1901) of the Bible unless otherwise indicated. Spiritual Reality: What It Is God is a Spirit: and they that worship him must worship in spirit and truth. (John 4.24) 1 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he shall 1 guide you into all the truth. (John 16.13) And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is the truth. (1 John 5.7) One thing which God’s people should take note of is that every spiritual matter has its reality before God. If what we have touched is mere appearance and not reality we shall find that it is of no spiritual value whatsoever. What then is spiritual reality? The reality of a spiritual thing is something spiritual not material. Although spiritual reality is often expressed in words, those words, however many, are not the reality. Although spiritual reality needs to be disclosed in our lives, the set formalities of our lives are not reality. Although spiritual reality must be manifested in conduct, human-manufactured pretension is not reality. -

Myspace.Com - - 43 - Male - PHILAD
MySpace.com - WWW.RECORDCASTLE.COM - 43 - Male - PHILAD... http://www.myspace.com/recordcastle Sponsored Links Gear Ink JazznBlues Tees Largest selection of jazz and blues t-shirts available. Over 100 styles www.gearink.com WWW.RECORDCASTLE.COM WWW.RECORDCASTLE.COM is in your extended "it's an abomination that we are in an network. obama nation ... ron view more paul 2012 ... balance the budget and bring back tube WWW.RECORDCASTLE.COM's Latest Blog Entry [ Subscribe to this Blog ] amps" [View All Blog Entries ] Male 43 years old PHILADELPHIA, Pennsylvania WWW.RECORDCASTLE.COM's Blurbs United States About me: I have been an avid music collector since I was a kid. I ran a store for 20 years and now trade online. Last Login: 4/24/2009 I BUY PHONOGRAPH RECORDS ( 33 lp albums / 45 rpms / 78s ), COMPACT DISCS, DVD'S, CONCERT MEMORABILIA, VINTAGE POSTERS, BEATLES ITEMS, KISS ITEMS & More Mood: electric View My: Pics | Videos | Playlists Especially seeking Private Pressings / Psychedelic / Rockabilly / Be Bop & Avant Garde Jazz / Punk / Obscure '60s Funk & Soul Records / Original Contacting WWW.RECORDCASTLE.COM concert posters 1950's & 1960's era / Original Beatles memorabilia I Offer A Professional Buying Service Of Music Items * LPs 45s 78s CDS DVDS Posters Beatles Etc.. Private Collections ** Industry Contacts ** Estates Large Collections / Warehouse finds ***** PAYMENT IN CASH ***** Over 20 Years experience buying collections MySpace URL: www.myspace.com/recordcastle I pay more for High Quality Collections In Excellent condition Let's Discuss What You May Have For Sale Call Or Email - 717 209 0797 Will Pick Up in Bucks County / Delaware County / Montgomery County / Philadelphia / South Jersey / Lancaster County / Berks County I travel the country for huge collections Print This Page - When You Are Ready To Sell Let Me Make An Offer ----------------------------------------------------------- Who I'd like to meet: WWW.RECORDCASTLE.COM's Friend Space (Top 4) WWW.RECORDCASTLE.COM has 57 friends. -
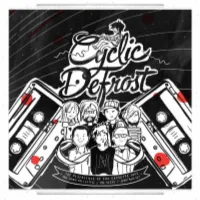
Cyclic Issue 32.Pdf
1 Cyclic Defrost Magazine Issue 32 | July 2013 www.cyclicdefrost.com Stockists Founder Contents The following stores stock Cyclic Defrost although Sebastian Chan 04 Editorial | Sebastian Chan arrival times for each issue may vary. Editors 06 Cover Designer | Jonathan Key NSW Alexandra Savvides 12 This Thing | Samuel Miers Black Wire, Emma Soup, FBi Radio, Goethe Shaun Prescott 16 The Longest Day | Chris Downton Institut, Mojo Music, Music NSW, Pigeon Ground, Sub-editor 20 Rise of the tape | Kate Carr The Record Store, Red Eye Records, Repressed Luke Telford 26 The Necks | Tony Mitchell Records, Title Music, Utopia Art Director 34 Arbol | Christopher Mann VIC Thommy Tran 40 Cyclic Selects | Bob Baker-Fish Collectors Corner Curtin House, Licorice Pie, Advertising latest reviews Polyester Records, Ritual Music and Books, Wooly Sebastian Chan Now all online at www.cyclicdefrost.com/blog Bully Advertising Rates QLD Download at cyclicdefrost.com Butter Beats, The Outpost, Rocking Horse, Taste-y Printing SA Unik Graphics B Sharp Records, Big Star Records, Clarity Records, Website Mr V Music, Title Music Adam Bell and Sebastian Chan WA Web Hosting 78 Records, Dadas, Fat Shan Records, Junction Blueskyhost Records, Mills Records, Planet Music, The Record www.blueskyhost.com Finder, RTRFM Cover Design TAS Jonathan Key Fullers Bookshop, Ruffcut Records Issue 32 Contributors NT Adrian Elmer, Alexandra Savvides, Bianca de Vilar, Bob Baker Fish, Chris Downton, Christopher Mann, Doug Happy Yess Wallen, Jonathan Key, Joshua Meggitt, Joshua Millar, ONLINE Kate Carr, Kristian Hatton, Luke Bozzetto, Samuel Miers, Twice Removed Records Stephen Fruitman, Tony Mitchell, Wayne Stronell, Wyatt If your store doesn't carry Cyclic Defrost, Lawton-Masi. -

La Dérive Des Sentiments Troisième Album Pour La Formation Dark Rock À Géométrie Variable De Michael Sele
www.daily-rock.com UNE PUBLICATION No 41 DU COLLECTIF ÉTÉ 2010 MENSUEL Daily Rock GRATUIT TOUTE L’ACTUALITÉ BRÛLANTE DU ROCK EN ROMANDIE ZZ Top Melissa Auf der Maur : Petrus au cœur du sujet p. 6 négatif p. 11 en Europe p.! 2 © Joseph Carlucci The Beauty Of Gemina, la dérive des sentiments Troisième album pour la formation dark rock à géométrie variable de Michael Sele. Une fois de plus, les hymnes, épiques et dramatiques, répondent présents. Peut-être enfin la reconnaissance à l'échelon planétaire ? Entretien avec le maître du château en personne. Est-ce ok d'être un artiste dans une société dominée par la médiocrité et la musique jetable ? Michael Sele : C'est un privilège d'écrire des chansons qui viennent de Edito l'intérieur et de jouer la musique que tu aimes. Cela rend la composition Maman, Papa agréable, surtout quand tu n'as pas à te conformer au mainstrean et aux J'avoue, j'ai fauté. En 2010, je me standards commerciaux. Avoir un suis tellement éloigné de mon rock nombre remarquable de personnes, chéri de mon enfance, que je me suis fans, journalistes et critiques qui retrouvée à chercher des tickets pour estiment ton travail, voilà ce qui me le concert de Lady Gaga à Dublin. rend fier et me motives à continuer. A la fin de la journée, un sentiment de Et pourtant, comme elle assure, cette Lady Gaga ! gratitude mélangé à un grand respect Là ou le rock'n'roll devient de plus en plus demeure. soft questions clips et complètement has-been question provocation, Stefani Germanotta nous Certaines personnes pensent que tu es balance un clip censuré de huit minutes et fait « At the End of the Sea » preuve d'imagination débordante, notamment en un vampire.. -

Stenerrockensstørstestemme
musikmetalfest nu 6 2011 torsdag 16. juni Fyens Stiftstidende Kyuss er pionerer inden forden moderne stenerrock, og albummet ”Blues forthe RedSun”erenmilepæl inden forden psykedeliskemetalrock. John Garcia er nummer trefra højre. PR-foto Stenerrockensstørstestemme ■ Sangeren John Garcia er en levende legende Kyuss Lives! kunne jeg mærke, at lysten mens datteren brokker sig til at stå på scenen og spille højlydt ibaggrunden over,aT inden for stenerrock, hvor tungeriffs og Kyuss blev dannet islutninen af Lives! af Garcia, Oliveri, Bjork sange fra ”Blues for the Red fortet ikke vil, som hun vil. psykedelisketekster forenes. Hans band Kyuss 1980’erne. Gruppen udgavfem samt Bruno Fevery. Sun” og ”... And the Circus er gendannet og optræder på metalfestivalen albummer samt en ep sammen Copenhell foregår fredagog Leaves To wn” igen var der. Europa forstår os med det nydannede Queens of lørdag17. og 18. juni på Refsha- Det gav mig blod på tanden Kyuss Lives! skal optræde i Copenhell under navnet KyussLives! the Stone Agei1997. leøen iKøbenhavn og har bl.a. til at gendanne bandet og gå Europa frem til august, og John Garcia og Josh Homme Judas Priest, Korn, BulletFor My igang med nyt materiale. Så John Garcia glæder sig til På forhånd havde jeg frygtet, delig dag, der begyndte klok- var bandets to fastemedlem- Valentine, Anvil, Opeth og May- ja, der kommer et album med endnu et møde med Europa. John Garcia ville være gna- ken 5.30. Ind imellem er det mer.Deblevsuppleret af Brant hem på programmet. Kyuss Lives! på et tidspunkt, -IUSA forstår publikum os ven og særdeles arrig at inter- som at befinde sig midt ien Bjork, Nick Oliveri, Scott Reeder, www.myspace.com/kyusslives lover John Garcia. -

Black Sabbath: Master of Reality Free Ebook
FREEBLACK SABBATH: MASTER OF REALITY EBOOK John Darnielle | 120 pages | 05 Jun 2008 | Bloomsbury Publishing PLC | 9780826428998 | English | London, United Kingdom Master of Reality It was Black Sabbath’s first album to debut in the Top Some early German, US and Canadian pressings had the title incorrectly printed on the record labels as 'Masters Of Reality'. Also their first album to feature the heavier new sound created by dropping the tuning three semi-tones below the standard E, thus creating the premise for what would become known as the stoner rock sound. Master of Reality is the third studio album by English rock band Black Sabbath, released on 21 July by Vertigo Records. It is regarded by some critics as the foundation of doom metal, stoner rock, and sludge metal. It peaked at number five on the UK Albums Chart and number eight on the US Billboard View credits, reviews, tracks and shop for the Misprinted Sleeve Vinyl release of Master Of Reality on Discogs. Master Of Reality It was Black Sabbath’s first album to debut in the Top Some early German, US and Canadian pressings had the title incorrectly printed on the record labels as 'Masters Of Reality'. Also their first album to feature the heavier new sound created by dropping the tuning three semi-tones below the standard E, thus creating the premise for what would become known as the stoner rock sound. Masters of Reality is an American rock band formed in by frontman Chris Goss and guitarist Tim Harrington in Syracuse, New York, United States. -

Ibtihaj Muhammad's
Featuring 484 Industry-First Reviews of Fiction, Nonfiction, Children'sand YA Books KIRKUSVOL. LXXXVI, NO. 15 | 1 AUGUST 2018 REVIEWS U.S. Olympic medalist Ibtihaj Muhammad’s memoir, Proud, released simultaneously in two versions—one for young readers, another for adults—is thoughtful and candid. It’s also a refreshingly diverse Cinderella story at a time when anti-black and anti-Muslim sentiments are high. p. 102 from the editor’s desk: Chairman Excellent August Books HERBERT SIMON President & Publisher BY CLAIBORNE SMITH MARC WINKELMAN # Chief Executive Officer MEG LABORDE KUEHN [email protected] Photo courtesy Michael Thad Carter courtesy Photo Editor-in-Chief Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World by Anana CLAIBORNE SMITH Giridharadas (Aug. 28): “Give a hungry man a fish, and you get to pat [email protected] Vice President of Marketing yourself on the back—and take a tax deduction. It’s a matter of some SARAH KALINA [email protected] irony, John Steinbeck once observed of the robber barons of the Gilded Managing/Nonfiction Editor ERIC LIEBETRAU Age, that they spent the first two-thirds of their lives looting the public [email protected] Fiction Editor only to spend the last third giving the money away. Now, writes politi- LAURIE MUCHNICK cal analyst and journalist Giridharadas, the global financial elite has [email protected] Children’s Editor reinterpreted Andrew Carnegie’s view that it’s good for society for VICKY SMITH [email protected] capitalists to give something back to a new formula: It’s good for busi- Young Adult Editor Claiborne Smith LAURA SIMEON ness to do so when the time is right, but not otherwise….A provocative [email protected] Staff Writer critique of the kind of modern, feel-good giving that addresses symptoms and not causes.” MEGAN LABRISE [email protected] Sweet Little Lies by Caz Frear (Aug. -

RYKO/ADA Global - NEWS 03/08 Im Vertrieb Von Lotus Records
RYKO/ADA Global - NEWS 03/08 im Vertrieb von Lotus Records Wien, 07.03.08 Hallo Redaktionen! Kurz bevor der Osterhase nach seinen Schoko- und Gelee-Auftritten in allen einschlägigen Supermärkten endgültig seine Nase durch die Tür steckt, präsentieren wir unseren Alternative/Indie-Feinkostbauchladen mit Athens/Georgia-Folk-Pop-Rock-Formation Elf Power und den fulminanten Hard-Rock-Neulingen Year Long Disaster aus L.A., die im Rahmen der "A SPRING BREAK ORGY TO REMEMBER" Tournee mit Turbonegro und Valient Thorr im März in Graz und Wien auch live zu sehen sein werden. Aktuell bei RYKO/ADA Global: Elf Power "In A Cave" - FuzzBox-Electonic, Acoustic-Folk, Kraut und Grass-Root-Rock, sowie klassischen Pop-Melodien ... Elf Power gelingt, was im heutigen Musik-Business kaum noch möglich scheint – langsames und nachhaltiges Entwickeln eines eigenen Sounds, das Experiment als Chance neue Spielarten zu entdecken und zu kultivieren – ohne dabei den Spass, Bauchgefühl und Tanzbein zu vergessen. Year Long Disaster "Year Long Disaster" - Das Rock 'n' Roll Power Trio gilt als Gitarren- Hoffnung des Jahres und brettert auf seinem Debüt-Album den "Highway to Hardrock-Hell" entlang. Daniel Davis (Sohn der Kinks-Legende Dave Davis), Rich Mullins (Ex-Karma To Burn) und Brad Hargreaves (Third Eye Blind) zeigen das Drogen-Rehab erfolgreich sein kann und die Erinnerung an 70er Power-Chords überlebt. Live-Termine in Österreich von Joe Jackson, Volcom Year Long Disaster und The Wombats RYKO/ADA podcast - The Real Alternative feat. Year Long Disaster, Elf Power & The Wombats http://www.tautscher.net/?tag=podcast Wir freuen uns über Anfragen, Ankündigung, Berichte, Kritiken, etc. -

2017 MAJOR EURO Music Festival CALENDAR Sziget Festival / MTI Via AP Balazs Mohai
2017 MAJOR EURO Music Festival CALENDAR Sziget Festival / MTI via AP Balazs Mohai Sziget Festival March 26-April 2 Horizon Festival Arinsal, Andorra Web www.horizonfestival.net Artists Floating Points, Motor City Drum Ensemble, Ben UFO, Oneman, Kink, Mala, AJ Tracey, Midland, Craig Charles, Romare, Mumdance, Yussef Kamaal, OM Unit, Riot Jazz, Icicle, Jasper James, Josey Rebelle, Dan Shake, Avalon Emerson, Rockwell, Channel One, Hybrid Minds, Jam Baxter, Technimatic, Cooly G, Courtesy, Eva Lazarus, Marc Pinol, DJ Fra, Guim Lebowski, Scott Garcia, OR:LA, EL-B, Moony, Wayward, Nick Nikolov, Jamie Rodigan, Bahia Haze, Emerald, Sammy B-Side, Etch, Visionobi, Kristy Harper, Joe Raygun, Itoa, Paul Roca, Sekev, Egres, Ghostchant, Boyson, Hampton, Jess Farley, G-Ha, Pixel82, Night Swimmers, Forbes, Charline, Scar Duggy, Mold Me With Joy, Eric Small, Christer Anderson, Carina Helen, Exswitch, Seamus, Bulu, Ikarus, Rodri Pan, Frnch, DB, Bigman Japan, Crawford, Dephex, 1Thirty, Denzel, Sticky Bandit, Kinno, Tenbagg, My Mate From College, Mr Miyagi, SLB Solden, Austria June 9-July 10 DJ Snare, Ambiont, DLR, Doc Scott, Bailey, Doree, Shifty, Dorian, Skore, March 27-April 2 Web www.electric-mountain-festival.com Jazz Fest Vienna Dossa & Locuzzed, Eksman, Emperor, Artists Nervo, Quintino, Michael Feiner, Full Metal Mountain EMX, Elize, Ernestor, Wastenoize, Etherwood, Askery, Rudy & Shany, AfroJack, Bassjackers, Vienna, Austria Hemagor, Austria F4TR4XX, Rapture,Fava, Fred V & Grafix, Ostblockschlampen, Rafitez Web www.jazzfest.wien Frederic Robinson,