Iv. Les Risques
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aubenas À 1/50 000
NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE AUBENAS À 1/50 000 par S. ELMI, R. BUSNARDO, B. CLAVEL, G. CAMUS, G. KIEFFER, P. BÉRARD, B. MICHAËLY 1996 Éditions du BRGM Service géologique national Références bibliographiques. Toute référence en bibliographie au présent document doit être faite de la façon suivante : - pour la carte : KERRIEN Y. (coord.), ELMI S., BUSNARDO R., CAMUS G., KIEFFER G., MOINEREAU J., WEISBROD A. (1989) - Carte géol. France (1/50000), feuille Aubenas (865). Orléans : BRGM. Notice explicative par S. Elmi, R. Busnardo, B. Clavel, G. Camus, G. Kieffer, P. Bérard, B. Michaëly (1996), 170 p. - pour la notice: ELMI S., BUSNARDO R., CLAVEL B., CAMUS G., KIEFFER G., BÉRARD P., MICHAËLY B. (1996) - Notice explicative, Carte géol. France (1/50000), feuille Aubenas (865). Orléans : BRGM, 170 p. Carte géologique par Y. Kerrien (coord.), S. Elmi, R. Busnardo, G. Camus, G. Kieffer, J. Moinereau, A. Weisbrod (1989). © BRGM 1996. Tous droits de traduction et de reproduction réservés. Aucun extrait de ce document ne peut être reproduit, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit (machine électronique, mécanique, à photocopier, à enregistrer ou tout autre) sans l'autorisation préalable de l'éditeur. ISBN : 2-7159-1865-8 SOMMAIRE Pages INTRODUCTION 5 CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA CARTE 5 APERÇU GÉOGRAPHIQUE ET STRUCTURAL 6 HISTOIRE GÉOLOGIQUE 8 DESCRIPTION DES TERRAINS 19 TERRAINS CRISTALLOPHYLLIENS 19 MIGMATITES ET GRANITES 20 VOLCANISME DES COIRONS 22 FORMATIONS SÉDIMENTAIRES PRIMAIRES 24 FORMATIONS SÉDIMENTAIRES SECONDAIRES -

CSC Le Palabre Pour L’Année En Cours � Chèque Ou Espèces Du Montant De La Prestation
Règlement intérieur des centres de loisirs CSC L E PALABRE 6 Rue Albert Seibel 07200 AUBENAS Tél : 04 75 35 28 73 / @ : [email protected] Nous mettons tout en œuvre pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. En contrepartie, nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance de ce règlement intérieur et de vous y conformer . 1° NOUVELLES INSCRIPTIONS : Les nouvelles inscriptions se font obligatoirement au secrétariat enfance jeunesse aux horaires indiqués ci-dessous : A Aubenas , la secrétaire enfance jeunesse vous accueille: Hors vacances scolaires : Pendant les vacances scolaires : - le mardi 9h à 12h 14h à 18h - Du lundi au jeudi 8h30 à 12h 15h à 18h30 - le mercredi 8h30 à 12h 14h30 à 18h30 - Le vendredi 8h30 à 12h FERME - le jeudi FERME 14h à 18h Pour le centre de Lavilledieu uniquement , la directrice vous accueille, sur rendez-vous : - Le mercredi 7h30 à 9h15 17h à 18h30 Nous sommes fermés les jours fériés. Le centre socioculturel Le Palabre est en gestion de quatre accueils de loisirs sans hébergement : Deux accueils de loisirs .xes à Aubenas et à Lavilledieu Deux accueils de loisirs itinérants CCBA (communauté de communes du bassin d’Aubenas), Tous nos accueils collectifs de mineurs sont déclarés et agréés par la DDCSPP. Les accueils de loisirs d’Aubenas et Lavilledieu accueillent les familles de toutes communes. Les accueils de loisirs itinérants accueillent les enfants de la communautés de communes CCBA ; ils s’installent dans les écoles et se déplacent à chaque période de vacances . Les communes de la CCBA concernées : Ailhon, Aizac, Antraïgues, Asperjoc, Aubenas, Fons, Genestelle, Juvinas, Labastide sur Besorgues, Labégude, Lachapelle sous Aubenas, Lavilledieu, Laviolle, Lentillères, Mercuer, Mezilhac, St Andéol de Vals, St Didier sous Aubenas, St Etienne de Boulogne, St Etienne de Fontbellon, St Joseph des Bancs, St Julien du Serre, St Michel de Boulogne, St Privat, St Sernin, Ucel, Vals les Bains, Vesseaux, Vinezac. -

Carte-Alp2019.Pdf
’Ardèche expériences 35 émerveillantes Avec le Pass, accédez librement aux sites visibles dans cette page avec le logo. PEAUGRES Davézieux VANOSC ANNONAY Saint Jean 3 JOURS 6 JOURS ANNUEL 01 Safari de Tél. 04 75 33 00 32 02 Musée des Tél. 04 75 69 89 20 Musée du Tél. 04 75 34 79 81 Montgolfières QUINTENAS 05 Train de de Muzols safari-peaugres.com musee-papeteries- 03 lavanaude.org 04 Tél. 04 75 34 41 14 Tél. 04 75 06 07 00 Peaugres Papeteries Canson canson-montgolfier.fr Charronnage & cie 06 17 96 70 23 l’Ardèche trainardeche.fr 39€ 49€ 79€ Du 09 février au 11 novembre 2019 Ouvert du 15 avril au 15 octobre : Décollez du quotidien ! montgolfieres-cie.com Le plus grand parc animalier et Montgolfier Ouvert toute l’année, mercredi au car du mercredi au dimanche Emerveillez-vous au rythme de la vapeur ! Du 30 mars au 11 novembre, Adulte : à partir de 20,50 € Embarquez avec une équipe passionnée Montez à bord de trains historiques pour d’Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la maison natale des frères Montgolfier, et dimanche de 14h30 à 18h. Joseph BESSET le petit charron… de 15h à 18h30. Bureau ouvert de 9h à 19h Jusqu’à 3 départs possibles Visitez l'Ardèche (période Ecozen) Tous les jours en Juillet et Août depuis 20 ans. Nous vous ferons découvrir des voyages à la journée ou la ½ journée. en toute liberté ! Au cœur de l’Ardèche, une immersion, à pied c’est l’aventure de la papeterie : magie Ouvert toute l’année sur rendez-vous. -

Voies Douces Climat ! #4 Ardèche !
P6 P7 P12 ON NE PERD PAS B A BA DES PARLONS LE NORD EN VOIES DOUCES CLIMAT ! #4 ARDÈCHE ! TOUT SAVOIR SUR LE BASSIN D’AUBENAS JUILLET 2019 LONGUE-VUE Voies douces Tous en selle ! EMPREINTE Édito L'été approche et, avec lui les beaux jours. Et si nous sortions prendre l'air ? Ce quatrième numéro du magazine intercommunal vous propose des sujets principalement tournés sur des activités "nature". Le dossier principal est consacré au réseau de voies douces, l'un des projets phares de la communauté de communes qui a pour vocation à développer le tourisme à vélo mais aussi, et surtout à encourager les déplacements domicile-travail en cycle. Louis Buffet Président de la "L'escapade sportive" nous emmène sur les traces des Communauté de Communes orienteurs : nous vous faisons découvrir ou redécouvrir la du Bassin d'Aubenas course d'orientation. La Coupe d'Europe Junior de Course d'Orientation verra sa dernière épreuve se dérouler sur notre I TOUT SAVOIR SUR LE BASSIN D’AUBENAS SUR LE BASSIN SAVOIR TOUT I territoire en septembre, un rendez-vous à prendre. A ba B Parce que les activités en extérieur ne peuvent se faire que dans un environnement sain, le "Zoom sur" vous parle du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui se met en place 2 sur le bassin de la communauté de communes. Nous devons tous travailler à réduire notre impact sur l'environnement, Communauté de Communes le PCAET fixe des axes d'actions et des objectifs à atteindre. du Bassin d’Aubenas 16, route de la Manufacture Royale 07200 Ucel Retrouvez également nos rubriques habituelles : le 04 75 94 61 12 "Panorama" qui fait un tour d'horizon des actions sur le [email protected] Directeur de publication territoire et les "Cartes postales" qui vous présentent Louis Buffet un retour sur des actions des derniers mois. -

FRDG245 Etat Des Connaissances 2014 Libellé De La Masse D'eau V2 : Grès Trias Ardéchois
Code de la masse d'eau V2 : FRDG245 Etat des connaissances 2014 Libellé de la masse d'eau V2 : Grès Trias ardéchois Date impression fiche : 12/12/2014 1. IDENTIFICATION ET LOCALISATION GEOGRAPHIQUE Correspond à tout ou partie de(s) ME V1 suivante(s): Code ME V1 Libellé ME souterraines V1 FRDG507 Formations sédimentaires variées de la bordure cévenole (Ardèche, Gard) et alluvions de la Cèze à St Ambroix Code(s) SYNTHESE RMC et BDLISA concerné(s) Code SYNTHESECode BDLISA Libellé ENTITE 607F 533AK00 Grès du Trias (moyen et inférieur) ardéchois Superficie de l'aire d'extension (km2) : totale à l'affleurement sous couverture 255.24 225.89 29.35 Type de masse d'eau souterraine : Dominante Sédimentaire Limites géographiques de la masse d'eau Département(s) Située dans la partie sud-est du département de l'Ardèche, cette masse d'eau correspond à une bande de terrains N° Superficie concernée détritiques qui sépare le socle des montagnes ardéchoises des formations jurassiques de la bordure-sous cévenole, (km2) entre Privas au nord-est et Les Vans au sud. On peut distinguer deux régions d'affleurement principales : 07 255.24 - Une première zone au Nord, correspondant au Bassin de Privas : sur les communes de Pranles, Lyas, Privas, Veyras, Creysseilles et Fourchères. - Une deuxième zone au Sud d'Aubenas : qui s'étend de Saint-Julien-de-Serre au Nord-Est jusqu'aux Vans au Sud- Ouest. District gestionnaire : Rhône et côtiers méditerranéens (bassin Rhône-Méditerranée-Corse) Trans-Frontières : Etat membre : Autre état : Trans-districts : Surface dans -

Recueil Des Actes Administratifs N°07-2017-028
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°07-2017-028 ARDÈCHE PUBLIÉ LE 21 MARS 2017 1 Sommaire 07_DDARS_Délégation départementale de l?Agence régionale de santé de l' Ardèche 07-2017-01-03-005 - 2016-6548 Portant renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "Résidence Les Gorges" à Saint-Martin-d 'Ardèche (07). (3 pages) Page 5 07-2017-03-17-001 - Arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire relative au captage "Vahille", situé sur la commune de SAINT CLEMENT (4 pages) Page 9 07-2017-03-10-005 - Arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête préalable à la DUP du captage "Vahille", situé sur la commune de SAINT-CLEMENT (3 pages) Page 14 07_DDCSPP_Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'Ardèche 07-2017-02-27-014 - APC modifiant les prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral n° 91/617 (2444 DIV) du 18 juillet 1991 autorisant le fonctionnement de l’établissement exploité par la société GL ALTESSE, anciennement ALTESSE BIJOUX, sis à Saint-Martin-de-Valamas (3 pages) Page 18 07-2017-03-08-003 - APC portant actualisation des prescriptions du permis de construire initial, de l’autorisation de défrichement et mise en place des garanties financières de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dénommée « Parc éolien de la Montagne Ardéchoise Sud 2» et exploitée par la société Parc éolien de la Montagne Ardéchoise Sud 2 sur la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès (7 pages) Page -

'Châtaigne D'ardèche'
14.8.2013 EN Official Journal of the European Union C 235/13 Publication of an application pursuant to Article 50(2)(a) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2013/C 235/06) This publication confers the right to oppose the application pursuant to Article 51 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council ( 1 ). SINGLE DOCUMENT COUNCIL REGULATION (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs ( 2) ‘CHÂTAIGNE D’ARDÈCHE’ EC No: FR-PDO-0005-0874-12.04.2011 PGI ( ) PDO ( X ) 1. Name ‘Châtaigne d’Ardèche’ 2. Member State or Third Country France 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.6. Fruit, vegetables and cereals, fresh or processed 3.2. Description of product to which the name in (1) applies The designation of origin ‘Châtaigne d’Ardèche’ is reserved for fruit of ancient local varieties of Castanea sativa Miller belonging to a population adapted to the local environmental conditions of the Ardèche region (ecotype) and displaying the following common characteristics: the fruit is elliptical in shape, with a pointed apex, terminating with a style. They are light chestnut brown to dark brown in colour and are marked by vertical grooves. They have a small hilum. After peeling, their kernel is creamy white to pale yellow in colour and has a ribbed surface. The pellicle (or inner skin) can penetrate the kernel to the point of dividing it in two. -

Communauté De Communes Du Vinobre Accueil De La Petite Enfance État Des Lieux Et Perspectives Diagnostic Étude-Action
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VINOBRE ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DIAGNOSTIC ÉTUDE-ACTION 27 MAI 2009 ÉTUDE ACTION SOMMAIRE PETITE ENFANCE Contexte, démographie Etat des lieux petite enfance Besoins et nécessités Démographie, habitat Ecoles, services & périphérie Développement Document support de l'étude diagnostic réalisée par le Réseau petite enfance ACEPP Ardèche Drôme, pour la Communauté de communes du Vinobre de février à fin mai 2009. Données provenant de l'INSEE, de la Caisse d'allocations familiales d'Aubenas et du Conseil général de l'Ardèche. Cartographie > Rémi Petitjean ; Illustrations > photos RPE ; conception & rédaction, Laetitia Cure & Claude Petitjean Tous droits réservés - reproduction interdite - © 1/6/2009 - RPE 07 - Communauté de communes du Vinobre 1.1 CONTEXTE, DÉMOGRAPHIE Préambule Instances politiques Evolution de la population Contexte géographique, Identification, caractéristiques poilitique & administratif et structuration du territoire Répartition de la population ÉTUDE ACTION PETITE ENFANCE 1.2 INTERCOMMUNALITÉS DU PRÉAMBULE DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE LOCALISATION Consciente des difficultés rencontrées par de nombreux parents de son territoire a trouver des places d’accueil adaptées pour leurs enfants (de COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 0-3 ans), la Communauté de Communes du Vinobre a choisi de prendre la DU VINOBRE compétence « Enfance - Jeunesse » et ainsi de développer l’offre de ser- vices petite enfance sur son territoire. Une telle «ambition nécessite une réflexion territoriale globale : OBJECTIFS TERRITORIAUX ➪Aménager son territoire en proposant des offres de services de proxi- mité adaptées. ➪ Viser l'équité territoriale pour l'ensemble de ses habitants. ➪ Renforcer l'identité de son territoire et la cohésion entre ses communes. OBJECTIFS PETITE ENFANCE ➪ Répondre de manière adaptée aux besoins des familles et de leurs en- fants et ainsi équilibrer l'offre et la demande de modes de garde pour les 0-3 ans. -

Mise En Page
Limony ISERE Saint-Jacques- d'Atticieux Charnas Vinzieux Brossainc LOIRE Félines Serrières Savas Saint-Marcel- Peyraud lès-Annonay Annonay Nord Peaugres Bogy Champagne CONSULTATION COORDINATION SPS Saint-Clair Boulieu- Colombier- lès-Annonay le-Cardinal Saint-Désirat Annonay Davézieux Saint-Cyr Saint-Étienne- Annonay Sud de-Valoux Lots de Coordination SPS Thorrenc Vernosc- Villevocance Roiffieux Vanosc lès-Annonay Talencieux C1 Andance Ardoix Monestier Vocance Quintenas C2 Saint-Alban-d'Ay Sarras Saint-Julien- Saint-Romain- d'Ay Ozon Vocance Eclassan Saint-Symphorien- C1 de-Mahun C3 Saint-Jeure- Arras- d'Ay sur-Rhône Satillieu Préaux Saint-Pierre- Cheminas Saint-André- sur-Doux Sécheras C4 en-Vivarais Lalouvesc Vion Vaudevant Saint-Victor C5 Étables Lemps Rochepaule Saint-Jean- Pailharès de-Muzols Lafarre Saint-Félicien Devesset Colombier-le-Vieux Tournon- Bozas sur-Rhône Saint-Jeure- Saint-Barthélemy- d'Andaure le-Plain Arlebosc Labatie- Boucieu- Mauves d'Andaure Nozières Empurany le-Roi Plats Colombier- Glun Le Crestet Mars le-Jeune Saint-Agrève Désaignes Saint- Châteaubourg Gilhoc- Sylvestre Saint-Romain- Intres sur-Ormèze Lamastre de-Lerps Cornas Saint-Julien- Boutières Saint-Barthélemy- Lachapelle- Saint-Jean- Grozon Champis Roure Saint-Basile Saint-Clément sous-Chanéac Saint-Prix Alboussière Saint-Péray Guilherand- Saint-Martin- Nonières Châteauneuf- Granges Chanéac de-Valamas Saint-Apollinaire- de-Vernoux Saint-Cierge- de-Rias La Rochette Boffres Jaunac sous-le-Cheylard Saint-Julien- Saint-Jean- Labrousse Chambre Toulaud Saint-Michel- -

Feuille1 Page 1 Accons 8 €/M² Ailhon 8 €/M² Aizac 8 €/M² Ajoux
Feuille1 Accons 8 €/m² Ailhon 8 €/m² Aizac 8 €/m² Ajoux 8 €/m² Alba-la-Romaine 8 €/m² Albon-d'Ardèche 8 €/m² Alboussière 8 €/m² Alissas 8 €/m² Andance 8 €/m² Annonay 8 €/m² Antraigues-sur-Volane 8 €/m² Arcens 8 €/m² Ardoix 8 €/m² Arlebosc 8 €/m² Arras-sur-Rhône 8 €/m² Asperjoc 8 €/m² Les Assions 8 €/m² Astet 8 €/m² Aubenas 8 €/m² Aubignas 8 €/m² Baix 8 €/m² Balazuc 8 €/m² Banne 8 €/m² Barnas 8 €/m² Le Béage 8 €/m² Beauchastel 8 €/m² Beaulieu 8 €/m² Beaumont 8 €/m² Beauvène 8 €/m² Berrias-et-Casteljau 8 €/m² Berzème 8 €/m² Bessas 8 €/m² Bidon 8 €/m² Boffres 8 €/m² Bogy 8 €/m² Borée 8 €/m² Borne 8 €/m² Bozas 8 €/m² Boucieu-le-Roi 8 €/m² Boulieu-lès-Annonay 8 €/m² Bourg-Saint-Andéol 8 €/m² Brossainc 8 €/m² Burzet 8 €/m² Cellier-du-Luc 8 €/m² Chalencon 8 €/m² Le Chambon 8 €/m² Page 1 Feuille1 Chambonas 8 €/m² Champagne 8 €/m² Champis 8 €/m² Chandolas 8 €/m² Chanéac 8 €/m² Charmes-sur-Rhône 8 €/m² Charnas 8 €/m² Chassiers 8 €/m² Châteaubourg 8 €/m² Châteauneuf-de-Vernoux 8 €/m² Chauzon 8 €/m² Chazeaux 8 €/m² Cheminas 8 €/m² Le Cheylard 8 €/m² Chirols 8 €/m² Chomérac 8 €/m² Colombier-le-Cardinal 8 €/m² Colombier-le-Jeune 8 €/m² Colombier-le-Vieux 8 €/m² Cornas 8 €/m² Coucouron 8 €/m² Coux 8 €/m² Le Crestet 8 €/m² Creysseilles 8 €/m² Cros-de-Géorand 8 €/m² Cruas 8 €/m² Darbres 8 €/m² Davézieux 8 €/m² Désaignes 8 €/m² Devesset 8 €/m² Dompnac 8 €/m² Dornas 8 €/m² Dunière-sur-Eyrieux 8 €/m² Eclassan 8 €/m² Empurany 8 €/m² Étables 8 €/m² Fabras 8 €/m² Faugères 8 €/m² Félines 8 €/m² Flaviac 8 €/m² Fons 8 €/m² Freyssenet 8 €/m² Genestelle 8 €/m² Gilhac-et-Bruzac -
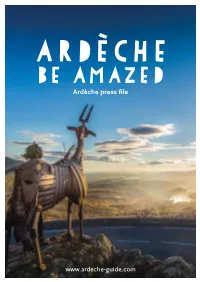
Ardèche Press File
Ardèche press file www.ardeche-guide.com © M. Dupont © M. The Ardèche can be summed up in three words: passion, beauty and talent. Prehistoric man came to the region as long as 36,000 years ago and laid the first foundations of art on the walls of the Chauvet-Pont d’Arc Cave, now classified as a Unesco World Heritage Site. It took passion and genius to tame the wild and awe-inspiring landscapes of Ardèche, such as the Ardèche Gorges, Mont Gerbier de Jonc, and the mountain and valley of Eyrieux. These little corners of paradise are also part of a precious and fragile local heritage that all who live and work here are more determined than ever to respect and conserve. Words are not enough to describe Ardèche, you have to experience it, by canoe or kayak, via ferrata or bike, by exploring some of the charming medieval villages perched on the moun- tainsides or by taking a detour to some of the fortresses that guard over the Rhône Valley and its prestigious wines. 2 CONTENT General information 4/5 Cultural heritage 26 What’s new 6 Top 5 tourist sites 27 Amazing accommodation 28 Follow the line of the watershed 7 UNESCO World Heritage 10 Camping, the ‘in’ thing 30 Wine tourism 12 Gastronomy 32 Follow the Craftsmen’s Trail 13 ‘Toqués d’Ardèche’ 33 ‘Maison du Gerbier’ 14 The wine trilogy 34 Places to visit 15 AOP Châtaigne d’Ardèche 38 Amazing water activities 16 Michelin starred chefs 40 Ardèche by bike 17 Bistrots de Pays 43 Cultural heritage & sites 22 Ardèche main events 44 Nature sites 23 Thrilling experiences 24 The secret world of caves 25 Crédit photo couverture : D. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°07-2019-088
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°07-2019-088 ARDÈCHE PUBLIÉ LE 8 NOVEMBRE 2019 1 Sommaire 07_DDCSPP_Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'Ardèche 07-2019-11-06-001 - Arrêté préfectoral portant application d'autorisation propre à Natura 2000 pour le projet de mise aux normes de sécurité des voies d'escalade du site de Mazet, sur la commune de Berrias-et-Casteljau. (5 pages) Page 6 07-2019-10-31-007 - Arrêté préfectoral portant organisation des prophylaxies collectives obligatoires des espèces bovine, ovine, caprine, et porcine dans le département de l’Ardèche (10 pages) Page 12 07_DDT_Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche 07-2019-11-04-011 - ap destruction chevreuil ST PERAY (2 pages) Page 23 07-2019-11-08-001 - AP destruction Sangliers LARGENTIERE (2 pages) Page 26 07-2019-11-05-001 - AP destruction Sangliers SAINT SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC (2 pages) Page 29 07-2019-11-07-001 - AP destruction Sangliers SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE (2 pages) Page 32 07-2019-11-06-002 - AP Régime Forestier_Cne Ailhon (7 pages) Page 35 07-2019-10-24-002 - ARR portant modification d' agrément CCSP suite au transfert du siège social (2 pages) Page 43 07-2019-10-23-012 - Arrêté autorisation défrichement_GAUTHIER Julien_Cne ST ALBAN AURIOLLES (3 pages) Page 46 07-2019-10-31-008 - Arrêté autorisation défrichement_GFA DES RIEUX_Cne CORNAS (3 pages) Page 50 07-2019-11-04-017 - Arrêté autorisation défrichement_GFA LES COPAINS_Cne CORNAS (3 pages) Page 54 07-2019-10-30-004 - Arrêté portant habilitation à produire les certificats de conformité attestant du respect des autorisations d'exploitation commerciale - SARL CABINET LE RAY.