Bibliothèque De L'assemblée Nationale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Assemblée Nationale Du Québec- Distribution Des Documents Parlementaires 880
ASSEMBLÉE NATIONALE PREMIÈRE SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Journal des débats de l’Assemblée Le mercredi 5 avril 2000 — N° 93 Président de l’Assemblée nationale: M. Jean-Pierre Charbonneau Abonnement annuel (TPS et TVQ en sus) Débats de l'Assemblée 145. Débats des commissions parlementaires 500. 88 Pour une commission en particulier: Commission de l'administration publique 75. Commission des affaires sociales 75. 88 Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation 25. Commission de l'aménagement du territoire 100. Commission de l'Assemblée nationale 5. Commission de la culture 25. Commission de l'économie et du travail 100. Commission de l'éducation 75. Commission des finances publiques 75. Commission des institutions 100. Commission des transports et de l'environnement 100. 888888888 Index (une session. Assemblée et commissions) 15.00 S Achat à l'unité: prix variable selon le nombre de pages Règlement par chèque à l'ordre du ministre des Finances et adressé comme suit Assemblée nationale du Québec- Distribution des documents parlementaires 880. autoroute Dufferin-Montmorencv. bureau 195 Québec. Qc GIR 5P3 Téléphone: (418)643-2754 Télécopieur: (418) 528-0381 Consultation des travaux parlementaires de l'Assemblée ou de^ commissions parlementaires sur Internet à l'adresse suivante: www.assnat.qc.ca Société canadienne des postes — Envoi de publications canadiennes Numéro de convention: 0592269 Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0823-0102 Débats de l'Assemblée nationale Le mercredi 5 avril 2000 Table des matières Affaires du jour Affaires inscrites par les députés de l’opposition Motion proposant que l’Assemblée exige du gouvernement qu’il diminue les taxes sur l’essence 5463 Mme Nathalie Normandeau 5463 M. -

E-Mail to Michel A. Duguay, Full Professor, Université Laval
Response, December 22, 2010 e-DOC: 3653567 ccmMercury: 2010-000690 E-mail to Michel A. Duguay, Full Professor, Université Laval Dear Dr. Duguay: I am writing in reference to your letter of December 6, 2010, which was sent by e-mail to Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) President Michael Binder and to Greg Rzentkowski, a Director General with the CNSC. Your letter concerns the ongoing public hearing pertaining to the Hydro-Québec application to renew its operating licence for the Gentilly-2 nuclear generating station in Bécancour, Quebec. Mr. Binder has asked me to answer your letter in my capacity as Commission Secretary. First of all., let me confirm that the Commission Members who have been asked to rule on Hydro-Québec’s application have received a copy of your letter. However, only the submissions by Hydro-Québec and by CNSC personnel were considered on December 10, which was the first day of the hearing (Hearing Day 1). As specified in the Notice of Public Hearing (enclosed), interventions from members of the public will be heard in Hearing Day 2, which will be held on April 13 and 14, 2011, in Bécancour. As you know, CNSC hearings are held on two separate days several months apart. Members of the public therefore have an opportunity to observe the presentations made by the licence holder and CNSC staff during Day 1, as well as the questions asked by the Commission Members. Interested members of the public can obtain a transcript or view a Webcast of the Day 1 proceedings and thus have more time and information with which to prepare their own submissions and presentations for Hearing Day 2. -

Provincial Legislatures
PROVINCIAL LEGISLATURES ◆ PROVINCIAL & TERRITORIAL LEGISLATORS ◆ PROVINCIAL & TERRITORIAL MINISTRIES ◆ COMPLETE CONTACT NUMBERS & ADDRESSES Completely updated with latest cabinet changes! 86 / PROVINCIAL RIDINGS PROVINCIAL RIDINGS British Columbia Surrey-Green Timbers ............................Sue Hammell ......................................96 Surrey-Newton........................................Harry Bains.........................................94 Total number of seats ................79 Surrey-Panorama Ridge..........................Jagrup Brar..........................................95 Liberal..........................................46 Surrey-Tynehead.....................................Dave S. Hayer.....................................96 New Democratic Party ...............33 Surrey-Whalley.......................................Bruce Ralston......................................98 Abbotsford-Clayburn..............................John van Dongen ................................99 Surrey-White Rock .................................Gordon Hogg ......................................96 Abbotsford-Mount Lehman....................Michael de Jong..................................96 Vancouver-Burrard.................................Lorne Mayencourt ..............................98 Alberni-Qualicum...................................Scott Fraser .........................................96 Vancouver-Fairview ...............................Gregor Robertson................................98 Bulkley Valley-Stikine ...........................Dennis -

C:\Documents and Settings\Eporlier\Bureau\TRANSIT
C A N D I D A T E S E T C A N D I D A T S P R O C L A M É S É L U S +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | CIRCONSCRIPTION | NOM | APPARTENANCE | PROFESSION | DOMICILE | | | | | | | | ÉLECTORALE | | POLITIQUE | | | | | | | | | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Abitibi-Est Alexis Wawanoloath P.Q. Val-d'Or Abitibi-Ouest François Gendron * P.Q. La Sarre Acadie Christine St-Pierre P.L.Q./Q.L.P. Outremont Anjou Lise Thériault * P.L.Q./Q.L.P. Anjou Argenteuil David Whissell * P.L.Q./Q.L.P. Brownsburg-Chatham Arthabaska Jean-François Roux A.D.Q./É.M.D. Victoriaville Beauce-Nord Janvier Grondin * A.D.Q./É.M.D. Saint-Jules Beauce-Sud Claude Morin A.D.Q./É.M.D. Québec Beauharnois Serge Deslières * P.Q. Salaberry-de-Valleyfield Bellechasse Jean Domingue A.D.Q./É.M.D. Saint-Romuald Berthier François Benjamin A.D.Q./É.M.D. Mandeville Bertrand Claude Cousineau * P.Q. Ste-Lucie-des-Laurentides Blainville Pierre Gingras A.D.Q./É.M.D. Blainville Bonaventure Nathalie Normandeau * P.L.Q./Q.L.P. Maria Borduas Pierre Curzi P.Q. Saint-Jean-Baptiste Bourassa-Sauvé Line Beauchamp * P.L.Q./Q.L.P. Montréal-Nord Bourget Diane Lemieux * P.Q. Montréal Brome-Missisquoi Pierre Paradis * P.L.Q./Q.L.P. Bedford Chambly Richard Merlini A.D.Q./É.M.D. La Prairie Champlain Pierre Michel Auger A.D.Q./É.M.D. Trois-Rivières Chapleau Benoît Pelletier * P.L.Q./Q.L.P. Gatineau Charlesbourg Catherine Morissette A.D.Q./É.M.D. -
Annual Report 2011 Founder
Annual Report 2011 Founder Claire Morissette was Quebec’s most ardent cycling activist ever. She co-coordinated Le Monde à Bicyclette with Robert Silverman for 25 years from the ‘70s to the ‘90s, fighting for the rights of cyclists in Montreal. Always ahead of her time, she helped launch Montréal’s car sharing organization Communauto, founded Cyclo Nord- Sud and published the vélorutionary essay Deux roues, un avenir. Staff Vision Claude Beauséjour Cyclo Nord-Sud promotes sustainable development based on respect Community Engagement for the biosphere and its inhabitants. and Logistics Coordinator Caroline Boudreau (contractor) Mission Project Manager – Learning Kit Geneviève Chrétien (jan.-oct.) Cyclo Nord-Sud collects used bicycles (as well as bike parts, tools and Lucie Poulin (oct.-dec.) accessories) and ships them to poor communities in the developing Communications Coordinator world where they serve as a means of transportation and a tool for Gerardo Frankenberger generating income and escaping poverty. Logistics Coordinator Glenn Rubenstein Values Development Coordinator Social Justice Sylvie St-Amand Administrative Coordinator Support for greater equality, and especially, providing women in the developing world with the ways and means to help promote equality between the sexes and further community development. Autonomy Board of Directors Acting to promote the autonomy of individuals and communities, by transferring resources and skills that facilitate active participation in community development and improve the quality of life. Robin Black Project Manager: Mon école à pied, à vélo ! Vélo Québec Citizen and Collective Engagement Myriam Boué An approach seeking to mobilize citizens and communities around Eco-councillor concrete actions of benefit to society as a whole, socially and environ- Collège Montmorency mentally. -

Framework Agreement Between the Crees of Eeyou Istchee and the Gouvernement Du Québec on Governance in the Eeyou Istchee James
FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE CREES OF EEYOU ISTCHEE AND THE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ON GOVERNANCE IN THE EEYOU ISTCHEE JAMES BAY TERRITORY TABLE OF CONTENTS PREAMBLE .................................................................................................................... 1 I. CONTEXT ............................................................................................................ 2 II. OBJECTIVES AND PRINCIPLES........................................................................ 2 III. CREE GOVERNANCE ON CATEGORY IB LANDS ........................................... 4 IV. CREE GOVERNANCE ON CATEGORY II LANDS ............................................. 4 A. Cree Regional Authority/Cree Nation Government............................... 4 B. Jurisdictions, Functions and Powers .................................................... 5 1. Municipal Management .................................................................... 5 2. Regional Conference of Elected Officers (CRÉ) ............................ 6 3. Planning Processes.......................................................................... 7 4. Land and Forest Management......................................................... 9 C. Société de développement de la Baie James........................................ 9 V. GOVERNANCE ON CATEGORY III LANDS....................................................... 9 A. Eeyou Istchee James Bay Regional Government................................. 9 B. Territory of Application ........................................................................ -

In the Matter of an Arbitration Under Chapter Eleven of the North American Free Trade Agreement and the Uncitral Arbitration Rules
IN THE MATTER OF AN ARBITRATION UNDER CHAPTER ELEVEN OF THE NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT AND THE UNCITRAL ARBITRATION RULES BETWEEN: LONE PINE RESOURCES INC. Claimant AND GOVERNMENT OF CANADA Respondent CLAIMANT'S MEMORIAL 10 APRIL 2015 ARBITRAL TRIBUNAL: Mr. V.V. Veeder (President) Professor Brigitte Stern Mr. David Haigh Lone Pine Resources Inc. v. Canada (UNCT/15/2) Page 2 of 192 REDACTED CONTENTS I. Glossary ______________________________________________________________ 4 II. Overview ______________________________________________________________ 9 III. Facts ________________________________________________________________ 12 A. The Parties __________________________________________________________________ 12 1. The Claimant, its Enterprise in Canada and Related Companies _______________________________ 12 2. The Respondent _____________________________________________________________________ 21 B. Shale Gas Exploration and Development __________________________________________ 22 1. Shale Gas and Hydraulic Fracturing _____________________________________________________ 22 2. Shale Gas in Quebec _________________________________________________________________ 26 C. The Regulation of Shale Gas Exploration and Development in Quebec __________________ 37 1. Exploration Permits Under the Mining Act ________________________________________________ 37 2. Exploration Permits Grant Immovable Real Rights Under Quebec Civil Law _____________________ 38 3. Obligations of a Permit Holder _________________________________________________________ -

Legislative Reports
Legislative Reports week, the President of the Finally on September, 28 Assembly tabled the report the President gave a ruling on from the Commission de a request to rise on a point of la représentation électorale privilege notified by the Member du Québec on the electoral for Pointe-aux-Trembles and boundaries. A debate was held on Chief Opposition Whip, Nicole this report on September 27 and Léger. She alleged that the n September 7, 2011, the day 28 as required by the Election Act. Minister of Natural Resources following the resignation and Wildlife had acted in O Rulings and directives from the contempt of Parliament when of Nathalie Normandeau, Chair Deputy Premier and Minister of she made comments regarding Natural Resources and Wildlife, Several rulings and directives the dismantlement of the Shell the Premier shuffled his Cabinet. were given by the President, refinery in east-end Montréal, Line Beauchamp, Member for Jacques Chagnon, since the by knowingly misleading the Bourassa-Sauvé, was appointed resumption of the parliamentary House and ridiculing the House. Deputy Premier, while continuing proceedings. First, at the sitting of The President stated that there to hold the office of Minister of September 20, the President ruled was nothing to suggest at first Education, Recreation and Sports. that the request for an urgent glance that the Minister acted in Sam Hamad, Member for Louis- debate made by the Member contempt of Parliament. Indeed, Hébert, was named Minister for Mercier on the facts set forth the presumption according of Economic Development, in the report from the Anti- to which a Member’s word Innovation and Export Trade. -
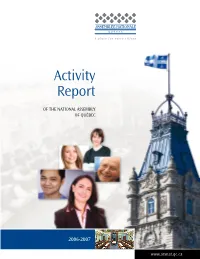
Activity Report
Activity Report OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF QUÉBEC NATIONAL ASSEMBLY OF QUÉBEC PARLIAMENT BUILDING Québec (Québec) G1A 1A3 www.assnat.qc.ca 2006-2007 [email protected] 1 866 DÉPUTÉS www.assnat.qc.ca On the cover: The new institutional signature, adopted by the authorities of the National Assembly in November 2006, has been used on the cover page of this Activity Report. Additional information on the logo is provided on page 41. Activity Report OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF QUÉBEC 2006-2007 www.assnat.qc.ca This publication was accomplished with the collaboration of the executive personnel and staff from all administrative branches of the National Assembly. Unless otherwise indicated, the data provided in this report concerns the activities of the National Assembly from 1 April 2006 to 31 March 2007. Director: Dominic Toupin Coordinator: Noémie Cimon-Mattar Supervisory and editorial committee: Noémie Cimon-Mattar Maude Daoust Joan Deraîche Dominique Drouin Robert Jolicoeur Marie-France Lapointe Georges Rousseau Christina Turcot Revision: Francine Boivin Lamarche Nancy Ford Sylvia Ford Marie-Jeanne Gagné Suzie Gauvin Translation: Sylvia Ford Graphic design: Myriam Landry Manon Paré Photographs: Clément Allard, pages 32, 34 Christian Chevalier, page 53 Robert Jolicoeur, page 4 Francis Leduc, page 59 Daniel Lessard, pages 4, 5, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 56 Claude Mathieu, page 59 François Nadeau, pages 4, 5, 33 Yannick Vachon, page 4 Claudie Vézina, page 5 This publication is available on the Internet site of the National Assembly at the -

POLITIKON: the IAPSS Journal of Political Science Vol 49 (June 2021)
POLITIKON: The IAPSS Journal of Political Science Vol 49 (June 2021) 1 1 1 POLITIKON: The IAPSS Journal of Political Science Vol 49 (June 2021) Volume 49: June 2021 ISSN 2414-6633 https://doi.org/10.22151/politikon.49 Editorial Board Andrea Bregoli (Switzerland) Andrew Devine (USA) Jesslene Lee (Singapore) Rafael Plancarte (Mexico) (Deputy Editor-in-Chief) Dana Rice (Australia) Max Steuer (Slovakia) (Editor-in-Chief) Editorial Assistants Nzube Chukwuma (Nigeria) Sarah Kassim de Camargo Penteado (Brazil / Germany) Andressa Liegi Vieira Costa (Brazil) Nicasia Picciano (Italy / Germany) Nabil Ferdaoussi (Morocco) Tobias Scholz (Germany) Julia Jakus (USA) Kamila Suchomel (Czech Republic David Keseberg (Germany) / USA) Md Intekhab Alam Khan (India) 2 POLITIKON: The IAPSS Journal of Political Science Vol 49 (June 2021) Table of Contents Editorial Note ............................................................................................................ 4 Articles Gender Parity in Cabinets: Towards the Mediatization of a Public Problem in Canada? / Carol-Ann Rouillard, Mireille Lalancette ................................................. 10 Accounting for Change in IR: The Application of Ontological Security Considerations to IR Theory / Esther Ng K.H. ................................................... 33 Discussing Subsidiarity in Terms of Justification: Some Practical Issues of the EU Legislative Process / Oxana Pimenova ............................................................ 53 Research Notes Family Feud, or Realpolitik? Opposition -

The Activity Report of the National Assembly of Québec for 2008-2009
ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec 2008-2009 www.assnat.qc.ca Cover illustration: Crown of fleurs de lys and acanthus leaves supporting a ring of lights informing the public when the National Assembly is sitting. ACTIVITY REPORT of the National Assembly of Québec 2008-2009 This publication was Supervision Jean Dumas prepared in collaboration Coordination and editing with the senior Noémie Cimon-Mattar management and Drafting committee the personnel of all Noémie Cimon-Mattar Yves Girouard the administrative units Robert Jolicoeur Lucie Laliberté of the National Assembly. Anne-Marie Larochelle Unless otherwise specified, Georges Rousseau the information in this Revision Francine Boivin Lamarche activity report covers Éliane de Nicolini the National Assembly’s Michelle Lavoie activities from April 1, Translation Anglocom 2008 to March 31, 2009. Sylvia Ford Art direction Manon Paré Graphic design Catherine Houle Manon Paré Photography Christian Chevalier, cover and pages 12, 14, 40, 42, 44 to 47, 49 to 52, 54 to 56, 60, 61, 68, 76, 77, and highlights François Asselin, page 76 Noémie Cimon-Mattar, page 76 Daniel Lessard, pages 43 and 68 Debates Broadcasting and Publishing Directorate, page 47 Stéphane Lévesque, page 46 Samuel Pignedoli, page 43 Kevin Thériault, page 43 Roch Théroux, page 48 Marie-Ève Vézina, “ From the 38th to 39th ” highlights Société du 400e anniversaire de Québec, page 50 Cover printing : Imprimerie LithoChic This publication is available on the National Assembly website at www.assnat.qc.ca Legal Deposit -
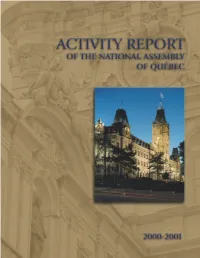
Rapport AN-2001
This publication was accomplished with the collaboration of the executive personnel and staff from all administrative branches of the National Assembly. Unless otherwise indicated, the data provided in this report concerns the activities of the National Assembly from 1 April 2000 to 31 March 2001. Director Cécilia Tremblay Coordinator Jean Bédard Supervisory Committee Jean Bédard Michel Bonsaint Hélène Galarneau Johanne Lapointe Patricia Rousseau Cécilia Tremblay Editor Johanne Lapointe assisted by Lise St-Hilaire Translator Sylvia Ford Revisors Nancy Ford Denise Léonard Design Joan Deraîche Page layout Robert Bédard Manon Dallaire Joan Deraîche Printing National Assembly Press Photographs Front cover: Eugen Kedl Luc Antoine Couturier Photographs of the Members of the 36th Legislature: Daniel Lessard Éric Lajeunesse Jacques Pontbriand Legal deposit - 2nd Quarter 2001 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 2-550-37742-7 ISSN 1492-9023 2 TABLE OF CONTENTS Preface .............................................................................................................. 5 Foreword ........................................................................................................... 6 The National Assembly ......................................................................... 7 its mission ...................................................................................................... 9 the Members .................................................................................................