Degradation Des Ressources Vegetales Au Contact Des Activites Humaines Et Perspectives De Conservation Dans Le Massif De L'aïr (Sahara, Niger)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

NIGER: Carte Administrative NIGER - Carte Administrative
NIGER - Carte Administrative NIGER: Carte administrative Awbari (Ubari) Madrusah Légende DJANET Tajarhi /" Capital Illizi Murzuq L I B Y E !. Chef lieu de région ! Chef lieu de département Frontières Route Principale Adrar Route secondaire A L G É R I E Fleuve Niger Tamanghasset Lit du lac Tchad Régions Agadez Timbuktu Borkou-Ennedi-Tibesti Diffa BARDAI-ZOUGRA(MIL) Dosso Maradi Niamey ZOUAR TESSALIT Tahoua Assamaka Tillabery Zinder IN GUEZZAM Kidal IFEROUANE DIRKOU ARLIT ! BILMA ! Timbuktu KIDAL GOUGARAM FACHI DANNAT TIMIA M A L I 0 100 200 300 kms TABELOT TCHIROZERINE N I G E R ! Map Doc Name: AGADEZ OCHA_SitMap_Niger !. GLIDE Number: 16032013 TASSARA INGALL Creation Date: 31 Août 2013 Projection/Datum: GCS/WGS 84 Gao Web Resources: www.unocha..org/niger GAO Nominal Scale at A3 paper size: 1: 5 000 000 TILLIA TCHINTABARADEN MENAKA ! Map data source(s): Timbuktu TAMAYA RENACOM, ARC, OCHA Niger ADARBISNAT ABALAK Disclaimers: KAOU ! TENIHIYA The designations employed and the presentation of material AKOUBOUNOU N'GOURTI I T C H A D on this map do not imply the expression of any opinion BERMO INATES TAKANAMATAFFALABARMOU TASKER whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations BANIBANGOU AZEY GADABEDJI TANOUT concerning the legal status of any country, territory, city or area ABALA MAIDAGI TAHOUA Mopti ! or of its authorities, or concerning the delimitation of its YATAKALA SANAM TEBARAM !. Kanem WANZERBE AYOROU BAMBAYE KEITA MANGAIZE KALFO!U AZAGORGOULA TAMBAO DOLBEL BAGAROUA TABOTAKI TARKA BANKILARE DESSA DAKORO TAGRISS OLLELEWA -

FINAL REPORT of the Terminal Evaluation of the Niger COGERAT Project PIMS 2294 Sustainable Co-Management of the Natural Resources of the Air-Ténéré Complex
FINAL REPORT of the Terminal Evaluation of the Niger COGERAT project PIMS 2294 Sustainable Co-Management of the Natural Resources of the Air-Ténéré Complex Co- gestion des Ressources de l'Aïr et du Ténéré Evaluation Team: Juliette BIAO KOUDENOUKPO, Team Leader, International Consultant Pierre NIGNON, National Consultant Draft Completed in July 2013 Original in FR + EN Translation reviewed and ‘UNDP-GEF-streamlined’ on 16 Dec 2014 STREAMLINING Project Title Sustainable Co-Management of the Natural Resources of the Air- Ténéré Complex (COGERAT)1 Concept Paper/PDF B proposal (PIF- GEF Project ID PIMS # 13-Nov-2003 2380 equivalent) UNDP-GEF PIMS # 2294 CEO Endorsement Date 14-Jun-2006 ATLAS Business Unit, NER10 / 00044111 / 00051709 PRODOC Signature Date 22-Aug-2006 Award # Proj. ID: Country(ies): Niger Date project manager hired: No info. Region: Africa Inception Workshop date: No info. Focal Area: Land Degradation / Multiple Planned planed closing date: Aug-2012 Trust Fund [indicate GEF GEF Trust Fund If revised, proposed op. closing date: Aug-2013 TF, LDCF, SCCF, NPIF] GEF Focal Area Strategic OP15 (Land Degradation / Sustainable Actual operational closing date (given TE 31-Dec-2014 Objective Land Management – of GEF3) harmonisation and mgt response finalisation) Exec. Agent / Implementing 2 Partner: Ministry in charge of the environment portfolio Decentralised authorities, particularly Communes and local communities, users of the Reserve, occupational groups and NGOs, Land Commissions, traditional chiefs, other opinion leaders, the Regional Governorate and decentralised technical services. In addition, there is the Ministry for Water and the Environment (MH/E) Other Partners: (providing the institutional basis of the project), UNDP as the Implementing Agency for the Global Environment Facility (GEF), the Technical and Financial partners, the Steering Committee, the Partners’ Forum, the management unit and operational units of COGERAT, the office of the Aïr and Ténéré Nature Reserve, and the Scientific Committee. -
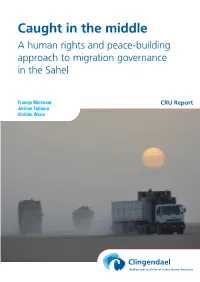
Caught in the Middle a Human Rights and Peace-Building Approach to Migration Governance in the Sahel
Caught in the middle A human rights and peace-building approach to migration governance in the Sahel Fransje Molenaar CRU Report Jérôme Tubiana Clotilde Warin Caught in the middle A human rights and peace-building approach to migration governance in the Sahel Fransje Molenaar Jérôme Tubiana Clotilde Warin CRU Report December 2018 December 2018 © Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Cover photo: © Jérôme Tubiana. Unauthorized use of any materials violates copyright, trademark and / or other laws. Should a user download material from the website or any other source related to the Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, or the Clingendael Institute, for personal or non-commercial use, the user must retain all copyright, trademark or other similar notices contained in the original material or on any copies of this material. Material on the website of the Clingendael Institute may be reproduced or publicly displayed, distributed or used for any public and non-commercial purposes, but only by mentioning the Clingendael Institute as its source. Permission is required to use the logo of the Clingendael Institute. This can be obtained by contacting the Communication desk of the Clingendael Institute ([email protected]). The following web link activities are prohibited by the Clingendael Institute and may present trademark and copyright infringement issues: links that involve unauthorized use of our logo, framing, inline links, or metatags, as well as hyperlinks or a form of link disguising the URL. About the authors Fransje Molenaar is a Senior Research Fellow with Clingendael’s Conflict Research Unit, where she heads the Sahel/Libya research programme. She specializes in the political economy of (post-) conflict countries, organized crime and its effect on politics and stability. -

Agadez FAITS ET CHIFFRES
CICR FAITS ET CHIFFRES Janvier- juin 2014 Agadez CICR/ François Thérrien CICR/ François Les activités du CICR dans les régions d’Agadez et Tahoua Entre Janvier et juin 2014, le CICR a poursuivi son action humanitaire dans la région d’Agadez et le nord de la région de Tahoua en vue de soutenir le relèvement des populations. Ainsi, en collaboration avec la Croix-Rouge nigérienne (CRN), le CICR a : SÉCURITE ÉCONOMIQUE Cash For Work EAU ET HABITAT Soutien à l’élevage y réhabilité 31 km de pistes rurales en Commune de Tillia (région de Tahoua) collaboration avec le service technique y vacciné 494 565 têtes d’animaux et traité du génie rural d’Agadez et la Croix- y construit un nouveau puits et réhabilité 143 048 au profit de 12 365 ménages de Rouge nigérienne des communes de celui qui existe à In Izdane, village situé pasteurs dans l’ensemble des communes Tabelot et Timia. Exécutée sous forme de à plus 130 km au sud-ouest du chef-lieu de Tchirozerine, Dabaga, Tabelot, Timia, Cash for work, cette activité a permis de de la commune. Ce projet vise à répondre Iférouane, Gougaram, Dannat et Agadez désenclaver quelques villages des chefs au besoin en eau de plus de 1200 commune en collaboration avec la lieux des communes de Timia et Tabelot et bénéficiaires et de leur cheptel; direction régionale de l’élevage et le va permettre aux maraîchers d’acheminer cabinet privé Tattrit vêt ; facilement leurs produits au niveau des y racheté 60 kg de semences de luzerne marchés. 280 ménages vulnérables ont SANTE auprès des producteurs pilotes et bénéficié de sommes d’argent qui ont redistribué à 200 nouveaux ménages agro permis d’accroître leur revenu. -

Annexe 38 EPPA Rapport D'évaluation Externe
ÉVALUATION TÉCHNIQUE « Projet d’intégration économique et sociale des jeunes : Emploi pour le patrimoine d’Agadez » (EPPA) Code projet : T05-EUTF-SAH-NE-08-03 Fond fiduciaire / Trust fund, Financé par l’Union Européenne au Niger à travers le « Plan d'Actions à Impact Économique Rapide à Agadez (PAIERA) » mise en œuvre par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix Javier Mantecón [email protected] +34646416712 Évaluation du « Projet d’intégration économique et sociale des jeunes : Emploi pour le patrimoine d’Agadez » (EPPA. 1 Février 2017- Janvier 2019, Agadez, Niger. Sommaire 1. INTRODUCTION 1.1 Contexte 1.2 Méthodologie 1.3 Étapes de la mission 1.4 Outils de collecte de données 1.5 Difficultés rencontrées 1.6 Opportunités 1.7 Méthodes de vérification 1.8 Évaluation par objectifs 1.9 Évaluation par résultats 2. REPONSES AUX QUESTIONS/CONSTATATIONS 2.1 Pertinences 2.2 Efficacité et Efficience 2.3 Impact 2.4 Durabilité 2.5 Visibilité du projet 3. EVALUATION GLOBALE 3.1 Conclusions 3.2 Recommandations Évaluation du « Projet d’intégration économique et sociale des jeunes : Emploi pour le patrimoine d’Agadez » (EPPA. 2 Février 2017- Janvier 2019, Agadez, Niger. 1. INTRODUCTION Le « Projet d’intégration économique et sociale des jeunes : Emploi pour le patrimoine d’Agadez » (EPPA) est soutenu par le Fond Fiduciaire d’Urgence de l’Union Européenne pour l’Afrique et mis en œuvre par le Comité International pour le Développement des Peuples (CISP), répond à la situation socio-économique actuelle du Niger. Cette évaluation correspond à l’action réalisée pendant 21 mois dans la région d'Agadez par le CISP, avec l'objectif de développer des actions dirigées aux jeunes et éviter une relation entre eux et des activités liées à l'immigration illégale dans le cadre du « Plan d'Action à Impact Économique Rapide à Agadez » (PAIERA) mis en place par la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix du Niger. -

Migration and Markets in Agadez Economic Alternatives to the Migration Industry
Migration and Markets in Agadez Economic alternatives to the migration industry Anette Hoffmann CRU Report Jos Meester Hamidou Manou Nabara Supported by: Migration and Markets in Agadez: Economic alternatives to the migration industry Anette Hoffmann Jos Meester Hamidou Manou Nabara CRU Report October 2017 Migration and Markets in Agadez: Economic alternatives to the migration industry October 2017 © Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’. Cover photo: Men sitting on their motorcycles by the Agadez market. © Boris Kester / traveladventures.org Unauthorised use of any materials violates copyright, trademark and / or other laws. Should a user download material from the website or any other source related to the Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’, or the Clingendael Institute, for personal or non-commercial use, the user must retain all copyright, trademark or other similar notices contained in the original material or on any copies of this material. Material on the website of the Clingendael Institute may be reproduced or publicly displayed, distributed or used for any public and non-commercial purposes, but only by mentioning the Clingendael Institute as its source. Permission is required to use the logo of the Clingendael Institute. This can be obtained by contacting the Communication desk of the Clingendael Institute ([email protected]). The following web link activities are prohibited by the Clingendael Institute and may present trademark and copyright infringement issues: links that involve unauthorized use of our logo, framing, inline links, or metatags, as well as hyperlinks or a form of link disguising the URL. About the authors Anette Hoffmann is a senior research fellow at the Clingendael Institute’s Conflict Research Unit. -

Etude De L'aménagement Des Vallées De Tabelot Et Afassas
.-. .- .- GROUPE DES ÉCOLES _- EIER - ETSHER -_a MEMOIRE DE FIN D’ETUDES 2004 .d Présen té par : YACOUBA Abdou _- THEME: Etude de l’aménagement des vallées de Tabelot et Afassas - Encadreur: A, L. MAR Je dédie ce travailà ma chère maman, pour Lësoutien inestima6lë qu éCGema apporté Toute ma vie. Que ce diplôme contri6ue à C’améfioration Des conditions dê vie dés milTiers dë Femmes ruralks qui luttent quotid&nnement Contre une nature hostile! et impitoya6k C&emerciements Au terme de cette étude, je tiens à remercier, tous ceux qui d’une façon ou d’une autre, ont contribué à la réussite de ce mémoire. Tout particulièrement à mes encadreurs, MM.Amadou Lamine MAR, Christophe LAROCHE et Philippe GINESTE pour m avoir suivi et appuyé pendant toute la durée de 1 é’tude. Leur soutien m ‘a été plus qu ‘indispensable. Ma reconnaissance va aussi envers MM. Hyppolite FREITAS et Pascal ZAHONERO pour toute 1 ‘aide qu ‘ils m ‘ont apportée sur les aspects pratiques de 1 ‘aménagement. Mes remerciements vont également à M François BLANCHET Directeur de la Cellule de Formation professionnelle à 1 ‘Ingénierie qui a rendu cette étude possible et qui m ‘a beaucoup encouragé dès le début. Ce serait ingrat de clore cette page de remerciements sans adresser toute ma gratitude à Bachona AHMADOU, qui a été mon fidèle guide et interprète pendant les deux mois que j ‘ai passés à Tabelot. Enfin ma reconnaissance va vers tous les maraîchers de la vallée, qui m ‘ont offert leur hospitalité pendant le parcours de la vallée. -

Etude Hydrologique Des Bassins De Tabelot
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE u. S. A. l. D. ÉT mCHNIQUE_2!!!..RE-MER i{[SSlON DE NIAMEY ETUDE HYDROWGlQUE DES BASSINS DE TABEWT (Rapport P~QviBOiro) par ~JI. HOEPFFNER et R. ABDALLAH Janvier 1978 SOMMAIRE Chapitre 1 - Introduction p.1 Chapitre 2 - Caractéristiques physiques des bassins p.3 2.1 Situation 2.2 Caractères morphométriques 2.3 Hyp§ométrie 2,.4 Géologie 2.5 Sols et végétation 2.6 Interprétation Chapitre 3- Equipement p.8 3.1 Pluviométrique ... 3.2 Limnimétrique Chapitre 4 - Observations et mesures 4.1 Pluies 4.2 HauteurS' 4.3 Mesures de débit Chapitre 5 - Description des évènements Chapitre 6 - Caractéristiques des crues p. 23 Chapitre 1 - Bilan annuel Chapitre 8 - Conclusion • - 1 - Chapitre 1 Introduction l' U.S.A.I.n. a demandé à l'ORSTOM le 10 Juin 1977 de procéder en 1977 aux opérations nécessaires à la détermination des carac téristiques des averses et des crues sur les Kori TELOUES, NABAROU et AKHEREB, situés à 150 Ion à l'Est-Nord-Est d'AGADEZ (Figure n01) }Oi. HOEPFFNER, ingénieur hydrologue àe l'ORSTO}.[, a entrepris avec l'aide de S. HARRIS du 11 au 18 Juillet: - l'installation de 17 pluviomètres fournis par l'organisation " Church World Service" .. - l'installation d'une station limnimétrique sur chacun des 3 Koris. S. HARRIS , du Service du Génie Rural d'AGADEZ,a effectué, contr8lé et supervisé les relevés de pluviométrie et de hau teurs limnimétriques, ainsi que les mesures de vitesse dans les Korls. Ce rapport provisoire fournit les données brutes recueillies durant cette saison des pluies 1977 sur les 3 bassins étudiés dans la région de TABELOT à la demande de l'U.S.A.I.D. -

Ref Agadeza1.Pdf
REGION D'AGADEZ: Carte référentielle Légende L i b y e ± Chef lieu de région Chef lieu de département localité Route principale Route secondaire ou tertiaire Frontière internationale Frontière régionale Cours d'eau MADAMA Région d'Agadez A l g é r i e ☶ Population Djado DJABA DJADO CHIRFA KANARIA I-N-AZAOUA SARA BILMA DAOTIMMI I-N-TADERA ☶ 17 459 TOUARET SEGUEDINE IFEROUANE TAGHAJIT TAMJIT TAZOUROUTETASSOS INTIKIKITENE OURARENE AGALANGAÏ ☶ 32 864 DOUMBA EZAZAW FARAZAKAT ANEY ASSAMAKKA ABARGOT TEZIRZEK LOTEY TCHOUGOY TIRAOUENE TAKARATEMAMANAT ZOURIKA EMI TCHOUMA AZATRAYA AGREROUM ET TCHWOUN ARLIT Gougaram ACHENOUMA IFEROUANE ISSAWANE ARRIGUI Dirkou ACHEGOUR TEMET DIRKOU ☶ 103 369 INIGNAOUEI TILALENE ARAKAW MAGHET TAKRIZA TARHMERT ARLIT AGAMGAM BILMA ANOU OUACHCHERENE TCHIGAYEN TAZOURAT TAGGAFADI Dannet GOUGARAM SIDAOUET ZOMO ASSODE IBOUL TCHILHOURENE ERISMALAN TIESTANE Bilma MAZALALE AJIWA INNALARENE TAZEWET AGHAROUS ESSELEL ZOBABA ANOUZAGHARAN DANNET FAYAYE Timia FACHI TIGUIR AJIR IMOURAREN TIMIA FACHI MARI Fachi TAKARACHE ZIKAT OFENE MALLETAS AKEREBREB ABELAJOUAD TCHINOUGOUWENEARITAOUA IN-ABANGHARIT TAMATEDERITTASSEDET ASSAK HARAU INTAMADE T c h a d EGHARGHAR TILIA OOUOUARI Dabaga ELMEKI BOURNI TIDEKAL SEKIRET ASSESA MERIG AKARI TELOUES EGANDAWEL AOUDERAS EOULEM SOGHO TAGAZA ATKAKI TCHIROZERINE TABELOT EGHOUAK M a l i AZELIK DABLA ABARDOKH TALAT INGAL IMMASSATANE AMAN NTEDENT ELDJIMMA ☶ 241 007 GUERAGUERA TEGUIDDA IN TESSOUM ABAZAGOR Tabelot FAGOSCHIA DABAGA TEGUIDDA IN TAGAIT I-N-OUTESSANE ☶ EKIZENGUI AGALGOU 51 818 TCHIROZERINE INGOUCHIL -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft
Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

Agadez, Niger
Mayors Dialogue on Growth and Solidarity City profile: Agadez, Niger Population: 137,354 (2017 ) GDP per capita: $555 (2019, national) Major industries: trade and logistics, livestock, agriculture Percentage of migrants: 1% (2017, national) Mayor’s name: Dr Boukari Mamane | Next election date: 2021 Socioeconomic profile Migration profile Agadez is the fifth largest city in Niger, capital Agadez is home to a large number of internal rural of both the Agadez Region and Aïr, a traditional migrants who moved to the city in the 1970s and Tuareg–Berber federation (Institut National de la 1980s to escape severe droughts. Changes in rainfall Statistique, 2014). The city is geographically dispersed causing both drought and flash floods continue and is home to 137,354 individuals over an area to displace people across Niger (121,000 in 2019) of 213 km2 (Institut National de la Statistique du (Internal Displacement Monitoring Centre, n.d.). In Niger, 2020a). Since 2000, the population has been terms of international migration, Niger is home to growing by 3.17% annually (Institut National de la 295,600 foreign-born residents, mostly from nearby Statistique du Niger, 2019). A substantial proportion countries (Nigeria, Mali and Burkina Faso) (EU of Agadez residents are nomadic or semi-nomadic Commission, 2019). Out of Niger’s population of people (Molenaar et al., 2017). The city’s population around 21.5 million, this implies a national migrant is younger than the Nigerien average, with 40% population of around 1% (EU Commission, 2019). between the ages of 15 and 39 (Institut National de la In 2017, there were also 165,700 refugees and 300 Statistique du Niger, 2020b). -

NIGER • Inondation Rapport De Situation 6 16 Septembre 2009
NIGER • Inondation Rapport de situation 6 16 septembre 2009 Ce rapport a été publié par OCHA/Niger. Il couvre la période allant du 13 au 15 septembre 2009. I. FAITS SAILLANTS/PRIORITÉS Estimations des personnes affectées dans les communes d’Agadez, Dabaga, Tchirozerine et Tabelot: 79,129 Début du relogement des sinistrés de la commune urbaine d’Agadez dans 4 sites aménagés et évacuation du site de Toudou Akoly par les autorités. Les 4 sites accueilleront environ 1 250 ménages qui sont en train de libérer les écoles. Le gouvernement du Niger a reçu des dons de l’Algérie, du Maroc et de la Lybie (vivres, abris, médicaments), ainsi que de sociétés nigériennes. GAPs : Seuls les sinistrés de la commune urbaine d’Agadez ont reçu une assistance à ce jour. Malgré la mobilisation des humanitaires, du gouvernement et l’assistance des pays voisins, tous les besoins ne sont pas encore couverts (Cf. tableau des estimations des besoins). Les personnes sinistrées étant restées sur les sites touchés par les inondations, non assainis et privés d’eau potable, doivent être assistées. Le nombre de tentes familiales mises à disposition à ce jour est de 1,050 sur un besoin total estimé à 3,800, soit 27,6% de couverture. II. Contexte général Deux semaines après les inondations qui ont frappé la région d’Agadez et causé des pertes en vies humaines ainsi que d’importants dégâts matériels, l’assistance aux sinistrés s’organise de mieux en mieux. Les personnes affectées sont estimées à 79 129 pour la région (communes d’Agadez, Dabaga, Tchirozerine et Tabelot).