Une Saison À L'opéra (1996-1997)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Central Opera Service Bulletin • Vol
CENTRAL OPERA SERVICE COMMITTEE Founder MRS. AUGUST BELMONT Honorary National Chairman ROBERT L. B. TOBIN National Chairman ELIHU M. HYNDMAN National Co-Chairmen MRS. NORRIS DARRELL GEORGE HOWERTON Profntional Committee KURT HERBERT ADLER BORIS GOLDOVSKY San Francisco Opera Goldovsky Opera Theatre WILFRED C. BAIN DAVID LLOYD Indiana University Lake George Opera Festival GRANT BEGLARIAN LOTFI MANSOURI University of So. California Canadian Opera Company MORITZ BOMHARD GLADYS MATHEW Kentucky Opera Association Community Opera SARAH CALDWELL RUSSELL D. PATTERSON Opera Company of Boston Lyric Opera of Kansas City TITO CAPOBIANCO MRS. JOHN DEWITT PELTZ San Diego Opera Metropolitan Opera KENNETH CASWELL EDWARD PURRINGTON Memphis Opera Theatre Tulsa Opera ROBERT J. COLLINGE GLYNN ROSS Baltimore Opera Company Seattle Opera Association JOHN CROSBY JULIUS RUDEL Santa Fe Opera New York City Opera WALTER DUCLOUX MARK SCHUBART University of Texas Lincoln Center ROBERT GAY ROGER L. STEVENS Northwestern University John F. Kennedy Center DAVID GOCKLEY GIDEON WALDROP Houston Grand Opera The Juilliard School Central Opera Service Bulletin • Vol. 21, No. 4 • 1979/80 Editor, MARIA F. RICH Assistant Editor, JEANNE HANIFEE KEMP The COS Bulletin is published quarterly for its members by Central Opera Service. For membership information see back cover. Permission to quote is not necessary but kindly note source. Please send any news items suitable for mention in the COS Bulletin as well as performance information to The Editor, Central Opera Service Bulletin, Metropolitan Opera, Lincoln Center, New York, NY 10023. Copies this issue: $2.00 |$SN 0008-9508 NEW OPERAS AND PREMIERES Last season proved to be the most promising yet for new American NEW operas, their composers and librettists. -
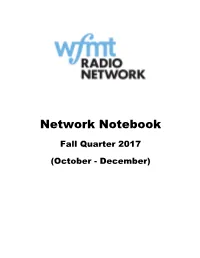
Network Notebook
Network Notebook Fall Quarter 2017 (October - December) A World of Services for Our Affiliates We make great radio as affordable as possible: • Our production costs are primarily covered by our arts partners and outside funding, not from our affiliates, marketing or sales. • Affiliation fees only apply when a station takes three or more programs. The actual affiliation fee is based on a station’s market share. Affiliates are not charged fees for the selection of WFMT Radio Network programs on the Public Radio Exchange (PRX). • The cost of our Beethoven and Jazz Network overnight services is based on a sliding scale, depending on the number of hours you use (the more hours you use, the lower the hourly rate). We also offer reduced Beethoven and Jazz Network rates for HD broadcast. Through PRX, you can schedule any hour of the Beethoven or Jazz Network throughout the day and the files are delivered a week in advance for maximum flexibility. We provide highly skilled technical support: • Programs are available through the Public Radio Exchange (PRX). PRX delivers files to you days in advance so you can schedule them for broadcast at your convenience. We provide technical support in conjunction with PRX to answer all your distribution questions. In cases of emergency or for use as an alternate distribution platform, we also offer an FTP (File Transfer Protocol), which is kept up to date with all of our series and specials. We keep you informed about our shows and help you promote them to your listeners: • Affiliates receive our quarterly Network Notebook with all our program offerings, and our regular online WFMT Radio Network Newsletter, with news updates, previews of upcoming shows and more. -

(Fcmttecticitt Sa% (Eamjnta Serving Storrs Since 1896
More UConn meat missing To day 9s fo recas t HAKTFORD. Conn. (AP)—"Generally School officials say they already have lax security'* and an "absence ol manage- taken steps to prevent recurrence. Fair tonight. Low temperatures in the mid 30's. Cloudy ment oversight" are blamed by state Auditors Henry J. Becker Jr. and Leo V. auditors in the disappearance of five tons of Saturday with a chance of showers. Highs around 50. Nor- Donohue issued their final report Wednes- thwest winds around 10 mph today. Light and variable win- meat worth more than $25,000 at the ,da\. miminating a two-month inquiry by ds tonight. University of Connecticut. SEE MEAT. PAGE 3 (fcmttecticitt Sa% (Eamjnta Serving Storrs Since 1896 Vol. LXXXV No. 109 University of Connecticut Friday, April 2,1982 USG election procedures questioned By Chris Schneider have signed statements at- votes within 75 feet of the bers that they were not According to Connecticut Staff Writer testing to those of Veils' polling place. At an infor- allowed to sollicit within 75 State Statue 9-23b. no At a press conference It is possible that can- mational meeting for all can- feet of the polling area. political advertising or Wednesday afternoon, didates including Veil, were didates, they were told by However. no further soliciting of voters within 75 Cheryl Hayden, Chairperson misinformed about a state elections committee mem- specifications were given at feet of the outside entrance of the Undergraduate statute concerning soliciting this time. of a building where balloting Student Government, an- Election results lakes place. Those spon- nounced the results of the soring the elections arc USG Student Assembly elec- COMMUTERS. -

Network Notebook
Network Notebook Summer Quarter 2017 (July - September) A World of Services for Our Affiliates We make great radio as affordable as possible: • Our production costs are primarily covered by our arts partners and outside funding, not from our affiliates, marketing or sales. • Affiliation fees only apply when a station takes three or more programs. The actual affiliation fee is based on a station’s market share. Affiliates are not charged fees for the selection of WFMT Radio Network programs on the Public Radio Exchange (PRX). • The cost of our Beethoven and Jazz Network overnight services is based on a sliding scale, depending on the number of hours you use (the more hours you use, the lower the hourly rate). We also offer reduced Beethoven and Jazz Network rates for HD broadcast. Through PRX, you can schedule any hour of the Beethoven or Jazz Network throughout the day and the files are delivered a week in advance for maximum flexibility. We provide highly skilled technical support: • Programs are available through the Public Radio Exchange (PRX). PRX delivers files to you days in advance so you can schedule them for broadcast at your convenience. We provide technical support in conjunction with PRX to answer all your distribution questions. In cases of emergency or for use as an alternate distribution platform, we also offer an FTP (File Transfer Protocol), which is kept up to date with all of our series and specials. We keep you informed about our shows and help you promote them to your listeners: • Affiliates receive our quarterly Network Notebook with all our program offerings, and our regular online WFMT Radio Network Newsletter, with news updates, previews of upcoming shows and more. -

Robert Hart Baker – Biography
Conductor Jack Price Managing Director 1 (310) 254-7149 Skype: pricerubin [email protected] Rebecca Petersen Executive Administrator 1 (916) 539-0266 Skype: rebeccajoylove [email protected] Olivia Stanford Marketing Operations Manager [email protected] Karrah O’Daniel-Cambry Opera and Marketing Manager [email protected] Contents: Biography Mailing Address: Program Biography 1000 South Denver Avenue Reviews and Testimonials Suite 2104 Tulsa, OK 74119 Repertoire Sample Programs Website: Curriculum Vitae http://www.pricerubin.com Reference Letters YouTube Video Links Complete artist information including video, audio and interviews are available at www.pricerubin.com Robert Hart Baker – Biography Robert Hart Baker has been the conductor of the St. Louis Philharmonic since 1982. He has served as principal guest conductor with the Asheville Lyric Opera Company since 2004. He is Music Director Laureate of the Harrisburg Choral Society & Orchestra and the York Symphony Orchestra & Chorus in Pennsylvania, and is conductor laureate of the Asheville Symphony Orchestra. His broad repertory of classical symphonic, opera, choral and ballet scores are complemented by his skills as a Pops conductor, and he has received critical praise on the podium here and abroad in all genres. His work the York Symphony Association has earned two awards from the League of American Orchestras (Student Song Contest in 2003 and Saturday Morning Symphony in 2005). His DVD of the St. Louis Philharmonic Holiday Spectacular won the national Telly Award in 2004 for best classical local cable TV production. In December 2007, his holiday video with the Kirkwood Children's Chorale was in the finals of NBC's nationally-televised competition Clash Of The Choirs. -

JJ~~~@~~ • Donizetti Llil CE~W11jj)~~~ILIL(Q)
Weill ill)~~ JJ~~~@~~ • Donizetti llIL CE~W11jJ)~~~ILIL(Q). Cherubini 1flHI~ jJ)(Q)~1f(gJ@~~~ ll~~ • MenoUi 1fll{!~ W11~ill)ll@W11 • Donizetti ~n1f ~ • Menotti ll{!~ILjJ) £) ll{!~ILjJ) illl{!~ @IL(Q)Illi(Q)ILn~lJ\\~ • Rossini @~~~~~ (Q)If ~~WllILIL~. Puccini IL~ ~(Q)~]Q)ll~~ • Webber JJ (Q) ~ ~ jJ) ll{! ~~ ill) 1fll{! ~ ~~& IT ~ @ 1f ~ CE ll{! ~ II CE (Q) IL(Q) ~ ill) ~ ~~W11 CE (Q) ~1f • Mozart CE(Q)~ll If~~ 1f@1f1f~ • Puccini 1f(Q)~CE~ • MenoUi 1fll{!~ 1f~ILrn:jJ)ll{!(Q)~~. MenoUi 1fll{!~ W11~ , ill)ll@W11 • Holst u ll{!~ ~~~If~CE1f If(Q)(Q)IL • Verdi ~ll@(Q)IL~ , il1f(Q) • Puccini W11~ill)~~ ffi)@1flf~~IfIL W • Lehar lill{!~ W11~~~W ~llill)(Q)~ • Verdi IL~ lf~~Wll~lf~ • Mussorgsky @(Q)~ll~ @(Q)ill)@~(Q)W • Donizetti lrll{!IE ~lLll2%ll~ (Q)If IL@W~ • Strauss ill)ll~ Ifl1~w~~W11~@~ • Rossini 1fll{!~ ffi)~~ffi)~~ @If ~~WllILIL~ • Giannini ffi)~~(WlfW ~~ill) lfll{!~ ffi)~~~1f • Gershwin jJ)(Q)~@W ~IPITw ffi3~~~ • Puccini IL~ ffi)@ll{!~W11~ • DonizeUi IL@CEll~ ill)ll IL~W11W11~I&W11@(Q)~ • Rossini 1fll{!~ ffi)~~@~~ (Q)If ~~WllILIL~ • MenoUi 1fIMI~ 1f~IL~~ll{!(Q)~~ • DiChiera Wll@llIL~~CE~ • Pasatieri ~ ~~ll{!ll~@lf(Q)~ ~@@~~~ • Puccini W11~ill)~W11~ ffi)@ll1fill~IfIL W • Herbert ~~@@IMIlfW W11~~n~1flf ~ • Mozart lfll{!~ W11~@llCE IfIL@1r~ • Blitzstein ~~@ll~~ • Bizet CE~~W11~~ • Romberg 1fll{!~ ~1f@ill)~~li jJ)~ll~CE~ • Gounod If~@~lf • Menotti ~W11~ll{!IL ~~ill) lfll{!~ ~il@ll{!1f Wll~ll1F(Q)~~ • Donizetti ~llu ~ • DiChiera ~@W11jJ)~IL~1fllIL 1f~lJ\\ll~ • Bizet 1fll{!~ jJ)~~~IL Ifll~lli!~~~ • Kern ~ll{!(Q)~ffi)(Q)~lf • Verdi IL~ lf~~Wll~li~ • Leoncavallo II jJ)~@ILll~CECEll • Gruenberg 1fll{!~ ~W11jJ)~~(Q)~ JJ(Q)~~~ • Holst ull{!@: ~ ~~ill)~~ll~@ ~CEll{!@IL~~ • Barab ILU1f1FIL~ ~~ill) ~llill)ll~@ ll{!(Q)(Q)ill) • Verdi IL~ 1f~~ Wll~1f ~ • Copland lfll{!~ lf~~ill)~~ IL~~ill) • Puccini W11~ill)~~ ffi)@lflf~~IfIL W • Loesser lfll{!~ W11(Q)~1f ll{!~jJ)jJ)W If~ILIL~ • Verdi llIL 1f~(Q)W ~1f(Q)~~ • Puccini IL~ ffi)(Q)ll{!~W11@ • Tchaikovksy JJ(Q)~~ (Q)If ~~CE . -

PDF: V109-N27.Pdf
I I . I CO s _ __I _ ___I-_ -- I · _ II I - - I ---I -- -- r *a-. Rs I I -- r I - I --- ---- IC-c-- IBL MIT'ss ~arr· PA Record of Olldest aned Largest -:: Continuous News Serviee ~.. I- ~ for 108 Years , N~ewspaper ~~B~- a"' Vol. CI[X No. 27 --,-· CAMBRIDGE, MASS., MONDAYT, JUNJE 59 1989 Free C[TA . A: ADISSON SIIO[TL. .FOCIJS OIV (;?A..DES9 SCOE Commaittee Citees Facu~lty Concern 1850 TO~GRADUATEE OvernStudents' Performancesace AT COMMEN~rENCEEN SAY~ZS DIVERESITY MUUST BE MAINTAINED3Elt (]By Irene C. Kuo) (]By Andrew L. Fish) Approxrimately 1850 senior andII graduate students will Citing concerns about declining student per- receiveI an estimated 2000 formaznce, a faculty committee has asked the Ad- degreesI at MJIT's 123rd missions Office to place greater weight on commencementI exercises in grades and standardized test scores in mathe- MKillian Court today. Former US Sen. Paul1 Tson- matics and science when evaluating applicants. ,gasI (D-MA), the recently- appointed41 chairman of the Students proptest two weeks- ago against prop~osed changes~ein Projecgt Inrterphasae (Tech photo byIbLerothodi-Lapnla Leeuwenw'92). The Comnmittee on Under- This perception was brought state Board of Regents of graduate Admissions and Fi,- into focus in a report prepared by Professor Anthony P. nancial Aid said that appli- I cants' "non-acadermic French last year. French found .activities, talents, and personal that over the past 20 years the qualit~ies sho~uld be considered freshman class has had a pro- FORII\? SEAS mostly as a means of di~stin- gressively smallaer fraction of studednts with math~t and. -

José Carreras, Ilona Tokody Orchester: Philharmonisches Orchester Sevilla Dirigent: Vjekoslav Šutej
1. Konzert 16.07.1992, 20.00 Uhr José Carreras Solisten: José Carreras, Ilona Tokody Orchester: Philharmonisches Orchester Sevilla Dirigent: Vjekoslav Šutej 2. Konzert 17.07.1992, 20.00 Uhr Messias-Variationen von Georg Friedrich Händel in einer Bearbeitung von Bernd Wefelmeyer mit dem RBT-Orchester Solisten: Anke Lautenbach, Anke Schenker, Matthias Freihof Chor: Unternehmen Münchehofe Orchester: RBT-Orchester Dirigent: Bernd Wefelmeyer 1.Teil Orchester: Kammerorchester des Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Gymnasiums Berlin-Mitte Dirigent: Thomas Hofereiter 3. Konzert 18.07.1992, 20.00 Uhr Großes Strauß-Konzert Solisten: Barbara Daniels, Brigitte Eisenfeld, Christian Boesch, Adolf Dallapozza, Michael Rabsilber Posaunen: Posaunenquintett Berlin Orchester: Rundfunkorchester Berlin Dirigent: Prof. Hans-Dieter Baum 1. Konzert 15.07.1993, 21.00 Uhr Montserrat Caballé Solisten: Montserrat Caballé, Francisco Gonzales (Tenor) Orchester: Berliner Sinfonie-Orchester Dirigent: José Collado - Eine Koproduktion mit dem Schauspielhaus Berlin und Hoffmann-Konzerte GmbH Mannheim - 1 2. Konzert 16.07.1993, 21.00 Uhr Beliebte Opernchöre Die bekanntesten Opernmelodien aus Aida, Freischütz, Nabucco, Tannhäuser, Zar und Zimmermann Solisten: Dagmar Schellenberger, Eva-Maria Bundschuh, Michael Rabsilber, Kurt Rydl Chor: Chor der Deutschen Oper Berlin Orchester: Berliner Sinfonie-Orchester Dirigent: Klauspeter Seibel 3. Konzert 17.07.1993, 21.00 Uhr Großes Strauß-Konzert Johann Strauß und sein Jahrhundert Solisten: René Kollo, Elisabeth Werres, Franziska Stanner Orchester: -

Authorization to Copy
AUTHORIZATION TO COPY I authorize Kenneth S. Schmidt to scan the book I coauthored entitled, TULSA OPERA CHRONICLES, for the purpose of making a digital copy for use on the internet in the interest of preserving the history of the Tulsa Opera. Further copies may be made from this digital copy provided they are for educational, historical, personal enjoyment, or the promotion of fine art, and for non-profit use. For any other intentions, the copyright statement below applies. Laven Sowell Jack Williams June 15, 2007 Copyright © 1992 by Jack A. Williams and Laven Sowell All rights reserved under International Copyright Law. Contents May not be reproduced in whole or in part in any form without The express written consent of the authors. Library of Congress Catalog Number 92-96949 1 2 Website produced in appreciation of Mr. Laven Sowell by Ken Schmidt, student of Mr. Sowell since September 1964, Edison Jr. High School Boys Glee Club, Edison High School Mixed Chorus, and proud alumnus of the Edison High School Concert Chorus during the 1969 / 1970 school year in Tulsa, Oklahoma. Thank you for teaching me about great music. 3 To compensate for the page numbering difference between the original book and this PDF file, please add 10 to the page number when referencing the Table of Contents and the Index, and then search or scroll in your PDF viewer. 4 5 This book is dedicated to the loyal and talented chorus members, who have for many years given unselfishly of their time and talent to help make opera possible in the city of Tulsa. -

Spoleto Festival Usa Program History 2013–1977
SPOLETO FESTIVAL USA PROGRAM HISTORY 2013–1977 Spoleto Festival USA Program History Page 2 2013 Opera *Matsukaze, music by Toshio Hosokawa; libretto by Hannah Dübgen; conductor, John Kennedy; director, Chen Shi-Zheng; set designer, Chris Barreca; costume designer, Elizabeth Caitlin Ward; lighting designer, Scott Zielinski; video designer, Olivier Roset; Cast: Gary Simpson, Thomas Meglioranza, Pureum Jo, Jihee Kim; Dock Street Theatre Mese Mariano/Le Villi; Mese Mariano, music by Umberto Giordano; libretto by Salvatore Giacomo; Le Villi, music by Giacomo Puccini, libretto by Ferdinando Fontana; conductor, Maurizio Barbacini; director, Stefano Vizioli; set designer, Neil Patel; costume designer, Roberta Guidi di Bagno; lighting designer, Matt Frey; choreographer, Pierluigi Vanelli; Cast Mese Mariano: Linda Roark-Strummer, Ann McMahon Quintero, Jennifer Rowley, Yanzelmalee Rivera, Allison Faulkner, Nicole Fregala, Shari Perman, Anne Marie Stanley, Justin Su’esu’e; Cast Le Villi: Levi Hernandez, Jennifer Rowley, Dinyar Vania; Sottile Theatre Dance Jared Grimes; dancers, Jared Grimes, Robyn Baltzer, Dewitt Fleming Jr, Karida Griffith, Tony Mayes; Emmett Robinson Theatre Compagnie Käfig; artistic director and main choreographer, Mourad Merzouki; programs, Correria and Agwa; TD Arena Ballet Flamenco de Andalucía; artistic director and choreographer, Rubén Olmo; guest soloist, Pastora Galván; program, Noche Andaluza; TD Arena Lucky Plush Productions, creators/directors, Leslie Buxbaum Danzig and Julia Rhoads; original script, Leslie Buxbaum Danzig, -

Copyright 2010, Michigan Opera Theatre Copyright 2010, Michigan Opera Theatre Oakland University College of Arts and Sciences
Copyright 2010, Michigan Opera Theatre Copyright 2010, Michigan Opera Theatre Oakland University College of Arts and Sciences The Official Magazine of the Detroit Opera House Michigan Opera Theatre's 2000-2001 Season is lovingly dedicated to the memory of Lynn A. Townsend and Robert E. Dewar BRAVO IS A MICHIGAN OPERA THEATRE PUBLICATION Dr. David DiChiera, General Director Laura Wyss, Editor Kristen L. Shank, Associate Editor CONTRIBUTORS. Charlene Baldridge Pascal Blanchet R~berto Mauro Michigan 9pera Theatre Staff PUBLISHER Live Publishing Company Frank Cucciarre, Design and Art Direction Chuck Rosenberg, Copy Editor Toby Faber, Director of Advertising Sales ON THE COVER Celebrating 30 years of great performances. Photos courtesy of Michigan Opera Theatre. Design by Frank Cucciarre, Blink Concept &. Design. Michigan Opera Theatre would like to thank Harmony House Records for donating season recordings and videos. Michigan Opera Theatre's 2000-2001 subscription and single tickets have been graciously sponsored by Hunter House, Harmonie Park. Physicians' service provided by Henry Ford Medical Center. Pepsi-Cola is the offi cial soft drink and juice provider for the Detroit Opera House. Starbucks Coffee is the oJ[icial coffee of the Detroit Opera House. Steinway is the official piano of the Detroit Opera House and Michigan Opera Theatre. Steinway pianos are provided by Hammel Music, exclusive representative for Steinway and Sons in Michigan. President Tuxedo is the official provider of formal wear for the Detroit Opera House. Michigan Opera Theatre is a nonprofit cultural organizatiOn whose activities are supported in part by the Michigan Council for Arts and Cultural Affairs, the National Endowment for the Arts, and other individuals, corporations and foundations. -

The Glenn Giffin Interviews and Writings, 1967-2003 an Inventory of Holdings at the American Music Research Center
The Glenn Giffin interviews and writings, 1967-2003 An inventory of holdings at the American Music Research Center American Music Research Center, University of Colorado at Boulder The Glenn Giffin interviews and writings, 1967-2003 Descriptive summary Title Glenn Giffin interviews and writings Date(s) 1967-2003 Identification COU-AMRC-40 Creator(s) Repository The American Music Research Center University of Colorado at Boulder 288 UCB Boulder, CO 80309 Location Housed in the American Music Research Center Physical Description 10 Linear feet 30 boxes Scope and Contents Writings and recorded interviews conducted by Glenn Giffin (1943-2012), Denver Post music and dance critic; graduate of the University of Colorado Boulder (B.Mus.) and the University of Denver (Master of Library Arts); curator of the University of Denver's Carson-Brierly Dance Library; receipient of the Dance Alliance services in the field award, 2009. Includes 404 cassette tape interviews of musicians for his Denver Post column. Administrative Information Arrangement Interviews arranged by interviewee; writings and scrapbooks arranged chronologically. Access The collection is open for research. Usage Restrictions Copyright is not held by the American Music Research Center. Requests to publish materials should be directed to the copyright holder. Acquisition history Donated by Glenn Giffin, Denver, Colorado. Preferred Citation [Identification of item], Glenn Giffin interviews and writings, University of Colorado, Boulder - Page 2 - The Glenn Giffin interviews and writings, 1967-2003 Index Terms Access points related to this collection: Corporate names American Music Research Center Subject headings Musicians -- Interviews Musical criticism -- United States Music -- Colorado -- Denver - Page 3 - The Glenn Giffin interviews and writings, 1967-2003 Detailed Description Interviews conducted by Glenn Giffin Cassette Tape Interviews conducted by Glenn Giffin with people involved in the music industry.