Fonctionnement De L'eglise
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'o S S E Rvator E Romano
Price € 1,00. Back issues € 2,00 L’O S S E RVATOR E ROMANO WEEKLY EDITION IN ENGLISH Unicuique suum Non praevalebunt Fiftieth year, number 11 (2488) Vatican City Friday, 17 March 2017 Francis visits the Santa Maddalena di Canossa Parish in Rome Awaiting the Resurrection The Pope for this time GI O VA N N I MARIA VIAN As the fifth year of his pontificate began, Pope Francis once again drew inspiration from the question of a child who, in one of Rome’s parishes, asked him to reflect on his papal service. The Pope replied in simple and radical terms: “Jesus chooses whom he wants to be Pope in this time; in another time he chooses another, and in another, an- other”. Immediately thereafter Fran- cis shared a confidence: “I like [be- ing Pope]; and I also enjoyed being a priest in a parish, the rector of a faculty and also a parish priest — I liked both callings very much. I also enjoyed doing Sunday school, chil- d re n ’s Mass.... I like this. Being a priest is something that I have al- ways enjoyed very much”. The Pontiff’s simple and straight- forward answer is striking because it On Sunday afternoon, 12 March, some of the beautiful moments of children in 2016. He also greeted allows the disarming sincerity of his the Second Sunday of Lent, the his life and also to share his fears. altar servers and priests of the 36th life to shine through. “What God Holy Father made a pastoral visit to He was also asked how they might Prefecture, to which the parish be- wants. -

Cástor Oswaldo Azuaje Pérez, O.C.D., Bishop of the Diocese of Trujillo, Venezuela, Died Friday Morning 8 January 2021 in Valera (Trujillo)
N. 362 01 • 2021 Cástor Oswaldo Azuaje Pérez, O.C.D., Bishop of the Diocese of Trujillo, Venezuela, died Friday morning 8 January 2021 in Valera (Trujillo) ishop Azuaje was born in Maracaibo theological studies. He earned a doctorate on 19 October 1951 in a family of six in Moral Theology summa cum laude from Bbrothers. He first learned about the the Alfonsianum Academy in Rome in 1978. Discalced Carmelite order in 1966 through the Nearly 20 years later, he would return to nuns at Mérida, in the Venezuelan Andes. academic study and earn a diploma in spiritual Discerning his vocation to the Teresian theology in 1994 following a year of study at Carmel, Oswaldo Azuaje entered the novitiate the Universidad de la Mística, CITeS in Avila, program of the Province of Aragonia-Valenza, Spain. Spain at the Desert of las Palmas, in Castile. As is the case with every Discalced Carmelite He professed his first vows as a Discalced prelate, many years of rich and fruitful ministry Carmelite friar on 12 October 1968. followed, first in Costa Rica: Three years of philosophy studies followed • Formator-assistant to the Master of Novices in Zaragoza, and then Ajuaje pursued his and Master of Simple Professed (1978 and theology studies with the Discalced Carmelites, 1984), where he was the formator for another completing first-year theology (1971–1972) at future Discalced Carmelite bishop, Silvio José the historic Stella Maris seminary at Haifa, Báez, O.C.D. Israel and another three years (1972–1975) at • Professor at the Interdiocesan Seminary the Teresianum in Rome. -

N. 362 01 • 2021 Cástor Oswaldo Azuaje Pérez, O.C.D., Bishop of the Diocese of Trujillo, Venezuela, Died Friday Morning 8 January 2021 in Valera (Trujillo)
N. 362 01 • 2021 Cástor Oswaldo Azuaje Pérez, O.C.D., Bishop of the Diocese of Trujillo, Venezuela, died Friday morning 8 January 2021 in Valera (Trujillo) ishop Azuaje was born in Maracaibo on 19 October 1951 in a family of six brothers. He first learned about Bthe Discalced Carmelite order in 1966 through the nuns at Mérida, in the Venezuelan Andes. Discerning his vocation to the Teresian Carmel, Oswaldo Azuaje entered the novitiate program of the Province of Aragonia-Valenza, Spain at the Desert of las Palmas, in Castile. He professed his first vows as a Discalced Carmelite friar on 12 October 1968. Three years of philosophy studies followed in Zaragoza, and then Ajuaje pursued his theology studies with the Discalced Carmelites, completing first-year theology (1971–1972) at the historic Stella Maris seminary at Haifa, Israel and another three years (1972–1975) at the Teresianum in Rome. On 31 August 1974 Oswaldo Azuaje pronounced his solemn • Formator-assistant to the Master of Novices and Master vows; he was ordained to the priesthood at the age of 24 on of Simple Professed (1978 and 1984), where he was the Christmas Day, 25 December 1975 in Mérida, the city that formator for another future Discalced Carmelite bishop, was the cradle of his Carmelite vocation. Silvio José Báez, O.C.D. Azuaje returned to Rome to complete his theological • Professor at the Interdiocesan Seminary of Paso Ancho, studies. He earned a doctorate in Moral Theology summa San José, and at the Intercongregational Theological cum laude from the Alfonsianum Academy in Rome in Institute of Central America ITAC (1978 and 1984). -

Año 2005 (Enero - Diciembre)
BOlJETÍN lNFORMATlVO Df. DERECH() CANÓ TICO BOLETÍN INFORMATIVO DE DERECHO CANÓNICO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS Número 27 - 2005 - Madrid Depósito legal: NA 3.383-2000 Impresión: Imprenta Kadmos Salamanca PRESENTACIÓN Como cada mio, la Junta Directiva de la Asociación Espmiola de Canonistas tiene la satisfacción de presentar el vigésimo séptimo número del Boletín Informativo de Derecho Canónico, correspondien te al mio 2005. Constituye éste un sencillo instrumento que,junto a las Jornadas de Actualización que cada año organiza y celebra nuestra Asociación en la Sede de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, persigue como objetivo principal dar cumplimiento al prime ro de los fines de la Asociación, cual es ''fomentar e impulsar el estu dio y cultivo del Derecho Canónico para el mejor servicio de la Iglesia y de la sociedad civil" ( art. 2, I de sus Estatutos). Es de destacar el esfuerzo de síntesis que se ven obligados a rea lizar quienes colaboran en la elaboración de las distintas secciones de este Boletín, a quienes quiero transmitir, en nombre de todos los miem bros de la Asociación, nuestro más sincero agradecimiento por este servicio que prestan con tanto esmero y cualificación, así como por su diligencia en el envío de los originales, con la información actualiza da a fecha de 3I de diciembre, a fin de que todos los socios dispongan cuanto antes de este nuevo número. 5 Como venimos haciendo en anteriores números, incluimos en la primera página la composición de la Junta Directiva. Ni que decir tiene que cuantos la integramos estamos a disposición de los socios, en la misión que se nos ha confiado, a la vez que recordamos a todos que, en orden a mejorar en lo posible el servicio que se nos ha enco mendado y que desempeíiamos con el mayor celo posible, pueden hacer llegar todas aquellas sugerencias que estimen pertinentes a la Coordinadora del Boletín, Lourdes Ruano Espina, o a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, que acogerán gustosamente toda indicación que tienda a mejorar en lo posible nuestro Boletín. -
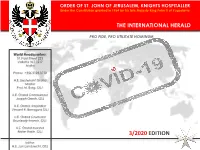
3/2020 Edition
ORDER OF ST. JOHN OF JERUSALEM, KNIGHTS HOSPITALLER Under the Constitution granted in 1964 by his late Majesty King Peter II of Yugoslavia THE INTERNATIONAL HERALD PRO FIDE, PRO UTILITATE HOMINUM World Headquarters: St. Paul Street 223 Valletta VLT 1217 Malta Phone +356 2123 0712 H.E. Lieutenant Grand Master Paul M. Borg, OSJ H.E. Grand Commander Joseph Grech, OSJ H.E. Grand Hospitaller Vincent R. Bonagura OSJ H.E. Grand Counselor Boudewijn Franck, OSJ H.E. Grand Marshal Krister Thelin, OSJ 3/2020 EDITION Editor: H.E. Jan Lambrecht, OSJ TABLE OF CONTENT • Word by our Lieutenant-Grand Master 3 • Wreath of Christ, by Niels Refskou, Chairman o/t E.C. 5 • Reflections on: Where is God in this pandemic ? (B) 8 • Quote 14 • Piece of antique damask at the Headquarters 15 • In memoriam: Rev. Fr. Victor Enriquez, Malta Grand Priory (MLT) 16 • Oscarsborg Fortress Days: rewards to the sponsors (NOR) 17 • Charity: the Norwegian Radium Hospital in Oslo(NOR) 19 • Citation on Charity, 1 Corinthians 13:13 20 • Report, Priory of Victoria (AU) 21 • Quote on (in)tolerance 26 • The Covid-19 Pandemic: a paradigm changer ? by Dominic Verhoeven, (B) 27 • Pro Fide: Historic Hagia Sophia cathedral converted into a mosque 33 • Call for content 34 • Charity report King Valdemar the Great & Costa Rica Cdries. (USA) 35 • Reflections on Pluralism (B) 37 • Prioratus Flandriæ from the “old days” (B) 42 • Citation: James, 1:12. 43 • Reflections on the miraculous power of patience(B) 44 • Personalia, promotions, disclaimer & word from the editor 47 2 Paul M. BORG, OSJ LIEUTENANT-GRAND MASTER A MESSAGE FROM H.E. -
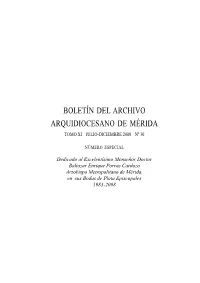
Primerasbol 30 Def.Pmd
Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo XI. Nº 30. Julio-diciembre 2008. Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173. BOLETÍN DEL ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA TOMO XI JULIO-DICIEMBRE 2008 Nº 30 NÚMERO ESPECIAL Dedicado al Excelentísimo Monseñor Doctor Baltazar Enrique Porras Cardozo Arzobispo Metropolitano de Mérida, en sus Bodas de Plata Episcopales 1983-2008 1 Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo XI. Nº 30. Julio-diciembre 2008. Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173. BOLETÍN DEL ARCHIVO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA Depósito Legal pp 87-0310 ISSN 1316-9173 Portada Lema latino de la portada: Virtus semina fortunae geminat cum tempore. Traducción: la virtud hace germinar con el tiempo, las semillas de la fortuna. El fotograbado de la portada del Boletín ilustra la primera página impresa de la obra de Agustín Barbosa, Summa apostolicarum decisionum (Suma de decisiones apos- tólicas), en su primera edición publicada en Lyon en 1645, que se conserva en la Biblioteca del AAM, cota X KJA 2002, B 37su, 1645. Barbosa, Agustín (1590-1649): Prelado y jurisconsulto portugués, obispo de Ugento, en el reino de Nápoles. Sus obras más sobresalientes fueron en el campo del derecho y se publicaron completas en Lyon, en 16 tomos a partir de 1712. Diseño Ana Hilda Duque Raquel E. Morales S. Diagramación Raquel E. Morales S. Arte final Unidad de Informática del Archivo Arquidiocesano de Mérida Dirección Archivo Arquidiocesano de Mérida. Palacio Arzobispal. Av. 4 . Esq. Calle 23. Apartado 26. Mérida 5101-A. Teléfonos (0274) 2524307-2525786. Fax: 2521238. Mérida-Venezuela. Correo electrónico: [email protected] / [email protected] portal: www.arquidiocesisdemerida.org.ve Indización REVENCYT (Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología), código RVB005. -

News Letter ING. 41
N° 41 JANUARY 2016 info.oessh.va REFLECTIONS OF THE GRAND MASTER The Order in Union with the Universal Church JUBILEE OF MERCY: A NEW FUTURE OFFERED TO MANKIND II Miserando AN EXEMPLARY AGREEMENT THAT STIMULATES PEACE IN THE HOLY LAND V atque THE SAVING POWER OF FORGIVENESS VI eligendo Proceedings of the Grand Magisterium THE AUTUMN MEETING OF THE GRAND MAGISTERIUM VII t began on an ordinary Saturday “DO NOT HAGGLE WITH GOD” X evening as he headed to a party A REGIONAL MEETING HELD IN AUSTRALIA: with other student friends. En THE FIRST STEP TOWARDS A SHARED JOURNEY XI I THE GRAND MASTER’S VISITS TO MEMBERS route, something prompted him to OF THE ORDER AROUND THE WORLD XIII offer a prayer in the church he was A WOMAN DEEPLY COMMITTED IN THE ORDER passing. He entered and felt the BECOMES PART OFTHE GRAND MAGISTERIUM XIII need to go to confession: “And I WELCOME TO FATHER JOHN BRUCE BATEMAN, don’t know what happened, but I NEW SECRETARY OF THE GRAND MASTER XV came out different, changed. I returned home with the certainty of The Order and the Holy Land having to consecrate myself to the LIVING THE JUBILEE OF MERCY IN THE HOLY LAND XVI Lord.” WELCOMING THE PRINCE OF PEACE TODAY The words of Pope Francis in a IN THE HOLY LAND XVII recent interview, describing a simple JERUSALEM CELEBRATES 50 YEARS OF unexpected moment that changed NOSTRA AETATE XVIII his life and ultimately, the world as well. “He has had mercy on me – The Life of the Lieutenancies (1) and he chose me!” It was a THE JOY OF THE INVESTITURE: A TESTIMONY moment filled with an -
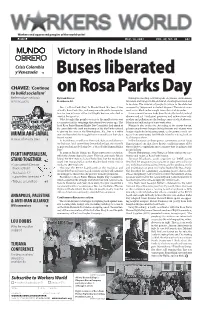
Ww13dec20007
Workers and oppressed peoples of the world unite! DEC. 13, 2007 VOL. 49, NO. 49 50¢ Victory in Rhode Island Crisis Colombia y Venezuela 12 Buses liberated CHAVEZ: ‘Continue to build socialism’ on Rosa Parks Day Referendum setback By Frank Neisser During the meeting, activists spoke on prisons, environmen- Providence, R.I. in Venezuela 9 tal racism and hunger in Rhode Island, showing how much had to be done. The number of people in prison in the state has Dec. 1 is Rosa Parks Day. In Rhode Island this year, it was increased by 700 percent in the last 20 years. The rate of incar- offi cially Rosa Parks Day, and everyone rode public transporta- ceration for Black males is eight times that of white males. tion for free in honor of the Civil Rights heroine, who died in Environmental racism feeds directly into the track to school 2005 at the age of 92. absence and jail. Lead-paint poisoning and asthma from rats, What brought this people’s victory to the smallest state was roaches and pollution are the leading causes of school absence. a concerted public campaign that started two years ago. The Schools are built on top of toxic waste sites. local Rosa Parks Human Rights Day Committee had aimed at Hunger is also on the rise. According to the census bureau, the 2005 date—the 50th anniversary of the day Parks refused 48,000 people were hungry during the year and 16,000 were to give up her seat on the Birmingham, Ala., bus to a white hungry regularly during 2004-2006, up by 3,000 in each cat- MUMIA ABU-JAMAL man and launched the struggle that won equality on that city’s egory from 2001-2003. -
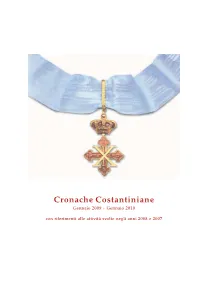
Cronache Costantiniane
Cronache Costantiniane Gennaio 2009 - Gennaio 2010 con riferimenti alle attività svolte negli anni 2008 e 2007 La presente Pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo dei Cavalieri Costantiniani: S.E. Ambasciatore Nobile Giuseppe Balboni Acqua Cavaliere di Gran Croce di Grazia Segretario Generale e Delegato per le Marche e l’Umbria Avvocato Prof. Franco Ciufo Cavaliere di Gran Croce di Merito Vice Delegato per il Lazio Avvocato Prof. Antonio Maria Leozappa Commendatore di Merito This pubblication has been realized thanks to the contribution of the following Constantinian Knights: HE Ambassador Sir Giuseppe Balboni Acqua Knight of Grand Cross of Grace Secretary General and Delegate for Marche and Umbria Regions Prof. Franco Ciufo, Lawyer Knight of Grand Cross of Merit Vice Delegate for Latium Region Prof. Antonio Maria Leozappa, Lawyer Commander of Merit Editoriale A tre anni di distanza dall’ultimo bollettino ufficiale, le Cronache Costantiniane riprendono la loro testimonianza delle iniziative dei Cavalieri e delle Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. E’ un’illustrazione di opere, attività, realizzazioni ed anche di propositi, con immagini fotografiche che talvolta esprimono, con maggiore efficacia dello scritto, il significato profondo dell’azione svolta. Il nuovo Gran Maestro del Sacro Ordine, il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro che è l’ispiratrice dell’azione umanitaria dell’Ordine, hanno indicato con forme rinnovate, adeguate ai tempi odierni, le tradizionali linee direttrici per il perseguimento delle finalità dell’Ordine. Le Cronache Costantiniane assicurano un’informazione ampia delle principali attività del Gran Magistero dell’Ordine fornendo anche un compendio delle comunicazioni provenienti dalle Delegazioni, non solo italiane, sulle iniziative promosse in sede locale. -

Noriega Tests U.S.-Vatican Relationship' by John Thavis Catholic News Service VATICAN CITY — the Strange Case of Deposed Pana Manian Dictator Gen
w^^^^m^miSis^^^M •V'S&8AJ&?*hV\ *• ***Wy. r^'t»^fe.<«^«W.^ >filfc; Special Inside Pull- Classifieds ......8A-9A Out Columns 10A-11A Section Feature : ...,:2A Sports ;..„,...»... 6A-7A World & Nation..... ...3A-5A Diocese of Rochester Thursday, January 4, 12-Page Pull-Out Section' Noriega tests U.S.-Vatican relationship' By John Thavis Catholic News Service VATICAN CITY — The strange case of deposed Pana manian dictator Gen. Manuel Noriega, who took refuge in the Panama City nunciature Dec. 24, set off a week of deli cate negotiations and diplomatic tensions between the Vati can, the United States and Panama. As the new year arrived, Noriega was still enjoying what the Vatican carefully termed "temporary diplomatic asy lum" in the nunciature, the Vatican's embassy. Mean while, U.S. troops kept up their watch outside the building, hoping to nab Noriega and bring him to the United States for trial on drug charges. As the week ended, no third'country had publicly offered World A generaUiew of the Vatican Embassy compound, center foreground political asylum to Noriega. With Panama's new govern where deposed Panamanian did- tator Gen. Manuel Noriega took refuge on Dec. 24. ment hesitant to take custody of Noriega and the Vatican unwilling to hand him over directly to the United States, the leader promisedtocall off his aimed struggle against the him to do so. Noriega is not living in a-hotel — so situation appeared to remain at an impasse. invasion. In fact, Vatican spokesman Joaquin Navarro- "Certainly, On Dec. 29, Panama's bishops told Pope John Paul II in a Valls said Dec. -

Ordine Costantiniano 2010.Qxd:Layout 1 10/05/11 09:06 Pagina 3
ordine costantiniano 2010.qxd:Layout 1 10/05/11 09:06 Pagina 3 Cronache Costantiniane Gennaio 2010 - Aprile 2011 ordine costantiniano 2010.qxd:Layout 1 10/05/11 09:06 Pagina 4 ordine costantiniano 2010.qxd:Layout 1 10/05/11 09:06 Pagina 5 La presente Pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo di S.E. l’Ambasciatore Nobile Giuseppe Balboni Acqua Cavaliere di Gran Croce di Grazia e del Dott. Sergio Antoniuzzi Cavaliere di Gran Croce di Merito This pubblication has been realized thanks to the contribution of H.E. the Ambassador Nob. Giuseppe Balboni Acqua Knight of Grand Cross of Grace & Dr. Sergio Antoniuzzi Knight of Grand Cross of Merit ordine costantiniano 2010.qxd:Layout 1 10/05/11 09:06 Pagina 6 Editorial The publication of the new issue of the Constantinian Chronicles coincides with the celebrations for the sesquicentennial anniversary of the unification of Italy. This event, which also recalls the end of the Kingdom of the Two Sicilies and the departure of the last Sovereign Francis II from Gaeta, must be regarded today as a matter of fact, a reference to an event that took place in the context of a historical period of the most profound changes not only in our country, but also in a larger European context. However, what is still a source of great confusion in the minds of many southerners is the memory of the modalities that realized this event which combines with the inevitable and persistent requests for explanation of the many current difficulties of economic and social development of these important Italian regions. -

The Archbishop Viganò Archive
The Archbishop Viganò Archive: January 1, 2021 Dr. Steve Bannon Interview: Great Awakening & Great Rest The following are Archbishop Viganò's responses to questions presented to him by Dr. Steve Bannon of "War Room" regarding the Great Awakening and the Great Reset. Dr. Steve Bannon: Now that the Vatican has renewed its insidious secret agreement with China, a deal which you have repeatedly condemned as promoted by Bergoglio with the assistance of McCarrick, what can the “children of light” of the Great Awakening concretely do to undermine this unholy alliance with this brutal Communist regime? Archbishop Carlo Maria Viganò: The dictatorship of the Chinese Communist Party is allied to the global deep state, on the one hand so that together they can attain the goals that they have in common, on the other hand because the plans for the Great Reset are an opportunity to increase the economic power of China in the world, beginning with the invasion of national markets. At the same time that it pursues this project in its foreign policy, China is pursuing a domestic plan to restore the Maoist tyranny, which requires the cancellation of religions (primarily the Catholic religion), replacing them with a religion of the State which defnitely has many elements in common with the universal religion desired by globalist ideology, whose spiritual leader is Bergoglio. The complicity of Bergoglio’s deep church in this infernal project has deprived Chinese Catholics of the indefectible defense that the Papacy had always been for them. Up until the papacy of Benedict XVI, the papacy had not made any agreements with the Beijing dictatorship, and the Roman Pontif retained the exclusive right to appoint bishops and govern dioceses.