Création D'un Forage Au Miocène Pour L'aep À Souprosse (40)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Résumé Non Technique Du Document D'objectifs Du Site Natura 2000
Résumé non technique du DOCument d’OBjectifs du site Natura 2000 FR7200722 Réseau hydrographique des affluents de la Midouze Natura 2000 doivent donc être le lieu d’une gestion Le dispositif européen concertée et assumée par tous les acteurs Natura 2000 intervenant sur les espaces naturels. La démarche Natura 2000 est née de l’application Chaque site est doté d’un plan de gestion appelé de deux Directives européennes : DOCument d’OBjectifs ou DOCOB. Ce document • la Directive " Habitats " de 1992 qui prévoit la définit les orientations de gestion et précise leurs création de Zones Spéciales de Conservation ou modalités de financement. ZSC pour la protection et la gestion des habitats naturels et des espèces de flore et de faune à Il contient un état des lieux écologique et socio- valeur patrimoniale ; économique du site. L’analyse de cette photographie • la directive " Oiseaux " de 1979 qui prévoit la du territoire permet de hiérarchiser les enjeux et de création de Zones de Protection Spéciales ou ZPS définir des objectifs de gestion. Ceux-ci sont alors pour la protection et la gestion des populations traduits en mesures de gestion mises en œuvre sur la d'espèces d'oiseaux sauvages. base du volontariat par les propriétaires, L’ensemble de ces zones forme à l’échelle du gestionnaires et usagers du site. territoire européen un réseau écologique communément appelé réseau Natura 2000. Le DOCOB du site des affluents de la Midouze est téléchargeable sur L’objectif de ce réseau s’inscrit pleinement dans la www.barthesmidouzemarensin.n2000.fr démarche de développement durable en permettant de "maintenir la biodiversité des milieux en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y attachent". -

Landes Randonnée® (Itinéraires Pédestres, VTT Et Équestres)
Les types de balisage ® Landes Randonnée (itinéraires pédestres, VTT et équestres) Les circuits de randonnée sont tous balisés sur le Offices de Tourisme terrain avec un code différent selon les pratiques Promenades de randonnée : à pied, à vélo ou à cheval. Aire-sur-l’Adour - 40800 et randonnées Tél : 05 58 71 64 70 - tourisme-aire-eugenie.fr Type de sentier Amou - 40330 dans les Landes Tél : 05 58 89 02 25 - amoutourisme.com Site Nature 40 Bonne Biscarrosse - 40600 direction Tél : 05 58 78 20 96 - biscarrosse.com À PIED, À CHEVAL OU À VÉLO : ou rappel À CHACUN SA RANDO ! Capbreton - 40130 Tél : 05 58 72 12 11 - capbreton-tourisme.com Tournez à Edition gauche Castets - 40260 2019 Tél : 05 58 89 44 79 - cotelandesnaturetourisme.com Tournez à Dax - 40100 droite Tél : 05 58 56 86 86 - dax-tourisme.com Eugénie-les-Bains - 40320 Mauvaise Tél : 05 58 51 13 16 - tourisme-aire-eugenie.fr direction Gabarret - 40310 Tél : 05 58 44 34 95 - tourisme-landesdarmagnac.fr Geaune - 40320 Tél : 05 58 44 42 00 - landes-chalosse.com Grenade-sur-l’Adour - 40270 Tél : 05 58 45 45 98 - cc-paysgrenadois.fr/tourisme Hagetmau - 40700 Tél : 05 58 79 38 26 - tourisme-hagetmau.com Hossegor - 40150 Tél : 05 58 41 79 00 - hossegor.fr Département Labastide-d’Armagnac - 40240 des Landes Tél : 05 58 44 67 56 - tourisme-landesdarmagnac.fr Les Actions Environnementales Labenne - 40530 Tél : 05 59 45 40 99 - landesatlantiquesud.com Département des Landes Comité départemental du tourisme Léon - 40550 Direction de l’Environnement équestre Tél : 05 58 48 76 03 - cotelandesnaturetourisme.com 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan cedex 40090 BOUGUE Lit-et-Mixe - 40170 Tél : 05 58 06 09 70 Tél : 05 58 42 72 47 - cotelandesnaturetourisme.com Tél. -

Bilan Besoins-Ressources Sur Le Bassin Versant De La Midouze
Bilan besoins-ressources sur le bassin versant de la Midouze La Midouze en amont de Tartas Avril 2008 Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne Chemin de l’Alette BP 449 / 65004 Tarbes cedex Tél. : +33 (0)5 62 51 71 49 / Fax : +33 (0)5 62 51 71 30 / www.cacg.fr Rapport d’étude Aménager les territoires et gérer l’eau Sommaire I SOMMAIRE PREAMBULE : CONTEXTE, OBJECTIFS DE L’ETUDE ET METHODOLOGIE .......3 1. Contexte et objectifs de l’étude..................................................................................................5 2. Méthodologie du bilan besoins-ressources..............................................................................7 CHAPITRE 1 : MODELISATION DU SYSTEME DES RESSOURCES EN EAU........9 1. Présentation du logiciel LAGON...............................................................................................11 2. Modélisation du réseau hydrographique.................................................................................15 2.1. Découpage du bassin en bassins versants élémentaires .................................................15 2.2. Constitution du réseau hydrographique de base dit naturel ..............................................15 3. Modélisation du système de gestion .......................................................................................17 3.1. Les principaux barrages réels............................................................................................17 3.2. Les ouvrages gérés fictifs ..................................................................................................18 -
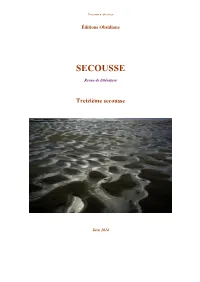
Treizième Secousse
Treizième ► Secousse Éditions Obsidiane SECOUSSE Revue de littérature Treizième secousse Juin 2014 Treizième ► Secousse Sommaire ► Directeur de la publication François Boddaert Conseil littéraire François Boddaert, Christine Bonduelle, Philippe Burin des Roziers, Jean-Claude Caër, Gérard Cartier, Pascal Commère, Pierre Drogi, Bruno Grégoire, Karim Haouadeg, Patrick Maury, Nimrod, Gérard Noiret, Anne Segal, Catherine Soullard, Vincent Wackenheim Responsables de rubrique Poésie Christine Bonduelle Proses Pascal Commère Lectures & entretiens Anne Segal Peinture Jean-Claude Caër Photographie Bruno Grégoire Théâtre Karim Haouadeg Cinéma Catherine Soullard Notes de lecture Patrick Maury Coordination Gérard Cartier Manifestations publiques Philippe Burin des Roziers Les textes sont à envoyer par courriel [email protected] Site de la revue http://www.revue-secousse.fr Sonothèque (lien actif) 2 Treizième ► Secousse Sommaire ► Sommaire Cliquer sur le titre pour l’atteindre Poésie Jean-Claude Caër ► Alaska 6 Bruno Germani ► Padre di famiglia in Arce (Italia) 9 Alain Lance ► Six Lance 13 Laura Marris ► Rançon 16 Angelo Maria Ripellino ► Nouvelles du déluge 20 Proses Gérard Cartier ► Du neutrino véloce ou Discours de la virgule 26 Emmanuel Moses ► Polonaise et autres textes 30 Jean-Pierre Otte ► Une reconquête poétique du monde 37 Essais Gérard Noiret ► « Voilà du biffin… » - Autres notes de chevet 41 Pierre Saint-Amand ► Paresse de Joubert 46 Aux dépens de la Compagnie Jean-Henri Fabre ► Souvenirs entomologiques 53 Carte Blanche -

Télécharger L'arrêté Préfectoral Du 23 Avril 2020 Portant
P a g e | 2 SOMMAIRE SOMMAIRE ...................................................................................................................................................... 2 TITRE I - PRÉAMBULE ................................................................................................................................ 4 TITRE II - CONSTITUTION, DENOMINATION, MEMBRES, PERIMETRE, OBJET, SIEGE ET DUREE ................... 4 ARTICLE 1. CONSTITUTION ET NATURE DU SYNDICAT ................................................................................................ 4 ARTICLE 2. DÉNOMINATION ................................................................................................................................ 4 ARTICLE 3. SIÈGE............................................................................................................................................... 4 ARTICLE 4. DURÉE ............................................................................................................................................. 4 ARTICLE 5. MEMBRES ........................................................................................................................................ 4 ARTICLE 6. PÉRIMÈTRE ....................................................................................................................................... 5 TITRE III - MISSIONS DU SYNDICAT .............................................................................................................. 5 ARTICLE 7. OBJET ............................................................................................................................................. -

Schéma Départemental Pour La Gestion Et La Valorisation Des Cours D’Eau Landais Bilan 2010-2015
Schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau landais Bilan 2010-2015 Les Actions Environnementales Sommaire Eléments de contexte page 4 Trois questions à Bernard Labadie, président du Syndicat mixte des rivières du bassin de l’Adour landais (SYRBAL) Bilan de la mise en œuvre page du schéma départemental 6 Trois questions à Jacques Marsan, président de la Fédération de pêche des Landes Témoignage : François Arrué, technicien rivières, Syndicat mixte de rivières du Marensin et du Born Perspectives de révision page 10 du schéma départemental Annexe : page 13 Tableau de bord de suivi Schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau landais Bilan 2010-2015 ELÉMENTS DE CONTEXTE Le Conseil départemental a initié, au début des années 1990, des actions questions à Bernard Labadie, président du Syndicat mixte Outils et moyens affectés Faits marquants des rivières du bassin de l’Adour landais (SYRBAL), en faveur de la gestion des cours d’eau, de la restauration et de l’entretien Le Département répond aux besoins des La politique de gestion des cours d’eau par 3 premier adjoint au maire d’Eyres-Moncube. pérenne des berges (gestion de la ripisylve). Un service technique dédié structures gestionnaires de cours d’eau sur les structures gestionnaires a évolué et s’est à l’accompagnement technique et financier des collectivités (CATER) et le plan technique et financier : adaptée aux différents évènements : Qu’est-ce que le SYRBAL ? un règlement d’intervention en faveur de la gestion et la restauration des § Le Service d’Animation pour la Gestion § évolution législative et réglementaire avec C’est un syndicat tout jeune. -

Relais Adour 08 09
MIGRADOUR Association pour la restauration des poissons migrateurs sur le bassin de l’Adour 2012 - Connaissance des stocks Suivi de la reproduction de la Lamproie marine sur le bassin de l’Adour Tranche 3/3 : Adour , affluents rive droite et Lèes Mesure SB 06- PLAGEPOMI Adour et côtiers : suivre tous les 3 ans la reproduction de la Lamproie marine Mesure GH 09 - PLAGEPOMI Adour et côtiers : évaluer les habitats des Lamproies marines MIGRADOUR 4 cours de la Marne 64110 Gelos Tél : 05.59.98.07.24 MIGRADOUR Association pour la restauration des poissons migrateurs sur le bassin de l’Adour 2012 - Connaissance des stocks Suivi de la reproduction de la Lamproie marine sur le bassin de l’Adour Tranche 3/3 : Adour , affluents rive droite et Lèes Rédacteurs : S. MARTY, C. LESFAURIES Prospections : C. LESFAURIES, S. CHALLA, E. ERRAMUZPE Coordination : S. MARTY Le suivi de la reproduction de la Lamproie marine 2012 a été financée par : l’Union européenne (fonds FEDER), l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la Fédération Nationale de la Pêche en France, Migradour. MIGRADOUR 4 cours de la Marne 64110 Gelos Tél : 05.59.98.07.24 SOMMAIRE 1. Introduction .................................................................................................... 1 1.1. Présentation de l’étude .........................................................................................1 1.2. Intérêts et valeurs de l’espèce ...............................................................................2 1.3. Statuts de l’espèce ................................................................................................2 -

Armagnac. Eaux De Vie Et Terroir
mmeaux 0réinUdRde vie et terroir f henri dufor WMmQBqbalMB & eaux de vie et terroir Privât Il a été tiré de cet ouvrage sur couché mat sept lacs des papeteries de Moulin- Vieux quatre mille exemplaires, constituant l'édition originale. ISBN : 2.7089.9005.5 " ,c 1982, Editions Privai, 14, rue des Arts, Toulouse Je tiens à nommer ici tous ceux qui, en m'apportant aide et conseils, ont vraiment facilité ma tâche. Tout d'abord à M. Pierre Dartigalongue, négociant à Nogaro (Gers) qui a, si gentiment et si souvent, éclairé ma lanterne, un grand merci. Toute ma gratitude également à Mme et M. Christian Amalvi qui m'ont accueilli avec un empressement si courtois à la Biblio- thèque nationale ainsi qu 'à Mme Téchené, directrice de la Biblio- thèque municipale d'Auch, puisque grâce au « prêt interbiblio- thèques » et à son entremise j'ai pu appuyer cette étude sur des textes à la fois riches et variés. Beaucoup d'autres, en Armagnac ou ailleurs, en m'apportant leurs témoignages ou leur appui, m'ont, eux aussi, permis de faire revivre cette grande aventure « historique et humaine » des eaux- de-vie gasconnes, notamment : M. Raoul Bouygard (Pont-de- Bordes), Mlle A.-M. Bozetto (Laujuzan), MM. Robert Cames (Condom), Roger Carrère (Condom), Jean Castarède (Mauléon- d'Armagnac), Jean Cavé (Lannepax), père F. Crouzel (Toulouse), Francis Dêche (Eauze), H. Dufréchou (Bourouillan), André Fontan (Nogaro), Guy Labédan (Auch), Gérard Laberdo- live (Mauvezin-d'Armagnac), René Laffargue (Eauze), Guy Lamothe (Marguestau), G. Ledun (Eauze), Fernand Lestage (Manciet), abbé G. Loubès (Auch), Mme Peyret (Auch), MM. -

Réseau Hydrographique Des Affluents De La Midouze
Réseau hydrographique des affluents de la Midouze SITE FR7200722 Charte Natura 2000 Version actualisée - Février 2014 1. Cadre réglementaire _____________________________ 1.1 Objet de la charte La charte Natura 2000 vise à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Elle va favoriser la poursuite, le développement et la valorisation de pratiques favorables à leur conservation. Il s’agit de "faire reconnaître" la gestion qui a permis le maintien de ces habitats remarquables. L’adhérent à la charte exprime son engagement en faveur de Natura 2000 et des objectifs du document d’objectifs. Les engagements proposés correspondent à des bonnes pratiques, n’entraînent pas de surcoût de gestion et ne donnent donc pas lieu à rémunération. Au contraire, les contrats Natura 2000 proposent des ajustements ou modifications de pratiques existantes ou la mise en œuvre de pratiques de gestion inconnues sur le site. La durée d’adhésion est de 5 ou 10 ans (renouvelable) et s’effectue par le biais d’un formulaire de déclaration d’adhésion. 1.2 Les avantages L’adhésion à la charte peut donner droit à une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles situées dans le site Natura 2000. Elle peut également constituer une des garanties de gestion durable requise pour bénéficier de certaines aides publiques ou exonérations fiscales. Enfin, elle offre la possibilité à l’adhérent de communiquer sur son implication dans le processus Natura 2000. 1.3 Le contenu La charte contient : • Des informations synthétiques permettant de sensibiliser aux enjeux de conservation du site : rappel de l’intérêt patrimonial du site et des objectifs de conservation définis dans le Docob. -

?UP[Afq ;ZR'qma
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Midouze ?UP[afQ ;ZR‘QMa n°1 - Décembre 2007 EDIT’Eau Le devenir de l’eau : un enjeu vital qui nous concerne tous L’eau, c’est la vie. C’est également l’élément central du développement de nos territoires, ce qui en fait certes une grande richesse, mais une richesse vulnérable. Préserver la ressource en eau est l’affaire de tous. C’est la raison pour laquelle les acteurs de l’eau (collectivités, administrations, agriculteurs, industriels, consommateurs, etc.) du bassin versant de la Midouze se sont organisés, au sein d’une Commission Locale de l’Eau (CLE), afin de pouvoir réfléchir ensemble à la politique à mettre en œuvre pour maîtriser la demande, préserver et gérer au mieux cette ressource. Installée en 2005, la CLE de la Midouze travaille actuellement à l’élaboration du SAGE - Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux – de la Midouze, et vient d’achever la phase d’analyse de la situation actuelle : l’état des lieux, qui décrit l’état de la ressource en eau sous toutes ses formes (quantité, qualité, milieux aquatiques, état des cours d’eau) et recense l’ensemble des usages. A partir de ce document, la CLE va maintenant réaliser le diagnostic du territoire (points forts / points faibles) afin d’en retirer les grands objectifs du SAGE qui serviront de base à l’élaboration du plan d’action. Cette lettre d’information fait le point sur le travail déjà réalisé.. Bernard SUBSOL Président de la CLE Midouze, Conseiller Général des Landes Qu’est-ce qu’un SAGE ? La réglementation évolue.. -

Balade Hydrogéologique Adour
Balades hydrogéologiques en Aquitaine Formations alluviales du Quaternaire dans les vallées de l’Adour et de la Midouze Introduction Balade hydrogéologique en Aquitaine - Quaternaire dans les vallées Adour et Midouze Introduction La thématique présentée dans ce parcours aborde l'hydrogéologie des nappes alluviales du Quaternaire, dans le sud de l'Aquitaine, et en particulier dans les vallées de l'Adour et de son principal affluent de rive droite, la Midouze. Figure 1 : Carte de localisation de la balade hydrogéologique en région Aquitaine (© BRGM). Les ressources en eau souterraine superficielle sont abondantes et facilement accessibles dans cette région, dont la géologie est caractérisée par les formations réservoir, à faciès silicoclastiques plus ou moins grossiers (galets, graviers et sables) des formations des Landes et des terrasses alluviales le long des fleuves et rivières. Les formations quaternaires, déposées depuis 2 millions d'années environ, constituant les principaux réservoirs des nappes superficielles très peu profondes, sont SIGES Aquitaine (sigesaqi.brgm.fr) 3 Balade hydrogéologique en Aquitaine - Quaternaire dans les vallées Adour et Midouze Introduction présentées, ainsi que certains imperméables les supportant qui existent dans le sud du département des Landes. Cependant elles ne sont que très rarement captées pour l'alimentation en eau potable qui, dans ce secteur, au nord de la Chalosse, est principalement fournie par les nappes captives du Miocène inférieur (Aquitanien et Burdigalien) se trouvant à faible ou moyenne profondeur (moins de 100 m). Les nappes libres (phréatiques) des alluvions quaternaires, qui sont les nappes d'accompagnement des cours d'eau dont elles soutiennent les débits d'étiage en été et début d'automne, servent surtout pour l'irrigation, notamment à l'aide des grandes rampes d'aspersion sur pivot et les canons à eau pour le maïs. -

Classement Des Cours D'eau Au Titre De L'article L.214-17 Du Code De L'environnement
Classement des cours d'eau au titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement Document technique d'accompagnement des classements pour le bassin Adour-Garonne - Version octobre 2013 - Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne Information générale Le présent document technique d'accompagnement a pour objectif de préciser les critères retenus, dans le bassin Adour Garonne, pour les classements des cours d'eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement. Il apporte des éléments d'information pour guider leur mise en œuvre. Ce document reprend de façon synthétique différentes informations mises à disposition au cours des diverses concertations et consultations organisées dans le cadre de la procédure de classements et pour l'avis du comité de bassin du 8 juillet 2013. Il constitue un document de référence à destination des services de l'Etat, des usagers potentiels des cours d'eau et des propriétaires ou exploitants d'ouvrages concernés par la liste 2 qui devront mettre en conformité leurs ouvrages dans le délai réglementaire de cinq ans. Pour la liste 1 le document technique d’accompagnement précise notamment pour les cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux définis dans l'arrêté : • le ou les départements concernés ; • le code hydrographique du cours d'eau ou dans le cas des entités regroupant plusieurs cours d'eau sous un même libellé celui de l'axe principal ; • le ou les critères ayant justifié le classement parmi les trois définis dans la loi (cours d’eau en très bon état, cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique ou cours d’eau nécessitant une protection complète pour les poissons migrateurs amphihalins).