Pathologies Des Écosystèmes Thème Etude De La Microdistribution Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
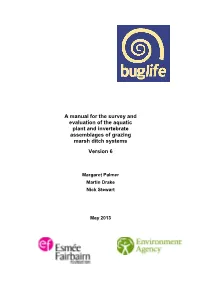
A Manual for the Survey and Evaluation of the Aquatic Plant and Invertebrate Assemblages of Grazing Marsh Ditch Systems
A manual for the survey and evaluation of the aquatic plant and invertebrate assemblages of grazing marsh ditch systems Version 6 Margaret Palmer Martin Drake Nick Stewart May 2013 Contents Page Summary 3 1. Introduction 4 2. A standard method for the field survey of ditch flora 5 2.1 Field survey procedure 5 2.2 Access and licenses 6 2.3 Guidance for completing the recording form 6 Field recording form for ditch vegetation survey 10 3. A standard method for the field survey of aquatic macro- invertebrates in ditches 12 3.1 Number of ditches to be surveyed 12 3.2 Timing of survey 12 3.3 Access and licences 12 3.4 Equipment 13 3.5 Sampling procedure 13 3.6 Taxonomic groups to be recorded 15 3.7 Recording in the field 17 3.8 Laboratory procedure 17 Field recording form for ditch invertebrate survey 18 4. A system for the evaluation and ranking of the aquatic plant and macro-invertebrate assemblages of grazing marsh ditches 19 4.1 Background 19 4.2 Species check lists 19 4.3 Salinity tolerance 20 4.4 Species conservation status categories 21 4.5 The scoring system 23 4.6 Applying the scoring system 26 4.7 Testing the scoring system 28 4.8 Conclusion 30 Table 1 Check list and scoring system for target native aquatic plants of ditches in England and Wales 31 Table 2 Check list and scoring system for target native aquatic invertebrates of grazing marsh ditches in England and Wales 40 Table 3 Some common plants of ditch banks that indicate salinity 50 Table 4 Aquatic vascular plants used as indicators of good habitat quality 51 Table 5a Introduced aquatic vascular plants 53 Table 5a Introduced aquatic invertebrates 54 Figure 1 Map of Environment Agency regions 55 5. -

Georeferenced Probabilistic Risk Assessment of Pesticides
TEXTE 05/2014 Georeferenced Probabil- istic Risk Assessment of Pesticides – Further Advances in Assessing the Risk to Aquatic Ecosystems by Spray Drift from Permanent Crops | TEXTE | 05/2014 ENVIRONMENTAL RESEARCH OF THE FEDERAL MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, NATURE CONSERVATION, BUILDING AND NUCLEAR SAFETY Project No. (FKZ) 3707 63 4001 Report No. (UBA-FB) 001740/E Georeferenced Probabilistic Risk Assessment of Pesticides – Further Advances in Assessing the Risk to Aquatic Ecosystems by Spray Drift from Permanent Crops by Kubiak R. & Hommen U., Bach M., Classen S., Gergs A., Golla B., Guerniche D., Klein M., Krumpe J., Preuss TG., Ratte HAT., Roß-Nickol M., Schäfers C., Strauss T., Toschki A., Trapp M. Project coordination Prof. Dr. Roland Kubiak Institute of Agroecology, RLP Agroscience, Neustadt a.d. Weinstraße Dr. Udo Hommen Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Apllied Ecology, Schmallenberg On behalf of the Federal Environment Agency (Germany) UMWELTBUNDESAMT Imprint Publisher: Umweltbundesamt Wörlitzer Platz 1 06844 Dessau-Roßlau Tel.: 0340/2103-0 Telefax: 0340/2103 2285 [email protected] Internet: www.umweltbundesamt.de http://fuer-mensch-und-umwelt.de/ www.facebook.com/umweltbundesamt.de www.twitter.com/umweltbundesamt Study performed by: Consortium under the leadership of: RLP AgroScience GmbH Institut für Agrarökologie Breitenweg 71 67435 Neustadt Study completed in: October 2011 Edited by: Section IV 1.3 Plant Protection Products Alexandra Müller Steffen Matezki Publikation as pdf: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/georeferenced-probabilistic-risk- assessment-of ISSN 1862-4804 Dessau-Roßlau, February 2014 Vorwort Das Umweltbundesamt unterstützt die Entwicklung von landschaftsbezogenen proba- bilistischen Methoden in der Umweltrisikobewertung von Pestiziden bereits seit 20031 mit eigenen Beiträgen einschließlich der Vergabe von Forschungsvorhaben. -

The Effect of Geographical Scale of Sampling on DNA Barcoding
Syst. Biol. 61(5):851–869, 2012 c The Author(s) 2012. Published by Oxford University Press on behalf of Society of Systematic Biologists. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI:10.1093/sysbio/sys037 Advance Access publication on March 7, 2012 The Effect of Geographical Scale of Sampling on DNA Barcoding 1,2,3 4 2,3 2,3 JOHANNES BERGSTEN ∗,DAVID T. BILTON ,TOMOCHIKA FUJISAWA ,MIRANDA ELLIOTT , MICHAEL T. MONAGHAN5,MICHAEL BALKE6,LARS HENDRICH6,JOJA GEIJER7,JAN HERRMANN7, GARTH N. FOSTER8,IGNACIO RIBERA9,ANDERS N. NILSSON10,TIMOTHY G. BARRACLOUGH3, AND ALFRIED P. VOGLER2,3 1Department of Entomology, Swedish Museum of Natural History, Box 50007, SE-104 05 Stockholm, Sweden; 2Entomology Department, Natural History Downloaded from https://academic.oup.com/sysbio/article-abstract/61/5/851/1736372 by guest on 20 November 2018 Museum, Cromwell road, London SW7 5BD, UK; 3Division of Biology, Imperial College London, Silwood Park Campus, Ascot SL5 7PY, UK; 4Marine Biology and Ecology Research Centre, School of Marine Science and Engineering, University of Plymouth, Drake Circus, Plymouth, Devon PL4 8AA, UK; 5Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Mueggelseedamm 301, 12587 Berlin, Germany; 6Zoologische Staatssammlung M¨unchen, M¨unchhausenstrasse21, 81247 M¨unchen,Germany; -

Groundwater Ecology: Invertebrate Community Distribution Across the Benthic, Hyporheic and Phreatic Habitats of a Chalk Aquifer in Southeast England
Groundwater Ecology: Invertebrate Community Distribution across the Benthic, Hyporheic and Phreatic Habitats of a Chalk Aquifer in Southeast England Jessica M. Durkota Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University College London Declaration of the Author I, Jessica M. Durkota, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. This work was undertaken with the partial support of the Environment Agency. The views expressed in this publication are mine and mine alone and not necessarily those of the Environment Agency or University College London (UCL). 2 Abstract Groundwater is an important resource for drinking water, agriculture, and industry, but it also plays an essential role in supporting the functioning of freshwater ecosystems and providing habitat for a number of rare species. However, despite its importance, groundwater ecology often receives little attention in environmental legislation or research. This study aims to improve our understanding of the organisms living in groundwater-dependent habitats and the influence of environmental conditions on their distribution. Invertebrate communities occurring in the benthic, hyporheic and phreatic habitats were surveyed at twelve sites over four years across the Stour Chalk Block, a lowland catchment in southern England. A diverse range of stygoxenes, stygophiles and stygobionts, including the first record of Gammarus fossarum in the British Isles, were identified using morphological and molecular techniques. The results indicate that under normal conditions, each habitat provided differing environmental conditions which supported a distinctive invertebrate community. -

The Effect of Geographical Scale of Sampling on DNA Barcoding
Systematic Biology Advance Access published April 16, 2012 c The Author(s) 2012. Published by Oxford University Press on behalf of Society of Systematic Biologists. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI:10.1093/sysbio/sys037 The Effect of Geographical Scale of Sampling on DNA Barcoding 1,2,3 4 2,3 2,3 JOHANNES BERGSTEN ∗, DAVID T.BILTON , TOMOCHIKA FUJISAWA , MIRANDA ELLIOTT , MICHAEL T.MONAGHAN5, MICHAEL BALKE6, LARS HENDRICH6, JOJA GEIJER7, JAN HERRMANN7, GARTH N.FOSTER8, IGNACIO RIBERA9, ANDERS N.NILSSON10, TIMOTHY G.BARRACLOUGH3, AND ALFRIED P.VOGLER2,3 1Department of Entomology, Swedish Museum of Natural History, Box 50007, SE-104 05 Stockholm, Sweden; 2Entomology Department, Natural History Museum, Cromwell road, London SW7 5BD, UK; 3Division of Biology, Imperial College London, Silwood Park Campus, Ascot SL5 7PY, UK; 4Marine Biology and Ecology Research Centre, School of Marine Science and Engineering, University of Plymouth, Drake Circus, Plymouth, Devon PL4 8AA, UK; 5Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Mueggelseedamm 301, 12587 Berlin, Germany; 6Zoologische Staatssammlung M¨unchen, M¨unchhausenstrasse21, 81247 M¨unchen,Germany; 7School of Natural Sciences, Linnaeus University, SE-391 82 Kalmar, Sweden; 8The Aquatic Coleoptera Conservation Trust, 3 Eglinton Terrace, Ayr KA7 1JJ Scotland, UK; 9Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF), Passeig Mar´ıtimde la Barceloneta 37-49, 08003 Barcelona, Spain; and 10Department of Ecology and Environmental Science, Ume˚aUniversity, SE-90187 Ume˚a,Sweden; ∗Correspondence to be sent to: Department of Entomology, Swedish Museum of Natural History, Box 50007, SE-104 05 Stockholm, Sweden; E-mail: [email protected]. -

Thoughts on Water Beetles in a Mediterranean Environment
Chapter 1 Thoughts on Water Beetles in a Mediterranean Environment Touaylia Samir TouayliaAdditional information Samir is available at the end of the chapter Additional information is available at the end of the chapter http://dx.doi.org/10.5772/66639 Abstract The chapter provides data from a survey carried out on water beetles in various freshwa- ter ecosystems in Tunisia as a Mediterranean country of considerable diversity. Studies dealing with these insects are fragmentary not only in comparison with the European fauna but also in comparison to other zoogeographical areas. A compiled checklist of beetle species collected from Tunisia is given with an insight on new recorded species. Diversity, altitudinal distribution, and geographical pattern of water beetles in Northern Tunisia are discussed with regard to other Mediterranean areas. They include various chorotypes related to the history of the Mediterranean basin. Several species are threat- ened and require conservation. According to the criteria of the IUCN, several water beetle species can be included in the list of threatened species. Keywords: water beetles, diversity, phenology, biogeography 1. Introduction Water beetles are holometabolous insects characterized by a strongly sclerotized body with the forewings hardened into elytra [1]. They occur in a wide variety of habitats, living in virtu- ally every kind of fresh- and brackish-water habitat, from the smallest ponds to lagoons and wetlands and from streams to irrigation ditches and reservoirs [2]. They exhibit high species richness in the Mediterranean area and are primarily found in the ecotone between land and inland waters [3]. They are of great ecological interest as bioindicators of the quality of limnic ecosystems, the type of water, and habitats in danger [4]. -

The Assemblages of Aquatic Coleoptera from Shallow Lakes In
Eur. J. Entorno!. 99: 289-298, 2002 ISSN 1210-5759 The assemblages of aquatic Coleóptera from shallow lakes in the northern Iberian Meseta: Influence of environmental variables Lu is F. VALLADARES1, J o se f in a GARRIDO2 and F r a n c isc GARCÍA-CRIADO1 o 'Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Universidad de León, 24071 León, Spain; e-mail: [email protected] 2Departamento de Ecología y Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, 36200 Vigo, Spain; e-mail: [email protected] Key words. Assemblages of Coleoptera, shallow lakes, environmental variables, Iberian Peninsula, multivariate analysis. Abstract. Aquatic Coleoptera in shallow lakes associated with the Canal de Castilla (Palencia Province, Spain) in the northern Ibe rian Meseta were sampled over the course of a year (spring 1998-winter 1999). These waterbodies are typical plateau wetlands with dense vegetation and vary in permanence and area (from 3.3 ha to 29.35 ha). Oxygen concentration, conductivity and pH were recorded at the time of sampling. Lake area, depth, water permanence and type of vegetation were also taken into account. Ninety two species were collected. Species richness was high in comparison with other wetlands in Spain. The assemblage structure was assessed in terms of three community parameters: richness, abundance and diversity (Shannon index). Their relationships with envi ronmental variables were explored using correlation coefficients. The assemblage composition was analysed by multivariate tech niques. First, the sites were classified by means of TWINSPAN. The presence of each species in the different TWINSPAN groups was used to assess their habitat preferences. -

A New Species of Agabus from South-West Portugal (Coleoptera: Dytiscidae)
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Koleopterologische Rundschau Jahr/Year: 1997 Band/Volume: 67_1997 Autor(en)/Author(s): Foster G.N., Bilton David T. Artikel/Article: A new species of Agabus from south-west Portugal (Dytiscidae). 113-118 ©Wiener Coleopterologenverein (WCV), download unter www.biologiezentrum.at Koleopterologische Rundschau 67 113- 118 Wien, Juni 1997 A new species of Agabus from south-west Portugal (Coleoptera: Dytiscidae) G.N. FOSTER & D.T. BILTON Abstract Agabus picotae, sp.n., is described as a member of the Agabus guttatus-group from Monchique, Algarve, Portugal. It appears to be madicolous, living on wet areas of rocks at the edges of exposed granite. It is illustrated and compared with similar Agabus species. A revised key to the western Palaearctic species of the A. guttatus-group is provided. Key words: Coleoptera, Dytiscidae, Colymbetinae, Agabini, Dichonectes, Agabus guttatus-group, taxonomy, Agabus picotae, new species, Palaearctic Region, madicoly Introduction A single female of an unfamiliar species of Agabus was found by the senior author in the Riba de Logardo, Monchique on January 1st, 1995. A subsequent visit by both authors established that this was an undescribed species of the Agabus guttatus-group associated with wet, exposed rock around Picota Mountain. Agabus picotae sp.n. LOCUS TYPICUS: Picota Mountain, Monchique, Algarve, Portugal. TYPE MATERIAL: Holotype cî: "PORTUGAL: Monchique SE side of Picota, 225 m 31.3.1996 leg. G.N. Foster & D.T. Bilton" (Naturhistorisches Mu- seum, Vienna - NMW). Paratypes (dcî + 59): 12 specimens with identical locality data "PORTUGAL: Monchique, Picota, 225-425 m 31.3.1996 leg. -

Development of a Novel Invertebrate Indexing Tool for the Determination of Salinity in Aquatic Inland Drainage Channels
DEVELOPMENT OF A NOVEL INVERTEBRATE INDEXING TOOL FOR THE DETERMINATION OF SALINITY IN AQUATIC INLAND DRAINAGE CHANNELS Alexander G. G. Pickwell A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the University of Lincoln for the degree of Master of Philosophy in Biology This research programme was carried out in collaboration with the Environment Agency August 2012 Page i Certificate of Originality This is to certify that I am responsible for the work submitted in this thesis, that the original work is my own, except as specified in the acknowledgements and in references, and that neither the thesis nor the original work contained therein has been previously submitted to any institution for the award of a degree. Signature: Name: Alexander G. G. Pickwell Date: 31st August 2012 Page i Abstract Salinisation of freshwater habitats is an issue with global implications that can have serious detrimental effects on the environment resulting in an overall loss in biodiversity. Whilst increases in salinity can occur naturally, such anthropogenic actions as the disposal of industrial and urban effluents and the disturbance of natural hydrological cycles can also result in the salinisation of freshwater habitats. The Water Framework Directive (WFD) requires Member States to restore all freshwater habitats to “good ecological status” and to prevent any further deterioration. Macro-invertebrates are widely used as indicators of river condition for a wide range of reasons and have been designated a key biological element in the assessment of aquatic habitats by the WFD. A review of the available literature, however, found no macro- invertebrate-based biotic indices have been developed for the detection and determination of salinity increases in freshwater habitats that are suitable for application in the United Kingdom for the purposes of the WFD. -

Arthropoda Fauna of Zindan Cave (Isparta, Turkey)
Türk. entomol. derg., 2021, 45 (2): 229-243 ISSN 1010-6960 DOI: http://dx.doi.org/10.16970/entoted.889779 E-ISSN 2536-491X Original article (Orijinal araştırma) Arthropoda fauna of Zindan Cave (Isparta, Turkey) with notes on new records and some ecological characteristics1 Zindan Mağarası (Isparta, Türkiye) Arthropoda faunası, yeni kayıtlar ve bazı ekolojik özellikler üzerine notlar Cemal Çağrı ÇETİN2* Ergin TURANTEPE3 Mehmet Faruk GÜRBÜZ4 Abstract The aims of the study were to investigate the Arthropoda fauna of Zindan Cave (Aksu, Isparta Province, Turkey) and to consider some ecological characteristics of the collected species such as feeding habits, cave-dwelling categories, and zone distributions in caves. Twenty-seven species of Arthropoda were determined between May 2015 and December 2016, from Zindan Cave. The species found belong to the following orders: nine to Collembola, six to Coleoptera, five to Araneae, two to Diplopoda and one to Orthoptera, Trichoptera, Diptera, Trombidiformes and Isopoda. Nine species are endemic of Turkey. Traegaardhia distosolenidia Zacharda, 2010 (Acari: Rhagidiidae) and Folsomia asiatica Martynova, 1971 (Collembola: Isotomidae) are newly recorded for the fauna of Turkey. The presence of Heteromurus sexoculatus Brown, 1926 (Collembola: Entomobryidae) in Turkey is confirmed. Twenty-four of the 27 species were from the dark zone and half of the collected species (6 troglobites and 8 troglophiles) are ecologically adapted to cave ecosystems. Species can be divided into three groups according to trophic preferences: 15 scavengers, 10 predators and two omnivores. Food habits, cave-dwelling categories, and zone distributions of collected species are discussed. Keywords: Arthropoda, biospeleology, cave-dwelling categories, habitat, Zindan Cave Öz Çalışmanın amacı, Zindan Mağarası (Aksu, Isparta, Türkiye) Arthropoda faunasını belirlemek ve toplanan türlerin beslenme alışkanlıkları, ekolojik sınıflandırılması ve zon dağılımları gibi bazı ekolojik özelliklerini ortaya koymaktır. -

Scope: Munis Entomology & Zoology Publishes a Wide Variety of Papers
_____________Mun. Ent. Zool. Vol. 13, No. 2, June 2018__________ 698 HEAVY ELEMENT ACCUMULATION IN SOME AGABUS SPECIES (COLEOPTERA: DYTISCIDAE) FROM DIFFERENT PROVINCES OF TURKEY Zeynep Aydoğan*, Ümit İncekara**, Mustafa Cemal Darılmaz*** and Ali Gürol**** * Atatürk University, Narman Vocational School, Narman, Erzurum, TURKEY. ** Atatürk University, Faculty of Science, Department of Biology, Erzurum, TURKEY. E- mail: [email protected] *** Aksaray University, Faculty of Science, Department of Biology, Aksaray, TURKEY. **** Atatürk University, Faculty of Science, Department of Physics, Erzurum, TURKEY. [Aydoğan, Z., İncekara, Ü., Darılmaz, M. C. & Gürol, A. 2018. Heavy element accumulation in some Agabus species (Coleoptera: Dytiscidae) from different provinces of Turkey. Munis Entomology & Zoology, 13 (2): 698-701] ABSTRACT: During 2007 and 2008, Agabus spp. (Dytiscidae) were collected and heavy element content of the insects were evaluated. Heavy element concentrations were analyzed by Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) spectroscopy. In this study sixteen heavy element (Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Pb) were measured for heavy element pollution in different city (Afyon, Denizli, Kütahya, Uşak) of Turkey. According to the results insects are able to accumulate these elements in certain concentrations. KEY WORDS: Bioaccumulation, Dytiscidae, Agabus, EDXRF, heavy element, Turkey Heavy elements are important environmental pollutant and are worldwide problem in these days. Elements are part of earth crust but unconscious and intensive usage of these elements increase the availability in ecosystem and food chain. Minor amount of those elements are necessary for continue life. But increasing level of heavy element affects drinking water quality, environment, food web and finally human health (Onuoha & Felicia, 2008). -

Monitoring on the Lewes Levels and Surveys in Yorkshire
Report Number 509 Laccophilus poecilus Klug Col., Dytiscidae Species Recovery Programme reportMarch 2000-August 2001 Monitoring on the Lewes Levelsand surveys inYorkshire English Nature Research Reports working today for nature tomorrow English Nature Research Reports Number 509 Laccophilus poecilus Klug Col., Dytiscidae Species Recovery Programme Report − March 2000−August 2001 Monitoring on the Lewes Levels and surveys in Yorkshire Peter J. Hodge You may reproduce as many additional copies of this report as you like, provided such copies stipulate that copyright remains with English Nature, Northminster House, Peterborough PE1 1UA ISSN 0967-876X © Copyright English Nature 2003 Contents Acknowledgements Summary 1. Introduction....................................................................................................................9 2. Additional historical data...............................................................................................9 2.1 Information from R.J. Marsh .............................................................................9 2.2 Information from R. (Bob) Merritt ..................................................................10 2.3 Specimens in the Joy collection (BENHS, Reading).......................................10 3. The 2000 survey...........................................................................................................11 3.1 Celery sewer, Lewes Brooks SSSI, E. Sussex, Mar - Oct 2000 ......................11 3.2 Yorkshire (V. C.’s 61 & 63), August 2000......................................................13