RABARISOLOSON NIRINA Fenomanantsoa Jean Emilson
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Distr. GENERAL CRC/C/8/Add.5 13 September 1993 ENGLISH Original
Distr. GENERAL CRC/C/8/Add.5 13 September 1993 ENGLISH Original: FRENCH COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES PURSUANT TO ARTICLE 44 OF THE CONVENTION Initial reports of States parties due in 1993 Addendum MADAGASCAR [20 July 1993] CONTENTS Paragraphs Page Introduction ........................ 1- 4 4 I. GENERAL PRINCIPLES .................. 5-34 4 A. Non-discrimination ................ 7-20 4 B. Best interests of the child............ 21-26 7 C. Right to life, survival and development...... 27-31 8 D. Respect for the views of the child ........ 32-34 9 II. BASIC HEALTH AND WELFARE ............... 35-64 10 A. Survival and development ............. 36-43 10 B. Disabled children................. 44-49 11 C. Health and health services ............ 50-61 12 GE.93-18558 (E) CRC/C/8/Add.5 page 2 CONTENTS (continued) Paragraphs Page D. Social security.................. 62- 64 14 E. Standard of living ................ 65- 66 14 III. CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS............... 67-154 15 A. Right of the child to an identity (art. 7) and preservation of identity (art. 8)......... 70-101 15 B. Freedom of expression (art. 13), freedom of thought, conscience and religion (art. 14) and access to information (art. 17).......... 102-139 21 C. Freedom of association and peaceful assembly (art. 15)..................... 140 28 D. Protection of privacy (art. 16).......... 141 28 E. Right not to be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 37 (a)) ............. 142-154 28 IV. FAMILY ENVIRONMENT AND ALTERNATIVE CARE........ 155-210 31 A. Parental guidance (art. 5) ............ 155-166 31 B. -

RESETTLEMENT ACTION PLAN Part One: Detailed Resettlement Action Plan for the Dam and Reservoir
SUPPLIED TO MARY BOOMGARD, OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION ON 22 NOV 19 04:53:40 GMT Madagascar Sahofika Hydropower Plant RESETTLEMENT ACTION PLAN Part One: Detailed Resettlement Action Plan for the Dam and Reservoir Part Two: Abbreviated Resettlement Action Plan for the Linear Components of the Project Prepared by: Land Resources, Antananarivo, Madagascar With: Frédéric Giovannetti, Lyon, France Date: June 30, 2019 Version: C SUPPLIED TO MARY BOOMGARD, OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION ON 22 NOV 19 04:53:40 GMT SUPPLIED TO MARY BOOMGARD, OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION ON 22 NOV 19 04:53:40 GMT Eiffage Eranove HIER Themis Consortium Madagascar - Sahofika Hydropower Plant Resettlement Action Plan - Version C TRACEABILITY Version Date Reference Commented on Status by A 04/25/2019 Draft B 06/20/2019 Draft for publication C 07/05/2019 Version for submission to ONE ABBREVIATIONS AEC: Administrative Evaluation Commission AFD: French Development Agency AfDB: African Development Bank AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome ALC: Local Liaison Officer Art.: Article AWS Drinking Water Supply BD: Board of Directors Banky Fampadrosoana ny Varotra (Malagasy subsidiary of the BFV: Société Générale Group) BIF: Birao Ifoton'ny Fananan-tany (Communal Land Office) CASEF: Agricultural Growth and Land Security CIRTOPO: Topographic Constituency COBA: Grassroots Community CPAR: Short Resettlement Plan Framework CSB: Basic Health Center CTD: Decentralized Territorial Communities Inter-Regional Departments and Services for the Environment -

Diagnostic Territorial De La Région Du Vakinankaratra À Madagascar
« Prospective territoriale sur les dynamiques démographiques et le développement rural en Afrique subsaharienne et à Madagascar » ETUDE pour le compte de l’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RAPPORT PAYS Diagnostic Territorial de la Région du Vakinankaratra à Madagascar Auteurs : Jean-Michel SOURISSEAU, Patrick RASOLOFO, Jean-François BELIERES, Jean-Pierre GUENGANT, Haja Karmen RAMANITRINIONY, Robin BOURGEOIS, Tovonirina Théodore RAZAFIMIARANTSOA, Voahirana Tantely ANDRIANANTOANDRO, Manda RAMARIJAONO, Perrine BURNOD, Hajatiana RABEANDRIAMARO, Nathalie BOUGNOUX Version finale Février 2016 Avant-Propos Ce rapport est un des produits de l’étude « Prospective territoriale sur les dynamiques démographiques et le développement rural en Afrique subsaharienne et à Madagascar » menée dans deux régions d’Afrique : la région de Ségou au Mali et la région de Vakinankaratra à Madagascar Il s’agit du diagnostic territorial rétrospectif de la Région du Vakinankaratra. Une première version a servi à la préparation de l’atelier de prospective « Les avenirs de Vakinankaratra en 2035 » qui s’est tenu du 17 au 21 août 2015 à Antsirabe et qui a donné lieu à la production d’un rapport, également disponible. Une deuxième version, très largement enrichie, datée de janvier 2016, a été éditée à cent cinquante exemplaires, et diffusée lors des ateliers de restitution qui ont eu lieu à Antsirabe et Antananarivo, les 02 et 04 février 2016. Ce document (daté de février 2016) constitue la version finale qui prend en compte les remarques faites lors de ces ateliers. Ce rapport sur la région de Vakinankaratra est le pendant du document établi pour la région de Ségou au Mali. Ses principaux enseignements, complétés par les produits de l’atelier, sont intégrés dans le rapport de synthèse de l’étude, produit final rassemblant les acquis de la prospective dans les deux régions et les perspectives en termes de méthode et de reproduction dans d’autres situations. -
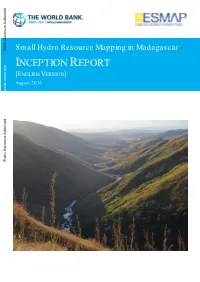
Small Hydro Resource Mapping in Madagascar
Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -
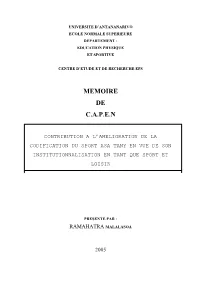
Memoire De C.A.P.E.N
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EPS MEMOIRE DE C.A.P.E.N CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU SPORT ASA TANY EN VUE DE SON INSTITUTIONNALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR PRESENTE PAR : RAMAHATRA MALALASOA 2005 1 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE ENS. /EPS Promotion : « VARATRA » MEMOIRE DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT D’APTITUDE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE (CAPEN) « CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU SPORT ASA TANY EN VUE DE SON INSTITUTIONNALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR » Présenté et soutenu publiquement le : 26 Octobre 2005 Par : RAMAHATRA Malalasoa Né le : 08 Mars 1978 A : Arivonimamo MEMBRE DU JURY : Président : ANDRIANAIVO Victorine Juge : RASOLONJATOVO Haingo Harinambinina Rapporteur : RAKOTONIAINA Jean Baptiste 2 TITRE : «CONTRIBUTION A L’ AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU « SPORT ASA TANY » EN VUE DE SON INSTITUTIONALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR » AUTEUR : RAMAHATRA Malalasoa NOMBRE DE PAGES : 76 NOMBRE DE TABLEAUX : 10 RESUME : La richesse culturelle de Madagascar mérite une recherche particulière, au niveau de la tradition aussi bien que de sa civilisation. En effet, le présent mémoire essaie d’apporter des améliorations à la codification, de la pratique du sport asa tany que l’association sport asa tany Madagascar a déjà essayé dans quelques territoires malgache et ailleurs, mais elle n’est pas arrivée à le sportiviser comme le cas des autres sports traditionnels. De ce faite, l’existence des règlements officiels et uniques facilite l’organisation des championnats qui peut entraîner la naissance des clubs, les sections et la fédération sportive pour ce nouvel sport venant des paysans malgaches. -

1 COAG No. 72068718CA00001
COAG No. 72068718CA00001 1 TABLE OF CONTENT I- EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................................................................. 6 II- INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 10 III- MAIN ACHIEVEMENTS DURING QUARTER 1 ........................................................................................................... 10 III.1. IR 1: Enhanced coordination among the public, nonprofit, and commercial sectors for reliable supply and distribution of quality health products ........................................................................................................................... 10 III.2. IR2: Strengthened capacity of the GOM to sustainably provide quality health products to the Malagasy people 15 III.3. IR 3: Expanded engagement of the commercial health sector to serve new health product markets, according to health needs and consumer demand ........................................................................................................ 36 III.4. IR 4: Improved sustainability of social marketing to deliver affordable, accessible health products to the Malagasy people ............................................................................................................................................................. 48 III.5. IR5: Increased demand for and use of health products among the Malagasy people -

Bulletin H6+ Santé
Bulletin H6+ Santé Edition Décembre 2018 - N4 H6+ Madagascar Partenariat pour la promotion de la santé des mères, des nouveaux-nés et des enfants Sommaire Santé des adolescents Un nouveau projet mis en œuvre par l’UNICEF, avec le financement du KOICA, dans la région d’Anosy 2 Adoption de Madagascar des directives de l’OMS La prise en charge des infections bacteriennes graves des nourrissons, quand le transfert est impossible 3 Histoire à succés Un agent communautaire perseverant se voit recompenser pour ses services et insprire d’autres 4 Santé maternelle et néonatale Stratégie de mise en œuvre de l’approche qualité de l’OMS 5 Accès aux soins Accroître la disponibilité et l’accessibilité aux soins de santé primaire au niveau communautaire 7 Soins obstetricaux et neonatals « Monitoring » des Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence à Madagascar 8 Continuum de soin Un agent communautaire montre l’exemple 9 H6+ Edition Décembre 2018 - N4 Editorial près les différents engagements qui ont fait leurs preuves, qui sont pris par Madagascar, l’accélération rentables et qui permettent de sauver la de la réduction de la mortalité vie d’innombrables mères et nouveau-nés. maternelleA et la mortalité néonatale est En effet, Il est indispensable de protéger l’une des principales priorités du pays. davantage la santé de la mère pour sauver Pour cette année 2018, les membres du la vie du nouveau nés car la survie et le groupe H6+, dont l’UNICEF asure bien-être du nouveau-né dépendent de sa la présidence tournante, ont uni leur mère sous plusieurs aspects importants. -

COVID-19 Response Monthly Report: Redirection of Funding IMPACT (Improving Market Partnerships and Access to Commodities Together): February 2021
COVID-19 Response Monthly Report: Redirection of Funding IMPACT (Improving Market Partnerships and Access to Commodities Together): February 2021 Overview of COVID-19 Activities USAID has approved on January 27th the use of $149,253 for IMPACT to implement COVID-19 activities from February 2021 to March 2021 using the remaining COVID-19 funding from the May to October 2020 period. This is redirection funding from cancelled and/or postponed activities from Year 2. The purpose of this funding is to (i) help the GOM to purchase and transport health and expendable commodities (infection prevention products) from the central level to districts and communes (ii) sensitize Malagasy people in the eight most affected regions of COVID-19, including Boeny, Analanjirofo, Haute Matsiatra, Vatovavy Fitovinany, Amoron'i Mania, Vakinankaratra, Menabe, and Atsimo Andrefana. After receiving the approval from USAID, we noticed increased cases in two additional regions namely Diana and Atsinanana that we included in the supported regions for this recently approved funding for COVID-19 activity. Main Achievements with Detailed Results Transportation/Support of the DRSP and SDSP by providing supplies and expendable equipment IMPACT purchased and transported the following items: 2,226 washable protective masks, 3,800 hand towel rolls, 300 jerrycans 20L, 950 household gloves, 675 kg of soap powder, 180 mops, 83 garbage bins with pedal, 86 decontamination tanks, etc. from Antananarivo to the DRSP of Atsinanana, Vakinankaratra, Diana, Boeny, Haute Matsiatra and Atsimo Andrefana regions. These items were donations from IMPACT/USAID to the MOPH. Details per region are provided in Annex 1. IMPACT transported health commodities (300 tablets of Hydroxychloroquine, 180 tablets of Azytromicin 25mg, 300 magnesium B6 C, 39 boxes of surgical masks, 39 boxes of over blouses, etc.) from DRSP of Atsinanana to SDSP of Mahanoro and Vatomandry (details provided in the Annex 2). -

Air Photo Evidence of Historical Land Cover Change in the Highlands: Wetlands and Grasslands Give Way to Crops and Woodlots
MADAGASCAR CONSERVATION & DEVELOPMENT VOLUME 7 | ISSUE 3 — DECEMBER 2012 PAGE 144 ARTICLE http://dx.doi.org/10.4314/mcd.v7i3.7 Air photo evidence of historical land cover change in the highlands: Wetlands and grasslands give way to crops and woodlots Christian A. Kull Monash University Melbourne, Australia E - mail: Christian.Kull @ monash.edu ABSTRACT est les zones humides (les marécages), dont la superficie a Madagascar’s high plateau – where people farm, graze cattle, diminué de 60 pourcent. De plus, 37 pourcent de la superficie and set periodic fire in a grass dominated landscape – receives des forêts ripicoles ont disparu. Ces deux catégories de végé- disproportionately little conservation attention. An aerial photo- tation humide, qui sont représentées par des parcelles de faible graph-based analysis of land - cover change in the latter half of superficie distribuées le long du réseau hydrographique des the 20th century, based on a stratified random sample of twenty hautes terres, sont des habitats importants pour les écrevisses, eight sites, reveals dramatic trends associated with an increas- les amphibiens et d’autres éléments de la faune et de la flore. Ce ing human population that is building a cultural landscape of résultat suggère que les efforts de conservation sur les hautes villages and agro-ecosystems to assure its livelihoods. On aver- terres devraient se concentrer plus sur les zones ouvertes, les age across the sample sites, about 23 % of grassland areas zones humides et les forêts ripicoles qui subsistent, au lieu de present in 1949–1950 were converted to crops fields, farm trees se concentrer sur les îlots de forêt sempervirente (qui, dans and built - up areas by the 1990s. -

Land Rights Among Subsistence Farmers: an Examination of Madagascar’S Land Reform and Prevailing Systems of Land Tenure in Betafo Taylor Crowl SIT Study Abroad
SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad SIT Digital Collections Independent Study Project (ISP) Collection SIT Study Abroad Fall 2014 Land Rights Among Subsistence Farmers: An Examination of Madagascar’s Land Reform and Prevailing Systems of Land Tenure in Betafo Taylor Crowl SIT Study Abroad Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection Part of the Growth and Development Commons, Inequality and Stratification Commons, Natural Resources and Conservation Commons, Politics and Social Change Commons, Rural Sociology Commons, and the Urban Studies and Planning Commons Recommended Citation Crowl, Taylor, "Land Rights Among Subsistence Farmers: An Examination of Madagascar’s Land Reform and Prevailing Systems of Land Tenure in Betafo" (2014). Independent Study Project (ISP) Collection. 1896. https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/1896 This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please contact [email protected]. ! Land Rights Among Subsistence Farmers: An Examination of Madagascar’s Land Reform and Prevailing Systems of Land Tenure in Betafo ! ! ! ! Taylor Crowl Academic Advisor: Reine Razafimahefa Academic Director: Roland Pritchett Fall 2014 ! Abstract In Madagascar, legal systems of land tenure have been inaccessible for the vast majority of the rural population. This has stranded millions of subsistence farmers in a sense of insecurity, as they lack legal rights for the property that they have farmed for generations. Madagascar’s land reform, launched in 2005, attempted to change these exclusionary tenure practices. -

2015 Outcome Monitoring Survey (Oms) in the Usaid Intervention Zones in the South and South East Regions of Madagascar
2015 OUTCOME MONITORING SURVEY (OMS) IN THE USAID INTERVENTION ZONES IN THE SOUTH AND SOUTH EAST REGIONS OF MADAGASCAR FINAL REPORT April 2016 This publication was produced at the request of the United States Agency for International Development. It was prepared independently by BROOKESIA Madagascar and Consultant Associates Cabinets. PERFORMANCE EVALUATION: 2015 OUTCOME MONITORING SURVEY IN THE USAID INTERVENTION ZONES IN THE SOUTH AND SOUTH EAST OF MADAGASCAR 2 Acronym list ACT Artemisinin-Combination Therapy ANC AnteNatal Care ARI Acute Respiratory Infection BCC Behavior Change Communication BHC Basic Health Center CCDS Comité Communal pour le Développement de la Santé (Communal Committee for Health Development CHV Community Health Volunteer COF Completion of Field Work COR Contracting Officer’s Representative CSB Centre de Santé de Base CU5 Children under 5 years-old DMISC Data Management Information System Cards DPT Diphtheria, Pertussis and Tetanus FP/RH Family Planning/Reproductive Health HPN Health, Population and Nutrition HSS Health System Strengthening IEC Information Education and Communication INSTAT National Institute for Statistics IPC Inter-Personal Communication IPTp Intermittent Preventive Therapy for pregnant IRS Indoor Residual Spraying ISM Integrated Social Marketing project ITN Insecticide-Treated Nets LAM Lactational Amenorrhea Method LAMP Long Acting Permanent Method MCPR Modern Contraceptives Prevalence Rate MCH Maternal and Child Health MID Moustiquaire Impreignée Durable (Long Lasting Insecticide-Treated Nets) -

1407 Mandoto
dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 140701010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBARARATA dfggfdgffhCommune: MANDOTO dfggfdgffhDistrict: MANDOTO dfggfdgffhRegion: VAKINANKARATRA dfggfdgffhProvince: ANTANANARIVO Inscrits : 394 Votants: 198 Blancs et Nuls: 1 Soit: 0,51% Suffrages exprimes: 197 Soit: 99,49% Taux de participation: 50,25% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 55 27,92% 25 RAVALOMANANA Marc 142 72,08% Total voix: 197 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 140701030101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMPARIHY FENOMANANA dfggfdgffhCommune: MANDOTO dfggfdgffhDistrict: MANDOTO dfggfdgffhRegion: VAKINANKARATRA dfggfdgffhProvince: ANTANANARIVO Inscrits : 602 Votants: 306 Blancs et Nuls: 8 Soit: 2,61% Suffrages exprimes: 298 Soit: 97,39% Taux de participation: 50,83% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 73 24,50% 25 RAVALOMANANA Marc 225 75,50% Total voix: 298 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA