Etude D'impact Social Et Environnemental
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Physical, Mechanical, and Other Properties Of
ARC: 634.9 TA/OST 73-24 C559a PHYSICAL, MECHANICAL, AND OTHER PROPERTIES OF SELECTED SECONDARY SPECIES in Surinam, Peru, Colombia, Nigeria, Gabon, Philippines, and Malaysia FPL-AID-PASA TA(Aj)2-73 (Species Properties) * PHYSICAL, MECHANICAL, AND OTHER PROPERTIES OF SELECTED SECONDARY SPECIES LOCATED IN SURINAM, PERU, COLOMBIA, NIGERIA, GABON, PHILIPPINES, AND MALAYSIA MARTIN CHUDNOFF, Forest Products Technologist Forest Products Laboratory Forest Service, U.S. Department of Agriculture Madison, Wisconsin 53705 November 1973 Prepared for AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT U.S. Department of State Washington, DC 20523 ARC No. 634.9 - C 559a INTRODUCTION This report is a partial response to a Participating Agency Service Agreement between the Agency for Inter national Development and the USDA, Forest Service (PASA Control No. TA(AJ)2-73) and concerns a study of the factors influencing the utilization of the tropical forest resource. The purpose of this portion of the PASA obligation is to present previously published information on the tree and wood characteristics of selected secondary species growing m seven tropical countries. The format is concise and follows the outline developed for the second edition of the "Handbook of Hardwoods" published by HMSO, London. Species selected for review are well known in the source countries, but make up a very small component, if any, of their export trade. The reasons why these species play a secondary role in the timber harvest are discussed in the other accompanying PASA reports. ii INDEX Pages SURINAM 1-11 Audira spp. Eperu falcata Eschweilera spp. Micropholis guyanensis Nectandra spp. Ocotea spp. Parinari campestris Parinari excelsa Pouteria engleri Protium spp. -

Back Grou Di Formatio O the Co Servatio Status of Bubi Ga Ad We Ge Tree
BACK GROUD IFORMATIO O THE COSERVATIO STATUS OF BUBIGA AD WEGE TREE SPECIES I AFRICA COUTRIES Report prepared for the International Tropical Timber Organization (ITTO). by Dr Jean Lagarde BETTI, ITTO - CITES Project Africa Regional Coordinator, University of Douala, Cameroon Tel: 00 237 77 30 32 72 [email protected] June 2012 1 TABLE OF COTET TABLE OF CONTENT......................................................................................................... 2 ACKNOWLEDGEMENTS................................................................................................... 4 ABREVIATIONS ................................................................................................................. 5 ABSTRACT.......................................................................................................................... 6 0. INTRODUCTION ........................................................................................................10 I. MATERIAL AND METHOD...........................................................................................11 1.1. Study area..................................................................................................................11 1.2. Method ......................................................................................................................12 II. BIOLOGICAL DATA .....................................................................................................14 2.1. Distribution of Bubinga and Wengé species in Africa.................................................14 -

MUTENYE Page 1Of 4
MUTENYE Page 1of 4 Family: FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE (angiosperm) Scientific name(s): Guibourtia arnoldiana Commercial restriction: no commercial restriction WOOD DESCRIPTION LOG DESCRIPTION Color: brown Diameter: from 40 to 80 cm Sapwood: clearly demarcated Thickness of sapwood: from 5 to 8 cm Texture: fine Floats: no Grain: straight or interlocked Log durability: moderate (treatment recommended) Interlocked grain: slight Note: Heartwood yellowish brown to brown presenting a dark striping or reddish glints. PHYSICAL PROPERTIES MECHANICAL AND ACOUSTIC PROPERTIES Physical and mechanical properties are based on mature heartwood specimens. These properties can vary greatly depending on origin and growth conditions. Mean Std dev. Mean Std dev. Specific gravity *: 0,79 0,05 Crushing strength *: 79 MPa 10 MPa Monnin hardness *: 5,9 2,1 Static bending strength *: 138 MPa 14 MPa Coeff. of volumetric shrinkage: 0,56 % 0,06 % Modulus of elasticity *: 21250 MPa 4700 MPa Total tangential shrinkage (TS): 8,8 % 0,7 % Total radial shrinkage (RS): 5,0 % 0,6 % (*: at 12% moisture content, with 1 MPa = 1 N/mm²) TS/RS ratio: 1,8 Fiber saturation point: 27 % Musical quality factor: 123,4 measured at 2734 Hz Stability: moderately stable NATURAL DURABILITY AND TREATABILITY Fungi and termite resistance refers to end-uses under temperate climate. Except for special comments on sapwood, natural durability is based on mature heartwood. Sapwood must always be considered as non-durable against wood degrading agents. E.N. = Euro Norm Funghi (according to E.N. standards): class 3 - moderately durable Dry wood borers: durable - sapwood demarcated (risk limited to sapwood) Termites (according to E.N. standards): class M - moderately durable Treatability (according to E.N. -
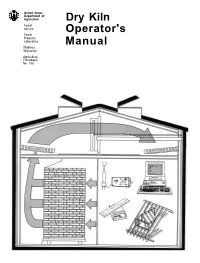
Dry Kiln Operator's Manual
United States Department of Agriculture Dry Kiln Forest Service Operator's Forest Products Laboratory Manual Madison, Wisconsin Agriculture Handbook No. 188 Dry Kiln Operator’s Manual Edited by William T. Simpson, Research Forest Products Technologist United States Department of Agriculture Forest Service Forest Products Laboratory 1 Madison, Wisconsin Revised August 1991 Agriculture Handbook 188 1The Forest Products Laboratory is maintained in cooperation with the University of Wisconsin. This publication reports research involving pesticides. It does not contain recommendations for their use, nor does it imply that the uses discussed here have been registered. All uses of pesticides must be registered by appropriate State and/or Federal agencies before they can be recommended. CAUTION, Pesticides can be injurious to humans, domestic animals, desirable plants, and fish or other wildlife-if they are not handled or applied properly. Use all pesticides selectively and carefully. Follow recommended practices for the disposal of surplus pesticides aand pesticide containers. Preface Acknowledgments The purpose of this manual is to describe both the ba- Many people helped in the revision. We visited many sic and practical aspects of kiln drying lumber. The mills to make sure we understood current and develop- manual is intended for several types of audiences. ing kiln-drying technology as practiced in industry, and First and foremost, it is a practical guide for the kiln we thank all the people who allowed us to visit. Pro- operator-a reference manual to turn to when questions fessor John L. Hill of the University of New Hampshire arise. It is also intended for mill managers, so that they provided the background for the section of chapter 6 can see the importance and complexity of lumber dry- on the statistical basis for kiln samples. -

Fplgtr113.Pdf
Abstract Summarizes information on wood as an engineering material. Presents properties of wood and wood-based products of particular concern to the architect and engineer. Includes discussion of designing with wood and wood-based products along with some pertinent uses. Keywords: wood structure, physical properties (wood), mechanical properties (wood), lumber, wood-based composites, plywood, panel products, design, fastenings, wood moisture, drying, gluing, fire resistance, finishing, decay, sandwich construction, preservation, and wood- based products On the cover: (Left to right, top to bottom) 1. Research at the Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin, contributes to maximizing benefits of the Nation’s timber resource. 2. Testing the behavior of wood in fire helps enhance fire safety. 3. The all-wood, 162-m (530-ft ) clear-span Tacoma Dome exemplifies the structural and esthetic potential of wood construction (photo courtesy of Western Wood Structures, Inc., Tualatin, Oregon). 4. Bending tests are commonly used to determine the engineering properties of wood. 5. Engineered wood trusses exemplify research that has led to more efficient use of wood. 6. The Teal River stress-laminated deck bridge is March 1999 located in Sawyer County, Wisconsin. 7. Kiln drying of wood is an important procedure Forest Products Laboratory. 1999. Wood handbook—Wood as an during lumber manufacturing. engineering material. Gen. Tech. Rep. FPL–GTR–113. Madison, WI: 8. Legging adhesive (photo courtesy of Air Products U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products and Chemicals, Inc., Allentown Pennsylvania). Laboratory. 463 p. Adhesive bonding is a critical component in the A limited number of free copies of this publication are available to the performance of many wood products. -

Actuele Houtmonstervoorraad Juni 2021
ltr Nr. Ltr Botanische namen Handels- en boomnamen Familie Prijs (EUR) Info A 1 Taxus baccata L. Taxus Taxaceae 2,25 5 A 1 B Taxus baccata L. Taxus Taxaceae 2,25 0 A 2 Abies alba Mill. Dennen, Duits Pinaceae 2,25 32 A 3 Tetragastris sp. / Protium sp. oa. T.hostmannii Salie Burseraceae 2,25 0 A 4 A Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britton Douglas, inlands Pinaceae 2,25 8 A 5 Picea abies (L.) H.Karst. Vuren, inlands Pinaceae 2,25 0 A 6 Picea abies (L.) H.Karst. Vuren, Duits Pinaceae 2,25 0 A 7 Picea abies (L.) H.Karst. Vuren, Fins Pinaceae 2,25 0 A 8 Picea abies (L.) H.Karst. Vuren, Noors Pinaceae 2,25 21 A 9 Picea spec.div. Vuren, Zweeds Pinaceae 2,25 1 A 10 Larix sp. Larix Pinaceae 2,25 0 A 10 A Larix sp. Larix Pinaceae 2,25 0 A 11 Pinus sylvestris L. Grenen, inlands Pinaceae 2,25 1 A 12 Pinus sylvestris L. Grenen, Duits Pinaceae 2,25 0 A 13 Pinus sylvestris L. Grenen, Fins Pinaceae 2,25 0 A 14 Pinus sylvestris L. Grenen, Noors Pinaceae 2,25 0 A 15 Pinus sylvestris L. Grenen, Zweeds Pinaceae 2,25 1 A 16 Pinus pinaster Aiton Grenen, Frans Pinaceae 2,25 0 A 17 Pinus nigra J.F.Arnold Grenen / Oostenrijkse den Pinaceae 2,25 0 A 18 Pinus nigra subsp. Laricio Maire Grenen / Corsicaanse den Pinaceae 2,25 18 A 19 A Pinus strobus L. Weymouth den Pinaceae 2,25 8 A 20 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. -

Evolution Et Adaptation Fonctionnelle Des Arbres Tropicaux : Le Cas Du Genre Guibourtia Benn
EVOLUTION ET ADAPTATION FONCTIONNELLE DES ARBRES TROPICAUX : LE CAS DU GENRE GUIBOURTIA BENN. FELICIEN TOSSO COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE UNIVERSITE DE LIEGE – GEMBLOUX AGRO-BIO TECH EVOLUTION ET ADAPTATION FONCTIONNELLE DES ARBRES TROPICAUX : LE CAS DU GENRE GUIBOURTIA BENN. Dji-ndé Félicien TOSSO Dissertation originale présentée en vue de l’obtention du grade de docteur en sciences agronomiques et ingénierie biologique Co-Promoteurs : Prof. Jean-Louis Doucet et Dr. Olivier J. Hardy Année 2018 Copyright Cette œuvre est sous licence Creative Commons. Vous êtes libre de reproduire, de modifier, de distribuer et de communiquer cette création au public selon les conditions suivantes : - paternité (BY) : vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'œuvre) ; - pas d'utilisation commerciale (NC) : vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales ; - partage des conditions initiales à l'identique (SA) : si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique à celui-ci. À chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaitre clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette œuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l’auteur. -

NAMIBIAN INDIGENOUS FOREST/TIMBER INDUSTRY with REFERENCE to ZAMBIA and ANGOLA Karen Nott , Amber Nott, David Newton
NOVEMBER 2019 A CRITICAL ASSESSMENT OF THE ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF THE NAMIBIAN INDIGENOUS FOREST/TIMBER INDUSTRY WITH REFERENCE TO ZAMBIA AND ANGOLA Karen Nott , Amber Nott, David Newton Product of the first research portfolio of TRAFFIC REPORT A Critical Assessment of the Economic and Environmental Sustainability of the Namibian Indigenous Forest/ Timber Industry with Reference to Zambia and Angola TRAFFIC is a leading non-governmental organisation working globally on trade in wild animals and plants in the context of both biodiversity conservation and sustainable development. Reprod uction of material appearing in this report requires written permission from the publisher. The views of the authors expressed in this publication do not necessarily reflect those of the organisations contributing to this report. The designation of geographical entities in this publication and the presentation of the material do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of contributing organisations concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Suggested citation: Nott, K., Nott, A. and Newton, D. (2019). A Critical Assessment of the Economic and Environmental Sustainability of the Namibian Indigenous Forest/ Timber Industry with Reference to Zambia and Angola. TRAFFIC, Southern Africa Programme Office, Pretoria. Product of the first research portfolio of SASSCAL SASSCAL 2012-2018 Published by: TRAFFIC, Southern -

Automated Classification of Wood Transverse Cross-Section Micro-Imagery from 77 Commercial Central-African Timber Species Núbia Rosa Da Silva, Maaike De Ridder, Jan M
Automated classification of wood transverse cross-section micro-imagery from 77 commercial Central-African timber species Núbia Rosa da Silva, Maaike de Ridder, Jan M. Baetens, Jan van den Bulcke, Mélissa Rousseau, Odemir Martinez Bruno, Hans Beeckman, Joris van Acker, Bernard de Baets To cite this version: Núbia Rosa da Silva, Maaike de Ridder, Jan M. Baetens, Jan van den Bulcke, Mélissa Rousseau, et al.. Automated classification of wood transverse cross-section micro-imagery from 77 commercial Central-African timber species. Annals of Forest Science, Springer Nature (since 2011)/EDP Science (until 2010), 2017, 74 (2), pp.30. 10.1007/s13595-017-0619-0. hal-02976526 HAL Id: hal-02976526 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02976526 Submitted on 23 Oct 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Annals of Forest Science (2017) 74: 30 DOI 10.1007/s13595-017-0619-0 ORIGINAL PAPER Automated classification of wood transverse cross-section micro-imagery from 77 commercial Central-African timber species NubiaRosadaSilva´ 1,2,3 · Maaike De Ridder4,5 -

Chapter 1 Properties of Wood Related to Drying
Chapter 1 Properties of Wood Related to Drying Commercial wood species 1 Lumber drying is one of the most time- and energy- Hardwoods and softwoods 2 consuming steps in processing wood products. The Structural features of wood 2 anatomical structure of wood limits how rapidly wa- Sapwood and heartwood 4 ter can move through and out of wood. In addition, Pith 4 the sensitivity of the structure to stresses set up in dry- Annual growth rings 4 ing limits the drying rate; rapid drying causes defects Wood rays 4 such as surface and internal checks, collapse, splits, Grain and texture 5 and warp. Drying time and susceptibility to many dry- Color 5 ing defects increase at a rate that is more than pro- Variations in structure 5 portional to wood thickness. The variability of wood Commercial lumber grades 6 properties further complicates drying. Each species has Hardwood lumber grades 6 different properties, and even within species, variability Softwood lumber grades 6 in drying rate and sensitivity to drying defects impose Wood-moisture relations 7 limitations on the development of standard drying pro- Free and bound water 8 cedures. The interactions of wood, water, heat, and Fiber saturation point 8 stress during drying are complex. The purpose of this Equilibrium moisture content 8 chapter is to describe some of the fundamental prop- How wood dries 9 erties of wood that are relevant to lumber drying. We Forces that move water 9 will discuss commercial wood species, wood structure, Factors that influence drying rate 10 lumber grades, water movement in wood, how wood Lumber thickness 10 dries, specific gravity and weight of wood, wood shrink- Specific gravity and weight of wood 10 age, stress development during drying, and electrical Shrinkage of wood 11 and thermal properties of wood. -

Microsatellite Development for the Genus Guibourtia (Fabaceae, Caesalpinioideae) Reveals Diploid and Polyploid Species1
Applications in Plant Sciences 2016 4(7): 1600029 Applications in Plant Sciences PRIMER NOTE MICROSATELLITE DEVELOPMENT FOR THE GENUS GUIBOURTIA (FABACEAE, CAESALPINIOIDEAE) REVEALS DIPLOID AND 1 POLYPLOID SPECIES FELICIEN TOSSO2,7, JEAN-LOUIS DOUCET2, ESRA KAYMAK3, KASSO DAÏNOU2,4, JÉRÔME DUMINIL3,5,6, And OLIVIER J. HARDY3 2Tropical Forestry, Management of Forest Resources, TERRA, Gembloux Agro-Bio Tech, University of Liège, 2 Passage des Déportés, B-5030 Gembloux, Belgium; 3Evolutionary Biology and Ecology Unit, CP 160/12, Faculté des Sciences, Université Libre de Bruxelles, Av. F. D. Roosevelt 50, B-1050 Brussels, Belgium; 4Nature+ asbl, Rue Provinciale 62, 1301 Wavre, Belgium; 5Bioversity International, Forest Genetic Resources Programme, Sub-Regional Office for Central Africa, P.O. Box 2008, Messa, Yaoundé, Cameroon; and 6Institut de Recherche pour le Développement, UMR-DIADE, BP 64501, 34394 Montpellier, France • Premise of the study: Nuclear microsatellites (nSSRs) were designed for Guibourtia tessmannii (Fabaceae, Caesalpinioideae), a highly exploited African timber tree, to study population genetic structure and gene flow. • Methods and Results: We developed 16 polymorphic nSSRs from a genomic library tested in three populations of G. tessmannii and two populations of G. coleosperma. These nSSRs display three to 14 alleles per locus (mean 8.94) in G. tessmannii. Cross- amplification tests in nine congeneric species demonstrated that the genus Guibourtia contains diploid and polyploid species. Flow cytometry results combined with nSSR profiles suggest that G. tessmannii is octoploid. • Conclusions: nSSRs revealed that African Guibourtia species include both diploid and polyploid species. These markers will provide information on the mating system, patterns of gene flow, and genetic structure of African Guibourtia species. -

Cop17 Prop. 56
Idioma original: francés CoP17 Prop. 56 CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES ____________________ Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes Johannesburgo (Sudáfrica), 24 de septiembre – 5 de octubre de 2016 EXAMEN DE LAS PROPUESTAS DE ENMIENDA A LOS APÉNDICES I Y II A. Propuesta Inscribir Guibourtia tessmannii en el Apéndice II de la CITES de conformidad con el Artículo II, párrafo 2 a), de la Convención, y la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16), Anexo 2 a, párrafo B. Inscribir Guibourtia pellegriniana en el Apéndice II de la CITES de conformidad con el Artículo II, párrafo 2 a), de la Convención, y la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16), Anexo 2 a, párrafo B. Inscribir Guibourtia demeusei por razones de semejanza en el Apéndice II de la CITES de conformidad con el Artículo II, párrafo 2 b), de la Convención, y la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16), Anexo 2 b, párrafo A. Anotación (1) #4 Todas las partes y derivados, excepto: a) las semillas (inclusive las vainas de Orchidaceae), las esporas y el polen (inclusive las polinias). La exención no se aplica a las semillas de Cactaceae spp. exportadas de México y las semillas de Beccariophoenix madagascariensis y Neodypsis decaryi exportadas de Madagascar; b) los cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles; c) las flores cortadas de plantas reproducidas artificialmente; d) los frutos, y sus partes y derivados, de plantas naturalizadas o reproducidas artificialmente del género Vanilla (Orchidaceae) y de la familia Cactaceae; e) los tallos, las flores, y sus partes y derivados, de plantas naturalizadas o reproducidas artificialmente de los géneros Opuntia subgénero Opuntia y Selenicereus (Cactaceae); y f) los productos acabados de Euphorbia antisyphilitica empaquetados y preparados para el comercio al por menor.