Anatole Romaniuk LE CONGO DE MA JEUNESSE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

William Brass 1921–1999
WILLIAM BRASS Copyright © The British Academy 2001 – all rights reserved William Brass 1921–1999 PROFESSOR WILLIAM BRASS, who died on 11 November 1999, was a demographer, statistician, and mathematician of great distinction. He made important contributions to knowledge in many fields, but is best known for his development of a body of analytical techniques for the esti- mation of fertility and mortality rates in countries lacking comprehensive systems of birth and death registration, and where data collected in censuses and surveys are liable to be severely biased by response errors. Such was the importance of his contribution to this field that the tech- niques were often described as ‘Brass methods’. They have also been labelled ‘indirect’, because many of them derive indices from questions and data only obliquely related to the desired measure. A good example, which will be further discussed below, is the estimation of life table prob- abilities of survival for adults from questions on whether persons’ fathers and mothers are still alive, generally called the ‘orphanhood’ method. This memoir will attempt to outline Bill Brass’s principal contributions to this field; the review will be very far from exhaustive and no attempt is made to describe his contributions in other areas of demography and statistics1. But the importance of his work is reflected in the fact that the figures, published regularly by the United Nations and other bodies, of the numbers of people living on this planet have been compiled largely with the help of the methods which he devised. 1 A complete bibliography of his published works may be obtained from the Centre for Popula- tion Studies, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 49–51 Bedford Square, London WC1B 3DP. -

Spring 2012 Message from the President As the Canadian
CPS Newsletter, Spring 2012 Volume 37 (3), Spring 2012 Message from the President As the Canadian Population Society’s 2012 annual meetings near, I want to take this opportunity to thank CPS members for the honor and privilege of serving as CPS President for the past two years. It has been a very productive two years for the CPS, with successful annual meetings in Fredericton, New Brunswick, last year, and the upcoming meetings in Kitchener- Waterloo. CPS members have also been very active with research, teaching, and travel to international professional meetings. INSIDE THIS ISSUE: President’s Message 1 In the News 11 Our Journal (CSP) 3 Feature Interview 12 Cluster News 5 Member Updates 15 Student News 7 Obituary 17 Stats Can Update 8 New Publications 18 Notices 9 CPS People 21 Thanks to CPS Members The President’s Message is always the time to recognize CPS members whose hard work has ensured that the CPS does its work and serves its members. I begin by thanking the officers of the society, many of whom will be stepping down this summer. I would like to thank Eric Fong (who has served as Vice-President), Laurie Goldmann (who has served as Secretary-Treasurer), Council members Jenna Hennebry, Feng Hou, Don Kerr, Jianye Liu, Anne Milan, and Zenaida Ravanera, and student representative Stacey Hallman. 1 | P a g e CPS Newsletter, Spring 2012 I also thank members who have helped by serving as CPS representatives to other organizations, including Alain Gagnon to the Federation of Canadian Demographers and Margaret Michalowski to the Canadian Federation of Humanities and Social Sciences. -

African Population History: Contributions of Moral Demography
The Journal of African History (2021), 62(2), 183–200 doi:10.1017/S002185372100044X FORUM CONTRIBUTION African Population History: Contributions of Moral Demography Sarah Walters* London School of Hygiene and Tropical Medicine *Corresponding author. E-mail: [email protected] (Received 6 April 2021; revised 2 July 2021; accepted 2 July 2021) Abstract Improving knowledge about African historical demography is essential to addressing current population trends and achieving deeper understanding of social, economic, and political change in the past and present. I use census and parish register data from Tanganyika to address the origins of twentieth-century population growth, to describe how major changes in fertility and child mortality began in the 1940s, and to emphasise the significance of the large rise in fertility between the 1940s and 1970s. Through this work and my wider survey of parish registers in Malawi, Uganda, Tanzania, and Zambia, I consider the relation- ships between power, evidence, and meaning in these data sources. Alongside the macro gaps in Africa’s population history are significant microsilences — lacunae in the sources and data which reflect the hegemonic structures within which they were produced. I suggest a moral demography approach to their analysis, borrowing from the reflexive and dialectic method found in studies of moral economy. Keywords: Africa; Tanzania; demography; quantitative sources; reproduction; family; fertility The population of Africa is projected to grow tenfold between 1960 and 2050, -

African Population History: Contributions of Moral Demography
The Journal of African History (2021), 62(2), 183–200 doi:10.1017/S002185372100044X FORUM CONTRIBUTION African Population History: Contributions of Moral Demography Sarah Walters* London School of Hygiene and Tropical Medicine *Corresponding author. E-mail: [email protected] (Received 6 April 2021; revised 2 July 2021; accepted 2 July 2021) Abstract Improving knowledge about African historical demography is essential to addressing current population trends and achieving deeper understanding of social, economic, and political change in the past and present. I use census and parish register data from Tanganyika to address the origins of twentieth-century population growth, to describe how major changes in fertility and child mortality began in the 1940s, and to emphasise the significance of the large rise in fertility between the 1940s and 1970s. Through this work and my wider survey of parish registers in Malawi, Uganda, Tanzania, and Zambia, I consider the relation- ships between power, evidence, and meaning in these data sources. Alongside the macro gaps in Africa’s population history are significant microsilences — lacunae in the sources and data which reflect the hegemonic structures within which they were produced. I suggest a moral demography approach to their analysis, borrowing from the reflexive and dialectic method found in studies of moral economy. Keywords: Africa; Tanzania; demography; quantitative sources; reproduction; family; fertility The population of Africa is projected to grow tenfold between 1960 and 2050, -

The Ukrainian Weekly 2006, No.15
www.ukrweekly.com INSIDE:• More on the results of Ukraine’s elections — page 3. • “An unidentified guest” and our family collections — page 7. • Special pullout: Ukrainian Debutante Balls — pages 13-16. Published by the Ukrainian National Association Inc., a fraternal non-profit association Vol. LXXIV HE KRAINIANNo. 15 THE UKRAINIAN WEEKLY SUNDAY, APRIL 9, 2006 EEKLY$1/$2 in Ukraine Tymoshenko and Moroz say Our Ukraine VerkhovnaT RadaU rejects calls W for complete recount of elections is backing out of forming Orange coalition by Zenon Zawada the whole system and how it subjugated by Zenon Zawada Ms. Tymoshenko added. Kyiv Press Bureau it today,” Mr. Symonenko said. Kyiv Press Bureau “I absolutely know that these boys, Outside the Parliament, more than 300 who did a lot toward ruining the hopes of KYIV – Ukraine’s Verkhovna Rada on protesters from all over Ukraine waved KYIV – Orange Revolution leaders the Orange Revolution, would rather eat April 4 rejected a recount of the parlia- the flags of losing political parties and Yulia Tymoshenko and Oleksander their hands than sign a memorandum in mentary elections, ignoring protests from voiced their complaints over what they Moroz accused Our Ukraine’s leadership which our political force has the right to politicians and their supporters who viewed as fraudulent elections. of trying to back out of forming an form the government,” Ms. Tymoshenko alleged that millions of ballots weren’t Leading the protests were Inna Orange coalition in the newly elected said. counted properly and that the elections Bohoslovska, leader of the Viche Party, Verkhovna Rada. Our Ukraine will not discuss distribut- were once again intentionally falsified. -

World Bank Document
PHN Technical Note 85-8 Public Disclosure Authorized DEVZLOPI%E-T CONSEQUENCES OF RAPID POPULATION GROWJT: Public Disclosure Authorized A REVIEW FROM TEE PERSPECTIVE OF SMB-SAHARAN AP:RICA by Susan H. Cochraae Public Disclosure Authorized July 1985 Population, Health and Nutrition DepartLment World Bank IThe World Bank does not accept responsibility for the views expressed herein which are those of the author(s) and should not be attributed to the World Bank or to i ts affiliated crganizations. The findings, interpretations, and coclusiolns are the restults of research supported by the Bank; they do not Public Disclosure Authorized necessarily repr:esent offi cial policy of -he Bank. The designations employed,t the preseatation of material, and any maps used in this document are solely ror the convenience of the reader and do not imply the expression of any opinion whlatsoever on the part of the World Bank or its af f iliates concerning the legal status of any country, territory, city, area, or of its authorities, or concernaing the delimitations of its boundaries, or national affiliation, PHN Technical Note 85-8 DEVELOPMENT CONSEQUENCES OF RAPID POPULATION GROWTH: A REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF SUB-SAHARAN AFRICA A B S T R A C T The purpose of this paper is to review Africans' perceptions of the relationship between population growth and economic development in sub-Saharan Africa. Even in the late 1960s there existed some concern for the negative consequences of population growth, but there also existed anger and frustration with simplistic visions of the role of population in economic development. -

The Ukrainian Weekly 1996, No.52
www.ukrweekly.com INSIDE:• “1996: THE YEAR IN REVIEW” — beginning on page 3. Published by the Ukrainian National Association Inc., a fraternal non-profit association Vol. LXIV HE No.KRAINIAN 52 THE UKRAINIAN WEEKLY SUNDAY, DECEMBER 29, 1996 EEKLY$1.25/$2 in Ukraine T U Kuchma appointsW new chief of staff, The state of Ukraine’s military a centrist leader and mayor of Kharkiv takes center stage in official circles by Marta Kolomayets lytical support to the president. by Marta Kolomayets brass gathered at the Collegium, the Special to The Ukrainian Weekly On December 18, 316 deputies appealed Special to The Ukrainian Weekly Defense Ministry’s headquarters: “I have to President Kuchma to cancel his decrees listened to explanations regarding the KYIV — Yevhen Kushnariov, mayor of on powers of the presidential administra- KYIV — Fifty-seven percent of chaos in Ukraine’s armed forces today, Kharkiv, was appointed President Leonid tion and restructuring the Cabinet, and Ukraine’s military officers do not think and I have stretched my limits to accept Kuchma’s chief of staff on December 20, making the interior, foreign, defense and the nation’s armed forces are capable of what I have been told. But, when we start just 10 days after the Ukrainian leader information ministers directly subordinate defending its territorial integrity and talking about discipline, I will not accept sacked his longtime aide and administration to the president on issues related to the independence. any excuses, nor do I want to hear any chairman Dmytro Tabachnyk. president’s constitutional powers. Only 30 percent of the 1,000 officers excuses. -
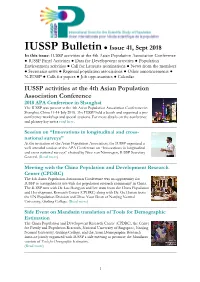
Printable PDF Version
IUSSP Bulletin ● Issue 41, Sept 2018 In this issue: IUSSP activities at the 4th Asian Population Association Conference ● IUSSP Panel Activities ● Data for Development activities ● Population Environment activities ● Call for Laureate nominations ● News from the members ● Secretariat news ● Regional population associations ● Other announcements ● N-IUSSP ● Calls for papers ● Job opportunities ● Calendar IUSSP activities at the 4th Asian Population Association Conference 2018 APA Conference in Shanghai The IUSSP was present at the 4th Asian Population Association Conference in Shanghai, China 11-14 July 2018. The IUSSP held a booth and organized a pre- conference workshop and special sessions. For more details on the conference and plenary key notes read here. Session on “Innovations in longitudinal and cross- national surveys” At the invitation of the Asian Population Association, the IUSSP organized a well-attended session at the APA Conference on “Innovations in longitudinal and cross-national surveys” chaired by Nico van Nimwegen, IUSSP Secretary General. (Read more) Meeting with the China Population and Development Research Center (CPDRC) The 4th Asian Population Association Conference was an opportunity for IUSSP to strengthen its ties with the population research community in China. The IUSSP met with Dr. Liu Hongyan and her team from the China Population and Development Research Center (CPDRC) along with Dr. Gu Danan from the UN Population Division and Zhao Yuan Dean of Nanjing Normal University, Ginling College. (Read more) Side Event on Mandarin translation of Tools for Demographic Estimation The China Population and Development Research Center (CPDRC), the Centre for Family and Population Research, National University of Singapore, Nanjing Normal University, Ginling College, and the Asian Demographic Research Institute jointly organized with IUSSP a side meeting to promote the Mandarin version of Tools for Demographic Estimation. -

Download (PDF)
The Canadian Studies Collection La Collection en études canadiennes ABORIGINAL STUDIES | ÉTUDES AUTOCHTONES #IdleNoMore Approaches to Aboriginal Education And the Remaking of Canada in Canada Ken Coates Searching for Solutions University of Regina Press Frances Widdowson and Albert Howard, eds. English 6 x 9 204 pages Brush Education 2015 Paperback C$27.95 English 6 x 9 456 pages 9780889773424 2013 Softcover C$39.95 2015 ePub C$17.95 9781550594560 9780889773431 2013 ePub C$29.99 2015 PDF C$27.95 9781550594577 9780889773448 2013 PDF C$29.99 PDF available through the Canadian Electronic 9781550594768 Library 2013 MOBI C$29.99 9781550594775 Aboriginal Populations Social, Demographic, and Epidemiological Becoming Inummarik Perspectives Men’s Lives in an Inuit Community Frank Trovato and Anatole Romaniuk, eds. Peter Collings University of Alberta Press McGill-Queen’s University Press English 6 x 9 600 pages English 6 x 9 424 pages 2014 Paperback C$60 2014 Cloth C$100 9780888646255 9780773543126 2014 PDF C$47.99 2014 Paperback C$32.95 9781772120325 9780773543133 2014 ePub C$32.95 9780773590335 An Act of Genocide 2014 PDF C$32.95 Colonialism and the Sterilization 9780773590328 of Aboriginal Women Karen Stote Bringing Home Animals, Fernwood Publishing Second Edition English 6 x 9 192 pages 2015 Paperback C$22.95 Mistissini Hunters of Northern Quebec 9781552667323 Adrian Tanner 2015 ePub C$22.95 ISER Books 9781552667545 English 6 x 9 368 pages 2014 Paperback C$24.95 9781894725149 2015 Clearing the Plains History and Renewal of Labrador’s Disease, Politics of Starvation, and the Loss Inuit-Métis of Aboriginal Life John C. -

BSPS Editor: Dr Melanie Channon News the British Society for Population Studies Newsletter Welcome to Winchester
Issue 126 Sep 2018 British Society for Population Studies BSPS Editor: Dr Melanie Channon News The British Society for Population Studies Newsletter Welcome to Winchester Welcome to the ology, pedagogical sciences, demography, and devel- 2018 conference opmental psychology. Central to her work is the ap- edition of the plication of the theory-based life course approach to BSPS newsletter, the behavior and well-being of individuals, and which finds us (extended) families. back in Winches- ter again. An PROFESSOR DANNY DORLING (University of Oxford): especially warm Linking mortality to the past - solving the geograph- welcome to our ical problems. Professor Dorling’s work concerns is- Dutch colleagues sues of housing, health, employment, education and joining us this poverty. If you’re interested in his work take a look year! The Neth- at his website: http://www.dannydorling.org/ erland Demo- graphic Society In other news, after two sterling years it is time for (NVD) Have orga- Alina, our wonderful postgrad rep, to step down. She nized two ses- has been a true asset to BSPS and a great support in sions in the pro- putting together the newsletter. Thank you Alina and gramme and we I know you’ll go on to do great things! In the next Winchester College have a Dutch plenary speaker. newsletter we’ll be welcoming our new postgrad rep: Alyce Raybould. Please remem- ber that the AGM will take place during the Confer- As always do let me know if you have any suggestions ence (11th Sep at 7.20pm) so please attend if you are for the newsletter. -

Interview with Ansley J. Coale PAA President in 1967-68
DEMOGRAPHIC DESTINIES Interviews with Presidents of the Population Association of America Interview with Ansley J. Coale PAA President in 1967-68 This series of interviews with Past PAA Presidents was initiated by Anders Lunde (PAA Historian, 1973 to 1982) And continued by Jean van der Tak (PAA Historian, 1982 to 1994) And then by John R. Weeks (PAA Historian, 1994 to present) With the collaboration of the following members of the PAA History Committee: David Heer (2004 to 2007), Paul Demeny (2004 to 2012), Dennis Hodgson (2004 to present), Deborah McFarlane (2004 to 2018), Karen Hardee (2010 to present), Emily Merchant (2016 to present), and Win Brown (2018 to present) ANSLEY J. COALE PAA President in 1967-68 (No. 31). Interview with Jean van der Tak in Dr. Coale's office at the Office of Population Research, Princeton University, May 11, 1988, with excerpts from Dr. Coale's interview with Anders Lunde during the PAA annual meeting in Philadelphia, April 27, 1979. CAREER HIGHLIGHTS: Ansley Coale was born in Baltimore, Maryland in 1917. Except for four years during and after World War II, he has spent all of his career at Princeton University, beginning as an undergraduate. From Princeton he received the B.A. in 1939, the M.A. in 1941, and the Ph.D. in 1947, all in economics. He has also received honorary degrees from the University of Pennsylvania and the Universities of Liege and Louvain in Belgium. From 1947 to 1954, he was Assistant Professor of Economics at Princeton, before returning to demography and the Office of Population Research, where he had been the second Milbank Memorial Fund Fellow and a research assistant before his wartime service. -

Biographical Lexicon of Public Health Aa LIBRARY of BIOMEDICAL PUBLICATIONS Book 49
IZET MASIC Biographical Lexicon of Public Health Aa LIBRARY OF BIOMEDICAL PUBLICATIONS Book 49 Author: Prof Izet Masic, MD, PhD Faculty of medicine, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Reviewers: Prof Doncho Donev, MD, PhD University of Skopje, Skopje, Republic of Macedonia Prof Enver Roshi, MD, PhD Faculty of Public Health, Tirana, Albania Prof Naser Ramadani, MD, PhD Public Health Institute, University of Prishtina, Republic of Kosova Prof Francis Roger France, MD, PhD University of Louvain, Louvain, Belgium Technical editor: Mirza Hamzic, dipl. oec. CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 614.2:929](031) MAŠIĆ, Izet Biographical lexicon of public health / Izet Masic. - Sarajevo : “Avicena”, 2015. - 410 pages. : fotogr. ; 25 cm. - (Library of biomedical publications ; book 49) Bibliography: pages. 401-405. ISBN 978-9958-720-60-4 I. Masic, Izet vidi Mašić, Izet COBISS.BH-ID 22302982 Published by: AVICENA, d.o.o., Sarajevo Printed by: Stamparija Fojnica, d.o.o., Fojnica Index A Natasha 37 Beral Valerie 56 Berger Berger 55 Aaltonen Pamela 23 B Berman Peter 56 Achebe Kechi 23 Babich Marie Suzanne 39 Berry M. Elliot 57 Acheson Donald 24 Babic Momcilo 40 Besser Richard 57 Adams Evan 25 Baccarelli Andrea 40 Bethel Ann Lynn 58 Ádány Róza 24 Backett Maurice 41 Bettiol Silvana 58 Adeniran Gbemi 25 Badr Elsiddig Elsheikh 41 Beutels Philippe 59 Adshead Fiona 25 Baillie Tam 42 Beveridge William 59 Agutu Sam 26 Bambra Clare 42 Bhopal Raj 60 Agyemang Charles 26 Banks Douglas 43 Bialecki Gregory 60 Akinwalon Melissa 27 Banks Frank 44 Birnbaum S. Linda 60 Alafia Samuels Thelma 29 Banks Ian 44 Birt A.