Tome 71 – 2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
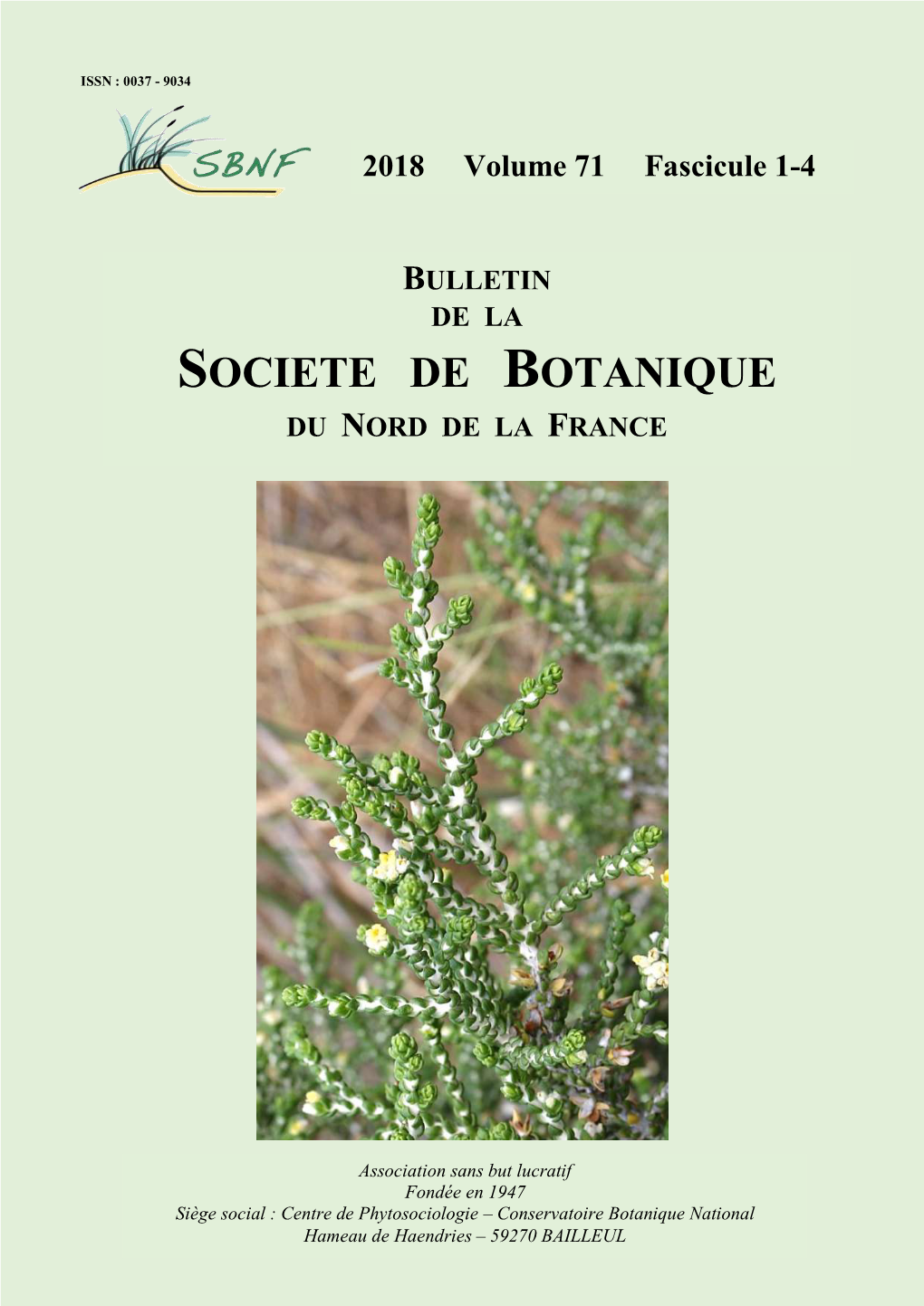
Load more
Recommended publications
-

Papp Et Al Taxnotes.Indd
DOI: 10.17110/StudBot.2016.47.1.179 Studia bot. hung. 47(1), pp. 179–191, 2016 TAXONOMICAL AND CHOROLOGICAL NOTES 2 (20–27) Viktor Papp1, Gergely Király2, János Koscsó3, Ákos Malatinszky4, Timea Nagy5, Attila Takács6 and Bálint Dima7,8 1Department of Botany and Soroksár Botanical Garden, Corvinus University of Budapest, H–1518 Budapest, Pf. 53, Hungary; [email protected] 2Institute of Silviculture and Forest Protection, University of West Hungary, H–9400 Sopron, Ady E. u. 5, Hungary; [email protected] 3H–3529 Miskolc, Sályi I. u. 16, Hungary; [email protected] 4Institute of Nature Conservation and Landscape Management, Szent István University, H–2103 Gödöllő, Páter K. u. 1, Hungary; [email protected] 5Department of Plant Sciences and Biotechnology, University of Pannonia, H–8360 Keszthely, Festetics u. 7, Hungary; [email protected] 6Department of Botany, University of Debrecen, H–4032 Debrecen, Egyetem tér 1, Hungary; [email protected] 7Plant Biology, Department of Biosciences, University of Helsinki, P. O. Box 65, 00014 Helsinki, Finland; [email protected] 8Department of Plant Anatomy, Institute of Biology, Eötvös Loránd University, H–1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, Hungary; [email protected] Papp, V., Király, G., Koscsó, J., Malatinszky, Á., Nagy, T., Takács, A. & Dima, B. (2016): Taxonomi- cal and chorological notes 2 (20–27). – Studia bot. hung. 47(1): 179–191. Abstract: Th e second part of the recently launched series includes miscellaneous new records from fungi to vascular plants. New chorological records of fi ve taxa of fungi are provided here: two new for Hungary (Entoloma tjallingiorum and Mycoacia nothofagi), one (Hohenbuehelia mastrucata) new for the Vértes and Börzsöny Mts, additional records and confi rmations for two taxa (Entoloma lampropus and Hohenbuehelia atrocoerulea) are also provided. -

Rubiaceae) in Africa and Madagascar
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Springer - Publisher Connector Plant Syst Evol (2010) 285:51–64 DOI 10.1007/s00606-009-0255-8 ORIGINAL ARTICLE Adaptive radiation in Coffea subgenus Coffea L. (Rubiaceae) in Africa and Madagascar Franc¸ois Anthony • Leandro E. C. Diniz • Marie-Christine Combes • Philippe Lashermes Received: 31 July 2009 / Accepted: 28 December 2009 / Published online: 5 March 2010 Ó The Author(s) 2010. This article is published with open access at Springerlink.com Abstract Phylogeographic analysis of the Coffea subge- biogeographic differentiation of coffee species, but they nus Coffea was performed using data on plastid DNA were not congruent with morphological and biochemical sequences and interpreted in relation to biogeographic data classifications, or with the capacity to grow in specific on African rain forest flora. Parsimony and Bayesian analyses environments. Examples of convergent evolution in the of trnL-F, trnT-L and atpB-rbcL intergenic spacers from 24 main clades are given using characters of leaf size, caffeine African species revealed two main clades in the Coffea content and reproductive mode. subgenus Coffea whose distribution overlaps in west equa- torial Africa. Comparison of trnL-F sequences obtained Keywords Africa Á Biogeography Á Coffea Á Evolution Á from GenBank for 45 Coffea species from Cameroon, Phylogeny Á Plastid sequences Á Rubiaceae Madagascar, Grande Comore and the Mascarenes revealed low divergence between African and Madagascan species, suggesting a rapid and radial mode of speciation. A chro- Introduction nological history of the dispersal of the Coffea subgenus Coffea from its centre of origin in Lower Guinea is pro- Coffeeae tribe belongs to the Ixoroideae monophyletic posed. -

Analyse De Risque Phytosanitaire Ditylenchus Dipsaci Sur Luzerne Avis De L’Anses Rapport D’Expertise Collective
Analyse de risque phytosanitaire Ditylenchus dipsaci sur luzerne Avis de l’Anses Rapport d’expertise collective Avril 2013 Édition scientifique Analyse de risque phytosanitaire Ditylenchus dipsaci sur luzerne Avis de l’Anses Rapport d’expertise collective Avril 2013 Édition scientifique Avis de l’Anses Saisine n° « 2012-SA-0086 » Le directeur général Maisons-Alfort, le 16 avril 2013 AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à « l’analyse de risque phytosanitaire Ditylenchus dipsaci sur luzerne » L’Anses met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste. L’Anses contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation et à évaluer les risques sanitaires qu’ils peuvent comporter. Elle contribue également à assurer d’une part la protection de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des végétaux et d’autre part l’évaluation des propriétés nutritionnelles des aliments. Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l’expertise et l’appui scientifique technique nécessaires à l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique). Ses avis sont rendus publics. L’Anses a été saisie le 15 mars 2012 par la Direction Générale de l’Alimentation du ministère en charge de l’agriculture d’une demande d’analyse de risque phytosanitaire (ARP) sur le nématode des tiges et bulbes (Ditylenchus dipsaci) sur luzerne (Medicago sativa). -

Patterns of Flammability Across the Vascular Plant Phylogeny, with Special Emphasis on the Genus Dracophyllum
Lincoln University Digital Thesis Copyright Statement The digital copy of this thesis is protected by the Copyright Act 1994 (New Zealand). This thesis may be consulted by you, provided you comply with the provisions of the Act and the following conditions of use: you will use the copy only for the purposes of research or private study you will recognise the author's right to be identified as the author of the thesis and due acknowledgement will be made to the author where appropriate you will obtain the author's permission before publishing any material from the thesis. Patterns of flammability across the vascular plant phylogeny, with special emphasis on the genus Dracophyllum A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of philosophy at Lincoln University by Xinglei Cui Lincoln University 2020 Abstract of a thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of philosophy. Abstract Patterns of flammability across the vascular plant phylogeny, with special emphasis on the genus Dracophyllum by Xinglei Cui Fire has been part of the environment for the entire history of terrestrial plants and is a common disturbance agent in many ecosystems across the world. Fire has a significant role in influencing the structure, pattern and function of many ecosystems. Plant flammability, which is the ability of a plant to burn and sustain a flame, is an important driver of fire in terrestrial ecosystems and thus has a fundamental role in ecosystem dynamics and species evolution. However, the factors that have influenced the evolution of flammability remain unclear. -
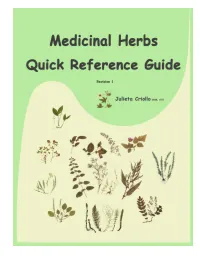
Medicinal Herbs Quick Reference Guide Revision 2*
Medicinal Herbs Quick Reference Guide * Revision 2 Julieta Criollo DNM, CHT Doctor of Natural Medicine Clinical Herbal Therapist Wellness Trading Post [email protected] www.wellnesstradingpost.com 604-760-6425 Copyright © 2004–2011 Julieta Criollo All rights reserved. Note to the reader This booklet is intended for educational purposes only. The information contained in it has been compiled from published books and material on plant medicine. Although the information has been reviewed for correctness, the publisher/author does not assume any legal responsibility and/or liability for any errors or omissions. Furthermore, herbal/plant medicine standards (plant identification, medicinal properties, preparations, dosage, safety precautions and contraindications, pharmacology, and therapeutic usage) are continuously evolving and changing as new research and clinical studies are being published and expanding our knowledge. Hence, readers are encouraged and advised to check the most current information available on plant medicine standards and safety. T his information is not intended to be a substitute for professional medical advice. Always seek the advice of a medical doctor or qualified health practitioner prior to starting any new treatment, or with any questions you may have regarding a medical condition. The publisher/author does not assume any legal responsibility and/or liability for the use of the information contained in this booklet. * Revision 1 updates: addition of color bars to the Herb Groups and the various Herb -

Medicinal Plants Used in the Uzunköprü District of Edirne, Turkey
Acta Societatis Botanicorum Poloniae DOI: 10.5586/asbp.3565 ORIGINAL RESEARCH PAPER Publication history Received: 2017-02-11 Accepted: 2017-11-14 Medicinal plants used in the Uzunköprü Published: 2017-12-28 district of Edirne, Turkey Handling editor Łukasz Łuczaj, Institute of Biotechnology, University of Rzeszów, Poland Fatma Güneş* Department of Pharmaceutical Botany, Faculty of Pharmacy, Trakya University, Edirne 22030, Funding Turkey The study was carried out with the support of Trakya University * Email: [email protected] (project 2013/22). Competing interests No competing interests have Abstract been declared. Tis study examined the use of plants in Uzunköprü and surrounding villages in the years 2013–2015 during the fowering and fruiting season of the studied plants Copyright notice © The Author(s) 2017. This is an (March–October). Interviews were carried out face-to-face with members of the Open Access article distributed community. Fify-seven people in 55 villages were interviewed. Overall, medicinal under the terms of the Creative plants from 96 taxa belonging to 45 families were recorded. Traditional medicinal Commons Attribution License, plants were used to treat 80 diseases and ailments such as diabetes, cold, fu, cough, which permits redistribution, commercial and non- stomachache, and hemorrhoids. According to the results, the largest eight families are commercial, provided that the Rosaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Poaceae, Ranunculaceae, Malvaceae, Cucurbitaceae, article is properly cited. and Brassicaceae. Te most commonly used species were Anthemis cretica subsp. tenuiloba, Cotinus coggyria, Datura stramonium, Ecballium elaterium, Hypericum Citation perforatum, Prunus spinosa, Pyrus elaeagnifolia subsp. bulgarica, Rosa canina, Güneş F. Medicinal plants used in the Uzunköprü district of Sambucus ebulus, Tribulus terestris, Urtica dioica. -

Flora Mediterranea 26
FLORA MEDITERRANEA 26 Published under the auspices of OPTIMA by the Herbarium Mediterraneum Panormitanum Palermo – 2016 FLORA MEDITERRANEA Edited on behalf of the International Foundation pro Herbario Mediterraneo by Francesco M. Raimondo, Werner Greuter & Gianniantonio Domina Editorial board G. Domina (Palermo), F. Garbari (Pisa), W. Greuter (Berlin), S. L. Jury (Reading), G. Kamari (Patras), P. Mazzola (Palermo), S. Pignatti (Roma), F. M. Raimondo (Palermo), C. Salmeri (Palermo), B. Valdés (Sevilla), G. Venturella (Palermo). Advisory Committee P. V. Arrigoni (Firenze) P. Küpfer (Neuchatel) H. M. Burdet (Genève) J. Mathez (Montpellier) A. Carapezza (Palermo) G. Moggi (Firenze) C. D. K. Cook (Zurich) E. Nardi (Firenze) R. Courtecuisse (Lille) P. L. Nimis (Trieste) V. Demoulin (Liège) D. Phitos (Patras) F. Ehrendorfer (Wien) L. Poldini (Trieste) M. Erben (Munchen) R. M. Ros Espín (Murcia) G. Giaccone (Catania) A. Strid (Copenhagen) V. H. Heywood (Reading) B. Zimmer (Berlin) Editorial Office Editorial assistance: A. M. Mannino Editorial secretariat: V. Spadaro & P. Campisi Layout & Tecnical editing: E. Di Gristina & F. La Sorte Design: V. Magro & L. C. Raimondo Redazione di "Flora Mediterranea" Herbarium Mediterraneum Panormitanum, Università di Palermo Via Lincoln, 2 I-90133 Palermo, Italy [email protected] Printed by Luxograph s.r.l., Piazza Bartolomeo da Messina, 2/E - Palermo Registration at Tribunale di Palermo, no. 27 of 12 July 1991 ISSN: 1120-4052 printed, 2240-4538 online DOI: 10.7320/FlMedit26.001 Copyright © by International Foundation pro Herbario Mediterraneo, Palermo Contents V. Hugonnot & L. Chavoutier: A modern record of one of the rarest European mosses, Ptychomitrium incurvum (Ptychomitriaceae), in Eastern Pyrenees, France . 5 P. Chène, M. -

The Pennsylvania State University
The Pennsylvania State University The Graduate School Intercollege Graduate Degree Program in Plant Biology PHYLOGENOMIC ANALYSIS OF ANCIENT GENOME DUPLICATIONS IN THE HISTORY OF PLANTS A Dissertation in Plant Biology by Yuannian Jiao © 2011 Yuannian Jiao Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy December 2011 The dissertation of Yuannian Jiao was reviewed and approved* by the following: Claude dePamphilis Professor of Biology Dissertation Advisor Chair of Committee Hong Ma Professor of Biology John Carlson Professor of Molecular Genetics Webb Miller Professor of Comparative Genomics and Bioinformatics Naomi Altman Professor of Statistics Teh-hui Kao Chair of Plant Biology Graduate Program *Signatures are on file in the Graduate School iii ABSTRACT Whole-genome duplication (WGD), or polyploidy, followed by gene loss and diploidization, has generally been viewed as a primary source of material for the origin of evolutionary novelties. Most flowering plants have been shown to be ancient polyploids that have undergone one or more rounds of WGDs early in their evolution, and many lineages have since undergone additional, independent and more recent genome duplications. It was suggested that the paleopolyploidy events were crucial to the radiation and success of angiosperms, but evidence for proposed ancient genome duplications remains equivocal. Plant genomes are highly dynamic and usually go through intense structural rearrangements and gene loss following duplication. Old(er) WGDs can not -

Phylogenetic Relationships of Ruteae (Rutaceae): New Evidence from the Chloroplast Genome and Comparisons with Non-Molecular Data
ARTICLE IN PRESS Molecular Phylogenetics and Evolution xxx (2008) xxx–xxx Contents lists available at ScienceDirect Molecular Phylogenetics and Evolution journal homepage: www.elsevier.com/locate/ympev Phylogenetic relationships of Ruteae (Rutaceae): New evidence from the chloroplast genome and comparisons with non-molecular data Gabriele Salvo a,*, Gianluigi Bacchetta b, Farrokh Ghahremaninejad c, Elena Conti a a Institute of Systematic Botany, University of Zürich, Zollikerstrasse 107, CH-8008 Zürich, Switzerland b Center for Conservation of Biodiversity (CCB), Department of Botany, University of Cagliari, Viale S. Ignazio da Laconi 13, 09123 Cagliari, Italy c Department of Biology, Tarbiat Moallem University, 49 Dr. Mofatteh Avenue, 15614 Tehran, Iran article info abstract Article history: Phylogenetic analyses of three cpDNA markers (matK, rpl16, and trnL–trnF) were performed to evaluate Received 12 December 2007 previous treatments of Ruteae based on morphology and phytochemistry that contradicted each other, Revised 14 July 2008 especially regarding the taxonomic status of Haplophyllum and Dictamnus. Trees derived from morpho- Accepted 9 September 2008 logical, phytochemical, and molecular datasets of Ruteae were then compared to look for possible pat- Available online xxxx terns of agreement among them. Furthermore, non-molecular characters were mapped on the molecular phylogeny to identify uniquely derived states and patterns of homoplasy in the morphological Keywords: and phytochemical datasets. The phylogenetic analyses determined that Haplophyllum and Ruta form Ruta reciprocally exclusive monophyletic groups and that Dictamnus is not closely related to the other genera Citrus family Morphology of Ruteae. The different types of datasets were partly incongruent with each other. The discordant phy- Phytochemistry logenetic patterns between the phytochemical and molecular trees might be best explained in terms of Congruence convergence in secondary chemical compounds. -

The Vascular Plants of British Columbia Part 1 - Gymnosperms and Dicotyledons (Aceraceae Through Cucurbitaceae)
The Vascular Plants of British Columbia Part 1 - Gymnosperms and Dicotyledons (Aceraceae through Cucurbitaceae) by George W. Douglas1, Gerald B. Straley2 and Del Meidinger3 1 George Douglas 2 Gerald Straley 3 Del Meidinger 6200 North Road Botanical Garden Research Branch R.R.#2 University of British Columbia B.C. Ministry of Forests Duncan, B.C. V9L 1N9 6501 S.W. Marine Drive 31 Bastion Square Vancouver, B.C. V6T 1Z4 Victoria, B. C. V8W 3E7 April 1989 Ministry of Forests THE VASCULAR PLANTS OF BRITISH COLUMBIA Part 1 - Gymnosperms and Dicotyledons (Aceraceae through Cucurbitaceae) Contributors: Dr. G.W. Douglas, Douglas Ecological Consultants Ltd., Duncan, B.C. — Aceraceae through Betulaceae Brassicaceae (except Arabis, Cardamine and Rorippa) through Cucurbitaceae. Mr. D. Meidinger, Research Branch, B.C. Ministry of Forests, Victoria, B.C. — Gymnosperms. Dr. G.B. Straley, Botanical Garden, University of B.C., Vancouver, B.C. — Boraginaceae, Arabis and Rorippa. With the cooperation of the Royal British Columbia Museum and the Botanical University of British Columbia. ACKNOWLEDGEMENTS We are grateful to Dr. G.A. Allen for providing valuable suggestions during the initial stages of the project. Thanks are also due to Drs. G.A. Allen, A. Ceska and F. Ganders for reviewing taxonomically difficult groups. Mrs. O. Ceska reviewed the final draft of Part 1. Mr. G. Mulligan kindly searched the DAO herbarium and provided information on Brassicaceae. Dr. G. Argus helped with records from CAN. Louise Gronmyr and Jean Stringer kindly typed most of the contributions and helped in many ways in the production of the final manuscript which was typeset by Beth Collins. -

Proceedings of Workshop on Gene Conservation of Tree Species–Banking on the Future May 16–19, 2016, Holiday Inn Mart Plaza, Chicago, Illinois, USA
United States Department of Agriculture Proceedings of Workshop on Gene Conservation of Tree Species–Banking on the Future May 16–19, 2016, Holiday Inn Mart Plaza, Chicago, Illinois, USA Forest Pacific Northwest General Technical Report September Service Research Station PNW-GTR-963 2017 Pacific Northwest Research Station Web site http://www.fs.fed.us/pnw Telephone (503) 808-2592 Publication requests (503) 808-2138 FAX (503) 808-2130 E-mail [email protected] Mailing address Publications Distribution Pacific Northwest Research Station P.O. Box 3890 Portland, OR 97208-3890 Disclaimer Papers were provided by the authors in camera-ready form for printing. Authors are responsible for the content and accuracy. Opinions expressed may not necessarily reflect the position of the U.S. Department of Agriculture. The use of trade or firm names in this publication is for reader information and does not imply endorsement by the U.S.Department of Agriculture of any product or service. Technical Coordinators Richard A. Sniezko is center geneticist, U.S. Department of Agriculture Forest Service, Dorena Genetic Resource Center, 34963 Shoreview Road, Cottage Grove, OR 97424 (e-mail address: [email protected]) Gary Man is a Forest health special- ist, U.S. Department of Agriculture Forest Service, State and Private Forestry, Forest Health Protection, 201 14th St SW 3rd FL CE, Washington DC 20024 (e-mail address: [email protected]) Valerie Hipkins is lab director, U.S. Department of Agriculture Forest Service, National Forest Genetics Laboratory, 2480 Carson Road, Placerville, CA 95667 (e-mail address: [email protected]) Keith Woeste is research geneti- cist, U.S. -

Centaurea Saxicola (Múrcia: La Azohia, Garcia-Jacas, Susanna 1616 & Vilatersana)
UNIVERSITAT DE BARCELONA FACULTAT DE FARMÀCIA DEPARTAMENT DE PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGETAL I EDAFOLOGIA SECCIÓ DE BOTÀNICA POLIPLOÏDIA, FILOGÈNIA I BIOGEOGRAFIA EN CENTAUREA L. SECCIÓ ACROCENTRON (Cass.) DC. Mònica Font Garcia Barcelona 2007 UNIVERSITAT DE BARCELONA FACULTAT DE FARMÀCIA DEPARTAMENT DE PRODUCTES NATURALS, BIOLOGIA VEGETAL I EDAFOLOGIA SECCIÓ BOTÀNICA PROGRAMA DE DOCTORAT BIOLOGIA VEGETAL POLIPLOÏDIA, FILOGÈNIA I BIOGEOGRAFIA EN CENTAUREA L. SECCIÓ ACROCENTRON (Cass.) DC. Memòria presentada per Mònica Font Garcia per optar al títol de doctor per la Universitat de Barcelona Dra. Núria Garcia-Jacas Dr. Alfonso Susanna de la Serna Dr. Joan Martín Villodre Mònica Font Garcia Mònica Font Garcia Barcelona 2007 AGRAÏMENTS Aquest treball s’ha pogut dur a terme gràcies al finançament provinent dels següents projectes: PB 93/0032 i PB 97/1134 provinents de la Dirección General de Enseñanza Superior; projectes CGL2004-04563-C02-01/BOS, CGL2004-04563-C02-02/BOS i CGL2006-01765/BOS del Ministerio de Educación y Ciencia; i 1999SGR 00332 i 2005/SGR/00344, de la Generalitat de Catalunya a través d’Ajuts a Grups de Recerca Consolidats. A part del finançament econòmic també hi ha hagut el suport i la col·laboració de moltes persones i institucions a qui vull donar les gràcies. En primer lloc, vull expressar el meu agraïment més sincer als directors d’aquesta tesi doctoral, el Dr. Alfonso Susanna de la Serna i la Dra. Núria Garcia-Jacas, per tot el suport que m’han mostrat constantment, tant a nivell personal com científic. Sense el seu ajut aquest treball no hagués estat possible. A la Unitat de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona per acceptar la inscripció d’aquesta tesi dins del seu programa.