Recueil Des Résumés
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
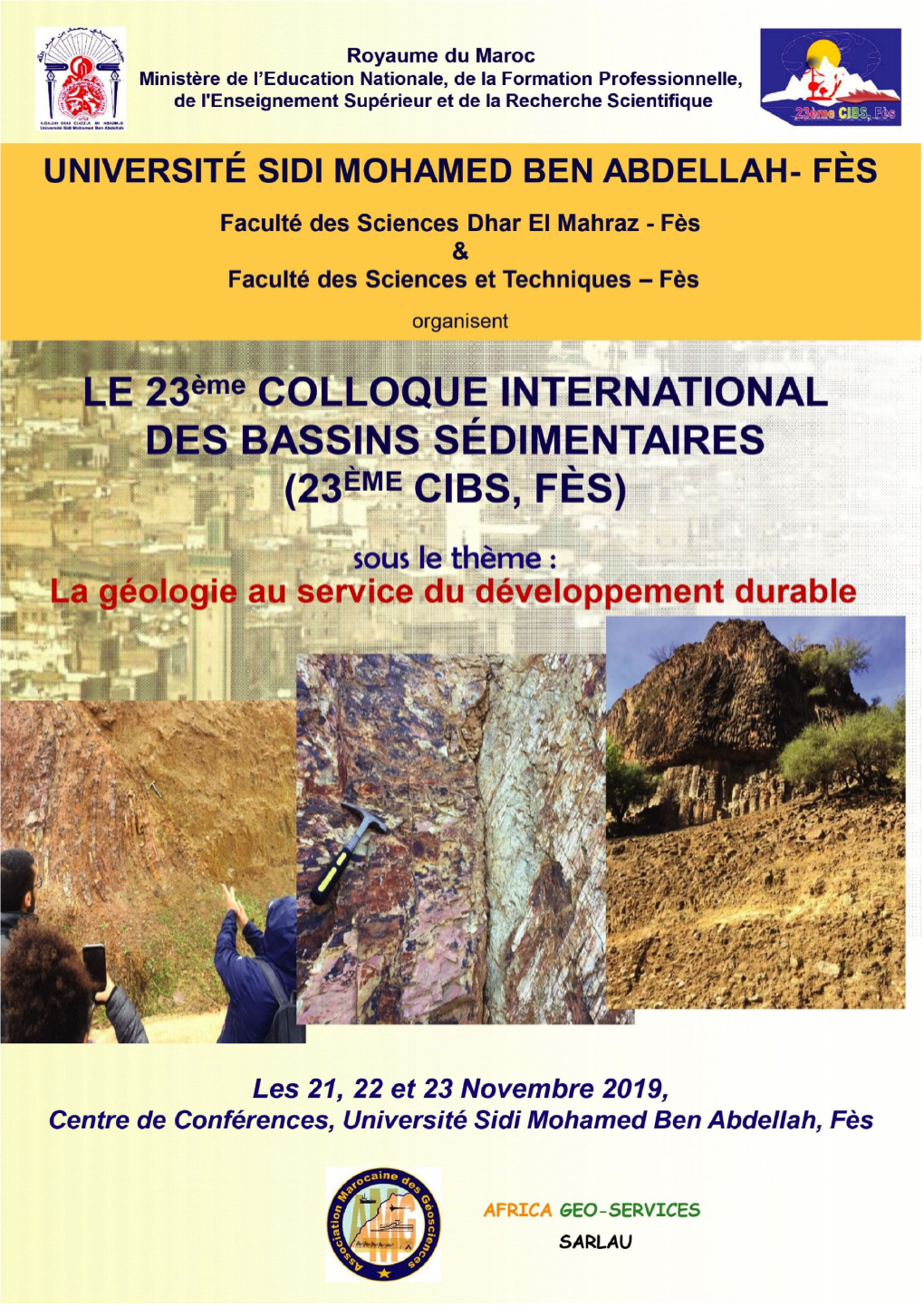
Load more
Recommended publications
-

Titanosaur Trackways from the Late Cretaceous El Molino Formation of Bolivia (Cal Orck’O, Sucre)
Annales Societatis Geologorum Poloniae (2018), vol. 88: 223 – 241. doi: https://doi.org/10.14241/asgp.2018.014 TITANOSAUR TRACKWAYS FROM THE LATE CRETACEOUS EL MOLINO FORMATION OF BOLIVIA (CAL ORCK’O, SUCRE) Christian A. MEYER1, Daniel MARTY2 & Matteo BELVEDERE3 1 Department of Environmental Sciences, University of Basel, Bernoullistrasse 32, CH-4056 Basel, Switzerland; e-mail: [email protected] 2 Museum of Natural History Basel, Augustinergasse 2, CH- 4000 Basel, Switzerland; e-mail: [email protected] 3 Office de la culture, Paléontologie A16, Hôtel des Halles, P.O. Box 64, CH-2900 Porrentruy 2, Switzerland; e-mail: [email protected] Meyer, C. A., Marty, D. & Belvedere, M., 2018. Titanosaur trackways from the Late Cretaceous El Mo- lino Formation of Bolivia (Cal Orck’o, Sucre). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 88: 223 – 241. Abstract: The Cal Orck’o tracksite is exposed in a quarry wall, approximately 4.4 km NW of Sucre (Department Chuquisaca, Bolivia) in the Altiplano/Cordillera Oriental, in the El Molino Formation (Middle Maastrichtian). Fossiliferous oolitic limestones, associated with large, freshwater stromatolites and nine levels of dinosaur tracks in the El Molino Formation document an open lacustrine environment. The main track-bearing level is almost vertical with a surface area of ~ 65,000 m2. The high-resolution mapping of the site from 1998 to 2015 revealed a total of 12,092 individual dinosaur tracks in 465 trackways. Nine different morphotypes of dinosaur tracks have been documented. Amongst them are several trackways of theropods, orni- thopods, ankylosaurs and sauropods, with the latter group accounting for 26% of the trackways. -

Sauropod Dinosaur Remains from a New Early Jurassic Locality in the Central High Atlas of Morocco
Sauropod dinosaur remains from a new Early Jurassic locality in the Central High Atlas of Morocco CECILY S.C. NICHOLL, PHILIP D. MANNION, and PAUL M. BARRETT Nicholl, C.S.C., Mannion, P.D., and Barrett, P.M. 2018. Sauropod dinosaur remains from a new Early Jurassic locality in the Central High Atlas of Morocco. Acta Palaeontologica Polonica 63 (1): 147–157. Despite being globally widespread and abundant throughout much of the Mesozoic, the early record of sauropod dinosaur evolution is extremely poor. As such, any new remains can provide significant additions to our understand- ing of this important radiation. Here, we describe two sauropod middle cervical vertebrae from a new Early Jurassic locality in the Haute Moulouya Basin, Central High Atlas of Morocco. The possession of opisthocoelous centra, a well-developed system of centrodiapophyseal laminae, and the higher elevation of the postzygapophyses relative to the prezygapophyses, all provide strong support for a placement within Sauropoda. Absence of pneumaticity indicates non-neosauropod affinities, and several other features, including a tubercle on the dorsal margin of the prezygapophyses and an anteriorly slanting neural spine, suggest close relationships with various basal eusauropods, such as the Middle Jurassic taxa Jobaria tiguidensis and Patagosaurus fariasi. Phylogenetic analyses also support a position close to the base of Eusauropoda. The vertebrae differ from the only other Early Jurassic African sauropod dinosaurs preserving overlapping remains (the Moroccan Tazoudasaurus naimi and South African Pulanesaura eocollum), as well as strati- graphically younger taxa, although we refrain from erecting a new taxon due to the limited nature of the material. -

Maroc) : Paléoenvironnements Successifs Et Signification Paléogéographique
Carnets de Géologie / Notebooks on Geology - Article 2008/06 (CG2008_A06) Les dépôts continentaux du Jurassique moyen au Crétacé inférieur dans le Haut Atlas oriental (Maroc) : paléoenvironnements successifs et signification paléogéographique 1 Hamid HADDOUMI 2 André CHARRIERE 3 Bernard ANDREU 4 Pierre-Olivier MOJON Résumé : Dans le Haut Atlas oriental marocain, les "Couches rouges" continentales succédant aux dernières formations marines jurassiques sont organisées en trois grands ensembles lithostratigraphiques : la Formation d'Anoual, la Formation de Ksar Metlili et le Groupe de Dekkar, séparés par deux importantes ruptures de l'enregistrement sédimentaire. La Formation d'Anoual correspond à des dépôts de plaine deltaïque à dominante fluviatile, suivis d'une ultime incursion marine d'âge Bathonien inférieur. La Formation de Ksar Metlili est uniquement localisée dans certaines aires subsidentes et représente un deuxième cycle fluvio-deltaïque avec des charophytes d'âge Tithonien terminal-Berriasien inférieur. Le Groupe de Dekkar traduit l'installation d'une nouvelle aire de sédimentation recouvrant l'ensemble de la région avec trois environnements successifs : cônes alluviaux associés à une sédimentation lacustre du Barrémien?-Aptien à charophytes et ostracodes, puis dépôts de plaines alluviales, enfin plaines et lagunes côtières au Cénomanien. Les "Couches rouges" continentales du domaine atlasique oriental correspondent ainsi à l'enregistrement sédimentaire de trois événements géodynamiques distincts : • une phase de comblement du sillon atlasique, associée à une forte subsidence dénotant une poursuite du rifting atlasique au Bathonien inférieur ; • une période d'émersion généralement marquée par une lacune du Bathonien au Barrémien- Aptien, mais au cours de laquelle subsiste une sédimentation résiduelle dans certaines cuvettes intra-continentales à la limite Jurassique/Crétacé ; • une phase d'ouverture générant au Barrémien?-Aptien de nouveaux bassins continentaux qui évoluent vers des conditions marines jusqu'à la transgression du Cénomanien-Turonien. -

The Upper Jurassic of Europe: Its Subdivision and Correlation
The Upper Jurassic of Europe: its subdivision and correlation Arnold Zeiss In the last 40 years, the stratigraphy of the Upper Jurassic of Europe has received much atten- tion and considerable revision; much of the impetus behind this endeavour has stemmed from the work of the International Subcommission on Jurassic Stratigraphy. The Upper Jurassic Series consists of three stages, the Oxfordian, Kimmeridgian and Tithonian which are further subdivided into substages, zones and subzones, primarily on the basis of ammonites. Regional variations between the Mediterranean, Submediterranean and Subboreal provinces are discussed and correlation possibilities indicated. The durations of the Oxfordian, Kimmeridgian and Tithonian Stages are reported to have been 5.3, 3.4 and 6.5 Ma, respectively. This review of the present status of Upper Jurassic stratigraphy aids identification of a num- ber of problems of subdivision and definition of Upper Jurassic stages; in particular these include correlation of the base of the Kimmeridgian and the top of the Tithonian between Submediterranean and Subboreal Europe. Although still primarily based on ammonite stratigraphy, subdivision of the Upper Jurassic is increasingly being refined by the incorporation of other fossil groups; these include both megafossils, such as aptychi, belemnites, bivalves, gastropods, brachiopods, echino- derms, corals, sponges and vertebrates, and microfossils such as foraminifera, radiolaria, ciliata, ostracodes, dinoflagellates, calcareous nannofossils, charophyaceae, dasycladaceae, spores and pollen. Important future developments will depend on the detailed integration of these disparate biostratigraphic data and their precise combination with the abundant new data from sequence stratigraphy, utilising the high degree of stratigraphic resolution offered by certain groups of fos- sils. -

Guelb El Ahmar (Bathonian, Anoual Syncline, Eastern Morocco): First Continental flora and Fauna Including Mammals from the Middle Jurassic of Africa
Published in *RQGZDQD5HVHDUFK ± which should be cited to refer to this work. Guelb el Ahmar (Bathonian, Anoual Syncline, eastern Morocco): First continental flora and fauna including mammals from the Middle Jurassic of Africa Hamid Haddoumi a,RonanAllainb, Said Meslouh c, Grégoire Metais b, Michel Monbaron d,DenisePonsb, Jean-Claude Rage b, Romain Vullo e, Samir Zouhri f, Emmanuel Gheerbrant b,⁎ a Département de Géologie, Faculté des Sciences, Université Mohammed 1er, BP. 524, 60 000 Oujda, Morocco b CR2P — Centre de Recherches sur la Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements, UMR 7207, Muséum National d'Histoire Naturelle, CNRS, UPMC, Sorbonne Universités, MNHN, CP38, 8 rue Buffon, 75005 Paris, France c Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, Rabat, Morocco d Département de Géosciences, Université de Fribourg, Switzerland e UMR-CNRS 6118, Géosciences Rennes, Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 263 avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes, France f Laboratoire de Géosciences, Faculté des Sciences Aïn Chock, Université Hassan II de Casablanca, Km 8, route de l'Université, 20100 Casablanca, Morocco We report the discovery in Mesozoic continental “red beds” of Anoual Syncline, Morocco, of the new Guelb el Ahmar (GEA) fossiliferous sites in the Bathonian Anoual Formation. They produced one of the richest continental biotic assemblages from the Jurassic of Gondwana, including plants, invertebrates and vertebrates. Both the sedimentolog- ical facies and the biotic assemblage indicate a lacustrine depositional environment. The flora is represented by tree trunks (three families), pollen (13 species, five major clades) and charophytes. It suggests local forests and humid (non-arid) conditions. -

Maroc) : Paléoenvironnements Successifs Et Signification Paléogéographique
Carnets de Géologie / Notebooks on Geology - Article 2008/06 (CG2008_A06) Les dépôts continentaux du Jurassique moyen au Crétacé inférieur dans le Haut Atlas oriental (Maroc) : paléoenvironnements successifs et signification paléogéographique 1 Hamid HADDOUMI 2 André CHARRIERE 3 Bernard ANDREU 4 Pierre-Olivier MOJON Résumé : Dans le Haut Atlas oriental marocain, les "Couches rouges" continentales succédant aux dernières formations marines jurassiques sont organisées en trois grands ensembles lithostratigraphiques : la Formation d'Anoual, la Formation de Ksar Metlili et le Groupe de Dekkar, séparés par deux importantes ruptures de l'enregistrement sédimentaire. La Formation d'Anoual correspond à des dépôts de plaine deltaïque à dominante fluviatile, suivis d'une ultime incursion marine d'âge Bathonien inférieur. La Formation de Ksar Metlili est uniquement localisée dans certaines aires subsidentes et représente un deuxième cycle fluvio-deltaïque avec des charophytes d'âge Tithonien terminal-Berriasien inférieur. Le Groupe de Dekkar traduit l'installation d'une nouvelle aire de sédimentation recouvrant l'ensemble de la région avec trois environnements successifs : cônes alluviaux associés à une sédimentation lacustre du Barrémien?-Aptien à charophytes et ostracodes, puis dépôts de plaines alluviales, enfin plaines et lagunes côtières au Cénomanien. Les "Couches rouges" continentales du domaine atlasique oriental correspondent ainsi à l'enregistrement sédimentaire de trois événements géodynamiques distincts : • une phase de comblement du sillon atlasique, associée à une forte subsidence dénotant une poursuite du rifting atlasique au Bathonien inférieur ; • une période d'émersion généralement marquée par une lacune du Bathonien au Barrémien- Aptien, mais au cours de laquelle subsiste une sédimentation résiduelle dans certaines cuvettes intra-continentales à la limite Jurassique/Crétacé ; • une phase d'ouverture générant au Barrémien?-Aptien de nouveaux bassins continentaux qui évoluent vers des conditions marines jusqu'à la transgression du Cénomanien-Turonien. -

Integrated Stratigraphy of the Oxfordian
Integrated stratigraphy of the Oxfordian global stratotype section and point (GSSP) candidate in the Subalpine Basin (SE France) Pierre Pellenard, Dominique Fortwengler, Didier Marchand, Jacques Thierry, Annachiara Bartolini, Slah Boulila, Pierre-Yves Collin, Raymond Enay, Bruno Galbrun, Silvia Gardin, et al. To cite this version: Pierre Pellenard, Dominique Fortwengler, Didier Marchand, Jacques Thierry, Annachiara Bartolini, et al.. Integrated stratigraphy of the Oxfordian global stratotype section and point (GSSP) candidate in the Subalpine Basin (SE France). Volumina Jurassica, Polish Geological Institute, 2014, 12 (1), pp.1-44. hal-01061435 HAL Id: hal-01061435 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01061435 Submitted on 2 Jun 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution| 4.0 International License Volumina Jurassica, 2014, Xii (1): 1–44 Integrated stratigraphy of the Oxfordian global stratotype section and point (GSSP) candidate in the Subalpine Basin (SE France) Pierre PELLENARD1, Dominique FORTWENGLER1, Didier MARCHAND1, Jacques THIERRY1, Annachiara BARTOLINI2, Slah BOULILA3, Pierre-Yves COLLIN1, Raymond ENAY4, Bruno GALBRUN3, Silvia GARDIN5, Vincent HUAULT6, Emilia HURET7, Mathieu MARTINEZ8, Carmela CHATEAU SMITH9 Key words: Callovian-Oxfordian boundary, biostratigraphy, ammonites, dinoflagellate cysts, calcareous nannofossils, cyclostratigraphy, chemostratigraphy. -

17 July 2021 Aperto
AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino MORPHOLOGY, TAXONOMY, AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF THE MONTEVIALE CROCODYLIANS (OLIGOCENE, ITALY). This is the author's manuscript Original Citation: Availability: This version is available http://hdl.handle.net/2318/1703198 since 2019-05-29T10:01:05Z Publisher: Samson, R., et al. Terms of use: Open Access Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law. (Article begins on next page) 09 October 2021 The 66th Symposium on Vertebrate Palaeontology and Comparative Anatomy Universities of Manchester September 5th-8th 2018 PROGRAMME AND ABSTRACTS Welcome to Manchester for SVPCA and SPPC 2018, the 66th Symposium on Vertebrate Palaeontology and Comparative Anatomy with the Symposium of Palaeontological Preparation. Herein you will find information about the schedule and programme of events including the line-up of oral and poster presentations, details about the social events, and a guide to the conference. The abstract booklet is available as a PDF only (emailed to delegates and at www.svpca.org) Local Host Committee: Robert Sansom, University of Manchester (Chair) Robin Beck, University of Salford Charlotte Brassey, Manchester Metropolitan University Robert Brocklehurst, -

Middle Jurassic” Gap Bone Versus Track Record in Dinosaurs Meyer, C
3 rd Swiss Geoscience Meeting, Zürich, 2005 Mind the “Middle Jurassic” gap Bone versus track record in dinosaurs Meyer, C. A. & Thüring, B. Naturhistorisches Museum Basel, Switzerland Augustinergasse 2. Ch-4001 Basel; [email protected] Up to now studies on vicariance biogeography or The track record indicates theropods in North cladistic biogeography of dinosaurs have been America and confirms the presence of theropods, performed with body fossils only. In the Triassic and sauropods and ornithischians in Europe and Early Jurassic these methods have produced rather theropods and sauropods in Africa. In the Callovian coherent patterns, probably due to the existence of sauropod remains are present on all continents Pangaea. They show a large cosmopolitan except Australia, theropods occur in South America, community of herrerasaurids, coelophysoids, Europe, Africa and Asia, whereas ornithischians are prosauropods and basal ornitischians (Holtz et al. found in Europe and Asia only. The track record 2004). adds sauropods to North and South America. The fossil record of body and trace fossils of Combining the record of both body and trace fossils dinosaurs in the Middle Jurassic consists of rather gives a somewhat different picture, although we are limited information. Today more than hundred far away to link particular trackways to specific locations are known to contain either trace or body vertebrate taxa. In this paper we would like to focus fossils. Although scattered, they occur on all on similarities and differences in the global track continents except on Antarctica. The best record record. including all stages comes from Europe where all The Middle Jurassic dinosaur fossil record is poor groups of dinosaurs are present, whereas all other and incomplete record during this time interval, when continents show only very few localities. -

Toarcian and Bajocian Ammonites from the Haushi
GeoArabia, 2011, v. 16, no. 4, p. 87-122 Gulf PetroLink, Bahrain Toarcian and Bajocian ammonites from the Haushi-Huqf Massif of southwestern Oman and the Hawasina Nappes of the Oman Mountains: Implications for paleoecology and paleobiogeography Raymond Énay ABSTRACT New and rare Jurassic ammonites have been found in Oman. A latest Bajocian Arabian Platform-type species was discovered in the Haushi-Huqf Massif autochthon of southwestern Oman, and Bajocian species typical of the Mediterranean Tethys and northwestern Europe were found in the Kawr-Misfah exotic unit of the Hawasina Nappes in the Oman Mountains. The dates provided by the new fauna have resulted in a reinterpretation of the geologic history of the containing rocks, and of their paleoecology and paleobiogeography. It is significant that ammonites from shallow-marine environments of the Arabian Platform are in close proximity to species from open-sea environments of the Mediterranean Tethys and northwestern Europe. This shows that endemism of the Arabian Province resulted from ecological isolation, whereas open-marine environments on the Oman margin, especially the pelagic seamounts off the margin, form part of a migration route between western and eastern Tethys (or Indo-Southwest Pacific), and perhaps far beyond. The occurrences among the Tethyan and pandemic components of ammonite faunas in the Canadian Pacific Cordillera of most of the taxa of the open-marine environments on the Oman margin reopens the question of Pacific biogeography during the Early Jurassic before the Hispanic oceanic corridor was completely open. Among the proposed models, the Pantropic Distribution Model of Newton is examined in the light of the Cretaceous paleobiogeography, with particular reference to rudists. -

A Basal Sauropod Dinosaur from the Early Jurassic of Morocco
Published in Comptes Rendus Palevol 3(3): 199-208, 2004 which should be cited to reference this work A basal sauropod dinosaur from the Early Jurassic of Morocco Ronan Allain a,b,*, Najat Aquesbi c, Jean Dejax a, Christian Meyer d, Michel Monbaron e, Christian Montenat f, Philippe Richir a, Mohammed Rochdy c, Dale Russell g, Philippe Taquet a a Laboratoire de paléontologie, département « Histoire de la Terre », Muséum national d’histoire naturelle, UMR 8569 CNRS, 8, rue Buffon, 75005 Paris, France b Université Rennes 1, Geosciences, Campus de Beaulieu, av. du Général-Leclerc, 35042 Rennes cedex, France c Institut Agdal, ministère de l’Énergie et des Mines, BP 6 208, Rabat, Morocco d Naturhistorisches Museum Basel, Augustinergasse 2, CH-4001 Basel, Switzerland e Département de Géosciences, université de Fribourg, chemin du Musée 4 , CH-1700 Fribourg, Switzerland f Institut géologique Albert-de-Lapparent (IGAL), 13, bd de l’Hautil, 95092 Cergy-Pontoise, France g North Carolina Museum of Natural Sciences, and Department of Marine, Earth and Atmospheric Sciences, North Carolina State University, Box 8208, Raleigh, NC 27695, USA Received 12 February 2004; accepted 15 March 2004 Available online 30 April 2004 Abstract Continental strata of Early Jurassic age are seldom exposed, and little is known of the history of sauropod dinosaurs prior to the Middle Jurassic radiation of neosauropods. Well-preserved skeletons and skulls have not been recovered from strata older than the Middle Jurassic. Here we report, in the Early Jurassic of the Moroccan High Atlas, the discovery of the skeleton, including cranial material, of a new vulcanodontid sauropod. -

A Middle Jurassic Sauropod Dinosaur from Algeria
ARTICLE IN PRESS C. R. Palevol "" (2005) """-""" http://france.elsevier.com/direct/PALEVO/ Systematic Palaeontology (Vertebrate Palaeontology) The ‘Giant of Ksour’, a Middle Jurassic sauropod dinosaur from Algeria Farida Mahammed a, Émilie Läng b,*, Leïla Mami, Larbi Mekahli c, Miloud Benhamou c, Boumediène Bouterfa c, Ali Kacemi c, Sid-Ali Chérief a, Hayate Chaouati a, Philippe Taquet b a Centre de recherche et développement, Sonatrach, av. du Premier-Novembre, 35000 Boumerdès, Algérie b Département « Histoire de la Terre », Muséum national d’histoire naturelle, UMR 5143 CNRS, CP 38, 57, rue Cuvier, 75231 Paris cedex 05, France c Laboratoire de géodynamique des bassins sédimentaires, université d’Oran Es-Sénia, Oran, Algérie Received 28 June 2005; accepted 5 July 2005 Presented by Philippe Taquet Abstract Continental strata of Early and Middle Jurassic age are seldom-exposed, and little is known of the history of sauropod dinosaurs prior to the neosauropod radiation of the end of the Middle Jurassic. Here, we report, in the Middle Jurassic of the Occidental Saharan Atlas (Algerian High Atlas), the discovery of a skeleton, including cranial material, of a new cetiosaurid sauropod. Chebsaurus algeriensis n. g., n. sp. represents the most complete Algerian sauropod available to date, only few remains were found before. To cite this article: F. Mahammed et al., C. R. Palevol 4 (2005). © 2005 Académie des sciences. Published by Elsevier SAS. All rights reserved. Résumé Le « Géant des Ksour », un dinosaure sauropode du Jurassique moyen d’Algérie. Parce que les dépôts continentaux du Jurassique inférieur et moyen affleurent rarement, l’histoire des dinosaures sauropodes est très mal connue avant la radiation des néosauropodes, à la fin du Jurassique moyen.