DOSSIER D'information SURF DES NEIGES Jeux Du Canada De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
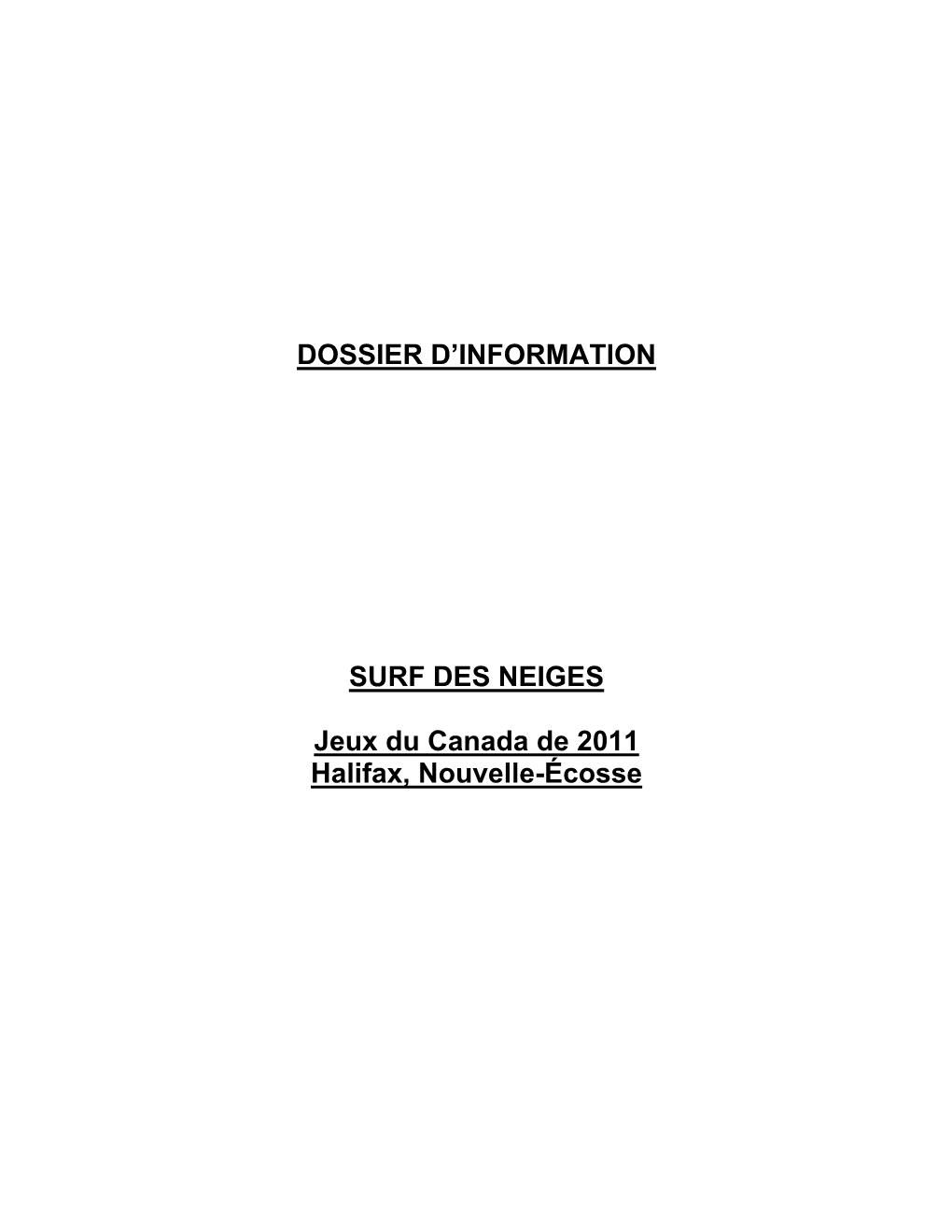
Load more
Recommended publications
-

Alana Nichols
USG-Sponsored Team USA Athletes ALANA NICHOLS I love what I do. I absolutely love it, and I believe in myself. I really do believe that I can accomplish what I set out to accomplish. —Alana Nichols The words ‘courage’, ‘determination’ and ‘champion’ are used a lot when describing Olympians. But when it comes to Alana Nichols, those words have never been more accurate. At the age of 17, Alana Nichols was snowboarding during an annual family vacation in Colorado. Attempting an ambitious back flip on the snowy mountains, Alana over twisted, lost control and landed forcefully on a rock, leaving her paralyzed from the waist down. The years that followed required tremendous courage and commitment as she recovered from this accident and became even stronger than she was before. While recuperating, Alana took an interest in the sport of wheelchair basketball. After two years of hard work and training, she found herself as an alternate for the U.S. Women’s Team during the 2004 Paralympic Games in Athens. Alana’s determination eventually led to her becoming a full-time member of the national team. And in 2006, she won her first silver medal at the 2006 Wheelchair Basketball Championship. In 2008, Alana was on the big stage again at the Paralympic Games, this time on a basketball court on the other side of the world, in Beijing, China. And that day, she and her teammates won Gold. But Alana, didn’t celebrate long. Instead, she moved to Colorado, with her eye set on an entirely different sport – Alpine skiing. -

1 SNOWBOARDING SPORT COMMITTEE MEETING MINUTES U.S. Ski & Snowboard Congress 2018 Center of Excellence, 1 Victory Lane, Park
SNOWBOARDING SPORT COMMITTEE MEETING MINUTES U.S. Ski & Snowboard Congress 2018 Center of Excellence, 1 Victory Lane, Park City, UT May 3,2018 COMMITTEE MEMBERS Mike Mallon – USASA Rep - present Alex Deibold – Athlete Rep - present Tricia Byrnes – Athlete Rep - present Ross Powers– Eastern Rep – present Coggin Hill – PNSA Rep – phone Paul Krahulec – Rocky Rep – excused Andy Gilbert – Intermountain Rep - phone Jessica Zalusky – Central Rep - phone Jeremy Lepore – IJC Rep - phone Peter Foley – Coaches Rep - present Ben Wisner – Far West Rep – present Mike Mallon – USASA Rep - present OTHERS IN ATTENDANCE Jeremy Forster – U.S. Ski & Snowboard Jeff Juneau – Killington Mtn School Dave Reynolds – U.S. Ski & Snowboard Tori Koski – SSWSC Nick Poplawski– Park City Ski & Snowboard Ben Wisner – Mammoth Mike Ramirez - U.S. Ski & Snowboard Lane Clegg – Team Utah Nichole Mason – U.S. Ski & Snowboard Rob LaPier – Jackson Hole via phone Mike Jankowski – U.S. Ski & Snwoboard Jeff Archibald – U.S. Ski & Snowboard Lisa Kosglow – U.S. Ski & Snowboard BOD Kim Raymer – USASA BOD Lane Clegg – Team Utah Rick Shimpeno – U.S. Ski & Snowboard Cath Jett – CJ Timing Kelsey Sloan – U.S. Ski & Snowboard CB Betchel – Crested Butte Jake Levine – Team Utah Matt Vogel – Team Summit Gregg Janecky – Northstar / HCSC Sarah Welliver – U.S. Ski & Snowboard Aaron Atkins – Eric Webster – U.S. Ski & Snowboard Jason Cook – AVSC Ross Hindman – ISTC Jeff Juneau – KMS Nick Alexakos – U.S. Ski & Snowboard Jeff Archibald – U.S. Ski & Snowboard Michael Bell – Park City Ski & Snwoboard Tom Webb – U.S. Ski & Snowboard Sheryl Barnes – U.S. Ski & Snowboard Tom Kelly – U.S. Ski & Snowboard Ritchie Date – U.S. -
![[Snowboard Cross] 2020/2021 FISスノーボード・ワールドカップ【スノーボードクロス】 【男子】 【女子】 スノーボードクロス/12月19日/チェルビニア(イタリア) Cancelled](https://docslib.b-cdn.net/cover/6615/snowboard-cross-2020-2021-fis-12-19-cancelled-586615.webp)
[Snowboard Cross] 2020/2021 FISスノーボード・ワールドカップ【スノーボードクロス】 【男子】 【女子】 スノーボードクロス/12月19日/チェルビニア(イタリア) Cancelled
2020/2021 FIS SNOWBOARD WORLD CUP [Snowboard Cross] 2020/2021 FISスノーボード・ワールドカップ【スノーボードクロス】 【男子】 【女子】 スノーボードクロス/12月19日/チェルビニア(イタリア) Cancelled スノーボードクロス/12月16日/モンタフォン(オーストリア) Cancelled スノーボードクロス第1戦/1月23日/キエーザ・イン・ヴァルマレンコ(イタリア) Qual. EF QF SF Qual. QF SF Rnk Bib Name Nation Round Rnk Bib Name Nation Round Q1/Time Rnk Q2/Time Rnk Heat Rnk Heat Rnk Heat Rnk Q1/Time Rnk Q2/Time Rnk Heat Rnk Heat Rnk 1 18 Glenn de BLOIS NED 50.18 36 49.10 2 8 2 12 1 14 2 Big Final 1 5 Michela MOIOLI ITA 56.96 5 - - 2 2 5 1 Big Final 2 1 Eliot GRONDIN CAN 47.12 1 - - 1 1 9 1 13 1 Big Final 2 4 Faye GULINI USA 56.75 4 - - 2 1 5 2 Big Final 3 17 Lorenzo SOMMARIVA ITA 49.43 19 48.77 1 1 2 9 2 13 2 Big Final 3 2 Eva SAMKOVA CZE 55.63 2 - - 4 1 6 1 Big Final 10 9 高原 宜希 Pasco SSC 48.68 9 - - 2 1 9 3 - - Quarter Final 14 11 中村 優花 仙台大学 58.54 11 56.28 3 3 4 - - Quarter Final 18 16 桃野 慎也 筋整流法 49.20 16 - - 1 3 - - - - 1/8 Finals スノーボードクロス第2戦/1月24日/キエーザ・イン・ヴァルマレンコ(イタリア) R EF QF SF EF QF SF Rnk Bib Name Nation Qual. Final Rnk Bib Name Nation Qual. Round Heat Rnk Heat Rnk Heat Rnk Heat Rnk Heat Rnk Heat Rnk Heat Rnk 1 1 Alessandro HAEMMERLE AUT 1 1 17 1 25 1 29 1 Big Final 1 2 Eva SAMKOVA CZE 8 1 12 1 14 1 Big Final 2 12 Merlin SURGET FRA 6 1 19 2 26 2 29 2 Big Final 2 4 Faye GULINI USA 4 1 10 1 13 2 Big Final cancelled 3 7 Hagen KEARNEY USA cancelled 13 1 23 1 28 2 30 2 Big Final 3 6 Julia PEREIRA de SOUSA MABILEAU FRA 6 2 11 2 14 2 Big Final 17 13 高原 宜希 Pasco SSC 7 1 20 3 - - - - 1/8 Finals 17 20 中村 優花 仙台大学 4 3 - - - - 1/8 Finals 25 24 桃野 慎也 筋整流法 3 2 18 4 - - - - 1/8 Finals スノーボードクロス/1月30日/サンラリー(フランス) Cancelled スノーボードクロス混合団体/1月31日/サンラリー(フランス) Cancelled スノーボードクロス/2月6日/フェルドベルグ(ドイツ) Cancelled スノーボードクロス混合団体/2月7日/フェルドベルグ(ドイツ) Cancelled スノーボードクロス/2月13日/ドルニ・モラーヴァ(チェコ) Cancelled スノーボードクロス第3戦/2月18日/ライターアルム(オーストリア) Qual. -

Using Athletes' 'S That Amateur Sports' Cannabis Policies May Be La
Varsity Greens: The Stigmatization of Cannabis-Using Canadian University Athletes by Alec S. J. Skillings A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Department of Sociology University of Alberta © Alec S. J. Skillings, 2020 ii Abstract Cannabis was legalized in Canada on October 17, 2018. However, it remains prohibited in amateur sport. Canadian university athletes still face punishments for their use of cannabis such as, suspensions, loss of awards and scholarships, and social stigmatization. This thesis presents the results of 12 semi-structured qualitative interviews with Canadian university athletes. I utilized Grounded Theory methodology to produce and analyze the data. The results of these interviews indicate that Canadian university athletes use cannabis in a multiplicity of ways. They use it to manage pain, promote satiety, and aid in sleep. They also use it to manage stress and anxiety, and to promote optimal experiences in recreational and non-competitive activities. Moreover, cannabis is used socially between teammates. Athletes undergo a process of role engulfment, meaning that their role as an athlete demands so much time and energy that other roles, such as academic and social, become overwhelmed by their athletic one. In some cases, cannabis is used to manage the process of role engulfment and in other cases it may promote the process. Athletes are stigmatized for their cannabis use because of their unique prestige status. Public expectations, or virtual demands, are imposed on athletes which result in an elevated stigma if they are caught using the substance. The athletes I interviewed implemented a variety of techniques to conceal their use from the public, drug testing agencies, coaches, and teammates. -
Fuel-Tank Manufacturer Plans Large-Scale Expansion
KESSEL’S HAT TRICK LIFTS US HOCKEY, SPORTS B1 LEESBURG, FLORIDA Monday, February 17, 2014 www.dailycommercial.com PRISONS: Use of smuggled LIVING HEALTHY: Study ties cellphones on the rise, A3 weather to stroke rates, C1 Kerry: Climate change is world’s ‘most fearsome’ WMD MATTHEW LEE shoddy science and scientists gled out big oil and coal con- AP Diplomatic Writer to delay measures needed to re- cerns as the primary offenders. JAKARTA, Indonesia — Cli- duce emissions of greenhouse “We should not allow a tiny mate change may be the gases at the risk of imperiling minority of shoddy scientists world’s “most fearsome” weap- the planet. He also went after and science and extreme ideo- on of mass destruction and ur- those who dispute who is re- logues to compete with sci- gent global action is needed sponsible for such emissions, entific facts,” Kerry told the to combat it, U.S. Secretary of arguing that everyone and ev- audience gathered at a U.S. State John Kerry said on Sun- ery country must take responsi- Embassy-run American Cen- day, comparing those who bility and act immediately. ter in a Jakarta shopping mall. deny its existence or question “We simply don’t have time “Nor should we allow any its causes to people who insist to let a few loud interest groups room for those who think that the Earth is flat. hijack the climate conversa- the costs associated with doing In a speech to Indonesian stu- tion,” he said, referring to what the right thing outweigh the benefits.” EVAN VUCCI / AP dents, civic leaders and govern- he called “big companies” that “The science is unequivo- U.S. -

Constance, GER, November 2019
To the INTERNATIONAL SKI FEDERATION - Members of the FIS Council Blochstrasse 2 - National Ski Associations 3653 Oberhofen/Thunersee - Committee Chairs Switzerland Tel +41 33 244 61 61 Fax +41 33 244 61 71 Oberhofen, 26th November 2019 Summary of the FIS Council Meeting, 23rd November 2019, Konstanz / Constance (GER) Dear President, Dear Ski Friends, In accordance with art. 32.2 of the FIS Statutes we have pleasure in sending you the Summary of the most important decisions from the FIS Council Meeting which took place on 23rd November 2019 in Constance (GER). 1. Members present The following elected Council Members were present at the meeting in Constance (GER) on Saturday, 23rd November 2019: President Gian Franco Kasper, Vice-Presidents Mats Arjes, Janez Kocijancic and Aki Murasato, Members: Steve Dong Yang, Dean Gosper, Alfons Hörmann, Hannah Kearney (Athletes’ Commission Representative), Roman Kumpost, Dexter Paine, Flavio Roda, Erik Roeste, Konstantin Schad (Athletes’ Commission Representative), Peter Schröcksnadel, Martti Uusitalo, Eduardo Valenzuela and Michel Vion, Secretary General Sarah Lewis Apologies: Vice-President Patrick Smith, Council Member Andrey Bokarev Honorary Members: Sverre Seeberg, Carl-Eric Stalberg, Hank Tauber Guest: Franz Steinle President German Ski Association Observer: Dave Pym (CAN) representing Patrick Smith Experts: Stephan Netzle, Legal Counsel; Erwin Lauterwasser, Environment 2. Minutes from the Council Meeting in Cavtat-Dubrovnik (CRO) June 2019 The Summary and Minutes from the Council Meetings in -
15Th – 17Th March 2019 Grindelwald
42nd International For Teams of Three 15th – 17th March 2019 Grindelwald Official Programme and Entry Instructions BEI UNS WERDEN IHRE POWDERTRÄUME WAHR. HELISKIING VOM SPEZIALISTEN TRAVELHOUSE.CH/SNOW 22164489_TH_Ins_Kessler_Snow_Image_105x210_D.indd 1 06.12.18 11:39 42nd International SAS Pentathlon Dear Pentathletes! Our beloved event is now well into its forties, and still going strong. Together with the Organizing Commit- tee, I am very proud to welcome you to the 42nd SAS Pentathlon and to present our honorary guest, Tanja Frieden Tanja celebrated her greatest victory in Turin, Italy, on February 17, 2006, when she won the Olympic Gold medal in the Snowboard-cross competition, as the first ever in this discipline. At the end of that win- ter, she finished 2nd in the overall Snowboard-cross World Cup. Her athletic career began in 1996, lasting 14 years until withdrawing from active competitions in 2010 after sustaining serious injuries in a crash in a race. By that time, her achievements included the silver medal in the 1999 European Championships and a total of 32 top-three positions in the highest ranking international Snowboard-cross competitions. As a true international, she raced for Norway in the beginning and ended competing for Switzerland. And in appreciation of her great athletic achievements, Tanja was named Swiss female athlete of the year in 2006. Shortly after ending her athletic career, Tanja ventured into charitable and social engagements. She has been an athlete ambassador for Right To Play for many years, and still is. And she is the acting president of the association GoSnow.ch, called to life to increase the attractiveness of snow-related activities and ski camps amongst school children. -

Tesi Di Laurea
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTÀ IN SCIENZE MOTORIE TESI DI LAUREA Lo snowboard in Italia e verso le Olimpiadi RELATORE: Prof. GIOACHINO KRATTER CANDIDATO: FABIO PERRICONE ANNO ACCADEMICO: 2001-2002 Dedicata a chi mi è stato e a chi mi è sempre vicino. Ai miei amici, ai compagni di corso e agli Istruttori Nazionali INDICE Introduzione pag. 4 PARTE PRIMA “Dall’America alle Alpi” • Alle radici dello snowboard pag. 7 • Finalmente anche l’Italia s’è desta pag. 20 • Bob Sorgente e il clan dei bardonecchiesi pag. 26 • Ispirati da Apocalypse Snow pag. 29 • Già 300 mila i praticanti in Italia e che spinta dai Giochi del 2006! pag. 38 • Il sillabario dello snowboard pag. 45 • A Madonna di Campiglio il primo Snowpark pag. 48 PARTE SECONDA “Verso le Olimpiadi” • Le gare olimpiche e di Coppa del mondo pag. 54 • Le piste e gli impianti di Bardonecchia/Melezet per i ventesimi Giochi Invernali pag. 65 • Le date delle 6 gare olimpiche pag. 71 • Lo snowboard approda in città pag. 73 • Metodologia della preparazione atletica pag. 80 2 PARTE TERZA ”Sport ancora da scoprire” • Carving e snow, c’è del feeling pag. 92 • I campioni di sci bravi anche su tavola? pag. 97 • Onda bianca, onda rosa… pag. 100 • Come è nata la figura del terzo maestro pag. 105 • Le quattro regole per insegnare pag. 111 • E oggi soft batte hard per K.O. pag. 116 • Quanto “tira” il mercato in Italia? pag. 124 • I traumi di una disciplina nuova pag. 133 Bibliografia pag. 137 Ringraziamenti pag. 141 3 Introduzione Due anni fa mi ero posto un obiettivo; in certo qual modo avevo lanciato una sfida a me stesso: diventare il primo maestro di snowboard non udente in Italia. -

New CARD Act May Put Some Students in a Bind Students Work
the retrIever weekly UNIVERSITY OF MARYLAND, BALtimore county’s student NEWSPAPER 02.23.10 VOLUME 44 ISSUE 17 retrieverweekly.com Employ- New ees file CARD grievance Act may against put some Chartwells students Rima Kikani SENIOR STAFF WRITER in a bind Because of payment issues dat- ing back to the fall of 2008, a group Gavin Way of Commons employees has filed a EDITORIAL STAFF grievance against Chartwells, UMBC’s food services provider. Before they lost Recent federal legislation has put their contract, Sodexho, the preced- students in a financial bind; new ing service, had promised employees federal law will prevent anyone, a raise in July and in September. The under the age of 21 from receiv- Chartwells administration agreed to ing a credit card. At a time when honor the deal when they began work- more and more parents are unable ing with UMBC, but according to em- to support their children all the way ployees never fulfilled its promise. through college, students have had Both parties recently reached a set- one option, however dangerous, tlement in which Chartwells agreed to ACHSAH JOSEPH — TRW removed from their reach. Jerry disburse payments that had been over- (Left) Dance Education major Josephine Kalema and (right) Visual Arts major Melanie Feattz assist in the fundrais- Welch, CEO of nFinanSe, wrote, ing to aid Haiti’s earthquake victims. due for 18 months. Resident District “Anxious to make their way in the Manager for Chartwells, Tom DeLuca, world and not always aware of the mentioned, “We have come to an long-term financial consequences of amicable agreement… As is the case Students work together to their actions, anyone under the age with these negotiations, it took quite of 21 will be much more protected a while to come to an agreement and from the dangers of credit cards. -

Sports of the Winter Olympics: Snowboarding
Sports of The Winter Olympics: Snowboarding The Sport Packet #10 Halfpipe Competitors take off from the halfpipe’s rim, performing challenging aerial maneuvers, including flips, twists and spins. They complete each trick by traveling back and forth between the halfpipe’s walls. Athletes complete two runs. The event takes place in a semi-circular ditch, or half of a pipe, dug into the surface of a hill. The halfpipe is typically 110 meters long with 3 to 4 meter deep vertical sides, each on an 85 degree rounded slope. The width from wall to wall is 13 meters to 15 meters. The format for the men and women’s event is the same. Parallel Giant Slalom Two competitors race simultaneously side by side down two courses. They take two runs, switching sides after the first one. The setting of the courses, the configura- tion of the ground and the preparation of the snow must be as identical as possible. The format is the same for the men and women’s event. The vertical drop of the course must be between 120 meters and 200 meters. The number of turns should be equal to 11 percent to 15 percent of the vertical drop in meters. Athletes must navigate around gates, which are 20 meters to 25 meters apart. A gate consists of two poles - one outside pole and one turning pole. Triangular banners are fastened between the poles so lower edges of the flag touch the snow. The banner is 110 cm tall on its long side and 25 cm tall on the short side; its base length is 130 cm. -

Nbc and Chevy Come Together
NBC AND CHEVROLET COME TOGETHER TO CREATE BRANDED WINTER OLYMPIC PROMOTIONAL CAMPAIGN AND ‘MINI-MOVIE’ FEATURING OLYMPIC HOPEFULS Chevy-sponsored Olympic Mini-movie to Premiere During Hit NBC Series “Las Vegas” and Then Jump to The Big Screen in Over 10,000 Movie Theaters Nationwide Through National CineMedia BURBANK – January 6, 2006 – NBC and Chevrolet teamed to combine brand and marketing strategies to create a mini-movie to promote NBC’s coverage of the upcoming Torino Winter Olympic Games. The mini-movie, which integrates Olympic hopeful athletes and Chevy vehicles into the fictional story of three American fans at the Torino Games, will premiere during the Monday, Jan. 9 (9-10 p.m. ET) original episode of NBC’s “Las Vegas” and subsequently will be presented by National CineMedia in more than 10,000 AMC Entertainment, Cinemark, Regal Cinemas, United Artists, Edwards and other select national theaters beginning January 13. For the first time in NBC’s 40-year history of broadcasting the Olympics, Olympic hopefuls will make a primetime cameo appearance prior to the Olympic Games. Playing themselves, 2002 Olympic snowboarding halfpipe gold medalists Kelly Clark and Ross Powers, along with Olympic hopeful and U.S. Open champion Gretchen Bleiler, join the cast of the sexy, fast-paced “Las Vegas.” In the hit drama, the three emphatic fans from the mini-movie are seen following the athletes around and vying for their attention. At a key point in the episode, the fans are whooshed -- “Las Vegas” style – halfway around the world to Torino, Italy and into the mini-movie. -

By BOLLÉ ® by Developing the Design of Its Frames, Bollé® Adds a New Touch of Style to Its Technological Benefits
For close to 100 years, BOLLÉ has been providing men and women with technical eyewear that exceeds the demands of even the most active lifestyles. Our unwavering commitment to innovation means using the latest advancements in optics and the best new mate- rials to create the finest possible eyewear for both every- day wear and the precise requirements of specific sports and activities. An important aspect of this approach is working with top athletes, observing them in action and using their feedback to optimize every last detail. The 6th Sense and Breakaway are the latest examples of this unique approach. These models have lightweight, highly adjustable frames fitted with oversized lenses, providing complete protection and stunning visual acuity. The result is a sporting experience that is more instinctive, ensuring athletes achieve both excellence and a real connection with their environment. BOLLÉ’s commitment goes far beyond protection from the sun. Our inclusive approach to making sunglasses is vali- dated by today’s finer understanding of the many factors required for success at any given sport. We believe that excelling at sport at any level is tied to the profound moments of pure focus athletes feel when trying to surpass themselves, becoming one with their surroun- dings without regard to weather. In rain, wind and even under a harsh sun, BOLLÉ eyewear is the perfect acces- sory to feel the full intensity of the moment. To fully realize the many rewards of outdoor sports, every motion must be perfectly aligned with the athletes’ surroundings … And that’s only possible with a clear view of every single detail.