Sejour En Campanie 18-23 Mars 2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
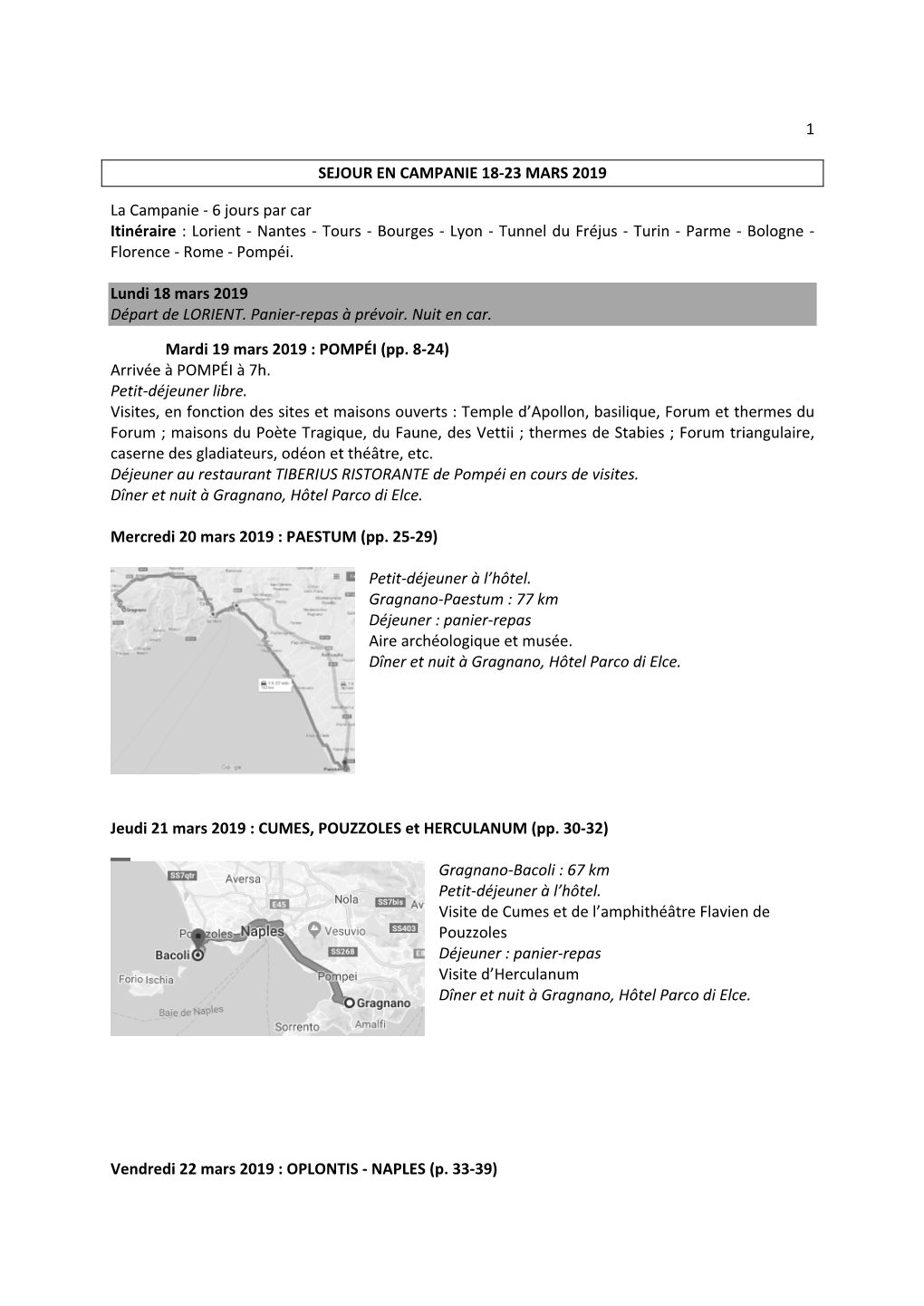
Load more
Recommended publications
-

Sightseeing Kampanien: Stadtführungen & Tickets
Sightseeing Volterra: Stadtführungen & Tickets Sightseeing Kampanien: Stadtführungen & Tickets www.viva-italia.it Privat-Transfer zwischen Flughafen Neapel und Hotels Genießen Sie einen entspannten Transfer zwischen dem Flughafen Neapel und Ihrem Hotel im Stadtzentrum. Entspannen Sie in der bequemen Mercedes-Luxuslimousine oder im Minibus und genießen Sie einen praktischen Service von Tür zu Tür. ab 35,- Euro pro Gruppe https://www.viva-italia.it/stadtfuehrung/index.php?region=Kampanien&category=152&Produkt=31437 Pompeji: Eintrittskarte Besuchen Sie die UNESCO-Welterbestätte von Pompeji mit einer reservierten Eintrittskarte. Erhalten Sie einen umfassenden Einblick in das Leben einer antiken römischen Stadt und erkunden Sie die archäologische Stätte in Ihrem eigenen Tempo. ab 22,- Euro pro Person https://www.viva-italia.it/stadtfuehrung/index.php?region=Kampanien&category=28&Produkt=69330 Herculaneum: Ticket mit bevorzugtem Einlass Überspringen Sie die Warteschlangen an der archäologischen Stätte Herculaneum, eine UNESCO-Welterbestätte und eine der weltweit am besten erhaltenen antiken Städte. ab 18,- Euro pro Person https://www.viva-italia.it/stadtfuehrung/index.php?region=Kampanien&category=27&Produkt=87431 Seite 1/126 milano24ore - 20065 Inzago (MI) - Via Collodi, 7a www.viva-italia.it [email protected] Sightseeing Volterra: Stadtführungen & Tickets Neapel: Eintritt in Bourbonen-Tunnel Genießen Sie eine Führung im Bourbonen-Tunnel, gebaut im Jahr 1853 von Ferdinand II. Erleben Sie eine bewegende Reise durch die Geschichte des unterirdischen Neapels. ab 10,- Euro pro Person https://www.viva-italia.it/stadtfuehrung/index.php?region=Kampanien&category=1&Produkt=165701 Ab Neapel: Tagestour durch Sorrent, Positano und Amalfi Erleben Sie die Schönheit der Amalfiküste auf einer Tagestour durch Sorrento, Positano und Amalfi. -

Villa Di Poppea - Oplontis
Villa di Poppea - Oplontis Il toponimo Oplontis ci è noto esclusivamente dalla Tavola Peutingeriana (mappa stradale risalente alla tarda età imperiale romana), collocato in un punto corrispondente all’odierna Torre Annunziata. Le testimonianze principali sono date da alcuni complessi residenziali: la cd. Villa di Poppea (villa A) ed il Complesso B. Il sito di Oplontis, insieme a Pompei ed Ercolano, è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. La villa di Poppea venne intercettata già nel Settecento tramite un cunicolo scavato a fianco del canale Conte di Sarno, ma la vera esplorazione per pozzi e gallerie si ebbe nell’Ottocento. Gli scavi archeologici moderni, condotti dal 1964 al 1984, hanno portato alla luce gran parte dell’edificio. L’impianto della villa, che si sviluppa principalmente attorno a due settori, l’atrio ed il peristilio, appare articolato tra portici, terrazze, ambienti residenziali ed un notevole impianto termale. Villa di Poppea, veduta generale L’ingresso antico dell’edificio era a Sud, in un’area già sconvolta nel Cinquecento dalla costruzione del Canale Conte di Sarno, che taglia in senso Est /Ovest tutta la parte meridionale della villa, in seguito ulteriormente danneggiata dalla costruzione di un pastificio. Il giardino era organizzato in un vialetto centrale ed altri laterali obliqui. Gli studi paleobotanici hanno permesso di riproporre la sistemazione originaria dello spazio verde, che ospitava nel suo tratto Est platani di cui si conservano i calchi. Di notevole rilevanza sono gli ambienti di riposo ubicati nel settore Sud-Ovest dell’atrio, per la ricchezza della loro decorazione parietale, con affreschi in II stile raffiguranti vedute prospettiche, ed altre stanze residenziali prospicienti il peristilio, anch’esse decorate con raffinati affreschi. -

Rome & Bay of Naples 2 Centre Location Guide Classics
ROME & BAY OF NAPLES 2 CENTRE LOCATION GUIDE CLASSICS Exceptional Tours Expertly Delivered Our location guide offers you information on the range of visits available in the Bay of Naples. All visits are selected with your subject and the curriculum in mind, along with the most popular choices for sightseeing, culture and leisure in the area. The information in your location guide has been provided by our partners in the Bay of Naples who have expert on the ground knowledge of the area, combined with advice from education professionals so that the visits and information recommended are the most relevant to meet your learning objectives. Making Life Easier for You This location guide is not a catalogue of opening times. Our Tour Experts will design your itinerary with opening times and location in mind so that you can really maximise your time on tour. Our location guides are designed to give you the information that you really need, including what are the highlights of the visit, location, suitability and educational resources. We’ll give you top tips like when is the best time to go, dress code and extra local knowledge. Peace of Mind So that you don’t need to carry additional money around with you we will state in your initial quote letter, which visits are included within your inclusive tour price and if there is anything that can’t be pre-paid we will advise you of the entrance fees so that you know how much money to take along. You also have the added reassurance that, WST is a member of the STF and our featured visits are all covered as part of our externally verified Safety Management System. -

Diapositiva 1
IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions and Culture March 22-24, 2014 Patras, Greece The Augustan aqueduct of Serino in the context of road system and urbanization of the served territory in Southern Italy Giacinto Libertini, Bruno Miccio, Nino Leone and Giovanni De Feo Emperor Marcus Vipsanius Agrippa, Gaius Julius Caesar Octavianus brotherly fellow of Augustus, Divi Filius Augustus pivotal pillar of Augustus success and power, and builder of the Augustan aqueduct The Augustan aqueduct of Serino (Aqua Augusta) was exceptional in size (the main trunk about 103 km long, the branches about 60 km). It served 13 towns, the civil port of Puteoli (one of the two most important civil ports of the Empire, the other was Alexandria in Aegyptus), the military port of Misenum (one of the two most important military ports of the Empire, the other was Ravenna), and many villas of eminent figures. Atella Acerrae Nola Cumae Neapolis Puteoli villae Baia Palepolis Bavli Herculaneum Misenum Pompeii villae Oplontis portus civilis portus militaris (Puteoli) (Misenum) Here, the Augustan aqueduct is examined in the rich context of the cities and roads existing in the Roman age in the crossed area. In Roman times (like today), the area was very fertile and densely populated. Many ancient centers are still in existence and many ancient roads coincide with the modern road layouts. Allifae Cubulteria Formiae Teanum Suessa Telesia Minturnae Trebula Cales Forum Popilii Sinuessa Caiatia Beneventum Urbana Casilinum Saticula Ad Octavum Capua Caudium Calatia Ad Novas Volturnum Vicus Feniculensis Atella Suessula Nola Acerrae Abellinum Liternum Neapolis Ad Teglanum Cumae Puteoli Baia Palepolis Urbula Bavli Herculaneum Misenum Pompeii Oplontis Nuceria Salernum Stabiae The centuriations existing in the same area were also considered. -

A Week in Naples with Allan Langdale (Including Pompeii, Herculaneum & Paestum)
A Week in Naples with Allan Langdale (including Pompeii, Herculaneum & Paestum) Detail of 13th century mosaics in the Naples cathedral General Description: This is an in-depth week in Naples and its environs, including Pompeii, Herculaneum, Paestum, and other significant art, archaeological, and architectural sights. It includes visits to the Museo Nazionale to see the artefacts from Pompeii and Herculaneum, a visit to the Capodimonte Museum, the catacombs of San Gennero, and various other wonderful sights of the city. Tour Leader: Dr. Allan Langdale is an art and architectural historian who has travelled widely in Italy, Turkey, Greece, and other Mediterranean and Middle Eastern countries. He often works on trips for Smithsonian Journeys, Lindblad/National Geographic, and Zegrahm Expeditions. He is the author of several articles and books such as In a Contested Realm: An Illustrated Guide to the Art, Archaeology, and Architecture of Northern Cyprus (2012), Palermo: Travels in the City of Happiness (2015), and The Hippodrome of Constantinople: An Illustrated History (2018). You can find out more about Allan, and follow his travel blog, by searching on the internet for Allan’s Art and Architecture Worlds. Itinerary: Day 1 (April 2): Flights from Canada / USA to Naples. I’ll try to meet you at airport. Transfers to hotels / rooms via Alibus and metro. Day 2 (April 3): Meet 10:00 am for walk to the cathedral of Naples AM; lunch, then walk through the old town and take the funicular to the outlook below Castle St Elmo. Dinner on your own. Day 3 (April 4): Meet 9:00 am and take bus to Capodimonte Museum. -

The Portico Belvedere: an Experience of Iconography, Illusion and Impressions Upon the Soul
The Portico Belvedere: An Experience of Iconography, Illusion and Impressions upon the Soul Phyllis J. Henderson (University of Florida) Abstract. Literally meaning “beautiful view” in Italian, the belvedere is an architectural construct designed precisely for the enjoyment of a view or intellectual connection to the landscape.1 The belvedere first took shape behind the summer dwellings along the coast of Italy when the architecture of the traditional Italic atrium villa experienced a gradual, yet crucial twist over the course of the second century B.C. Borrowing from Greek public buildings, the Hellenistic suburban villa replaced the static garden located at the rear of the house with the dynamic peristyle garden and the ambulatory portico belvedere that critically transformed the most basic function of the garden through the superimposition of physical and metaphysical experience. The belvedere is brought to light through historical hermeneutic interpretation, archaeological analysis and the case studies of the Villa Arianna, the Villa Poppaea at Oplontis and the Villa of the Mysteries with literature from Vitruvius, Cicero, Virgil and Pliny the Younger; each contributing a unique perspective that collectively describe the experience of the ancient Roman portico belvedere. Examining first the key physical aspects of the peristyle garden, this analysis explores phenomenological features that underscore the spatial perception and experience of the peristyle portico as a belvedere. Quite different from our present-day understanding of a belvedere as a static scenic overlook, the ancient portico belvedere is proposed as a physical mediator between the real and the illusionary, between the past and the present, between the human and the divine. -

Tourhighlights.Private Naples.4.12
Private Naples: Exemplary Palaces, Villas, Gardens & Archeological Sites Sponsored by the Institute of Classical Architecture & Art Organized by Pamela Huntington Darling, Chargée de Mission & Patron Member Saturday, October 17 to Sunday, October 25, 2015: 8 days & 8 nights The ancient port city of Naples’ rich and compelling history dates back nearly 3,000 years and bears the traces of the early Greeks, Romans, Byzantines and Normans and the later European powers of Spain, Austria and France. For decades Naples was one of the great capitals of Europe, reaching its cultural zenith during the reign of Charles VI, under whose reign Herculaneum and Pompeii were rediscovered, the palaces of Portici and Capodimonte were built and the Archeological Museum was founded. A UNESCO World Heritage Site, Naples' historic city center is the largest in the world. Our exclusive program, organized and conducted by Pamela Huntington Darling, will offer an intimate group of discerning travelers privileged access to sites of unparalleled historic importance and incomparable beauty in Naples, Ravello, Positano, the Phlegraean Fields Pompeii and Herculaneum—most listed as UNESCO World Heritage Sites. Guided by our expert lecturer, we will discover admirable private palazzi and villas, monuments and museums to observe masterpieces of architecture, art, interior and garden design, as well as some of the world's foremost archeological sites. We will be received by Italian nobility and esteemed members of the Neapolitan cultural elite for exclusive visits, luncheons, receptions and dinners in their remarkable private residences with admirable décor, museum-quality art and antiques, marvelous gardens and views of the Bay of Naples. -
RAG Vol 13 Issue 1
Roman Archaeology Group Inc Volume 13, Issue 1 May, 2018 The RAG Ulrich Jasper Seetzen and the Remains of the Past IN THIS ISSUE in Northwest Jordan David Kennedy The Middle East has undergone an enormous transformation since the First World War. The latter introduced twentieth century highly mechanised warfare to a region that had been a relative backwater of the fading Ottoman Empire. The subsequent carving up of the region into French (Lebanon and Syria) and British (Iraq, Transjordan and Palestine) Mandates brought about further changes largely unknown previously: Seetzen and the Remains of 1 aeroplanes were now a feature of the skies where they had been virtually the Past in NW Jordan unknown before; networks of surfaced roads were built; and efficient David Kennedy militaries created widespread security within a few years. Towns grew, deserted villages began to repopulate and overall populations grew. Despite that, by the early 1940s, Transjordan (= modern Jordan) still had only c. 340,000 people and Amman is estimated to have had 45,000 residents. Since then all of this has undergone a further shift of gear, the developments of the 1920s and 1930s massively eclipsed by those since the 1940s and especially the last 40 years. The explanation – and the consequences, for Jordan and its When in Rome... 5 archaeology can be summed up in two words: population explosion. The 340,000 of the early 1940s has given way now to c. 8 million, about half Various Contributors of them in metropolitan Amman. Western travellers in the region in the 19th century routinely report passing ruined and uninhabited villages, riding alongside Roman roads often still marked by milestones, seeing decayed field boundaries and terracing every. -

The Garden Room of the Villa of Livia Ad Galinas Albas At
Secret Gardens: The Garden Room of the Villa of Livia Ad Galinas Albas at Prima Porta Marianne Cole The Department of Art History and Communications Studies McGill University, Montreal A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Masters of Arts (Art History), 2015-2017 © Marianne Cole, April, 2017 Cole 1 Cole 2 Table of Contents Abstract…………………………………………………………………………………………………...3 Acknowledgements……………………………………………………………………………………...5 Introduction……………………………………………………………………………………………...7 The Garden Room……………………………………………………………………………………....8 Function………………………………………………………………………………………………...11 The Villa of Livia……………………………………………………………………………………...13 Walking Through the Villa: Atrium………………………………………………………………….24 The Large Terrace……………………………………………………………………………………..26 The Small Garden……………………………………………………………………………………...29 Peristyle Garden……………………………………………………………………………………….32 Art and Artifice………………………………………………………………………………………...34 Conclusion……………………………………………………………………………………………...43 Bibliography…………………………………………………………………………………………....45 Appendix…………………………………………………………………………………………….…53 Cole 3 Abstract English Now at the Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo alle Terme, the so-called Garden Room once adorned the semi underground room at the imperial estate of emperor Augustus and his wife Livia, the Villa of Livia Ad Gallinas Albas at Prima Porta. A unique example of Roman domestic decor, the Garden Room has been the subject of numerous archeological and art historical studies. Yet most studies have isolated the Garden Room frescoes from the wider spatial context of the villa itself. In this thesis, I explore the illusionism of the garden scene and the distinctive way in which it relates to the design of the Villa of Livia as a whole to create a space that brings the Augustan iconography of abundance vividly to life. The significance of the Garden Room frescoes begins beyond the room itself; it is entrenched in the villa’s mythological and material history as well as its architecture and design. -

Univerzita Palackého V Olomouci Filozofická Fakulta Katedra Historie
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE ZAHRADY A PARKY JAKO SOUČÁST OBYTNÉHO A VEŘEJNÉHO PROSTORU VE STAROVĚKÉ ITÁLII Bakalářská diplomová práce Autor práce: Zuzana Fojtíková Vedoucí práce: PhDr. Ivana Koucká Nezamyslice 2010 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškeré prameny, literaturu i ostatní zdroje, které jsem použila. V Nezamyslicích, 12. srpna 2010 ………………………………… 2 Poděkování Na začátku své bakalářské práce bych ráda zmínila několik poděkování. V první řadě paní PhDr. Ivaně Koucké za odborné vedení, užitečné rady a pomoc při psaní této práce. Další poděkování tímto směřuji nynější knihovnici Mgr. Martě Hoffmanové z Kabinetu pro klasická studia při Filozofickém Ústavu Akademie věd ČR v Praze za ochotu, kterou vynaložila při hledání nejrůznějších pramenů a publikací vztahujících se k tématu mé bakalářské práce. V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem mým blízkým, kteří mi s tvorbou bakalářské práce přímo či nepřímo pomáhali. Ať už se jedná o technickou stránku práce (tvorba obrázkové přílohy apod.) nebo poskytování psychické podpory. 3 Obsah Úvod 5 1. Základní písemné a archeologické prameny 8 2. „Obecné“ pojmy týkající se zahrad 12 2.1. Hortus, heredium, holerarium, pomarium.................................................. 13 2.2. Ars topiaria, viridarium.............................................................................. 15 2.3. Domus ....................................................................................................... -

The Arts Society Ealing Spring 2020 Tour
The Arts Society Ealing Spring 2020 tour - The History of the Amalfi Coast 26 April to 1 May 2020 Background Naples is filled with evidence of many centuries of occupation blended into the fabric of the present-day city. This complex heritage, from ancient Greeks and Romans to the dukes, kings and queens of the Middle Ages and beyond, has contributed to a rich store of galleries and museums, ancient amphitheatres and ruins, as well as churches, monasteries, royal palaces and monuments. The Bay of Naples and the Amalfi Coast have some of Italy’s finest scenery. Weather Late April the average temperature should be around 20C. Flights British Airways from Gatwick departing 15.55h, arriving 19.45h. Return from Naples departing 19.15h, arriving 21.05h. Transport to Gatwick Airport from home will be arranged at separate cost for those that need it. Accommodation - 4* Hotel Due Golfi. www.grandhotelduegolfi.com We stay five nights on a half board basis. The hotel is located a five minute walk from the centre of the village of Sant’ Agata sui Due Golfi, and a fifteen minute drive from Sorrento. Facilities at the hotel include a restaurant, bar and outdoor swimming pool. All rooms are en suite and have tea/coffee making facilities. Itinerary We plan to visit the following: ● Amalfi Coast ● Belvedere Positano ● Ravello ● Herculaneum ● Oplontis & Villa Poppaea ● Mount Vesuvius ● Pompeii ● Paestum ● Naples Price £1049 per person. Single Supplement £159 Price Includes: Not included in the price: Air travel and departure taxes Holiday insurance Five nights’ accommodation on half board (dinner, Tips to hotel. -

Virtual Reality in the Ancient Roman World Dissertation Presented In
Creating the Elsewhere: Virtual Reality in the Ancient Roman World Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Michael R. Bowman, M.A. Graduate Program in History of Art The Ohio State University 2015 Dissertation Committee: Mark D. Fullerton, Advisor Timothy J. McNiven Kristina B. Paulsen Copyright by Michael R. Bowman 2015 Abstract At first glance the ancient world may seem an odd place to study concepts of virtuality, but I believe that looking at the art and architecture of the ancient Romans through the modern lens of the virtual can provide surprising insights into how these spaces were viewed, experienced, and understood by their ancient users and may elucidate a further factor in the development of Roman painting beyond mere changes in aesthetic taste. Using a reexamined definition of the “virtual” that divorces it from a reliance on the digital and modern technology, I will investigate how ancient spaces were used to create environments that were intended to transport the viewer to another often distant or fantastic place, to a virtual “elsewhere.” In explaining how these Roman spaces worked to effect such “transportation” through their architectural forms and decorative schemata, I have had recourse to two primary theoretical frameworks. The first is the burgeoning sub-field of cognitive linguistics known as Text-world Theory, which attempts to provide an understanding of how humans universally process discourse through the creation of mental “worlds” into which they project themselves, a projection which I believe forms the basis of virtual experience.