2008Studiaalbanica1.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
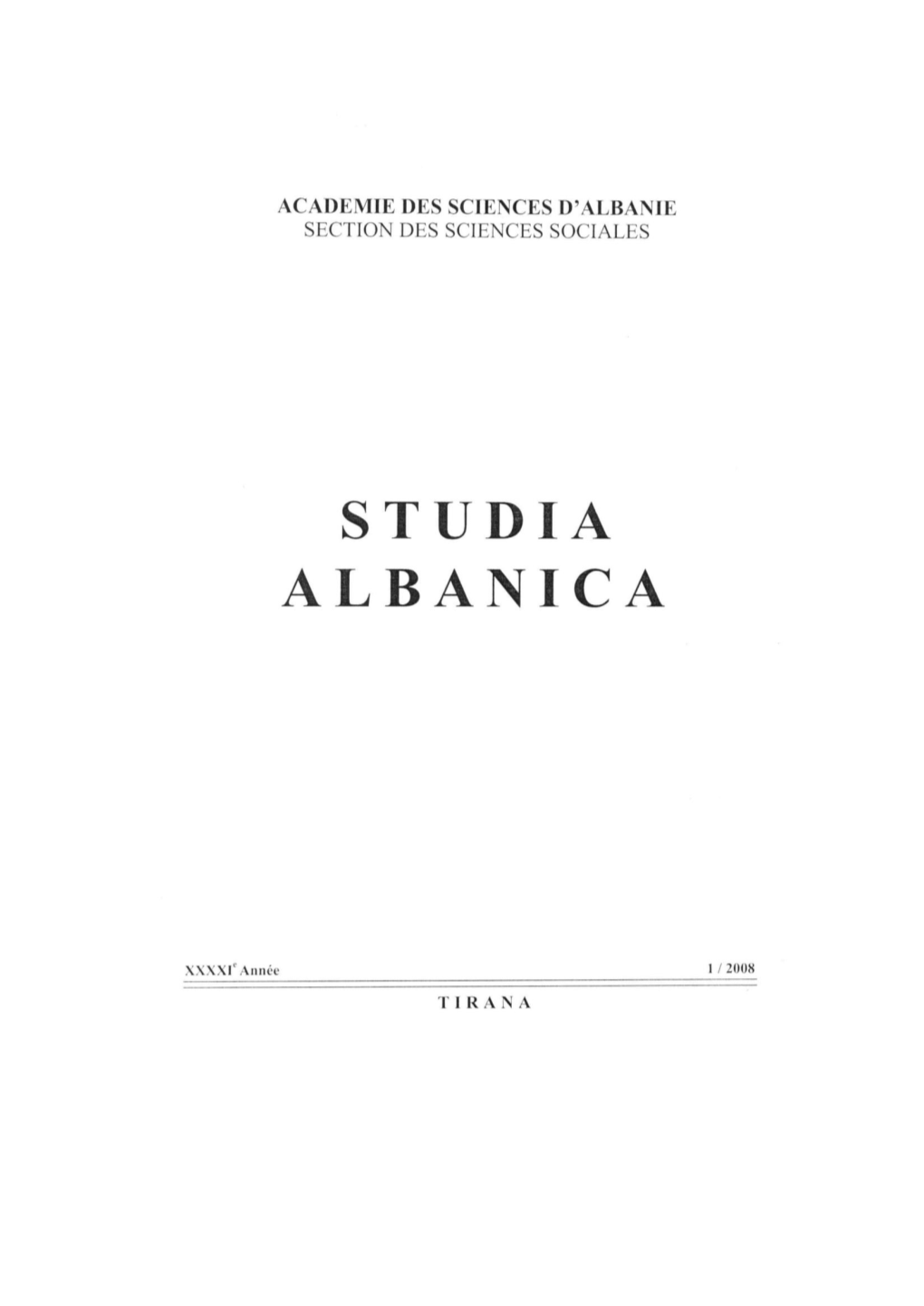
Load more
Recommended publications
-

Western Balkans Stability Monitor
Western Balkans Stability Monitor December 2018 Issue* * The issue is published in December and primarily covers issues occurring in the previous month. Table of contents Regional Overview 4 Albania 6 Government Stability 7 Opposition Activities 7 Regional Relations 8 Security 9 Looking Forward 10 Bosnia-Herzegovina 11 Government Stability 12 Opposition Activities 14 Regional Relations 15 Security 16 Looking Forward 17 Kosovo 18 Government Stability 19 Opposition Activities 20 Regional Relations 21 Security 23 Looking Forward 24 Macedonia 25 Government Stability 26 Opposition Activities 27 Regional Relations 29 Security 30 Looking Forward 31 2 Montenegro 32 Government Stability 33 Opposition Activities 34 Regional Relations 35 Security 36 Looking Forward 37 Serbia 38 Government stability 39 Opposition activities 40 Regional relations 41 Security 42 Looking Forward 43 About Risk Dimensions 44 War 44 Terrorism 44 Government Instability 44 Civil Unrest 44 Ethnic Unrest 44 About 45 Contact 45 3 Regional Overview Instability across the region remained unevenly spread over the last month in the Western Balkans. While most of the countries of the region remained broadly stable, Bosnia-Herzegovina and Kosovo set themselves apart as pockets of real – or possible – instability. In the case of Bosnia, the risk of instability largely derived from the post-election challenge of forming ruling coalitions at different levels of government. The process of ethnic coalition building can be challenging enough at the best of times. However, this time around it is compounded by the lack of a legal basis for forming part of the Federation entity’s Parliament (the upper House of Peoples), without which the Federation entity government cannot be formed. -

Monumentet Qarku Gjirokaster
LISTA E MONUMENTEVE TË KULTURËS - QARKU GJIROKASTËR ADRESA TË DHËNA TË SHPALLJES NR. EMËRTIMI I MONUMENTIT KATEG. NJ. INSTITUCIONI/ LAGJJA FSHATI BASHKIA QARKU ADMINISTRATIVE NR. VENDIMIT/ DATA 1. Vendim i Institutit i Shkencave (botuar në Gazetën Zyrtare Nr. 95, dt. 16.10.1948); 2.Rektorati i Universitetit Shtetëror të Tiranës/ 1 KALAJA E GJIROKASTRËS I Gjirokastër Gjirokastër Gjirokastër nr. 6/ dt. 15.01.1963 3.Ministria e Arsimit dhe Kulturës/nr.1886/ dt.10.06.1973 1.Rektorati i Universitetit Shtetëror të Tiranës/ nr. 6/ dt. 15.01.1963 2 KALAJA E MELANIT I Nepravishtë Qender Libohove Libohovë Gjirokastër 2.Ministria e Arsimit dhe Kulturës/nr.1886/ dt.10.06.1973 1.Rektorati i Universitetit Shtetëror të Tiranës/ nr. 6/ dt. 15.01.1963 3 KALAJA E LABOVËS SË KRYQIT I Labovë e Kryqit Qender Libohove Libohove Gjirokastër 2.Ministria e Arsimit dhe Kulturës/nr.1886/ dt.10.06.1973 1.Rektorati i Universitetit Shtetëror të Tiranës/ nr. 6/ dt. 15.01.1963 4 KALAJA SELOS I Selo Dropull I Siperm Dropull Gjirokastër 2.Ministria e Arsimit dhe Kulturës/nr.1886/ dt.10.06.1973 1.Rektorati i Universitetit Shtetëror të Tiranës/ 5 KALAJA E SHTËPEZËS I Shtëpezë Picar Gjirokastër Gjirokastër nr. 6/ dt. 15.01.1963 2.Ministria e Arsimit dhe Kulturës/nr.1886/ dt.10.06.1973 1.Rektorati i Universitetit Shtetëror të Tiranës/ 6 KALAJA E JERMËS I Saraqinisht Antigone Gjirokastër Gjirokastër nr. 6/ dt. 15.01.1963 2.Ministria e Arsimit dhe Kulturës/nr.1886/ dt.10.06.1973 1.Rektorati i Universitetit Shtetëror të Tiranës/ 7 KALAJA E KARDHIQIT I Kardhiq Cepo Gjirokastër Gjirokastër nr. -

1167821.En Pe 629.960
Question for written answer P-005565/2018 to the Commission Rule 130 Eleftherios Synadinos (NI) Subject: Ethnic Greek European citizen executed by Albanian police On 28 October, Greek National Day, commemorating the refusal of Greece to acquiesce in the savagery of other European states, its resistance to the massive Nazi offensive and its victory in Northern Epirus, Konstantinos Katsifas, an ethnic Greek, was gunned down by the Albanian authorities under circumstances that as yet remain unclear. It appears that the shooting occurred after he had raised a Greek flag at the Greek military cemetery during the official annual celebration held by Greek residents in the village of Bularat in Gjirokastër, some six kilometres from the border with Greece. It is here that those who fell during the epic struggle on the Albanian front are buried1 2. A political organisation representing the Greek ethnic minority in Albania has accused the Albanian police of carrying out a ‘coldblooded execution’ and of disregarding established procedures. It also complains of a wave of anti-Greek propaganda and a growing undercurrent of hostility towards the ethnic Greek minority3. In view of this: 1. Will the Commission launch an impartial investigation into what was effectively a breach of the human rights of a European citizen, in view of the EU-Albania accession negotiations? 2. Given that the Protocol of Corfu, which was ratified but not implemented, was never annulled by a subsequent agreement, will the Commission include it in the accession negotiations, underlining the need to ensure good neighbourly relations, with a view to upholding the rights of the Greek minority in Albania? 3. -

Krištín Paper.Indd
Raptor Journal 2020, 14: 15 – 22. DOI: 10.2478/srj-2020-0004 © Raptor Protection of Slovakia (RPS) Diet of the lesser kestrel Falco naumanni at post-breeding roosts in southern Albania Potrava sokola bielopazúrového Falco naumanni na pohniezdnych nocľažiskách v južnom Albánsku Anton KRIŠTÍN, Tomáš BĚLKA, David HORAL & Taulant BINO Abstract: The lesser kestrel is an insectivorous and migratory falcon species, frequently using communal roosts in the post- breeding period in southern Europe. Using pellet analysis from two post-breeding roosting sites in southern Albania collected in August 2017, we identifi ed 1539 prey items belonging to approximately 58 prey species, 20 families and 7 orders in 110 pellets from two sites. Invertebrates made up the major part of the diet spectrum (PNI = 99.8 %, PFI = 100 %). Invertebrate prey body size varied between 8 and 62 mm (mean 28.1 mm). Bush-crickets (Tettigoniidae) and locusts (Acrididae) were the most abundant and frequent prey groups (PNI = 33 % resp. 48.6 % and PFI = 97 % resp. 94 %). Within the bush-cricket family we could identify the species of genera Tettigonia, Decticus, Platycleis, Isophya and Metrioptera. The species of genera Calliptamus, Stenobothrus and Locusta belonged among the locust species identifi ed in the food. Birds and mammals were found in pellets only occasionally. The prey composition was rather similar at both studied sites, while locusts (Acrididae) were more abundant at the Jorgucat site and bush-crickets (Tettigonioidea) at the Mollas site in the same time. Prey groups Scarabeidae beetles and other beetles (Coleoptera other) were more abundant and frequent at Mollas than at Jorgucat, and spiders were more frequent at Jorgucat. -

United Nations Nations Unies UX'nwiricted
United Nations Nations Unies UX'NWiRICTED SECTJRITY CONSEIL s/:90 26 June 1947 COUNCIL DE SECURITE EXGLISEI . &; ..,.! '. .>..:\-;'I : 4%' ORIGINAL: FRiZ?CH ....<.T:I.')'..,,, -. 3 : DAmD 25 JUNE‘1947 New York, 25 June 1947 +$$l accordance with instructions from my Government, I have tke honour ,.l.z:: bring_tQ.YourI, _.#_. notice somefresh provocations comnitted by the Greek military frontier authorities and by Greek aeroplanes against our frontiers. 1. ,$ $8 May at Al:30 a.m. neat the village of Dpsadlie de Pogoni (Lfbohove), +rl.:a$, q$d Ho. 18 east-of the vlUage, ten Greek eoldlers fired several shots i~~r~q?:$irectlon of our territory from a distance of 500 metres from the aemarkatia line. After this they entered our territory to a depth of 50 metres for a few ml&tee an& then withdrew. Our patrol did not open fire . -.,-on thepr! 3-. On 19 May at ll:OO a.m. a few Greek soldiers lying in ambushin the neighbourhood of pyrsmid Do. 55 (Vidohove sector of Devolli, Kortcha) fired on ourptrol, while the latter..was on duty well inslde our terrltov. Our patrol dia not return the fire. 3. On 22 RXy at 4:30 p.m. a Greek aeroplane flew over the town of Saranda, Konispol, and crosaea the demarkation line as far as CapeStLlo; then, before ?.$%ng_.!_ ror Corfu, it flew over the coast from Cape StClo:as far as Kskome. It ~s.fIly~~.I. at a height of about a thousand metres. 4. On 22 my a Greek aeroplane .coming fromGreece passed over pyramid No. -

“FIERI, BAZE TRANSITI PER HEROINEN E AFGANISTANIT” Lista Me 1500 Përfituesit Nga E Gjithë Shqipëria “Droga, Ka Grupe Më Të Fuqishme Se Habilajt Me Lidhje Politike
Kryeredaktor: Erl MURATI Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116 E-mail:[email protected] Viti XXIII - Nr. 7347 E mërkurë 8 Nëntor 2017 Çmimi, 50 lekë (1.5 euro) Opinioni Nga SULEJMAN MATO Opinioni i Ditës i Ditës Nga ZOJE JAKAJ itullin e këtij shkrimi e kam të ë hapen shkolla riedukimi për Tkonvertuar nga tregimi i Ismail Profetët Ttë rinj që abuzojnë me lëndët Shkolla riedukimi Kadaresë, “Strategët e kafeneve”, pasi narkotike dhe kanë tendenca të profetët e sotëm të kafeneve u ngjajnë e kafeneve kthehen në hajdutë dhe vrasës, në vend të burgut shumë strategëve ...- Vijon në faqen 20 ndryshe ky vend... Vijon në faqen 21 INTERVISTA II/ FLET BLEDAR NAÇI, OFICERI I ANTIDROGES I DEKORUAR NGA TAHIRI 3 FAQE SPECIALE “FIERI, BAZE TRANSITI PER HEROINEN E AFGANISTANIT” Lista me 1500 përfituesit nga e gjithë Shqipëria “Droga, ka grupe më të fuqishme se Habilajt me lidhje politike. Trafikanti na tha ‘përgjimet që keni në zyrë, i dëgjoj në shtëpi’. Incidenti me policinë e Vlorës” “Ish-pronarët që REAGIMET POLITIKE INTERVISTA Prokuroria nis kanë aplikuar në hetimin pasuror për Tahirin dhe familjen e tij 1995-n, një muaj Në faqen 6 U DENUA 25 VITE afat për dosjet” Gjykata liron nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, apel: Futeni në fondin e burgu Genc Tafilin, kompensimit këtë vit, nëse plotësoni dokumentacionin që ju mungon Presidenti Meta e Nga ORNELA MANJANI prokuroria: Të hetohen Janë rreth 1500 dosje ish-pronarësh që presin kompen- Në faqen 9 simin nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, por që nuk kanë plotësuar gjithë dokumentacionin në përputhje DEBATET NE KOMISION me ligjin për trajtimin e pronës. -

Sustainability of the Karst Environment Dinaric Karst and Other Karst Regions
The designations employed and the presentation of material throughout the publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or the delineation of its frontiers or boundaries. Published in 2010 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP Printed by UNESCO © UNESCO 2010 IHP-VII/2010/GW-2 SUSTAINABILITY OF THE KARST ENVIRONMENT DINARIC KARST AND OTHER KARST REGIONS International Interdisciplinary Scientific Conference (Plitvice Lakes, Croatia, 23-26 September 2009) Convened and Organised by: Centre for Karst (Gospi, Croatia) International Scientific Committee Ognjen Bonacci (Croatia), Chairman Franci Gabrovšek (Slovenia) Mladen Jurai (Croatia) Božidar Biondi (Croatia) Wolfgang Dreybrodt (Germany) Arthur Palmer (USA) Derek C. Ford (Canada) David Culver (USA) Andrej Mihevc (Slovenia) Jacques Mudry (France) Daoxian Yuan (China) Nico Goldscheider (Switzerland, Germany) Zoran Stevanovi (Serbia) Mario Parise (Italy) Hans Zojer (Austria) Elery Hamilton - Smith (Australia) Neven Kreši (USA) Bartolomé Andreo (Spain) Local Organizing Committee Jadranka Pejnovi, Chair Željko Župan, Secretary Ivo Lui Neven Boi Aleksandar Luki Ljudevit Tropan Dubravka Kljajo Krešimir ulinovi Ivica Tomljenovi Foreword The objective of the international interdisciplinary scientific conference “Sustainability of the karst environment - Dinaric karst and other karst regions”, organized by Centre for Karst, Gospi, Croatia, was to give a theoretical and practical contribution to the concept of sustainable development in karst regions, with a special emphasis on the experiences achieved in the Dinaric karst region. The exchange of information and findings obtained in other karst regions worldwide allows for an integral approach to this complex issue, and thereby contribute towards finding reliable solutions. -

Pakistan Journal of Botany
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/313842333 RELIGIOUS DIFFERENCES AFFECT ORCHID DIVERSITY OF ALBANIAN GRAVEYARDS Article · February 2017 CITATIONS READS 4 142 7 authors, including: Attila Molnár V. Zoltán Barina University of Debrecen Hungarian Natural History Museum 157 PUBLICATIONS 610 CITATIONS 64 PUBLICATIONS 361 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Gábor Sramkó Jácint Tökölyi Hungarian Academy of Sciences University of Debrecen 92 PUBLICATIONS 495 CITATIONS 43 PUBLICATIONS 284 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Hydra Eco-Evo-Devo View project NKFIH K-119225 - How can plant ecology support grassland restoration? View project All content following this page was uploaded by Attila Molnár V. on 19 February 2017. The user has requested enhancement of the downloaded file. Pak. J. Bot., 49(1): 289-303, 2017. RELIGIOUS DIFFERENCES AFFECT ORCHID DIVERSITY OF ALBANIAN GRAVEYARDS ATTILA MOLNÁR V.1,2*, ATTILA TAKÁCS1,2, EDVÁRD MIZSEI3, VIKTOR LÖKI1, ZOLTÁN BARINA4, GÁBOR SRAMKÓ1,2 AND JÁCINT TÖKÖLYI5 1Department of Botany, University of Debrecen, Egyetem tér 1., H-4032, Debrecen, Hungary 2MTA-DE “Lendület” Evolutionary Phylogenomics Research Group, University of Debrecen, Egyetem tér 1., H-4032, Debrecen, Hungary 3Department of Evolutionary Zoology, University of Debrecen, Egyetem tér 1., H-4032, Debrecen, Hungary 4Department of Botany, Hungarian Natural History Museum, H-1431 Budapest, Pf. 137, Hungary 5MTA-DE “Lendület” Behavioural Ecology Research Group, University of Debrecen, Egyetem tér 1., H-4032, Debrecen, Hungary *Corresponding author’s email: [email protected], Phone: +36-52-/512-900/62648 ext. -
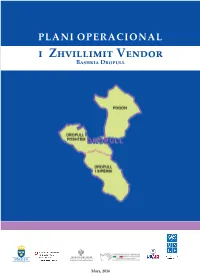
Bashkia Dropull.Pdf
PLANI OPERACIONAL i Zhvillimit Vendor Bashkia Dropull PB Bashkia Dropull Plani Operacional i Zhvillimit Vendor 1 Mars, 2016 Përgatitur nga: Akademia e Studimeve Politike 2 Bashkia Dropull Plani Operacional i Zhvillimit Vendor 3 Tabela e Përmbajtjes 1. Nevoja për një Plan Operacional për Investime 4 2. Plani operacional afatshkurtër në perspektivën e qeverisjes lokale dhe proceseve planifikuese 6 3. Metodologjia për përgatitjen e POZHL 8 4. Diagnoza 10 4.2 Zhvillimi ekonomik 10 4.3 Mirëqënia ekonomike dhe sociale 13 4.4 Burimet natyrore dhe qëndrueshmëria mjedisore 15 4.5 Konkluzione 15 5.Përcaktimi i problemeve dhe prioriteteve operacionale afat-shkurtra duke përfshirë pemën e problemeve 16 5.1 Pema e problemeve 17 5.2 Plani operacional 20 6. Vizioni strategjik 32 7. Harta dhe foto 33 8. Anekse 35 2 Bashkia Dropull Plani Operacional i Zhvillimit Vendor 3 Nevoja për një Plan Operacional 1. të Investimit Projekti i hartimit të Planit Operacional të Zhvillimit Lokal (POZHL) u iniciua nga Mi- nistri i Shtetit për Çështjet Vendore në bashkëpunim me projektin STAR, të menaxhuar nga UNDP. Projekti STAR ka ardhur si një reagim i menjëhershëm i mbështetjes që donatorë të ndryshëm ofruan për Qeverinë në përpjekjet e ndërmara për zbatimin e reformës admini- strative territoriale. Hartimi i POZHL rezulton si sfidë kryesore dhe nevojë imediate për të patur një plan të integruar të veprimeve dhe masave që bashkia e re duhet të marrë, për të si- guruar kohezionin administrativ dhe territorial të të gjitha njësive administrative të saj, pas reformës territoriale. Sigurimi i kohezionit administrativ dhe territorial kërkon masa dhe veprime që mund të përfshijnë ristrukturimin administrativ, të shërbimeve administrative dhe shërbimeve publike, të infrastrukturës lidhëse të njësive administrative etj. -

Monumentet Qarku Vlore
LISTA E MONUMENTEVE TË KULTURËS - QARKU VLORË ADRESA TË DHËNA TË SHPALLJES NR. EMËRTIMI I MONUMENTIT KATEG. NJ. INSTITUCIONI/ LAGJJA FSHATI BASHKIA QARKU ADMINISTRATIVE NR. VENDIMIT/ DATA 1.Rektorati i Universitetit Shtetëror të KALAJA E MAVROVËS NË Tiranës/ nr. 6/ dt. 15.01.1963 1 I Mavrovë Kotë Selenicë Vlorë FSHATIN MAVROVË 2.Ministria e Arsimit dhe Kulturës/nr.1886/ dt.10.06.1973 1.Vendim i Institutit i Shkencave (botuar në Gazetën Zyrtare Nr. 95, dt. 16.10.1948) KALAJA E KANINËS NË 2 I Kaninë Qendër Vlorë Vlorë Vlorë 2.Rektorati i Universitetit Shtetëror të FSHATIN KANINË Tiranës/ nr. 6/ dt. 15.01.1963 3.Ministria e Arsimit dhe Kulturës/nr.1886/ dt.10.06.1973 1.Rektorati i Universitetit Shtetëror të KALAJA E VRANISHTËS NË Tiranës/ nr. 6/ dt. 15.01.1963 3 I Vranisht Horë- Vranisht Himarë Vlorë FSHATIN VRANISHT 2.Ministria e Arsimit dhe Kulturës/nr.1886/ dt.10.06.1973 1.Rektorati i Universitetit Shtetëror të KALAJA E CERJES NË Tiranës/ nr. 6/ dt. 15.01.1963 4 I Brataj Himarë Himarë Vlorë FSHATIN BRATAJ 2.Ministria e Arsimit dhe Kulturës/nr.1886/ dt.10.06.1973 1.Rektorati i Universitetit Shtetëror të KALAJA E HIMARËS NË Tiranës/ nr. 6/ dt. 15.01.1963 5 I Himarë fshat Himarë Himarë Vlorë FSHATIN HIMARË 2.Ministria e Arsimit dhe Kulturës/nr.1886/ dt.10.06.1973 1.Rektorati i Universitetit Shtetëror të KALAJA E GJON BOÇARIT NË Tiranës/ nr. 6/ dt. 15.01.1963 6 I Tragjas Orikum Vlorë Vlorë FSHATIN TRAGJAS 2.Ministria e Arsimit dhe Kulturës/nr.1886/ dt.10.06.1973 1.Vendim i Institutit i Shkencave (botuar në Gazetën Zyrtare Nr. -

Download This PDF File
July 2020 e-ISSN: 1857-8187 p-ISSN: 1857-8179 https://doi.org/10.5281/zenodo.4149017 Case Study Linguistics ERROR ANALYSIS OF PASSIVE IN THE WRITINGS OF ALBANIAN Keywords: Be, modal, transitive, non-transitive, by, passive voice, contrastive analysis, error analysis, LEARNERS OF ENGLISH data analyzing. Përparim Skuka University of Tetova “Fadil Sulejmani”. North Macedonia. Abstract The aim of this thesis is the analysis of errors commonly madein the 9-th grade students in urban and rural Albanian schools in the academic year 2018-2019 in using the passive voice. A quantitative approach is applied in conducting the research. The samples of the research are24 students in both schools, 12 students in each school. The descriptive analysis method is going to beused in this research to find the errors of the students and to analyze the data. “The major focus of this study is the Contrastive Analysis between the English passive forms through their Albanian correspondents; contribute to the theoretical linguistics, to the general theory of contrastive linguistics, to the development of contrastive studies in Albanian, to the development of Albanian prescriptive grammars.”1 They are the theories of English grammar, Error analysis, and Language Teaching and Contrastive Analysis Hypothesis. Theory of English grammar was used to know and understand the structure of English passive voice.While, the theory of error analysis was used to analyze the student’ errors based on the Linguistic Category Taxonomy particularly for the English passive voice, and Contrastive Analysis Hypothesis was used to find out the similarity and the difference between English and Albanian passive voice. -

The Classification of Rural Settlements in Gjirokastra Region
E-ISSN 2281-4612 Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol 5 No 3 S1 ISSN 2281-3993 MCSER Publishing, Rome-Italy December 2016 The Classification of Rural Settlements in Gjirokastra Region Assoc. Prof. Albina Sinani Department of Geography, Faculty of Education and Social Sciences, “Eqrem Çabej” University Gjirokaster 6001, Albania; *[email protected] Doi:10.5901/ajis.2016.v5n3s1p24 Abstract The network of residential areas in the region of Gjirokastra has changed depending of a complex factors. This has affected to the utilization rate of the region's rural territories. Considering the economic orientation of rural settlements by relief factor, we look that in settlements that lie in the landscape field, dominates this main branch of the economy: agriculture, livestock, processing of agricultural and livestock products and trade. In settlements that lie in low relief and high montane prevail livestock and orchards, while in the mountainous terrain of petty farming prevails (in villages of municipalities Picar, Cepo, Pogon and Frashër). To achieve this classification serves the real estate registry, which contains books of plots, with surfaces by categories (arable land, orchard, vineyards, forests, pastures, unproductive land). Until 1990, social-economic factor determining in order to limit the application of the regulatory policies of rural settlements. The old system aimed the limiting of the occupation of agricultural land and increasing population density in the rural area. After 1990 have not been implemented proper policies for the development of rural areas. Gjirokastra region rural areas have outstanding value to the organization as space and landscape, as well as the architecture and internal organization of housing and other buildings, infrastructure etc.