La Revue Théâtrale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

1629 Corneille Pierre Mélite C 1630 Corneille Pierre Clitandre Ou L
1629 Corneille Pierre Mélite C 1630 Corneille Pierre Clitandre ou l'innocence persécutée TC 1632 Corneille Pierre La Veuve C 1632 Corneille Pierre Mélanges poétiques 1633 Corneille Pierre La Galerie du Palais C 1634 Corneille Pierre La Suivante C 1634 Corneille Pierre La Place Royale ou l'Amour extravagant C 1635 Corneille Pierre Médée T 1636 Corneille Pierre L'Illusion comique C 1637 Corneille Pierre Le Cid TC 1637 Corneille et 4 autres La Grande Pastorale 1640 Corneille Pierre Horace T 1642 Corneille Pierre Cinna T 1643 Corneille Pierre Polyeucte T 1643 Corneille Pierre La Mort de Pompée T 1643 Corneille Pierre Le Menteur C 1644 Corneille Pierre La Suite du Menteur C 1645 Corneille Pierre Rodogune T 1645 Corneille Pierre sixains pour Valdor "Le Triomphe de Louis le Juste" 1646 Corneille Pierre Théodore T 1647 Corneille Pierre Héraclius T 1650 Corneille Pierre Andromède T 1650 Corneille Pierre Don Sanche d'Aragon CH 1651 Corneille Pierre Nicomède T 1651 Corneille Pierre trad. de l'"Imitation de Jésus-Christ", 20 ch. 1652 Corneille Pierre Pertharite T 1659 Corneille Pierre Oedipe T 1660 Corneille Pierre La Toison d'or (T à machines) 1662 Corneille Pierre Sertorius T 1663 Corneille Pierre Sophonisbe T 1664 Corneille Pierre Othon T 1666 Corneille Pierre Agésilas T 1667 Corneille Pierre Attila T 1669 Corneille Pierre trad. de l'"Office de la Vierge" 1670 Corneille Pierre Tite et Bérénice T 1671 Corneille + Molière/Quinault Psyché CB 1672 Corneille Pierre Pulchérie T 1674 Corneille Pierre Suréna T 1654 Molière L'Etourdi 1656 Molière Le Dépit -

Felix W. Leakey Collection 19Th and 20Th Centuries
Felix W. Leakey Collection 19th and 20th centuries Biography/ History Felix W. Leakey (1922‐1999). Felix Leakey was born in Singapore in 1922. He held positions at the universities of Sheffield, Glasgow, and Reading, prior to assuming the position of Professor of French Language and Literature and Head of the Department of French at Bedford College, London University in 1973. Felix Leakey’s distinction as a scholar is based on his writings on the French poet Charles Baudelaire (1821‐1867). After completing his Ph.D. thesis on Baudelaire’s Les Fleurs du Mal, Leakey received wide praise for his study, Baudelaire and Nature, published in 1969. The originality of Leakey’s contributions to Baudelaire studies consists of his chronological approach to Les Fleurs du Mal and his position that Baudelaire’s aesthetic theories evolved throughout the poet’s life. Leakey published selected poems from Les Fleurs du Mal translated into English verse in 1994 and 1997. While traveling in Ireland, Leakey discovered the original manuscript of Samuel Beckett’s translation of Arthur Rimbaud’s “Le Bateau ivre.” Drunken boat: a translation of Arthur Rimbaud’s poem Le Bateau ivre was published by Whiteknights Press in 1976 with introductions by Leakey and James Knowlson, a renowned Beckett scholar. It was the wish of Felix Leakey that this collection be donated to the W.T. Bandy Center at Vanderbilt University. Professor Leakey died in Northumberland, England in 1999. The donation was made in 2000. For additional information see: Patricia Ward. “The Felix Leakey Collection”. Bulletin Baudelairien, XXXVIII, numéros 1 et 2 (avril‐décembre 2003), 29‐34. -

Polyeucte's Gad Marching Boldly and Joyfully Ta Martyrdom, Poly- Eucte
Polyeucte's Gad Marching boldly and joyfully ta martyrdom, Poly- eucte, hero of Pierre Corneille's first Christian tragedy Polyeucte, hardly appears as a humble, gentle f ollower of Jesus Christ. Like his Corne- li an predecessors Don Rodrigue and Horace, this saint suggests, by his aggression and fearless zeal, that he seeks more ta satisfy his pride and amour-propre thraugh extraordinary deeds of cou- rage than ta fulfill a duty. Indeed, he never considers how he might bring Christ 's message of hope and joy ta his own people or even whether his defiance of imperial authority will compromise "cet ordre social • • • dont, de g_ar son sang royal, il devait ~tre le gardien." Launching himself on the heroic quest at the first opportu- ni ty, he espouses the cause of Christianity be- cause Jesus' promise of salvation ta the faithful would accord him the "more permanent expressions or manifestations of his générosité" 2 that he sa desires. As Claude Abraham states, ·~e may strive for heaven but only becaus3 there is a bigger and better glory there ••••" For Polyeucte, mar- tyrdom is simply the best way ta enshrine his own name in everlasting glory, and ta his last breath, he will rejoice in his own triumphs, not God's, as Serge Doubrovsky well notes: "La 'palme' de Polyeucte, ce sont les 'trophées' d'Horace, mais avec une garantie éternelle. En mourant pour son Dieu, Pflyeucte meurt donc exclusivement pour lui- m~me." His eyes fixed on the splendor of.his heavenly triumph, the martyr displays a self- assurance and a self-centeredness in his earthly trial that proves he is neither a staunch dévot who wishes ta igspire his wife and father-in-law by his exemple, nor a jealous husband who hopes ta d~stinguish himself as a hero in his wife's eyes. -

Extrait Pierre Corneille.Pdf
Corneille : Oeuvres complètes (Extrait) Pierre Corneille ARVENSA ÉDITIONS La référence des éditions numériques des oeuvres classiques en langue française Bénéficiez d'offres privilégiées en vous abonnant à notre lettre d'actualité. Vous serez informé des mises à jour de cette édition et de nos nouvelles publications : Ou rendez-vous sur notre site internet : www.arvensa.com ISBN : 9791027300808 ©Arvensa® Editions Page 2 Copyright Arvensa Editions Corneille : Oeuvres complètes (Extrait) Pierre Corneille NOTE DE L’ÉDITEUR L’objectif des Éditions Arvensa est de vous faire connaître les œuvres des plus grands auteurs de la littérature classique en langue française à un prix abordable, tout en vous fournissant la meilleure expérience de lecture sur votre liseuse. C’est donc un très grand plaisir de vous présenter cette édition numérique originale des Oeuvres complètes de Corneille. Car s’il manquait un auteur à notre catalogue, c’est bien Pierre Corneille. Pour constituer cette édition, nous avons puisé nos sources dans la très riche édition de Charles Marty-Laveaux[1]. De nombreuses notices et notes lui sont empruntées. Nous les avons quelquefois complétées par quelques autres commentaires de Voltaire sur l’œuvre de Corneille. Nous avons aussi apporté nos propres présentations, notes et références. Si nous avons suivi pour l’essentiel le classement des œuvres adopté par Ch. Marty-Laveaux, nous nous en sommes éloignés quelquefois. Nous avons notamment placé les trois discours sur l’art dramatique dans les œuvres en prose. Ils font directement suite aux œuvres théâtrales, ce qui ne nous semble pas dénaturer l’intention originelle de Corneille qui les avait joints à ses œuvres dramatiques. -

On the Passions of Kings: Tragic Transgressors of the Sovereign's
ON THE PASSIONS OF KINGS: TRAGIC TRANSGRESSORS OF THE SOVEREIGN’S DOUBLE BODY IN SEVENTEENTH-CENTURY FRENCH THEATRE by POLLY THOMPSON MANGERSON (Under the Direction of Francis B. Assaf) ABSTRACT This dissertation seeks to examine the importance of the concept of sovereignty in seventeenth-century Baroque and Classical theatre through an analysis of six representations of the “passionate king” in the tragedies of Théophile de Viau, Tristan L’Hermite, Pierre Corneille, and Jean Racine. The literary analyses are preceded by critical summaries of four theoretical texts from the sixteenth and seventeenth centuries in order to establish a politically relevant definition of sovereignty during the French absolutist monarchy. These treatises imply that a king possesses a double body: physical and political. The physical body is mortal, imperfect, and subject to passions, whereas the political body is synonymous with the law and thus cannot die. In order to reign as a true sovereign, an absolute monarch must reject the passions of his physical body and act in accordance with his political body. The theory of the sovereign’s double body provides the foundation for the subsequent literary study of tragic drama, and specifically of king-characters who fail to fulfill their responsibilities as sovereigns by submitting to their human passions. This juxtaposition of political theory with dramatic literature demonstrates how the king-character’s transgressions against his political body contribute to the tragic aspect of the plays, and thereby to the -

Corneille in the Shadow of Molière Dominique Labbé
Corneille in the shadow of Molière Dominique Labbé To cite this version: Dominique Labbé. Corneille in the shadow of Molière. French Department Research Seminar, Apr 2004, Dublin, Ireland. halshs-00291041 HAL Id: halshs-00291041 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00291041 Submitted on 27 Nov 2009 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. University of Dublin Trinity College French Department Research Seminar (6 April 2004) Corneille in the shadow of Molière Dominique Labbé [email protected] http://www.upmf-grenoble.fr/cerat/Recherche/PagesPerso/Labbe (Institut d'Etudes Politiques - BP 48 - F 38040 Grenoble Cedex) Où trouvera-t-on un poète qui ait possédé à la fois tant de grands talents (…) capable néanmoins de s'abaisser, quand il le veut, et de descendre jusqu'aux plus simples naïvetés du comique, où il est encore inimitable. (Racine, Eloge de Corneille) In December 2001, the Journal of Quantitative Linguistics published an article by Cyril Labbé and me (see bibliographical references at the end of this note, before appendixes). This article presented a new method for authorship attribution and gave the example of the main Molière plays which Pierre Corneille probably wrote (lists of these plays in appendix I, II and VI). -

The Cornelian Ethics of Flight and the Case of Horace
Trinity University Digital Commons @ Trinity Modern Languages and Literatures Faculty Research Modern Languages and Literatures Department 2016 The Cornelian Ethics of Flight and The Case of Horace Nina Ekstein Trinity University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.trinity.edu/mll_faculty Part of the Modern Languages Commons Repository Citation Ekstein, N. (2016). The Cornelian ethics of flight and the case of Horace. Romance Notes, 56(3), 485-493. doi: 10.1353/rmc.2016.0050 This Article is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures Department at Digital Commons @ Trinity. It has been accepted for inclusion in Modern Languages and Literatures Faculty Research by an authorized administrator of Digital Commons @ Trinity. For more information, please contact [email protected]. The Cornelian eThiCS of flighT and The CaSe of horaCe nina ekSTein flighT is a simple dramatic action, one that lends itself to any number of dif- ferent plots. its implied movement can be represented on stage or merely recounted. So common is it that the words fuite and fuir appear in every one of Corneille’s 32 plays, from as infrequently as twice to as many as 32 times.1 The two terms belong to a broad semantic network including retraite, éviter, dérober, échapper, partir, quitter, abandonner, but differ in their suggestion of abrupt, precipitous movement as well as the element of fear implied. furetière begins his definition of fuir with “Tascher d’éviter un péril en s’en éloignant à force de jambes.” The next sentence, however, immediately ties the term to issues of morality: “les braves aiment mieux périr que fuir d’une bataille.” Thus a common, if at times startling, action has inherent ethical ram- ifications. -

Corneille's Absent Characters
Trinity University Digital Commons @ Trinity Modern Languages and Literatures Faculty Research Modern Languages and Literatures Department 2004 Corneille's Absent Characters Nina Ekstein Trinity University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.trinity.edu/mll_faculty Part of the Modern Languages Commons Repository Citation Ekstein, N. (2004). Corneille's absent characters. Papers on French Seventeenth Century Literature, 31(60), 27-48. This Article is brought to you for free and open access by the Modern Languages and Literatures Department at Digital Commons @ Trinity. It has been accepted for inclusion in Modern Languages and Literatures Faculty Research by an authorized administrator of Digital Commons @ Trinity. For more information, please contact [email protected]. Corneille's Absent Characters by NINA EKSTEIN The relationship between presence and absence in theater is intertwined and complex. For Kibedi Varga, a work of art invariably signifies absence in that it proposes an image, a representation, rather than the thing itself (341 -42). This is obviously true of theater. At the same time, theater is es sentially about presence. The empty stage is a space that derives its poten tial for force and meaning from the expectation of live bodies engaged in concrete actions there. 1 Perhaps more to the point, theater is about the dia lectical relationship between absence and presence. According to Fuchs, "theatre is ever the presence of the absence and the absence of the pres ence" ( 172). This dialectic is of course in no way limited to the theater; it pervades current critical theory.2 Kierkegaard provides a visual image that captures well the interplay between the two: he describes a painting de picting the tomb of Napoleon framed by two trees. -
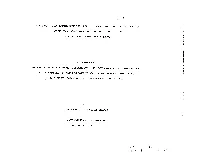
Theme and Structure in Rodogune of Corneille And
- !‘ / THEME AND STRUCTURE IN RODOGUNE OF CORNEILLE AND LA TH1~BA~DE OF RACINE: A STUDY OF THE BAROQUE A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF ATLANTA UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE DEGREE OF MASTER OF ARTS BY RUSSELL WILLINGHAM ATLANTA, GEORGIA AUGUST 1967 PI?EFACE In this study, the writer shall examine the parallels and contrasts between Rodogune of Pierre Corneille and La Th~ba’~ide of Jean Racine, with special emphasis on the baroque aspects of the two works. The total production of these two writers has long been unjustly placed or labeled in one particular category, that of being “classical.” That type of categorizing is quite unjust if we take into consideration such works as Rodogune, Attila, Sor~na of Cornejlle and La Th~ba’ide and Alexandre Le Grand of Racine. This traditional and misleading conception in applying the label “classical” to the two dramatist by such critics as Gustave Lanson in his Esquisse d’une histoire de la trag~die français and Martin Trunell in his Classical Moment has been challenged by a group of “Revisionists.” Such modern day cdtinc as W.G. Moore, French Classi~l Literature, Imbrie Buffum , Studies in the Baroque and E. B. Borgehoff, “The Freedom of French Classicism.?? The study of these revisionists have lead to a truer and deeper appraisal of the two dramatist. In this study, the writer shall consider the baroque and classicism, not only in their artistic and literary sense but also in relation to the time and the milieu in which they developed. -

To Joseph S. Ford - July 19, 1894
Colby College Digital Commons @ Colby Edwin Arlington Robinson Letters and The Letters of Edwin Arlington Robinson: A Transcriptions Digital Edition 7-19-1894 To Joseph S. Ford - July 19, 1894 Edwin Arlington Robinson Follow this and additional works at: https://digitalcommons.colby.edu/robinson_transcriptions Part of the Literature in English, North America Commons Recommended Citation Robinson, Edwin Arlington, "To Joseph S. Ford - July 19, 1894" (1894). Edwin Arlington Robinson Letters and Transcriptions. 199. https://digitalcommons.colby.edu/robinson_transcriptions/199 This Book is brought to you for free and open access by the The Letters of Edwin Arlington Robinson: A Digital Edition at Digital Commons @ Colby. It has been accepted for inclusion in Edwin Arlington Robinson Letters and Transcriptions by an authorized administrator of Digital Commons @ Colby. EAR-JS Ford July 19/94 - 1 TO JOSEPH S. FORD My dear Ford, I am glad to hear that you have been reading Coppée, but I am sorry to be obliged to tell you that Leconte de Lisle1 is still a stranger to me. As you well know, I intended to buy Poemes Antiques and Mon Franc Parler; but I fell in with Tryon's brother (who, by the way, is a very good fellow) and the natural consequence was that I was com- pelled to borrow the wherewithal to get back to Maine – where there are - fortunately for me - no "Pop" concerts, nor much of anything else to interfere with the desperately even ten- or of my way. However, between my pipe and my beans and my lofty genius, I manage to get along very well. -

Médée Comme Mémoire Du Théâtre
Médée comme mémoire du théâtre Une poétique du mal (1556-1713) par Aurélie Chevanelle-Couture Département de langue et littérature françaises Université McGill, Montréal Thèse soumise à l’Université McGill en vue de l’obtention du grade de Ph. D. en langue et littérature françaises Décembre 2017 © Aurélie Chevanelle-Couture, 2017 Table des matières Résumé ........................................................................................................................................................ iv Abstract ......................................................................................................................................................... v Remerciements ............................................................................................................................................ vi INTRODUCTION .................................................................................................................................... 1 Dionysos et Médée .......................................................................................................................................... 7 Le théâtre maléfique ..................................................................................................................................... 12 Revenances de Médée, revenances du mal ................................................................................................... 18 Plongée dans une mémoire occulte ............................................................................................................. -

The Strange Career of Voltaire, Bestselling Playwright of Eighteenth-Century France
Databases, Revenues, & Repertory: The French Stage Online, 1680– 1793 • Databases, Revenues, & Repertory: The French Stage Online, 1680-1793 The Strange Career of Voltaire, Bestselling Playwright of Eighteenth- Century France Lauren R. Clay Published on: Oct 08, 2020 License: Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0) Databases, Revenues, & Repertory: The French Stage Online, 1680–1793 The Strange Career of Voltaire, Bestselling Playwright of Eighteenth- • Databases, Revenues, & Repertory: The French Stage Online, 1680- Century France 1793 To most readers, it would seem impossible that it could have become necessary to save François-Marie Arouet, better known as Voltaire, from the condescension of posterity.1 During his lifetime, according to Antoine Lilti, Voltaire became Europe’s greatest celebrity.2 Aristocrats, ambassadors, artists, and men and women of letters made pilgrimages to his chateau at Ferney to meet or even just catch a glimpse of a living genius.3 By the 1760s, his fame was such that an array of Voltaire merchandise, including portraits, silhouettes, small busts, and intimate engravings purporting to reveal his private life, were marketed to curious and eager fans.4 His triumphal return to Paris in 1778 after a thirty-year absence threw the capital into paroxysms of excitement, culminating in his ceremonial crowning at the Comédie-Française. Even after his death, Voltaire loomed larger than life. The project to establish a Panthéon where France’s “grands hommes” would be honored by “la patrie reconnaissante” was conceived with Voltaire in mind. He was the first man of letters interred there, by order of the National Assembly, in July 1791.5 Voltaire remains a foundational figure in the French literary canon and in the French national imagination, and his works are widely read today.