Le Guide Des Chaînes Numeriques 2013 Pdf 1 Mo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Downloaded in 2002, Some of of 13.7 Million Euros
01 02 03 M6 explores today In 2002, M6 feted its 15th year, the age when an adult and responsible future M6 has been a shareholder of the TPS satellite bouquet since its launching starts to crystallize. An occasion that a television network can celebrate and has also participated in its development. only if it has managed to match consistency with the will to move ahead. The prospects are encouraging for a group with the backing of a strong As the network with France’s second largest advertising market share, in generalist television network. The year’s activity, described in these pages, just a few years M6 has succeeded in earning our industry’s highest tributes. is the best illustration. Late off starting blocks, our network has worked patiently, and without arro- gance, to win over increasingly demanding viewers. Jean Drucker Throughout these fifteen years, with growing audiences and an ever expan- ding share of the advertising market, M6 has never ceased to make its pro- grams more rewarding, boosting its investment in diversity, discovery, and culture, particularly music and magazines, where our network has played a major role. M6 is also the network where new talent and formats are first tried out. 04 Ambitious objectives With its strong operating performance of 2002, M6 proved its capacity to diversification activities, all orientations which enable the Group to adapt to resist in a difficult market. its market. Finally, M6 has the necessary financial resources to consider every investment opportunity. First, it confirmed the station’s standing as the second most watched chan- nel among viewers under 50, with an audience share equal to 2001, which With its one thousand permanent staff members, all motivated by a corpo- had been an exceptional year. -

20.3. Consolidated Financial Statements BOLLORÉ
BOLLORÉ Board of Directors As of March 23, 2017 Vincent Bolloré Chairman and Chief Executive Officer Cyrille Bolloré Deputy Chief Executive Officer, Vice-Chairman and Managing Director Yannick Bolloré Vice-Chairman Cédric de Bailliencourt Vice-Chairman Gilles Alix Representative of Bolloré Participations, Chief Executive Officer of the Bolloré Group Chantal Bolloré Marie Bolloré Sébastien Bolloré Valérie Coscas Marie-Annick Darmaillac Representative of Financière V Hubert Fabri Janine Goalabré Representative of Omnium Bolloré Dominique Hériard-Dubreuil Céline Merle-Béral Alexandre Picciotto Olivier Roussel Martine Studer François Thomazeau Financial information Emmanuel Fossorier Xavier Le Roy Director of Financial Communications Director of Investor Relations Tel.: +33 (0)1 46 96 47 85 Tel.: +33 (0)1 46 96 47 85 Fax: +33 (0)1 46 96 42 38 Fax: +33 (0)1 46 96 42 38 REGISTRATION DOCUMENT 2016 01 02 — Group profile 04 — Message from the Chairman 06 — Key figures 08 — Economic organizational chart 09 — Stock exchange data 10 — Our locations 13 — Transportation and logistics 21 — Communications 29 — Electricity storage and solutions 37 — Other assets 41 — Corporate Social Responsibility 45 — Annual financial report 02 Group BOLLORÉ Profile Founded in 1822, the Bolloré Group is among the 500 largest companies in the world. Publicly traded, it is still majority controlled by the Bolloré family. The stability of its shareholder base enables it to follow a long-term investment policy. Thanks to its diversification strategy based on innovation -

An N U Al R Ep O R T 2018 Annual Report
ANNUAL REPORT 2018 ANNUAL REPORT The Annual Report in English is a translation of the French Document de référence provided for information purposes. This translation is qualified in its entirety by reference to the Document de référence. The Annual Report is available on the Company’s website www.vivendi.com II –— VIVENDI –— ANNUAL REPORT 2018 –— –— VIVENDI –— ANNUAL REPORT 2018 –— 01 Content QUESTIONS FOR YANNICK BOLLORÉ AND ARNAUD DE PUYFONTAINE 02 PROFILE OF THE GROUP — STRATEGY AND VALUE CREATION — BUSINESSES, FINANCIAL COMMUNICATION, TAX POLICY AND REGULATORY ENVIRONMENT — NON-FINANCIAL PERFORMANCE 04 1. Profile of the Group 06 1 2. Strategy and Value Creation 12 3. Businesses – Financial Communication – Tax Policy and Regulatory Environment 24 4. Non-financial Performance 48 RISK FACTORS — INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT — COMPLIANCE POLICY 96 1. Risk Factors 98 2. Internal Control and Risk Management 102 2 3. Compliance Policy 108 CORPORATE GOVERNANCE OF VIVENDI — COMPENSATION OF CORPORATE OFFICERS OF VIVENDI — GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY 112 1. Corporate Governance of Vivendi 114 2. Compensation of Corporate Officers of Vivendi 150 3 3. General Information about the Company 184 FINANCIAL REPORT — STATUTORY AUDITORS’ REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS — CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS — STATUTORY AUDITORS’ REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS — STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS 196 Key Consolidated Financial Data for the last five years 198 4 I – 2018 Financial Report 199 II – Appendix to the Financial Report 222 III – Audited Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2018 223 IV – 2018 Statutory Financial Statements 319 RECENT EVENTS — OUTLOOK 358 1. Recent Events 360 5 2. Outlook 361 RESPONSIBILITY FOR AUDITING THE FINANCIAL STATEMENTS 362 1. -
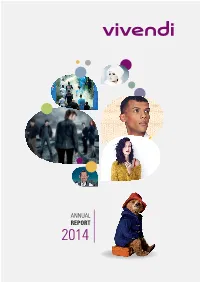
Annual Report
ANNUAL REPORT 2014 Management Message 02 At the center of our businesses 04 12 Group Profi le | Businesses | Societal, Social and Litigation | Risk Factors 07 Environmental Information 41 1. Group Profi le 09 1. Corporate Social Responsibility (CSR) Policy 42 2. Businesses 20 2. Societal Information 47 3. Litigation 32 3. Social Information 62 4. Risk Factors 38 4. Environmental Information 77 5. Verifi cation of Non-Financial Data 85 3 Information about the Company | Corporate Governance | Reports 91 1. General Information about the Company 92 2. Additional Information about the Company 93 3. Corporate Governance 106 4. Report by the Chairman of Vivendi’s Supervisory Board on Corporate Governance, Internal Audits and Risk Management – Fiscal Year 2014 147 5. Statutory Auditors’ report, prepared in accordance with Article L.225-235 of the French Commercial Code, on the Report prepared by the Chairman of the Supervisory Board of Vivendi SA 156 4 Financial Report | Statutory Auditors’ Report on the Consolidated Financial Statements | Consolidated Financial Statements | Statutory Auditors’ Report on the Financial Statements | Statutory Financial Statements 159 Selected key consolidated fi nancial data 160 I - 2014 Financial Report 161 II - Appendices to the Financial Report: Unaudited supplementary fi nancial data 191 III - Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2014 195 IV - Vivendi SA - 2014 Statutory Financial Statements 294 56 Recent events | Outlook 337 Responsibility for Auditing 1. Recent events 338 the Financial Statements 341 2. Outlook 339 1. Responsibility for Auditing the Financial Statements 342 ANNUAL REPORT 2014 The Annual Report in English is a translation of the French “Document de référence” provided for information purposes. -

Bilan De L'économie Des Chaînes Payantes Année 2009
Bilan de l’économie des chaînes payantes Année 2009 les bilans du CSA Décembre 2010 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L ’AUDIOVISUEL Direction des programmes Direction des études et de la prospective Service de l’information et de la documentation Bilan de l’économie des chaînes payantes Année 2009 Bilan 2009 de l’économie des chaînes payantes Comme chaque année, le CSA a dressé le bilan de l’économie des chaînes payantes. Cette analyse, qui ne prend pas en compte la chaîne Canal+, porte sur 99 des 117 chaînes payantes existant fin 2009. Elle fait notamment apparaître que près de 42 % des foyers équipés d’un téléviseur étaient à cette date abonnés à une offre multichaîne payante. Synthèse Un bilan qui porte sur 99 chaînes payantes Le bilan réalisé par le CSA entend par télévision payante tout service qui n’est accessible que par le biais d’un abonnement, que ce soit pour une offre globale, couplée ou non avec d’autres services (internet, téléphone), ou pour des services vendus à l’unité. Cette définition ne tient donc pas compte du financement des services. Au 31 décembre 2009, le nombre des services payants conventionnés ou autorisés en langue française (hors Canal+) diffusés sur le câble, le satellite et l’ADSL en France métropolitaine était de 117, contre 116 en 2008. Parmi ceux-ci, 6 étaient autorisés et 111 conventionnés. Toutefois, les données statistiques qui font l’objet de l’étude portent sur 99 services édités par 58 sociétés. 13 sociétés éditent plusieurs services chacune - Canal J (3 chaînes) : Canal J, June et Tiji ; - Disney Channel -

AVRIL 2017 15E ÉDITION SOMMAIRE
GUIDE DES CHAÎNES NUMÉRIQUES AVRIL 2017 15e ÉDITION SOMMAIRE SYNTHÈSE ........................................................4 Partie II : la production audiovisuelle et RESSOURCES DOCUMENTAIRES .....................6 cinématographique à partir des données du CNC 1. La production audiovisuelle ................................................ 43 CHAPITRE 1 2. La production cinématographique ................................ 49 L’OFFRE DE CHAÎNES NUMÉRIQUES CHAPITRE 6 1. Les chaînes de la TNT ................................................................... 8 L’ÉCONOMIE DES CHAÎNES NUMÉRIQUES 2. Les chaînes conventionnées et déclarées dans l’offre élargie ........................................................................ 8 Partie I : résultats économiques du secteur 3. Les chaînes payantes diffusées 1. Bilan financier des chaînes gratuites en 2015 .......... 56 en France en 2016 ......................................................................... 9 2. Bilan financier des chaînes payantes en 2015 ........ 66 . La télévision de rattrapage (TVR) ..................................... 10 4 Partie II : la publicité 1. Investissements publicitaires bruts CHAPITRE 2 sur l’ensemble des chaînes .................................................. 75 LES MODES DE RÉCEPTION 2. Les dépenses et recettes DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE EN FRANCE publicitaires nettes en 2015 et en 2016 ......................... 81 1. Le marché des récepteurs .................................................... 14 Partie III : l’emploi 2. Les modes de réception........................................................ -

Décision N° 11-D-12 Du 20 Septembre 2011 Relative Au Respect Des
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des engagements figurant dans la décision autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus L’Autorité de la concurrence, Vu la décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006, autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus sous réserve de l’ensemble des engagements pris par ces sociétés le 24 août 2006, ensemble l’avis émis sur l’opération par le Conseil de la concurrence le 13 juillet 2006 ; Vu la lettre, enregistrée le 4 juillet 2008 sous le numéro 08/0075 A, par laquelle le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a saisi le Conseil de la concurrence pour avis sur l’exécution des engagements souscrits par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus ; Vu la décision n° 09-SO-01 du 28 octobre 2009 par laquelle l’Autorité s’est saisie d’office de l’exécution des engagements souscrits par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus (affaire enregistrée sous le numéro 09/0116 R) ; Vu le livre IV du code de commerce, et notamment son article L. 430-8 ; Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2010-0381 du 15 avril 2010 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2010-13 du 27 mai 2010 ; Vu les rapports du mandataire relatifs à l’état de réalisation des engagements souscrits par le Groupe Canal Plus ; Vu les observations présentées par Vivendi Universal, Groupe Canal Plus et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Les rapporteures, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 24 mai 2011 ; Adopte la décision suivante : I. -

Financial Report and Unaudited Condensed Financial Statements for the Nine Months Ended September 30, 2017
Financial Report and Unaudited Condensed Financial Statements for the nine months ended September 30, 2017 November 16, 2017 VIVENDI Société anonyme with a Management Board and a Supervisory Board with a share capital of €7,119,287,400.50 Head Office: 42 avenue de Friedland – 75380 PARIS CEDEX 08 – FRANCE IMPORTANT NOTICE: READERS ARE STRONGLY ADVISED TO READ THE IMPORTANT DISCLAIMERS AT THE END OF THIS FINANCIAL REPORT. Thursday November 16, 2017 KEY CONSOLIDATED FINANCIAL DATA FOR THE LAST FIVE YEARS ............................................................................................................. 4 I- FINANCIAL REPORT FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2017 ...................................................................................................................... 5 1 EARNINGS ANALYSIS: GROUP AND BUSINESS SEGMENTS ............................................................................................................................... 5 1.1 STATEMENT OF EARNINGS .................................................................................................................................................................................. 6 1.2 STATEMENT OF EARNINGS ANALYSIS ................................................................................................................................................................... 7 1.3 BUSINESS SEGMENT PERFORMANCE ANALYSIS ................................................................................................................................................... -
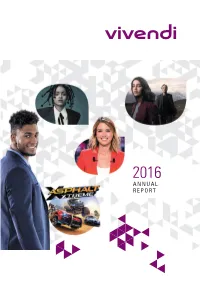
View Annual Report
2016 ANNUAL REPORT CONTENT MESSAGES FROM THE SUPERVISORY BOARD AND THE MANAGEMENT BOARD 02 1 4 Profile of the Group and its Businesses | Financial Report | Statutory Auditors’ Report Financial Communication, Tax Policy on the Consolidated Financial Statements | and Regulatory Environment | Risk Factors 05 Consolidated Financial Statements | 1. Profi le of the Group and its Businesses 07 Statutory Auditors’ Report on 2. Financial Communication, Tax policy and Regulatory Environment 43 the Financial Statements | Statutory 3. Risk Factors 47 Financial Statements 183 Selected key consolidated fi nancial data 184 I - 2016 Financial Report 185 II - Appendix to the Financial Report: Unaudited supplementary fi nancial data 208 2 III - Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2016 210 Societal, Social and IV - 2016 Statutory Financial Statements 300 Environmental Information 51 1. Corporate Social Responsibility (CSR) Policy 52 2. Key Messages 58 3. Societal, Social and Environmental Indicators 64 4. Verifi cation of Non-Financial Data 101 5 Recent Events | Forecasts | Statutory Auditors’ Report on EBITA forecasts 343 1. Recent Events 344 2. Forecasts 344 3 3. Statutory Auditors’ Report on EBITA forecasts 345 Information about the Company | Corporate Governance | Reports 107 1. General Information about the Company 108 2. Additional Information about the Company 109 3. Corporate Governance 125 6 4. Report by the Chairman of Vivendi’s Supervisory Board Responsibility for Auditing the Financial Statements 347 on Corporate Governance, Internal Audits and Risk 1. Responsibility for Auditing the Financial Statements 348 Management – Fiscal year 2016 172 5. Statutory Auditors’ Report, Prepared in Accordance with Article L.225-235 of the French Commercial Code, on the Report Prepared by the Chairman of the Supervisory Board of Vivendi SA 181 ANNUAL REPORT 2016 ANNUAL REPORT 2016 The Annual Report in English is a translation of the French “Document de référence” provided for information purposes. -

Press Release FRANCE TELECOM and TPS LAUNCH DIGITAL
Press release FRANCE TELECOM AND TPS LAUNCH DIGITAL TELEVISION OVER TELEPHONE LINES France Télécom and TPS (TF1: 66% - M6: 34%) have signed a strategic agreement which will enable TPS to offer digital television services using ADSL technology over France Télécom’s network from December 2003. ADSL technology makes it possible simultaneously to phone, connect to broadband internet services and receive the TPS platform of channels, provisionally named TPSL, as well as programmes-on- demand and interactive services. All customers will need to do to receive TPSL will be to take out a video access subscription from France Télécom (ADSL video access and terminal set connected to the television) and select one of the packages offered by TPS. Programmes-on-demand will be offered by France Télécom using the ‘kiosk’ model already familiar to Minitel users. These new services from France Télécom and TPS will be launched in Lyon in December 2003, and then in Paris in the spring of 2004, before gradually being rolled out to other French cities. They will be available through approved outlets, such as specialist stores, department stores, installers and France Télécom shops. Thierry Breton, CEO of France Télécom, stated, "This agreement with TPS is a concrete example of France Télécom’s strategy of forging industrial partnerships that will benefit its customers. It represents a major innovation in extending the use of broadband connections beyond the internet and in developing new ways of distributing audiovisual content. It has been made possible by the quality of our networks and by the technical expertise that France Télécom has gained in the area of image transmission, an area which offers substantial growth potential, particularly for fixed-line telephone services". -

BOLL 1902299 RAPPORT ACTIVIT… 2018 GB.Indd
Bolloré Business report 2018 ! — !Message!from!the!Chairman # —$ Profile % —$ Key!figures & —$ Economic!organizational!chart ' —$ Stock!exchange!data ( —$ Our!locations (! —$ Group!strategy (# —$ Business!model (% —$ CSR!key!figures () — !Governance The Group (& Transportation and logistics !% Communications ,# Electricity storage and solutions #! — ! Other!assets #% —$ Corporate!social!responsibility *! — !History!of!the!Group BUSINESS REPORT 2018 — BOLLORÉ 01 Message from the Chairman Vincent Bolloré, Chairman and Chief Executive O! cer of Financière de l’Odet Bolloré was founded in Brittany, in 1822, by leaders. Having seen him at work in the Group my two great-great-great-great-grandfathers, for twelve years, I fi rmly believe that Cyrille François Le Marié and René Bolloré. They Bolloré is the right choice for this new chapter were followed successively by their children, in the Group’s story. As planned, I will remain Nicolas Le Marié, my great-great-great-uncle, Chairman and Chief Executive Officer of and Jean-Claude Guillaume Bolloré, my Financière de l’Odet – which controls 65% of great-great-great-grandfather, their children Bolloré’s share capital – until February 17, 2022, and their children’s children, right down to date of our bicentennial, to ensure that the my uncles and my father. transition is as smooth as possible. Today, it gives me great pride to see the seventh generation take over the reins, with the help of teams of cohesive and experienced 02 BOLLORÉ — BUSINESS REPORT 2018 Cyrille Bolloré" Chairman and Chief Executive O! cer of Bolloré I am greatly honored by the confidence that Consolidated operating income was 1.3 billion the Board of Directors has shown me by unani- euros, a 25% increase attributable largely to mously appointing me Chairman and Chief the Communications business (+29%), driven Executive Officer of Bolloré, replacing Vincent by the very good performance of Vivendi’s Bolloré. -
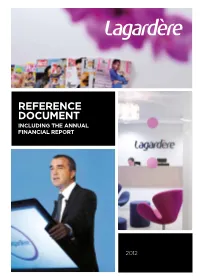
Reference Document Including the Annual Financial Report
REFERENCE DOCUMENT INCLUDING THE ANNUAL FINANCIAL REPORT 2012 PROFILE LAGARDÈRE, A WORLD-CLASS PURE-PLAY MEDIA GROUP LED BY ARNAUD LAGARDÈRE, OPERATES IN AROUND 30 COUNTRIES AND IS STRUCTURED AROUND FOUR DISTINCT, COMPLEMENTARY DIVISIONS: • Lagardère Publishing: Book and e-Publishing; • Lagardère Active: Press, Audiovisual (Radio, Television, Audiovisual Production), Digital and Advertising Sales Brokerage; • Lagardère Services: Travel Retail and Distribution; • Lagardère Unlimited: Sport Industry and Entertainment. EXE LOGO L'Identité / Le Logo Les cotes indiquées sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entrepreneurs. Ceux-ci devront soumettre leurs dessins Echelle: d’éxécution pour approbation avant réalisation. L’étude technique des travaux concernant les éléments porteurs concourant la stabilité ou la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, devra être vérifié par un bureau d’étude qualifié. Agence d'architecture intérieure LAGARDERE - Concept C5 - O’CLOCK Optimisation Les entrepreneurs devront s’engager à executer les travaux selon les règles de l’art et dans le respect des règlementations en vigueur. Ce 15, rue Colbert 78000 Versailles Date : 13 01 2010 dessin est la propriété de : VERSIONS - 15, rue Colbert - 78000 Versailles. Ne peut être reproduit sans autorisation. tél : 01 30 97 03 03 fax : 01 30 97 03 00 e.mail : [email protected] PANTONE 382C PANTONE PANTONE 382C PANTONE Informer, Rassurer, Partager PROCESS BLACK C PROCESS BLACK C Les cotes indiquées sont données à titre indicatif et devront être vérifiées par les entrepreneurs. Ceux-ci devront soumettre leurs dessins d’éxécution pour approbation avant réalisation. L’étude technique des travaux concernant les éléments porteurs concourant la stabilité ou la Echelle: Agence d'architecture intérieure solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux, devra être vérifié par un bureau d’étude qualifié.