Faculté Des Lettres
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

E3.59390 2.Pdf
X Ecrits II 1. Journal, Correspondance (1923-1953) BIBLIOTHÈQUE DU NOUVEAU MONDE comité de direction Roméo Arbour, Yvan G. Lepage, Laurent Mailhot, Jean-Louis Major De Paul-Emile Borduas dans la même collection Ecrits I (André-G. Bourassa, Jean Fisette et Gilles Lapointe) La « Bibliothèque du Nouveau Monde » entend constituer un ensemble d'éditions critiques de textes fondamentaux de la littérature québécoise. Elle est issue d'un vaste projet de recherche (CORPUS D'ÉDITIONS CRITIQUES) administré par l'Université d'Ottawa et subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. BIBLI OTHÈ QU E DU NOUVEAU MONDE Paul-Emile Borduas Écrits II 1. Journal, Correspondance (1923-1953) Édition critique par ANDRÉ-G. BOURASSA et GILLES LAPOINTE Université du Québec à Montréal 1997 Les Presses de l'Université de Montréal C. P. 6128, succursale Centre-Ville, Montréal (Québec), Canada H3C 3J7 Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada a contribué à la publication de cet ouvrage. Données de catalogage avant publication (Canada) Borduas, Paul-Emile, 1905-1960 (Bibliothèque du Nouveau Monde) Écrits II, tome 1 : Journal, Correspondance (1923-1953) Édition critique / André-G. Bourassa (1936- ) et Gilles Lapointe (1953-) Comprend des références bibliograhiques. ISBN 2-7606-1690-8 ND249.B6B67 1987 759.11 C88-004202-8 «Tous droits de traduction et d'adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous les pays. La reproduction d'un extrait quelconque de ce livre, par quelque procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, en particulier par photocopie et par microfilm, est interdite sans l'autorisation écrite de l'éditeur.» ISBN 2-7606-1692-4 (tomes 1 et 2) ISBN 2-7606-1690-8 (tome 1) Dépôt légal, 1er trimestre 1997 Bibliothèque nationale du Canada Bibliothèque nationale du Québec © Les Presses de l'Université de Montréal, 1997 Paul-Emile Borduas, Paris, 1957; à l'arrière-plan, Composition n° 35 (photo Philip Pocock). -

1945-2019 EG : Exposition De Groupe ES
Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle Liste des expositions et bibliographie – 1945-2019 EG : exposition de groupe ES : exposition solo ED : exposition en duo 1945 EG : 62e Salon du printemps, Musée des beaux-arts de Montréal, cat., 5-29 avril 1945. BIBLIOGRAPHIE Paul Duval. « Montreal Artists EstablisHing New Landmarks in Canadian Art ». Saturday Night, 10 novembre 1945, p. 24. 1946 EG : The Borduas Group, Studio Boas, New York. Borduas, Gauvreau, Leduc, Mousseau, Riopelle et Viau, janvier 1946. EG : Septième exposition annuelle de peintures et dessins, Société d’art contemporain, Musée des beaux-arts de Montréal, cat., 2-14 février 1946. EG : Exposition automatiste, 1257, rue AmHerst à Montréal. Borduas, Barbeau, Leduc, Mousseau, Gauvreau, Fauteux et Riopelle, 20-29 avril 1946. 1947 Signature du manifeste Rupture inaugurale avec le groupe d’André Breton le 21 juin 1947. EG : Automatisme, Galerie du Luxembourg, Paris, avec Barbeau, Borduas, Fauteux, Leduc, Mousseau et Riopelle, 20 juin-13 juillet 1947. Mise à jour : 20 décembre 2019. EG : Le Surréalisme en 1947, Exposition internationale du surréalisme, Galerie MaegHt, Paris, présentée par André Breton et Marcel DucHamp, cat. Pierre à feu, MaegHt Éditeur, 7 juillet-30 septembre 1947. EG : Salon des Surindépendants, Paris, octobre 1947. ED : Mousseau-Riopelle, cHez Muriel Guilbault, 374, rue SHerbrooke Ouest à Montréal, 29 novembre-14 décembre 1947. EG : Mezinárodní Surrealismus, Topicuv Salon, Prague, avec Baskine, Bellmer, Brauner, Bouvet, Donati, Ernst, Herold, Jean, Kiesler, Kujavski, Lam, Matta, Miró, Riopelle, Serpan, Tanguy, Toyen, Trouille et Younane, cat. EG : L’Imaginaire, Galerie du Luxembourg, Paris. Exposition présentée par J.J. MarcHand, avec Arp, Atlan, Brauner, Bryen, Hartung, Leduc, Mathieu, Picasso, Riopelle, Solier, Ubac, Verroust, Vulliamy et Wols. -

Le Discours Muséal À Travers L'exposition Des Collections De
Université de Montréal Le discours muséal à travers l’exposition des collections de quatre musées d’art: Montréal, Québec, Joliette et Sherbrooke par Nathalie Houle Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques Faculté des arts et des sciences Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maîtrise ès arts (M.A.) en histoire de l’art août 2013 © Nathalie Houle , 2013 Université de Montréal Faculté des études supérieures Ce mémoire intitulé : Le discours muséal à travers l’exposition des collections de quatre musées d’art : Montréal, Québec, Joliette et Sherbrooke Présenté par : Nathalie Houle A été évalué par un jury composé des personnes suivantes : Nicole Dubreuil Président-rapporteur Christine Bernier Directrice de recherche Johanne Lamoureux Membre du jury RÉSUMÉ Les musées d’art sont des lieux privilégiés pour contempler les productions artistiques du passé et d’aujourd’hui. En vertu de leur mandat, ceux-ci ont la tâche difficile de concilier leurs fonctions de délectation et d’éducation du public. Certains favorisent une approche plutôt que l’autre, mais tous portent un regard subjectif sur ce qu’ils exposent. Même si les œuvres semblent être disposées naturellement dans les salles, tout ce qui relève de la conception et de la réalisation des expositions est savamment construit et résulte d’un parti-pris de la part du musée. En fonction de ses choix, c’est-à-dire de ce qu’elle présente ou non et comment elle le fait, l’institution muséale participe à la définition de ce qu’est l’art et influence la signification des œuvres. -

Exhibitions, Manifestos, and the Seventieth Anniversary of Refus Global Ray Ellenwood
Document generated on 09/29/2021 1:23 a.m. RACAR : Revue d'art canadienne Canadian Art Review Exhibitions, Manifestos, and the Seventieth Anniversary of Refus global Ray Ellenwood Volume 44, Number 1, 2019 URI: https://id.erudit.org/iderudit/1062156ar DOI: https://doi.org/10.7202/1062156ar See table of contents Publisher(s) UAAC-AAUC (University Art Association of Canada | Association d'art des universités du Canada) ISSN 0315-9906 (print) 1918-4778 (digital) Explore this journal Cite this review Ellenwood, R. (2019). Review of [Exhibitions, Manifestos, and the Seventieth Anniversary of Refus global]. RACAR : Revue d'art canadienne / Canadian Art Review, 44(1), 99–105. https://doi.org/10.7202/1062156ar Tous droits réservés © UAAC-AAUC (University Art Association of Canada | This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit Association d'art des universités du Canada), 2019 (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ Exhibitions, Manifestos, and the Seventieth Anniversary of Refus global Reviews | Recensions Ray Ellenwood August 8, 2018, was the 70th anniver- sary of the publication of Refus global, the manifesto of a multi-disciplin- ary group of Montreal artists called the Automatists, widely recognized as important avant-garde figures in the history of Canadian modern- ism. -

Refus Global Went on Sale in Montreal on 6 August 1948, It Waws a Pivota.I Moment for the Group Which Produced It
THE AUTOMATIST MOVEMENT OF MONTREAL Towards Non-Figuration in Painting, Dance, and Poetry Ray Ellenwood "... il faut sentir vraiment autre chose dans la matière verbale que de plates similitudes logiques pour pouvoir vibrer à la poésie." — [Claude Gauvreau] HEN Refus global went on sale in Montreal on 6 August 1948, it waws a pivota.i moment for the group which produced it. Only a few months earlier, they had been dubbed "les automatistes" by a local journalist and the name stuck, appropriate or not. Although the lead manifesto was written by a painter, Paul-Emile Borduas, it was signed by fifteen other people who were active in various artistic pursuits and Borduas' manifesto was only one part of a substantial publication which included photographs of paintings and people, as well as eight other texts, among them three short dramatic pieces by Claude Gauv- reau and an essay on dance by Françoise Sullivan. Refus global1 was a squaring of accounts in many ways. Borduas' major text was a broadly political statement after the European mode, calling for a revolution in sensibility, condemning a Quebec society which he found repressed and repres- sive. Public reaction in 1948 was almost entirely focussed on the lead manifesto and its social commentary. Not surprisingly, interest in Refus global as a primary docu- ment of Quebec's "quiet revolution" has continued over the years. I would like to concentrate, however, on the Automatists as a group of artists, predominantly but not exclusively painters, who sought to define themselves not only in opposition to an academic establishment but also in contrast to related branches of modernism such as Surrealism. -

Le Cercle Des Automatistes Et La Différence Des Femmes Rose Marie Arbour
Document généré le 30 sept. 2021 15:18 Études françaises Le cercle des automatistes et la différence des femmes Rose Marie Arbour L’automatisme en mouvement Résumé de l'article Volume 34, numéro 2-3, automne–hiver 1998 À la parution de Refus global, l'abstraction en peinture était la voie royale et logique pour marquer la rupture avec la tradition artistique et une société URI : https://id.erudit.org/iderudit/036107ar conservatrice. C'est dans ce contexte d'affrontement de l'abstraction gestuelle DOI : https://doi.org/10.7202/036107ar que les automatistes se sont fait connaître et que les stratégies du groupe se sont définies. Une telle conjoncture explique l'effacement de pratiques Aller au sommaire du numéro artistiques multidisciplinaires auxquelles les femmes du groupe étaient toutes reliées. C'est seulement beaucoup plus tard que le rôle des femmes artistes et leur apport multidisciplinaire au mouvement automatiste ont été réévalués, nous donnant une image plus complexe des rapports de pouvoir et de Éditeur(s) légitimation symbolique qui avaient alors cours au sein du groupe. Les Presses de l'Université de Montréal ISSN 0014-2085 (imprimé) 1492-1405 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Arbour, R. M. (1998). Le cercle des automatistes et la différence des femmes. Études françaises, 34(2-3), 157–173. https://doi.org/10.7202/036107ar Tous droits réservés © Les Presses de l'Université de Montréal, 1998 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. -

Just Playing Mad: Irrationalism in Automatism Via Claude Gauvreau
The Brock Review Volume 10, Number 2 (2009) © Brock University Just Playing Mad: Irrationalism in Automatism via Claude Gauvreau Gregory Betts Department of English Language & Literature Brock University Abstract: Using the work and aesthetic theories of Claude Gauvreau as both case study and focalizer, my paper will address the aesthetics of madness as it arose in one substantial node of Canadian avant-gardism – the French-Canadian Automatist movement. The Automatists shared the European Surrealist’s strong spirit of unbridled, irrational psychological utopianism, but believed they had surpassed the Surrealists in rejecting representationalism in art (including dream representation). This paper demonstrates how and why the work of the Automatists struggled to enact and unleash an irrational art on an unsuspecting Québécois public. Surrealism is not a poetic form. It is a cry of the mind turning back on itself, and it is determined to break apart its fetters, even if it must be by material hammers! “Declaration of January 27, 1925”1 Garagognialullulululululululululululululululululululullullululululullululullululululullululullullullululululululululululul lulululululuuuuuuuu Claude Gauvreau, “Jappements à la lune”2 In Claude Gauvreau’s outré dramatic objects and poetry, the madness of revolutionary politics is embedded and embodied in a disjunctive aesthetic form. In the 1940s, Gauvreau was a member of Québec’s Automatist movement that has received acclaim and notoriety for their intellectual inheritance from the continental European Surrealists -

Théorisation Et Contextualisation Des Microchromies Dans Le Cheminement Artistique Et Spirituel De Fernand Leduc
Université de Montréal Théorisation et contextualisation des microchromies dans le cheminement artistique et spirituel de Fernand Leduc par Marianne Blais-Racette Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques Faculté des arts et des sciences Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de Maître ès arts (M.A.) en histoire de l’art Août 2018 © Marianne Blais-Racette, 2018 Résumé Notre travail propose une lecture à la fois théorique et contextuelle des œuvres de Fernand Leduc produites à partir des années 1970 : les microchromies. Cherchant d’abord à comprendre le fonctionnement intrinsèque de ces œuvres, nous analysons de manière formelle quatre microchromies en portant une attention particulière sur les problématiques que chacune tente d’élucider. Le regard que nous portons sur les microchromies s’appuie sur les relations qu’entretient l’œuvre d’art avec la littérature de l’artiste, permettant ainsi de cerner l’évolution de sa pensée et de son art. Par cette double lecture, nous sommes en mesure d’inscrire les microchromies dans un cheminement long de plus de soixante-dix ans d’expérimentations artistiques et d’explorations spirituelles. À cet effet, nous analysons les courants artistiques et les philosophies qui ont, de près ou de loin, participé à la métamorphose de la démarche picturale de l’artiste. Les microchromies étant les œuvres les plus tardives de la carrière de Leduc, nous en proposons une analyse comparative avec les œuvres du début de sa carrière dans le but d’élucider ce cheminement continuel. Ainsi, il nous est possible de déterminer en quoi les microchromies peuvent être, ou non, inscrites dans la « rythmique du dépassement » en tant qu’aboutissement de sa carrière. -

Université Du Québec Memoire Présenté À L'université Du Québec À Chicouttmi Comme Exigence Partielle De La Maîtrise En
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC MEMOIRE PRÉSENTÉ À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTTMI COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN ÉTUDES LITTÉRAIRES PAR VINCENT JOHN MILLWARD VERS UNE DEFINITION DE L'AUTOMATISME QUEBECOIS PRINTEMPS 1997 UIUQAC bibliothèque Paul-Emile-Bouletj Mise en garde/Advice Afin de rendre accessible au plus Motivated by a desire to make the grand nombre le résultat des results of its graduate students' travaux de recherche menés par ses research accessible to all, and in étudiants gradués et dans l'esprit des accordance with the rules règles qui régissent le dépôt et la governing the acceptation and diffusion des mémoires et thèses diffusion of dissertations and produits dans cette Institution, theses in this Institution, the l'Université du Québec à Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) est fière de Chicoutimi (UQAC) is proud to rendre accessible une version make a complete version of this complète et gratuite de cette œuvre. work available at no cost to the reader. L'auteur conserve néanmoins la The author retains ownership of the propriété du droit d'auteur qui copyright of this dissertation or protège ce mémoire ou cette thèse. thesis. Neither the dissertation or Ni le mémoire ou la thèse ni des thesis, nor substantial extracts from extraits substantiels de ceux-ci ne it, may be printed or otherwise peuvent être imprimés ou autrement reproduced without the author's reproduits sans son autorisation. permission. Ce mémoire a été réalisé à Chicoutimi dans le cadre du programme de maîtrise en études littéraires de l'Université du Québec à Trois-Rivières extensionné à l'Université du Québec à Chicoutimi. -
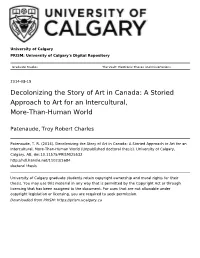
Decolonizing the Story of Art in Canada: a Storied Approach to Art for an Intercultural, More-Than-Human World
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository Graduate Studies The Vault: Electronic Theses and Dissertations 2014-08-15 Decolonizing the Story of Art in Canada: A Storied Approach to Art for an Intercultural, More-Than-Human World Patenaude, Troy Robert Charles Patenaude, T. R. (2014). Decolonizing the Story of Art in Canada: A Storied Approach to Art for an Intercultural, More-Than-Human World (Unpublished doctoral thesis). University of Calgary, Calgary, AB. doi:10.11575/PRISM/25532 http://hdl.handle.net/11023/1684 doctoral thesis University of Calgary graduate students retain copyright ownership and moral rights for their thesis. You may use this material in any way that is permitted by the Copyright Act or through licensing that has been assigned to the document. For uses that are not allowable under copyright legislation or licensing, you are required to seek permission. Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca UNIVERSITY OF CALGARY Decolonizing the Story of Art in Canada: A Storied Approach to Art for an Intercultural, More-Than-Human World by Troy Patenaude A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF ARTS IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND CULTURE CALGARY, ALBERTA AUGUST, 2014 © Troy Patenaude 2014 ii Abstract The master narrative dominating the field of Canadian art history has continually privileged Eurocentric, colonialist ways of knowing. Many art historians and critics have called for a new story, but nothing to date has been proposed. This dissertation marks the first attempt at re-envisioning the story of art in Canada. -
Thérèse Renaud : Écrire Le « Refus Global »
Thérèse Renaud : écrire le « refus global » Claudine POTVIN Université de l’Alberta Au début des années 40, quinze artistes québécois, réunis autour de Paul-Émile Borduas, vont repenser pendant près d’une décennie le contexte social, culturel et religieux du Québec d’alors, gouverné par Duplessis et l’Église catholique. À part Claude Gauvreau, le seul écrivain du groupe, poète, dramaturge, pamphlétaire, ce sont avant tout des peintres qui se rencontrent soit chez Borduas lui-même soit chez quelqu’un d’autre pour discuter de l’atmosphère étouffante qui entoure la production et l’enseignement artistiques, discussions qui donneront lieu à la rédaction d’un manifeste qui dénonce le conservatisme et l’idéologie du clergé québécois, les valeurs traditionnelles basées sur la foi, la famille, le respect de analyses, vol. 6, nº 1, hiver 2011 l’autorité, les politiques dictatoriales. Le manifeste propose une transformation sociale totale, l’ouverture des frontières mentales, l’abolition de toutes les peurs qui assaillent l’homme au nom de la spontanéité et de la liberté, enfin une esthétique « automatique » qui vise à renouveler la pensée. Lancé à la Librairie Tranquille le 9 août 1948, le Refus global va créer une série de remous dans l’univers culturel québécois. À ce sujet, il est remarquable qu’André Beaudet écrive en 1981 que « nous n’avons pas encore commencé à penser avec Borduas. Les trente années qui nous en séparent n’y auront pas suffi. Nous sommes, affirme-t-il encore, en deçà de sa nuit étoilée » (Leduc, 1981, p. 25). Trente ans plus tard, le Refus global aura été relu à maintes reprises (voir Lapointe, 2004) et réexaminé comme emblème paradoxal du sentiment identitaire (voir Lamoureux, 2001, p. -

Vente Aux Enchères En Ligne Printemps 2020 Online Auction Spring 2020
ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN POST-WAR & CONTEMPORARY ART Vente aux enchères en ligne Printemps 2020 Online Auction Spring 2020 DU 28 MAI AU 18 JUIN 2020 MAY 28 TO JUNE 18, 2020 Vente aux enchères en ligne Printemps 2020 Online Auction Spring 2020 DU 28 MAI AU 18 JUIN 2020 MAY 28 TO JUNE 18, 2020 LA VENTE SE TERMINE LE 18 JUIN À 14 H AUCTION CLOSES JUNE 18 AT 2 PM Rue St-Dominique Rue St-Denis Boul St-Laurent Rue Clark Rue Beaubien E Rosemont M Les enchères BYDealers Rue de Bellechasse Auction House Rue Beaubien O Ave Van Horne P Ave du Parc Boul St-Laurent Ave Bernard 2 ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR & CONTEMPORARY ART Exposition des œuvres Preview of works MONTRÉAL 6345, boul. Saint-Laurent DU MARDI AU SAMEDI, DE 10 H À 18 H TUESDAY TO SATURDAY, 10 AM TO 6 PM ART D’APRÈS-GUERRE & CONTEMPORAIN / POST-WAR AND CONTEMPORARY ART 28 MAI AU 18 JUIN 2020 / MAY 28 TO JUNE 18, 2020, MONTRÉAL 3 Les enchères BYDealers / Catalogue Inscriptions au catalogue / Auction House Catalogue Subscriptions Directrice du catalogue / Pour recevoir le catalogue des futures enchères, visitez 6345, boulevard Saint-Laurent Catalogue Manager notre site Internet pour remplir le formulaire d’inscription Montréal (Québec) H2S 3C3 Annie Lafleur ou écrivez-nous à [email protected]. 1 888 399-7856 Révision et lecture d’épreuves / To receive catalogues of future auctions, visit 514 274-2606 Copy editing our website to fill out the form or write to us at [email protected] Joanie Demers [email protected].