Le Gisement De Craie Phosphatee De Ciply Donnees Nouvelles
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Commune Cuesmes
BE-A0524_705531_702560_FRE Inventaire des archives de la commune de Cuesmes, 1709-1968 Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Commune Cuesmes DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................9 DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.......................................................11 I. Généralités.................................................................................................11 A. Archives............................................................................................................ 11 B. Conseil Communal...........................................................................................11 2 - 10 Délibérations. 1802-1882.......................................................................11 11 - 14 Procès-verbaux des séances. 1836-1887.............................................12 15 - 69 Minutes des procès-verbaux. 1869-1923.............................................12 70 - 89 Convocations, ordres du jour. 1883-1903.............................................16 90 - 100 Rapports adressés au Conseil communal par le Collège, en exécution de l'article 70 de la Loi communale. 1901-1913...............................................18 C. Collège echevinal.............................................................................................19 101 - 104 Délibérations. 1836-1893.................................................................19 -

3E Trim 2017
Le trimestriel de votre zone de police Mons - Quévy 3e Trim 2017 LE 21 JUILLET, LA ZONE DE POLICE A ACCUEILLI LA COMMISSAIRE GÉNÉRALE AU VILLAGE POLICIER À BRUXELLES. Commune de Quévy Édito Pour davantage de sécurité dans nos quartiers Chère Montoise, Cher Montois, Une des priorités en matière de police est la présence maximale des policiers sur le Une police plus terrain. Ce que nous voulons, c’est empêcher au maximum les méfaits, avant donc qu’ils ne se produisent, et c’est pour cela que la prévention est primordiale. Nous efficiente et plus avons décidé de débloquer un budget supplémentaire afin d’engager de nouveaux proche du citoyen, policiers, 20 au total cette année. Nous voulons aussi libérer au maximum les poli- c’est la volonté ciers de leurs tâches administratives pour qu’ils soient plus présents dans les rues et dans les quartiers. commune des autorités et Pour soutenir les policiers dans leurs missions, nous travaillons depuis plusieurs années à de la police. l’installation de davantage de caméras de surveillance, à la fois dans le centre-ville de Mons et dans les autres communes. Ainsi, après l’installation de nouvelles caméras à Havré, la zone de police va prochainement en installer sur la Place de Cuesmes et sur la Place de Bootle. Les caméras ne résolvent pas tous les problèmes de sécurité mais elles permettent notamment aux policiers d’être plus efficients. Car il ne s’agit pas seulement d’ins- taller les caméras mais bien de détecter les situations problématiques ! En cas de situation suspecte, l’opérateur peut directement envoyer une équipe sur place ou fournir les images dans le cadre d’une enquête. -

Nos Centres De Prélèvements
Nos centres de prélèvements Masnuy-St-Jean : 24, rue des Déportés - 0494 85 39 45 Prises de sang : lun. 7h-9h30 et sur RDV / mar.-sam. sur RDV Enfants de plus de 2 ans sur RDV AuVu CHUle contexte Ambroise exceptionnel Paré, le laboratoirede la pandémie, est ouvert veuillez : prendre contact Maurage : 208, rue de la Croisette - 0498 23 25 79 par téléphone avec le centre de prélèvement de votre choix afin de Prises de sang : lun., mer. et ven. 7h-9h / vous assurer que celui-ci pourra vous accueillir ainsi que les mar., jeu. et sam. sur RDV éventuellesdu lundi conditions au vendredi. de 7h à 17h Mons : 12, place du Marché aux Herbes – 0475 56 18 33 le samedi de 8h à 11h Prises de sang : lun.-ven. 7h-10h Les trianglesRenseignements d’hyperglycémie et prises ne de sont RDV momentanément : 065/ 41 78 11 plus réalisés dans le centre du CHU. Nimy : place de Nimy (219, rue des Viaducs) – Tous les centres de prélèvements (y compris celui du laboratoire) sont 0476 54 48 13 Prise de sang : lun.-sam. 7h-10h fermés les dimanches et jours fériés. Obourg : 61, rue Saint-Macaire – 0496 20 15 57 Prise de sang : lun.-ven. 6h30-8h30 Les documents suivants sont obligatoires : - la prescription médicale et votre Carte d’identité au CHU Quaregnon : 293, rue de Monsville - 0495 23 00 68 ou - la prescription médicale et 3 vignettes de mutuelle dans les 0470 52 64 43 Prise de sang : lun.-ven. 7h à 10h / sam. 8h-10h centres de prélèvements. Quiévrain : 10, avenue Reine Astrid - 0479 67 52 75 / Tests sur RDV : 0475 81 33 59 Prises de sang : lun.-ven. -

Préfecture Du Département De Jemappes
BE-A0524_708550_707627_FRE Inventaire des archives de la préfecture du département de Jemappes Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Préfecture du département de Jemappes DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:..............................................................21 Consultation et utilisation..............................................................................22 Conditions d'accès.....................................................................................22 Histoire du producteur et des archives..........................................................23 Producteur d'archives................................................................................23 Compétences et activités.......................................................................23 Organisation...........................................................................................24 Les préfets du département de Jemappes, de 1800 à 1814...............24 Les sous-préfets..................................................................................26 Le secrétaire général de préfecture....................................................27 Le Conseil de préfecture.....................................................................27 Archives.....................................................................................................29 Historique...............................................................................................29 -

La S.A. Des Charbonnages Du Levant Et Des Produits Du Flénu
Sauvegarde des Archives industrielles du Couchant de Mons Société anonyme des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu Inventaire provisoire 2008 Sauvegarde des Archives Industrielles du Couchant de Mons SAICOM A.S.B.L. – Centre d’archives privées Rue Saint-Patrice, 2b B-7110 Houdeng-Aimeries Introduction _______________________________________________________________ 4 La S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flenu, à Cuesmes __________________ 5 Inventaire _________________________________________________________________ 7 1. S.A. des Charbonnages du Levant du Flénu, à Cuesmes ____________________________ 8 La direction générale et financière _________________________________________________________ 8 La direction de l’exploitation ______________________________________________________________ 9 Personnel ____________________________________________________________________________ 10 Régie ________________________________________________________________________________ 10 2. S.A. des Charbonnages des Produits du Flénu, à Flénu ____________________________ 11 La direction de l’exploitation _____________________________________________________________ 11 Personnel ____________________________________________________________________________ 12 Etudes des mines étrangères/Voyages d’études _____________________________________________ 12 3. S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, à Cuesmes _______________ 12 Société ______________________________________________________________________________ 12 Direction -

Save Pdf (0.63
Netherlands Journal of Geosciences — Geologie en Mijnbouw | 90 – 2/3 | 165 - 178 | 2011 The belemnite zonation of the uppermost Cretaceous in the Maastricht-Aachen-Liège, Brabant-Méhaigne and Mons areas (Belgium, southeast Netherlands)* N. Keutgen KFPBR, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy Bydgoszcz, ul. Bernardynska 6/8, PL-85 029 Bydgoszcz, Poland. Email: [email protected]. Manuscript received: January 2011, accepted: July 2011 Abstract An overview is presented of belemnitellid faunas of Santonian to Maastrichtian (Late Cretaceous) age in the Mons Basin and in the Brabant-Méhaigne and Maastricht-Aachen-Liège areas (Belgium, southeast Netherlands). As many as twenty-two species of the genera Actinocamax Miller, 1823, Gonioteuthis Bayle, 1878, Belemnitella d’Orbigny, 1840 and Belemnella Nowak, 1913 have been recorded to date. On the basis of these, thirteen zones can be distinguished: three in the Santonian (G. w. westfalica, G. westfalicagranulata and G. granulata), six in the Campanian (G. granulataquadrata, G. quadrata, Blt. mucronata, Blt. woodi, Blt. minor I and Blt. minor II) and four in the Maastrichtian (Bln. obtusa, Bln. ex gr. sumensis/cimbrica, Blt. junior and Bln. kazimiroviensis). Correlative schemes between these zones and those proposed for Norfolk (southeast England) and for the combined Lägerdorf-Kronsmoor-Hemmoor section (northern Germany) are presented. The belemnitellid assemblage of the study area closely resembles that of Norfolk, but differs from the late Campanian faunas of northwest Germany. Keywords: Belemnitellids, stratigraphy, Actinocamax, Gonioteuthis, Belemnitella, Belemnella, Upper Cretaceous, Belgium, the Netherlands Introduction not (yet) been identified in northern Germany (Kronsmoor, Lägerdorf), but there Blt. langei (sensu Schulz, 1978) and Blt. During the last decades, belemnitellid cephalopods (Coleoidea) schulzi appear, two forms apparently restricted to that region and have been considered to be of fundamental importance for unknown from Norfolk, the Mons Basin and the MAL area. -
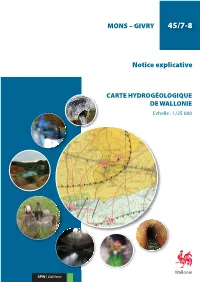
Carte Hydrogéologique De Mons-Givry 45/7-8
MONS – GIVRY 45/7-8 Notice explicative CARTE HYDROGÉOLOGIQUE DE WALLONIE Echelle : 1/25 000 Photos couverture © SPW-DGARNE(DGO 3) Fontaine de l'ours à Andenne Forage exploité Argilière de Celles à Houyet Puits et sonde de mesure de niveau piézométrique Emergence (source) Essai de traçage au Chantoir de Rostenne à Dinant Galerie de Hesbaye Extrait de la carte hydrogéologique Mons – Givry MONS – GIVRY 45/7-8 Anne MENGEOT , Sylvie ROLAND , Alain RORIVE Université de Mons Rue de Houdain, 9 - B-7000 Mons (Belgique) NOTICE EXPLICATIVE 2017 Première version : Février 2000 Actualisation partielle : NovemBre 2016 Dépôt légal – D/2017/12.796/8- ISBN : 978-2-8056-0232-0 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE DE L 'A GRICULTURE , DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L 'E NVIRONNEMENT (DGARNE-DGO 3) AVENUE PRINCE DE LIEGE , 15 B-5100 NAMUR (J AMBES ) - BELGIQUE Table des matières AVANT-PROPOS .......................................................................................................................................................... 6 I. INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 8 II. CADRE GEOGRAPHIQUE, GEOMORPHOLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE ............................................................... 9 III. CADRE GEOLOGIQUE ............................................................................................................................................11 III.1. CADRE GEOLOGIQUE REGIONAL -

Fiche Communale
Fiche communale Mons Édition 2020 Fiche communale Mons Editeurs responsables Nathalie QUEVY Helen BARTHE BATSALLE Hainaut développement Observatoire de la Santé du Hainaut Parc scientifique Initialis Rue de Saint-Antoine 1 – 7021 Havré Boulevard Initialis 22 – 7000 Mons Tél.: +32 65 879 600 – Fax: +32 65 879 679 Tél.: +32 65 342 612 – Fax: +32 65 342 603 Récolte, structuration des données – Rédaction HAINAUT DEVELOPPEMENT OBSERVATOIRE DE LA SANTE DU HAINAUT Système d’Information stratégique Paul BERRA Richard REMISZ – Sam VAN DE VOORDE Rue de Saint-Antoine 1 – 7021 Havré Parc scientifique Initialis Tél.: +32 65 879 635 – Fax: +32 65 879 679 Boulevard Initialis 22 – 7000 Mons Tél.: 0800 15 500 – Fax: +32 65 342 566 Email: [email protected] "Hormis les exceptions explicitement prévues par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse et préalable de l'éditeur". 2ème mise à jour 2020 1 Sommaire Éléments marquants… ......................................................................................................................... 4 1. Territoire .......................................................................................................................................... 5 2. Population ....................................................................................................................................... 6 2.1. Population et évolution .......................................................................................................... -

Collection Dite "Petites Archives De Familles", Xiiie - Xxe Siècles
BE-A0524_707440_703003_FRE Inventaire de la collection dite "Petites archives de familles", XIIIe - XXe siècles Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Collection dite "Petites archives de familles" DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................7 DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.........................................................9 Collection dite " Petites Archives de Familles "................................................9 1 - 2 Acarin (Jean). Bail d'un bien à Chièvres. 1710................................................9 13 - 14 Ansseau. Fontaine-l'Évêque et Mons. Papiers de famille et documents divers. 1623-1802................................................................................................10 69 - 74 Berlaymont (de). Mouffrin, dépendance de Nattoye (Namur). Mons, Bougnies, Spiennes. Papiers de famille. XVIIe-XVIIIe siècles.................................16 76 - 77 Bernard. Papiers de famille. Chassereau de biens. XVIIIe-XIXe siècles.....16 88 - 91 Biens. Papiers de famille. XVIIe-XVIIIe siècles...........................................18 101 - 110 Blois (De) Papiers de famille, gestion des biens XVIIe-XIXe siècles......18 113 - 114 Boele. Papiers de famille, pièces concernant les biens. 1613-1778.....20 119 - 125 Boisacq. Tournai. Papiers de famille et d'affaires, actes de gestion de biens, dessins et chansons d'époque. XVIIIe-XIXe siècles.....................................20 -

Abbaye De Bélian Mesvin
BE-A0524_705994_707787_FRE Inventaire des archives de l'abbaye de Bélian à Mons, XIIIe-XVIIIe siècles Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Abbaye de Bélian Mesvin DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................5 DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.........................................................7 Les archives de l'abbaye de Bethléem ou de Bélian à Mesvin-lez-Mons (XIIIe- XVIIIe siècle)....................................................................................................7 I. Généralités.......................................................................................................... 7 II. Statuts et discipline conventuelle.......................................................................7 III. Comptabilité...................................................................................................... 8 10 - 12 Comptes des recettes et dépenses de l'abbaye de Bélian. 1742 - 1785. ........................................................................................................................... 8 IV. Refuges de l'abbaye..........................................................................................8 V. Biens................................................................................................................... 8 A. Belgique........................................................................................................ -

Nouvelles Générales
MONS/LA LOUVIÈRE MENSUEL N° 9 - NOVEMBRE 2012 NOUVELLES GÉNÉRALES 4 556 VISITEURS AU SALON DE L’EMPLOI DE LA LOUVIÈRE Le Forem organisait du 9 au 19 octobre la 5 ème édition de la Au salon de La Louvière, plus de 4 500 visiteurs sont venus ren- Semaine de l’Emploi. Lors de cette semaine, des salons ont eu contrer les 40 entreprises participantes et découvrir les forma- lieu dans différentes villes de Wallonie. Cette initiative a permis tions qui mènent à l’emploi. Parmi les résultats enregistrés au à 27 710 candidats de postuler auprès 363 entreprises. Louvexpo, on épinglera les 247 demandes de formation auprès du Forem ainsi que les 226 visites comptabilisées au village de AU SOMMAIRE la création d’activité. A noter également que 95 personnes ont passé un test pour évaluer leur niveau en langues. Au-delà de NOUVELLES GÉNÉRALES 0 4 556 VISITEURS AU SALON DE L’EMPLOI DE LA LOUVIÈRE ces chiffres bruts enregistrés au salon de l’emploi, ce sont 0 REOUVERTURE DU CANAL CONDE-POMMEROEUL EN 2016 surtout les témoignages et les premiers retours des partici- 0 BINCHE S’OFFRE UN NOUVEL HOTEL DE POLICE pants qui sont encourageants. Une responsable de Decathlon 0 « DOUR CENTRE-VILLE » INTEGRE DE NOUVEAUX LOCAUX confirme : « Nous recherchions un vendeur, un hôte de caisse 0 INITIER DES PROJETS INNOVANTS POUR TROUVER DE L’EMPLOI ! 0 FACILITER L’INTEGRATION ET LA RÉORIENTATION DES TRAVAILLEURS MOINS VALIDES et un responsable de rayon. Nous avons reçu beaucoup de 0 LE MUNDANEUM AFFIRME LA RENAISSANCE DU 2.O monde au salon dont environ 30 personnes qui correspondent SECTEURS ET ENTREPRISES aux profils recherchés. -

Ciply • Cuesmes • Flénu • Ghlin Harmignies • Harveng
J’AIME CIPLY • CUESMES • FLÉNU • GHLIN HARMIGNIES • HARVENG • HAVRÉ • HYON JEMAPPES • MAISIÈRES • MESVIN • MONS NIMY • NOUVELLES • OBOURG SAINT-DENIS • SAINT-SYMPHORIEN SPIENNES • VILLERS-SAINT-GHISLAIN MONS BILAN MONS 2012-2018 Photo : Gregory Mathelot 1 2 TABLE DES MATIÈRES LA CRÉATION D’ACTIVITÉS 6 LA SÉCURITÉ 8 LA MOBILITÉ 10 LA PROPRETÉ 12 L’ÉDUCATION 13 LA COHÉSION SOCIALE 14 LA PARTICIPATION CITOYENNE 20 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 21 LA MÉTAMORPHOSE DE LA VILLE 22 LE SPORT 26 LE COMMERCE 28 LE LOGEMENT 29 LA CULTURE 30 L’AGRICULTURE 32 UN SERVICE PUBLIC PERFORMANT 33 LE TOURISME 34 LES TRAVAUX COMMUNE PAR COMMUNE 35 VOS CANDIDATS 60 3 Chère Madame, Cher Monsieur, Vous serez appelé(e) à voter, le 14 octobre prochain, afin de choisir les 45 conseillères et conseillers qui siégeront au Conseil communal de notre ville durant les 6 prochaines an- nées. Ce sera un moment très important pour le Grand-Mons et tous ses habitants. Votre choix sera guidé par de multiples facteurs : les programmes des partis, votre connais- sance personnelle des candidats, et peut-être aussi la reconnaissance du travail effectué par le Collège. À cet égard, j’ai le plaisir de vous présenter ce document de synthèse, qui vous aidera à prendre votre décision. Il s’agit d’un aperçu du travail réalisé par les conseillers communaux socialistes au cours de cette législature qui a vu Mons devenir la Capitale européenne de la Culture. Vous y trouverez un bilan des grandes réalisations menées sous l’impulsion du PS ainsi qu’un état des lieux de notre ville.