Le Grand-Mons Point De Depart D'une Grande Agglomeration?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Commune Cuesmes
BE-A0524_705531_702560_FRE Inventaire des archives de la commune de Cuesmes, 1709-1968 Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Commune Cuesmes DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................9 DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.......................................................11 I. Généralités.................................................................................................11 A. Archives............................................................................................................ 11 B. Conseil Communal...........................................................................................11 2 - 10 Délibérations. 1802-1882.......................................................................11 11 - 14 Procès-verbaux des séances. 1836-1887.............................................12 15 - 69 Minutes des procès-verbaux. 1869-1923.............................................12 70 - 89 Convocations, ordres du jour. 1883-1903.............................................16 90 - 100 Rapports adressés au Conseil communal par le Collège, en exécution de l'article 70 de la Loi communale. 1901-1913...............................................18 C. Collège echevinal.............................................................................................19 101 - 104 Délibérations. 1836-1893.................................................................19 -

Nos Centres De Prélèvements
Nos centres de prélèvements Masnuy-St-Jean : 24, rue des Déportés - 0494 85 39 45 Prises de sang : lun. 7h-9h30 et sur RDV / mar.-sam. sur RDV Enfants de plus de 2 ans sur RDV AuVu CHUle contexte Ambroise exceptionnel Paré, le laboratoirede la pandémie, est ouvert veuillez : prendre contact Maurage : 208, rue de la Croisette - 0498 23 25 79 par téléphone avec le centre de prélèvement de votre choix afin de Prises de sang : lun., mer. et ven. 7h-9h / vous assurer que celui-ci pourra vous accueillir ainsi que les mar., jeu. et sam. sur RDV éventuellesdu lundi conditions au vendredi. de 7h à 17h Mons : 12, place du Marché aux Herbes – 0475 56 18 33 le samedi de 8h à 11h Prises de sang : lun.-ven. 7h-10h Les trianglesRenseignements d’hyperglycémie et prises ne de sont RDV momentanément : 065/ 41 78 11 plus réalisés dans le centre du CHU. Nimy : place de Nimy (219, rue des Viaducs) – Tous les centres de prélèvements (y compris celui du laboratoire) sont 0476 54 48 13 Prise de sang : lun.-sam. 7h-10h fermés les dimanches et jours fériés. Obourg : 61, rue Saint-Macaire – 0496 20 15 57 Prise de sang : lun.-ven. 6h30-8h30 Les documents suivants sont obligatoires : - la prescription médicale et votre Carte d’identité au CHU Quaregnon : 293, rue de Monsville - 0495 23 00 68 ou - la prescription médicale et 3 vignettes de mutuelle dans les 0470 52 64 43 Prise de sang : lun.-ven. 7h à 10h / sam. 8h-10h centres de prélèvements. Quiévrain : 10, avenue Reine Astrid - 0479 67 52 75 / Tests sur RDV : 0475 81 33 59 Prises de sang : lun.-ven. -

La S.A. Des Charbonnages Du Levant Et Des Produits Du Flénu
Sauvegarde des Archives industrielles du Couchant de Mons Société anonyme des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu Inventaire provisoire 2008 Sauvegarde des Archives Industrielles du Couchant de Mons SAICOM A.S.B.L. – Centre d’archives privées Rue Saint-Patrice, 2b B-7110 Houdeng-Aimeries Introduction _______________________________________________________________ 4 La S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flenu, à Cuesmes __________________ 5 Inventaire _________________________________________________________________ 7 1. S.A. des Charbonnages du Levant du Flénu, à Cuesmes ____________________________ 8 La direction générale et financière _________________________________________________________ 8 La direction de l’exploitation ______________________________________________________________ 9 Personnel ____________________________________________________________________________ 10 Régie ________________________________________________________________________________ 10 2. S.A. des Charbonnages des Produits du Flénu, à Flénu ____________________________ 11 La direction de l’exploitation _____________________________________________________________ 11 Personnel ____________________________________________________________________________ 12 Etudes des mines étrangères/Voyages d’études _____________________________________________ 12 3. S.A. des Charbonnages du Levant et des Produits du Flénu, à Cuesmes _______________ 12 Société ______________________________________________________________________________ 12 Direction -
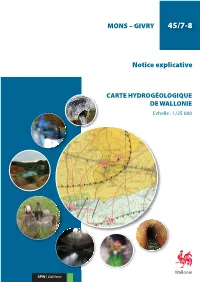
Carte Hydrogéologique De Mons-Givry 45/7-8
MONS – GIVRY 45/7-8 Notice explicative CARTE HYDROGÉOLOGIQUE DE WALLONIE Echelle : 1/25 000 Photos couverture © SPW-DGARNE(DGO 3) Fontaine de l'ours à Andenne Forage exploité Argilière de Celles à Houyet Puits et sonde de mesure de niveau piézométrique Emergence (source) Essai de traçage au Chantoir de Rostenne à Dinant Galerie de Hesbaye Extrait de la carte hydrogéologique Mons – Givry MONS – GIVRY 45/7-8 Anne MENGEOT , Sylvie ROLAND , Alain RORIVE Université de Mons Rue de Houdain, 9 - B-7000 Mons (Belgique) NOTICE EXPLICATIVE 2017 Première version : Février 2000 Actualisation partielle : NovemBre 2016 Dépôt légal – D/2017/12.796/8- ISBN : 978-2-8056-0232-0 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE DE L 'A GRICULTURE , DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L 'E NVIRONNEMENT (DGARNE-DGO 3) AVENUE PRINCE DE LIEGE , 15 B-5100 NAMUR (J AMBES ) - BELGIQUE Table des matières AVANT-PROPOS .......................................................................................................................................................... 6 I. INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 8 II. CADRE GEOGRAPHIQUE, GEOMORPHOLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE ............................................................... 9 III. CADRE GEOLOGIQUE ............................................................................................................................................11 III.1. CADRE GEOLOGIQUE REGIONAL -

Guide De La Seconde Main Mons & Borinage
Guide de la seconde main Mons & Borinage Plus de 30 adresses et des bons plans dans l'Internet ! u'on y trou e q ve -c ? st 'e u Que ce soit Q des vêtements, la puériculture, du mobilier, des livres, des jeux ou encore de l’électroménager ain... c'e m st q de u n o o i c Obtenir ? e s ou utiliser une a L chose alors que celle-ci a déjà été possédée par une autre personne ui ? r q ou p t s e ' Pour toi, C moi, toutes les personnes qui sont à la recherche de « la bonne affaire » nses-t n pe u ? u'e i q o T. : t t « C’est cool ! E C’est bien pour les gens qui n’ont pas les moyens. Pour mes vêtements, je fais beaucoup de recherches sur Facebook. Et je trouve mon bonheur » M. : « Ce n’est pas cher ! Efficace pour les gens à petit budget. Je J. : vais souvent chercher des « J’utilise vêtements pour ma fille et souvent des moi-même. On peut même vêtements de seconde trouver des vêtements main que ce soit pour mes de marque à petit enfants et moi-même. Je prix » recherche sur Facebook. J’ai également utilisé des meubles de seconde main » S. : « Mon mari achetait des voitures en seconde main. Avant je n’avais jamais pris des vêtements ou des meubles déjà utilisés. Mais maintenant je fais des recherches A. : pour des meubles et je trouve des « Vêtements choses intéressantes pour mon en seconde main, futur déménagement à des jamais ! Mais ça c’était prix abordables » avant. -

Fiche Communale
Fiche communale Mons Édition 2020 Fiche communale Mons Editeurs responsables Nathalie QUEVY Helen BARTHE BATSALLE Hainaut développement Observatoire de la Santé du Hainaut Parc scientifique Initialis Rue de Saint-Antoine 1 – 7021 Havré Boulevard Initialis 22 – 7000 Mons Tél.: +32 65 879 600 – Fax: +32 65 879 679 Tél.: +32 65 342 612 – Fax: +32 65 342 603 Récolte, structuration des données – Rédaction HAINAUT DEVELOPPEMENT OBSERVATOIRE DE LA SANTE DU HAINAUT Système d’Information stratégique Paul BERRA Richard REMISZ – Sam VAN DE VOORDE Rue de Saint-Antoine 1 – 7021 Havré Parc scientifique Initialis Tél.: +32 65 879 635 – Fax: +32 65 879 679 Boulevard Initialis 22 – 7000 Mons Tél.: 0800 15 500 – Fax: +32 65 342 566 Email: [email protected] "Hormis les exceptions explicitement prévues par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse et préalable de l'éditeur". 2ème mise à jour 2020 1 Sommaire Éléments marquants… ......................................................................................................................... 4 1. Territoire .......................................................................................................................................... 5 2. Population ....................................................................................................................................... 6 2.1. Population et évolution .......................................................................................................... -

The Overview of the Conservation and Renewal of the Industrial Belgian Heritage As a Vector for Cultural Regeneration
information Review The Overview of the Conservation and Renewal of the Industrial Belgian Heritage as a Vector for Cultural Regeneration Jiazhen Zhang 1, Jeremy Cenci 1,* , Vincent Becue 1 and Sesil Koutra 1,2 1 Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Mons, Rue d’ Havre, 88, 7000 Mons, Belgium; [email protected] (J.Z.); [email protected] (V.B.); [email protected] (S.K.) 2 Faculty of Engineering, Erasmus Mundus Joint Master SMACCs, University of Mons, 7000 Mons, Belgium * Correspondence: [email protected]; Tel.: +32-498-79-1173 Abstract: Industrial heritage reflects the development track of human production activities and witnessed the rise and fall of industrial civilization. As one of the earliest countries in the world to start the Industrial Revolution, Belgium has a rich industrial history. Over the past years, a set of industrial heritage renewal projects have emerged in Belgium in the process of urban regeneration. In this paper, we introduce the basic contents of the related terms of industrial heritage, examine the overall situation of protection and renewal in Belgium. The industrial heritage in Belgium shows its regional characteristics, each region has its representative industrial heritage types. In the Walloon region, it is the heavy industry. In Flanders, it is the textile industry. In Brussels, it is the service industry. The kinds of industrial heritages in Belgium are coordinate with each other. Industrial heritage tourism is developed, especially on eco-tourism, experience tourism. The industrial heritage in transportation and mining are the representative industrial heritages in Belgium. -

Collection Dite "Petites Archives De Familles", Xiiie - Xxe Siècles
BE-A0524_707440_703003_FRE Inventaire de la collection dite "Petites archives de familles", XIIIe - XXe siècles Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Collection dite "Petites archives de familles" DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................7 DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.........................................................9 Collection dite " Petites Archives de Familles "................................................9 1 - 2 Acarin (Jean). Bail d'un bien à Chièvres. 1710................................................9 13 - 14 Ansseau. Fontaine-l'Évêque et Mons. Papiers de famille et documents divers. 1623-1802................................................................................................10 69 - 74 Berlaymont (de). Mouffrin, dépendance de Nattoye (Namur). Mons, Bougnies, Spiennes. Papiers de famille. XVIIe-XVIIIe siècles.................................16 76 - 77 Bernard. Papiers de famille. Chassereau de biens. XVIIIe-XIXe siècles.....16 88 - 91 Biens. Papiers de famille. XVIIe-XVIIIe siècles...........................................18 101 - 110 Blois (De) Papiers de famille, gestion des biens XVIIe-XIXe siècles......18 113 - 114 Boele. Papiers de famille, pièces concernant les biens. 1613-1778.....20 119 - 125 Boisacq. Tournai. Papiers de famille et d'affaires, actes de gestion de biens, dessins et chansons d'époque. XVIIIe-XIXe siècles.....................................20 -

Abbaye De Bélian Mesvin
BE-A0524_705994_707787_FRE Inventaire des archives de l'abbaye de Bélian à Mons, XIIIe-XVIIIe siècles Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Abbaye de Bélian Mesvin DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................5 DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.........................................................7 Les archives de l'abbaye de Bethléem ou de Bélian à Mesvin-lez-Mons (XIIIe- XVIIIe siècle)....................................................................................................7 I. Généralités.......................................................................................................... 7 II. Statuts et discipline conventuelle.......................................................................7 III. Comptabilité...................................................................................................... 8 10 - 12 Comptes des recettes et dépenses de l'abbaye de Bélian. 1742 - 1785. ........................................................................................................................... 8 IV. Refuges de l'abbaye..........................................................................................8 V. Biens................................................................................................................... 8 A. Belgique........................................................................................................ -

Ciply • Cuesmes • Flénu • Ghlin Harmignies • Harveng
J’AIME CIPLY • CUESMES • FLÉNU • GHLIN HARMIGNIES • HARVENG • HAVRÉ • HYON JEMAPPES • MAISIÈRES • MESVIN • MONS NIMY • NOUVELLES • OBOURG SAINT-DENIS • SAINT-SYMPHORIEN SPIENNES • VILLERS-SAINT-GHISLAIN MONS BILAN MONS 2012-2018 Photo : Gregory Mathelot 1 2 TABLE DES MATIÈRES LA CRÉATION D’ACTIVITÉS 6 LA SÉCURITÉ 8 LA MOBILITÉ 10 LA PROPRETÉ 12 L’ÉDUCATION 13 LA COHÉSION SOCIALE 14 LA PARTICIPATION CITOYENNE 20 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 21 LA MÉTAMORPHOSE DE LA VILLE 22 LE SPORT 26 LE COMMERCE 28 LE LOGEMENT 29 LA CULTURE 30 L’AGRICULTURE 32 UN SERVICE PUBLIC PERFORMANT 33 LE TOURISME 34 LES TRAVAUX COMMUNE PAR COMMUNE 35 VOS CANDIDATS 60 3 Chère Madame, Cher Monsieur, Vous serez appelé(e) à voter, le 14 octobre prochain, afin de choisir les 45 conseillères et conseillers qui siégeront au Conseil communal de notre ville durant les 6 prochaines an- nées. Ce sera un moment très important pour le Grand-Mons et tous ses habitants. Votre choix sera guidé par de multiples facteurs : les programmes des partis, votre connais- sance personnelle des candidats, et peut-être aussi la reconnaissance du travail effectué par le Collège. À cet égard, j’ai le plaisir de vous présenter ce document de synthèse, qui vous aidera à prendre votre décision. Il s’agit d’un aperçu du travail réalisé par les conseillers communaux socialistes au cours de cette législature qui a vu Mons devenir la Capitale européenne de la Culture. Vous y trouverez un bilan des grandes réalisations menées sous l’impulsion du PS ainsi qu’un état des lieux de notre ville. -
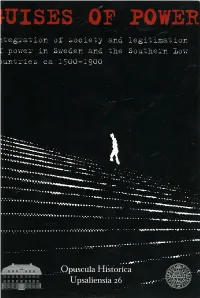
Scangate Document
Opuscula Historica Upsaliensia utges av Historiska institutionen vid Uppsala universitet och syftar till att sprida information om den forskning som bedrivs på institutionen. Huvudredaktör: Asa Karlsson. Redaktion: Gudrun Andersson, Håkan Gunneriusson och Karin Jansson. Löpande prenumeration tecknas genom skriftlig anmälan till Opuscula, Historiska institutionen, S:t Larsgatan 2, 753 10 Uppsala. Enstaka nummer kan beställas från Historiska institutionen. För ytterligare information kontakta på telefon 018-47115 42, telefax 018-47115 28 eller E-post: [email protected], Karin.J [email protected] Guises of Power Integration of society and legitimisation of power in Sweden and the Southern Low Countries ca 1500-1900 Maria Ågren, Asa Karlsson and Xavier Rousseaux (eds.) Distribution Department of History, S:t Larsgatan 2, SE-753 10 Uppsala, Sweden Cover: Håkan Belin © The Authors Graphics and layout: Chripa Fotograf & Reklam Printed in Sweden by: X-O Graf Tryckeri AB Uppsala 2001 ISSN 0284-8783 ISBN 91-506-1423-1 Contents Preface 5 Maria Ågren, Asa Karlsson and Xavier Rousseux A Modern Year for a Modern Mind. The replacement of holidays by dates in Swedish legal ordinances 11 Henrik Ågren Gender as Symbolic Capital? Women and property in the seven- teenth and eighteenth centuries 23 Gudrun Andersson Identity and Integration. Student unrest in early modern Uppsala Lars Geschwind. 33 Legitimisation of Resistance: The Argumentation of Rebellious Peasants, 1742-43 45 Karin Sennefelt Spatial Integration at the District Courts in Seventeenth -

Belgian Laces
Belgian Laces Rolle Volume 22#86 March 2001 BELGIAN LACES Official Quarterly Bulletin of THE BELGIAN RESEARCHERS Belgian American Heritage Association Our principal objective is: Keep the Belgian Heritage alive in our hearts and in the hearts of our posterity President/Newsletter editor Régine Brindle Vice-President Gail Lindsey Treasurer/Secretary Melanie Brindle Deadline for submission of Articles to Belgian Laces: January 31 - April 30 - July 31 - October 31 Send payments and articles to this office: THE BELGIAN RESEARCHERS Régine Brindle - 495 East 5th Street - Peru IN 46970 Tel/Fax:765-473-5667 e-mail [email protected] *All subscriptions are for the calendar year* *New subscribers receive the four issues of the current year, regardless when paid* ** The content of the articles is the sole responsibility of those who wrote them* TABLE OF CONTENTS Letter from the Editor - Membership p25 Ellis Island American Family Immigration History Center: p25 "The War Volunteer” by Caspar D. p26 ROCK ISLAND, IL - 1900 US CENSUS - Part 4 p27 "A BRIEF STOP AT ROCK ISLAND COUNTY HISTORICAL SOCIETY,"by Michael John Neill p30 Declarations of Intention, Douglas Co. Wisconsin, Part 1, By John BUYTAERT, MI p32 History of Lace p35 DECLARATIONS OF INTENTION — BROWN COUNTY, WISCONSIN, by MaryAnn Defnet p36 In the Land of Quarries: Dongelberg-Opprebais, by Joseph TORDOIR p37 Belgians in the United States 1990 Census p39 Female Labor in the Mines, by Marcel NIHOUL p40 The LETE Family Tree, Submitted by Daniel DUPREZ p42 Belgian Emigrants from the Borinage, Combined work of J. DUCAT, D. JONES, P.SNYDER & R.BRINDLE p43 The emigration of inhabitants from the Land of Arlon, Pt 2, by André GEORGES p45 Area News p47 Queries p47 Belgian Laces Vol 23-86 March 2001 Dear Friends, Just before mailing out the December 2000 issue of Belgian Laces, and as I was trying to figure out an economical way of reminding members to send in their dues for 2001, I started a list for that purpose.