Madame Butterfly
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
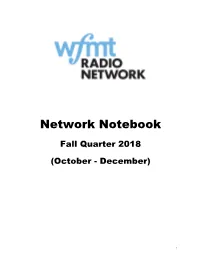
Network Notebook
Network Notebook Fall Quarter 2018 (October - December) 1 A World of Services for Our Affiliates We make great radio as affordable as possible: • Our production costs are primarily covered by our arts partners and outside funding, not from our affiliates, marketing or sales. • Affiliation fees only apply when a station takes three or more programs. The actual affiliation fee is based on a station’s market share. Affiliates are not charged fees for the selection of WFMT Radio Network programs on the Public Radio Exchange (PRX). • The cost of our Beethoven and Jazz Network overnight services is based on a sliding scale, depending on the number of hours you use (the more hours you use, the lower the hourly rate). We also offer reduced Beethoven and Jazz Network rates for HD broadcast. Through PRX, you can schedule any hour of the Beethoven or Jazz Network throughout the day and the files are delivered a week in advance for maximum flexibility. We provide highly skilled technical support: • Programs are available through the Public Radio Exchange (PRX). PRX delivers files to you days in advance so you can schedule them for broadcast at your convenience. We provide technical support in conjunction with PRX to answer all your distribution questions. In cases of emergency or for use as an alternate distribution platform, we also offer an FTP (File Transfer Protocol), which is kept up to date with all of our series and specials. We keep you informed about our shows and help you promote them to your listeners: • Affiliates receive our quarterly Network Notebook with all our program offerings, and our regular online WFMT Radio Network Newsletter, with news updates, previews of upcoming shows and more. -

A Season of Thrilling Intrigue and Grand Spectacle –
A Season of Thrilling Intrigue and Grand Spectacle – Angel Blue as MimÌ in La bohème Fidelio Rigoletto Love fuels a revolution in Beethoven’s The revenger becomes the revenged in Verdi’s monumental masterpiece. captivating drama. Greetings and welcome to our 2020–2021 season, which we are so excited to present. We always begin our planning process with our dreams, which you might say is a uniquely American Nixon in China Così fan tutte way of thinking. This season, our dreams have come true in Step behind “the week that changed the world” in Fidelity is frivolous—or is it?—in Mozart’s what we’re able to offer: John Adams’s opera ripped from the headlines. rom-com. Fidelio, to celebrate the 250th anniversary of Beethoven’s birth. Nixon in China by John Adams—the first time WNO is producing an opera by one of America’s foremost composers. A return to Russian music with Musorgsky’s epic, sweeping, spectacular Boris Godunov. Mozart’s gorgeous, complex, and Boris Godunov La bohème spiky view of love with Così fan tutte. Verdi’s masterpiece of The tapestry of Russia's history unfurls in Puccini’s tribute to young love soars with joy a family drama and revenge gone wrong in Rigoletto. And an Musorgsky’s tale of a tsar plagued by guilt. and heartbreak. audience favorite in our lavish production of La bohème, with two tremendous casts. Alongside all of this will continue our American Opera Initiative 20-minute operas in its 9th year. Our lineup of artists includes major stars, some of whom SPECIAL PRESENTATIONS we’re thrilled to bring to Washington for the first time, as well as emerging talents. -

2021 WFMT Opera Series Broadcast Schedule & Cast Information —Spring/Summer 2021
2021 WFMT Opera Series Broadcast Schedule & Cast Information —Spring/Summer 2021 Please Note: due to production considerations, duration for each production is subject to change. Please consult associated cue sheet for final cast list, timings, and more details. Please contact [email protected] for more information. PROGRAM #: OS 21-01 RELEASE: June 12, 2021 OPERA: Handel Double-Bill: Acis and Galatea & Apollo e Dafne COMPOSER: George Frideric Handel LIBRETTO: John Gay (Acis and Galatea) G.F. Handel (Apollo e Dafne) PRESENTING COMPANY: Haymarket Opera Company CAST: Acis and Galatea Acis Michael St. Peter Galatea Kimberly Jones Polyphemus David Govertsen Damon Kaitlin Foley Chorus Kaitlin Foley, Mallory Harding, Ryan Townsend Strand, Jianghai Ho, Dorian McCall CAST: Apollo e Dafne Apollo Ryan de Ryke Dafne Erica Schuller ENSEMBLE: Haymarket Ensemble CONDUCTOR: Craig Trompeter CREATIVE DIRECTOR: Chase Hopkins FILM DIRECTOR: Garry Grasinski LIGHTING DESIGNER: Lindsey Lyddan AUDIO ENGINEER: Mary Mazurek COVID COMPLIANCE OFFICER: Kait Samuels ORIGINAL ART: Zuleyka V. Benitez Approx. Length: 2 hours, 48 minutes PROGRAM #: OS 21-02 RELEASE: June 19, 2021 OPERA: Tosca (in Italian) COMPOSER: Giacomo Puccini LIBRETTO: Luigi Illica & Giuseppe Giacosa VENUE: Royal Opera House PRESENTING COMPANY: Royal Opera CAST: Tosca Angela Gheorghiu Cavaradossi Jonas Kaufmann Scarpia Sir Bryn Terfel Spoletta Hubert Francis Angelotti Lukas Jakobski Sacristan Jeremy White Sciarrone Zheng Zhou Shepherd Boy William Payne ENSEMBLE: Orchestra of the Royal Opera House, -

The American Opera Series May 16 – November 28, 2015
The American Opera Series May 16 – November 28, 2015 The WFMT Radio Network is proud to make the American Opera Series available to our affiliates. The American Opera Series is designed to complement the Metropolitan Opera Broadcasts, filling in the schedule to complete the year. This year the American Opera Series features great performances by the Lyric Opera of Chicago, LA Opera, San Francisco Opera, Glimmerglass Festival and Opera Southwest. The American Opera Series for 2015 will bring distinction to your station’s schedule, and unmatched enjoyment to your listeners. Highlights of the American Opera Series include: • The American Opera Series celebrates the Fourth of July (which falls on a Saturday) with Lyric Opera of Chicago’s stellar production of George Gershwin’s Porgy and Bess. • LA Opera brings us The Figaro Trilogy, including Mozart’s The Marriage of Figaro, Rossini’s The Barber of Seville, and John Corigliano’s The Ghosts of Versailles. • The world premiere of Marco Tutino’s Two Women (La Ciociara) starring Anna Caterina Antonacci, based on the novel by Alberto Moravia that became a classic film, staged by San Francisco Opera. • Opera Southwest’s notable reconstruction of Franco Faccio’s 1865 opera Amleto (Hamlet), believed lost for over 135 years, in its American premiere. In addition, this season we’re pleased to announce that we are now including multimedia assets for use on your station’s website and publications! You can find the supplemental materials at the following link: American Opera Series Supplemental Materials Please note: If you have trouble accessing the supplemental materials, please send me an email at [email protected] Program Hours* Weeks Code Start Date Lyric Opera of Chicago 3 - 5 9 LOC 5/16/15 LA Opera 2 ½ - 3 ¼ 6 LAO 7/18/15 San Francisco Opera 1 ¾ - 4 ¾ 10 SFO 8/29/15 Glimmerglass Festival 3 - 3 ½ 3 GLI 11/7/15 Opera Southwest Presents: Amleto 3 1 OSW 11/28/15 Los Angeles Opera’s Production of The Ghosts of Versailles Credit: Craig Henry *Please note: all timings are approximate, and actual times will vary. -

Wagner's Die Meistersinger Von Nürnberg August 7–8 Donizetti's Roberto Devereux August 14
FREE OPERA STREAMS IN AUGUST: Wagner’s Die Meistersinger von Nürnberg August 7–8 Donizetti’s Roberto Devereux August 14–15 SAN FRANCISCO, CA (July 19, 2021) — In anticipation of San Francisco Opera’s return to the War Memorial Opera House stage for the opening of its 99th season, beginning with Puccini’s Tosca on August 21, the Company has added two weekly, free opera streams for the month of August: Richard Wagner’s Die Meistersinger von Nürnberg (August 7–8) and Gaetano Donizetti’s Roberto Devereux (August 14–15). Part of the Company’s Opera is ON initiative, free opera streams are viewable on demand with registration at sfopera.com, beginning at 10 am (PT) on the first streaming date through 11:59 pm the following day. Current San Francisco Opera subscribers and members (donors of $75 and up) retain access to opera titles after their window of public access through August 20. This fall, San Francisco Opera will present a new live streaming option for select performances of Music Director Eun Sun Kim’s inaugural season. Offered for the first time in Company history, livestreams of San Francisco Opera’s new productions of Beethoven’s Fidelio on October 14, 17 and 20 and Così fan tutte on November 21, 23 and 27 will enable audiences from anywhere in the world to experience these live performances. Virtual tickets will be available for $25 this fall; for more information, visit sfopera.com/online. 1 DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG AUGUST 7–8 Scenes from Die Meistersinger von Nürnberg (2015). Photos: Cory Weaver/San Francisco Opera Conductor Sir Mark Elder makes his San Francisco Opera debut in Sir David McVicar’s “enthralling” (San Francisco Chronicle) production of Richard Wagner’s 1868 opera, Die Meistersinger von Nürnberg. -

First Look at San Francisco Opera's RUSALKA by BWW News Desk Jun
Photo Flash: First Look at San Francisco Opera's RUSALKA by BWW News Desk Jun. 16, 2019 Tweet Share San Francisco Opera presents Antonín Dvo?ák's Rusalka at the War Memorial Opera House, June 16-28, in David McVicar's "thoughtfully conceived and brilliantly executed" (Chicago Tribune) production. The Czech fairy tale opera features a cast headed by Rachel Willis- Sørensen in her role debut as Rusalka,Brandon Jovanovich as the Prince, Jamie Barton as Je?ibaba, bass Kristinn Sigmundsson as Vodník and Sarah Cambidge as the Foreign Princess. South Korean maestra and Houston Grand Opera Principal Guest Conductor Eun Sun Kim leads the cast and San Francisco Opera Orchestra in her first Company engagement. Chorus Director Ian Robertson prepares the chorus. Inspired by Hans Christian Andersen's The Little Mermaid and the novella Undine by Friedrich de la Motte Fouqué,Rusalka follows the tragic heroine of the title, a water nymph who makes a grave sacrifice to win the love of a human prince. Known in the world's concert halls for his brilliant symphonies and chamber music, Dvo?ák dedicated himself to opera late in life and created a masterpiece in Rusalka, which had its 1901 premiere in Prague. Filled with references to Czech folk music and the composer's stirring, orchestral textures, the opera features many memorable moments, including the title heroine's Act I soliloquy, "M?sí?ku na nebi hlubokém," or the "Song to the Moon." The operatic productions of Scottish director David McVicar, especially Berlioz's Les Troyens and Wagner's Die Meistersinger von Nürnberg, have thrilled San Francisco Opera audiences in recent seasons. -

Xx Ľ Festival Koncertného
STREDOEURÓPSKY CENTRAL EUROPEAN XX ľ FESTIVAL MUSIC FESTIVAL KONCERTNÉHO www.hc.sk UIVIC IM IM JASôPRAN tnuj-pu. JZTIRCSÁK jy 11.-16. apríl 2011 Dom umenia Fatra, Žilina festival víťazov prestížnych svetových súťaží pod záštitou ministra kultúry SR Daniela Krajcera n^^**Ä*S&'»KlAVIR (RUS) jJpi dENJAMIN WALLFISCHíIXP #DgiGEjrr(GB)*MAffiTRENEL^SI!\IFONiA*r ^FRANCESCO*!^^^"™] &LUIS^Iff^p, KlhfikBÄ'SS+ALEXANDER ^PÍáÄ KOMORNí* VARSO RTSZ^^S«ÍIJÍP#^ G0RF3UN0V, XFILHARMONIE.CZ,*-JU ALFY— S^B«SRXMAGAU ™A <RUS)Ä- •liÄ'JgtísIfr "'MFON äXMOSNIER*ÄČSä ^POUNASOP^NTOJ^JQJ QV^^ŕí&fií(FR| *JAKUBSlA #% PASZTlRCSAK*cAPPEiífisTR( IS (PL] ~4#RpBERTKLAViR(SB) —Tíz *EKÄ»»JUMAGAU ^i.DVg; «*i SS s) •""•«FSTERZIUNAMí#*PF' H# * J ÍTt MR *'£XANDFr JAS f# \N > 'RBUNr TIR • 7k 1 fi Jt UNA (RUS !\| SZ C* 10 F!S( S ™|a AD! M NÁSTT \B IVJ. Ani TOU *AII* ••" •- " ÍUEV.3KI JASE :%m **Hliii »y It » v^ALDy" (CRO H* y EL i AVJRf »PELLÄ ISTROPOLIT/ ORGANIZÁTOR hudobné 9 entrlim > MUSIC CENTRE SLOVAKIA Wfcl Ďakujeme za láskavú podporu podujatia týmto partnerom P We wish to express our gratitude to these partners for their kind support 3STK jksamNU S FINANČNÝM PRÍSPEVKOM MK SR DE ^ L#|— MINISTERSTVO KULTÚRY ©|4Jŕ HLAVNÍ PARTNERI • QlOVAKGiNFOMETTA 5C Mesto Žilina m O© of Žilina V™*~ ' *F!Í nMi HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI IH PHI Slovenský [71 ™dto. ITÄRi Ľ-íl rozhlas S Devín NIYK HEST1 PARTNERI ČESKé CENTRUM * ÉS ^ : — 5Ffi Éi INIA OVIA* (PL) MEDIÁLNI PARTNERI 8 Wí JJU* <ggg> »fcf sffiÄ hudobný * :«IISSSS& •ÉP' REKLAMNÍ PARTNERI • Oeuroawk v/meof/a ňjí,£,£££ FESTIVAL ALEJ PODPORILI ~—jl HOTEL FESTIVALU ("l JBW r ^DELMLLE*^** DIRIGEíW íGB)ftp* !Bfl«J VAUFiSCHKLWIRNEDUO(ES)*SBOfltf "*iVIÄRC TRENEL* pL f" "*MARC TREWELi '*JOHÄNŇEs FISCHER WVPRAZSI s • * vBÄ ŕAGOT(FR)*"«Ki m «i IM JlBÍCiE NÁSTROJE (DE) f% FILHAR1 ^PRAŽSKÁ KOioRNÍ ^|^ fíilKQÄlfMiREi*W1N**yi( WFILHARIVIONIE,CZI ^^POGOSTKINä**^ ro #1 lUi^ec^rMT^ n3T,.«r . -

The Royal Opera House Announces Full Details of the 2021/22 Season
Tuesday 1 June 2021 The Royal Opera House announces full details of the 2021/22 Season • 11 new productions, including 5 world premieres, and 20 revivals. • An exciting roster of UK and international talent with many debuts The Royal Opera House today confirms details for its 2021/22 Season, the first full Season since 2019. Opening on Monday 13 September, the Season includes five world premieres from The Royal Ballet and The Royal Opera, classic revivals and an exciting roster of international and UK talent performing across the two stages of the Royal Opera House. In its 90th anniversary year, The Royal Ballet presents a Season that respects the past and heralds the future. Three world premieres, including Wayne McGregor’s The Dante Project, Christopher Wheeldon’s Like Water for Chocolate and a new work by American choreographer Kyle Abraham, are performed alongside much-loved 19th-century classics and heritage ballets by Frederick Ashton and Kenneth MacMillan. The Linbury Theatre hosts a raft of partnerships and co-productions including with Ballet Black, Alessandra Ferri, Yorke Dance Project and a world premiere from Company Wayne McGregor. Creative opportunities for emerging talent will also feature with Draft Works and the Next Generation Festival. The Season culminates in July 2022 with The Royal Ballet 1 making a welcome return to international touring with a three-week tour of Japan where the Company will perform Kenneth MacMillan’s Manon and Peter Wright’s Giselle. The Royal Opera Season will open with a new production of Verdi’s Rigoletto, directed by Oliver Mears – his first production since becoming The Royal Opera’s Director of Opera in 2017. -
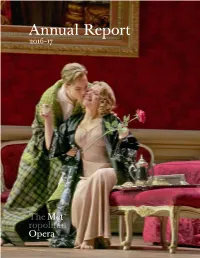
FY17 Annual Report View Report
Annual Report 2016–17 1 2 4 Introduction 6 Metropolitan Opera Board of Directors 7 Season Repertory and Events 14 Artist Roster 16 The Financial Results 48 Our Patrons 3 Introduction In the 2016–17 season, the Metropolitan Opera continued to present outstanding grand opera, featuring the world’s finest artists, while maintaining balanced financial results—the third year running in which the company’s finances were balanced or very nearly so. The season opened with the premiere of a new production of Wagner’s Tristan und Isolde and also included five other new stagings, as well as 20 revivals. The Live in HD series of cinema transmissions brought opera to audiences around the world for the 11th year, with ten broadcasts reaching approximately 2.3 million people. Combined earned revenue for the Met (Live in HD and box office) totaled $111 million. Total paid attendance for the season in the opera house was 75%. All six new productions in the 2016–17 season were the work of distinguished directors who had previous success at the Met. The compelling Opening Night new production of Tristan und Isolde was directed by Mariusz Treliński, who made his Met debut in 2015 with the double bill of Tchaikovsky’s Iolanta and Bartók’s Bluebeard’s Castle. French-Lebanese director Pierre Audi brought his distinctive vision to Rossini’s final operatic masterpiece Guillaume Tell, following his earlier staging of Verdi’s Attila in 2010. Robert Carsen, who first worked at the Met in 1997 on his popular production of Tchaikovsky’s Eugene Onegin, directed a riveting new Der Rosenkavalier, the company’s first new staging of Strauss’s grand comedy since 1969. -

Elektra at San Francisco Opera Encore
Manon 2017 cover.qxp_Layout 1 10/19/17 1:04 PM Page 6 2017–18 SEASON ManoJULES MnASSENET WHO YOU WORK WITH MATTERS Consistently ranked one of the top 25 producers at Sotheby’s International Realty nationally, Neill Bassi has sold over $133 million in San Francisco this year. SELECT 2017 SALES Address Sale Price % of Asking Representation 3540 Jackson Street* $15,000,000 100% Buyer 3515 Pacific Avenue $10,350,000 150% Seller 3383 Pacific Avenue $10,225,000 85% Buyer 1070 Green Street #1501 $7,500,000 101% Seller 89 Belgrave Avenue* $7,500,000 100% Seller 1164 Fulton Street $7,350,000 101% Seller 2545-2547 Lyon Street* $6,980,000 103% Seller 3041 Divisadero Street $5,740,000 118% Seller 2424 Buchanan Street $5,650,000 94% Buyer 3984 20th Street $4,998,000 108% Seller 1513 Cole Street $4,250,000 108% Seller 1645 Pacific Avenue #4G* $2,750,000 97% Buyer *Sold off market NOW ACCEPTING SPRING 2018 LISTINGS Request a confidential valuation to find out how much your home might yield when marketed by Neill Bassi and Sotheby’s International Realty. NEILL BASSI Associate Broker 415.296.2233 [email protected] | neillbassi.com “Alamo Square Victorian Sale CalBRE#1883478 Breaks Neighborhood Record” Sotheby’s International Realty and the Sotheby’s International Realty logo are registered (or unregistered) service marks used with permission. Operated by Sotheby’s International Realty, CURBED Inc. Real estate agents affiliated with Sotheby’s International Realty, Inc. are independent contractor sales associates and are not employees of Sotheby’s International Realty, Inc. -

Madama Butterfly
LYRIC OPERA OF CHICAGO MADAMATHE THREE BUTTERFLY QUEENS 2019|20 SEASON In this issue Dan Rest Madama Butterfly | pp. 16-32 6 WELCOME TO YOUR LYRIC 40 RYAN OPERA CENTER 8 From the Chairman and the 42 Ryan Opera Center General Director alumni around the world 10 Board of Directors 42 Program staff 12 The power of opera 43 Ryan Opera Center contributors 16 PERFORMANCES 44 THANK YOU FOR 18 Title page and cast YOUR SUPPORT 19 Introduction 46 Production sponsors 20 Artist profiles 47 Aria Society 24 Orchestra & Chorus 59 Supporting our future — Todd Rosenberg Todd 28 Opera notes endowments at Lyric The power of opera | pp. 12-15 32 After the curtain falls 60 Faces of Lyric 63 Gift planning 34 BEYOND THE STAGE 66 Corporate partners 36 Lyric Unlimited – 68 Annual individual learning & creative engagement and foundation support 74 Commemorative gifts 76 THE COMPANY 76 Artistic roster 78 Lyric staff 80 Backstage life Lyric Opera of Chicago | 2 Paid ad Lyric Opera of Chicago | 3 Since 1991 Gail McGrath Tahira Merchant You can view this program Publisher & President Graphic Designer on your mobile device at Sheldon Levin lyricopera.org/programs Publisher & Director Joy Morawez of Finance Accounting For advertising information LISA MIDDLETON A. J. Levin Willie Smith call 847-770-4620. To see Executive Editor Director of Operations Supervisor Operations our Terms and Conditions Earl Love relating to advertising ROGER PINES Rand Brichta Operations orders, visit our website at Editor Arnie Hoffman Wilfredo Silva performancemedia.us. Account Managers Operations All contents copyrighted. MAGDA KRANCE Michael Hedge Steve Dunn All rights reserved. -

WERTHER Jules Massenet (1842-1912)
Brandon Jovanovich et Nora Gubisch en répétition 3 WERTHER Jules Massenet (1842-1912) Nouvelle production avec Brandon Jovanovich Werther Drame lyrique en 4 actes et 5 tableaux Nora Gubisch Charlotte Livret Edouard Blau, Paul Milliet et Georges Hartmann, René Schirrer Le Bailli d’après Goethe Hélène Guilmette Sophie Présenté pour la première fois à Vienne le 16 février 1892 Pierre Doyen Albert Jacques Calatayud Johann Direction musicale Alain Altinoglu Christophe Mortagne Schmidt Mise en scène Yves Beaunesne Yves Vandenbussche Brühlmann Décors Damien Caille-Perret Dorothée Pinto Käthchen Lumières Joël Hourbeight / Jean-Pascal Pracht Costumes Patrice Cauchetier Max Calimez, Maeva Descamps, Manon Dubois, Coline Collaboration artistique à la mise en scène Jean Gaudin Fertin, Florence Gourlet, Alexandre Lacomblez, William Assistante à la mise en scène Janick Moisan Ockenden Les enfants Deuxième assistant à la mise en scène Augustin Debiesse Chef de chant Nathalie Steinberg orchestre national de lille / région nord-pas de calais — Maîtrise Boréale Chef de choeur Eric Deltour — Production Opéra de Lille — Durée 2h40 avec entracte 4 orchestre national de lille / région nord-pas de calais direction jean-claude casadesus violon solo altos flûtes trombones fernand iaciu paul mayes chrystel delaval christian briez jean-marc lachkar pascal langlet alain vernay violons jean-paul blondeau raphaël patrix marc crenne anne le chevalier hautbois (trombone basse) françois cantault lionel part daniel pechereau alexandre diaconu chantal saradin philippe gérard