Amadou MOROU MADOUGOU
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

High Quality Permanent Draft Genome Sequence of Chryseobacterium Bovis DSM 19482T, Isolated from Raw Cow Milk
Lawrence Berkeley National Laboratory Recent Work Title High quality permanent draft genome sequence of Chryseobacterium bovis DSM 19482T, isolated from raw cow milk. Permalink https://escholarship.org/uc/item/4b48v7v8 Journal Standards in genomic sciences, 12(1) ISSN 1944-3277 Authors Laviad-Shitrit, Sivan Göker, Markus Huntemann, Marcel et al. Publication Date 2017 DOI 10.1186/s40793-017-0242-6 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Laviad-Shitrit et al. Standards in Genomic Sciences (2017) 12:31 DOI 10.1186/s40793-017-0242-6 SHORT GENOME REPORT Open Access High quality permanent draft genome sequence of Chryseobacterium bovis DSM 19482T, isolated from raw cow milk Sivan Laviad-Shitrit1, Markus Göker2, Marcel Huntemann3, Alicia Clum3, Manoj Pillay3, Krishnaveni Palaniappan3, Neha Varghese3, Natalia Mikhailova3, Dimitrios Stamatis3, T. B. K. Reddy3, Chris Daum3, Nicole Shapiro3, Victor Markowitz3, Natalia Ivanova3, Tanja Woyke3, Hans-Peter Klenk4, Nikos C. Kyrpides3 and Malka Halpern1,5* Abstract Chryseobacterium bovis DSM 19482T (Hantsis-Zacharov et al., Int J Syst Evol Microbiol 58:1024-1028, 2008) is a Gram-negative, rod shaped, non-motile, facultative anaerobe, chemoorganotroph bacterium. C. bovis is a member of the Flavobacteriaceae, a family within the phylum Bacteroidetes. It was isolated when psychrotolerant bacterial communities in raw milk and their proteolytic and lipolytic traits were studied. Here we describe the features of this organism, together with the draft genome sequence and annotation. The DNA G + C content is 38.19%. The chromosome length is 3,346,045 bp. It encodes 3236 proteins and 105 RNA genes. The C. bovis genome is part of the Genomic Encyclopedia of Type Strains, Phase I: the one thousand microbial genomes study. -

Emerging Flavobacterial Infections in Fish
Journal of Advanced Research (2014) xxx, xxx–xxx Cairo University Journal of Advanced Research REVIEW Emerging flavobacterial infections in fish: A review Thomas P. Loch a, Mohamed Faisal a,b,* a Department of Pathobiology and Diagnostic Investigation, College of Veterinary Medicine, 174 Food Safety and Toxicology Building, Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA b Department of Fisheries and Wildlife, College of Agriculture and Natural Resources, Natural Resources Building, Room 4, Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Flavobacterial diseases in fish are caused by multiple bacterial species within the family Received 12 August 2014 Flavobacteriaceae and are responsible for devastating losses in wild and farmed fish stocks Received in revised form 27 October 2014 around the world. In addition to directly imposing negative economic and ecological effects, Accepted 28 October 2014 flavobacterial disease outbreaks are also notoriously difficult to prevent and control despite Available online xxxx nearly 100 years of scientific research. The emergence of recent reports linking previously uncharacterized flavobacteria to systemic infections and mortality events in fish stocks of Keywords: Europe, South America, Asia, Africa, and North America is also of major concern and has Flavobacterium highlighted some of the difficulties surrounding the diagnosis and chemotherapeutic treatment Chryseobacterium of flavobacterial fish diseases. Herein, we provide a review of the literature that focuses on Fish disease Flavobacterium and Chryseobacterium spp. and emphasizes those associated with fish. Coldwater disease ª 2014 Production and hosting by Elsevier B.V. on behalf of Cairo University. Flavobacteriosis Mohamed Faisal D.V.M., Ph.D., is currently a Thomas P. -

The Histidine Biosynthetic Genes in the Superphylum Bacteroidota-Rhodothermota-Balneolota-Chlorobiota: Insights Into the Evolution of Gene Structure and Organization
microorganisms Article The Histidine Biosynthetic Genes in the Superphylum Bacteroidota-Rhodothermota-Balneolota-Chlorobiota: Insights into the Evolution of Gene Structure and Organization Sara Del Duca , Christopher Riccardi , Alberto Vassallo , Giulia Fontana, Lara Mitia Castronovo, Sofia Chioccioli and Renato Fani * Department of Biology, University of Florence, Via Madonna del Piano 6, Sesto Fiorentino, 50019 Florence, Italy; sara.delduca@unifi.it (S.D.D.); christopher.riccardi@unifi.it (C.R.); alberto.vassallo@unifi.it (A.V.); [email protected]fi.it (G.F.); [email protected] (L.M.C.); sofia.chioccioli@unifi.it (S.C.) * Correspondence: renato.fani@unifi.it; Tel.: +39-055-4574742 Abstract: One of the most studied metabolic routes is the biosynthesis of histidine, especially in enterobacteria where a single compact operon composed of eight adjacent genes encodes the complete set of biosynthetic enzymes. It is still not clear how his genes were organized in the genome of the last universal common ancestor community. The aim of this work was to analyze the structure, organization, phylogenetic distribution, and degree of horizontal gene transfer (HGT) of his genes in the Bacteroidota-Rhodothermota-Balneolota-Chlorobiota superphylum, a group of phylogenetically close bacteria with different surviving strategies. The analysis of the large variety of his gene structures and organizations revealed different scenarios with genes organized in more Citation: Del Duca, S.; Riccardi, C.; or less compact—heterogeneous or homogeneous—operons, in suboperons, or in regulons. The Vassallo, A.; Fontana, G.; Castronovo, organization of his genes in the extant members of the superphylum suggests that in the common L.M.; Chioccioli, S.; Fani, R. -

Chryseobacterium Oleae Sp. Nov., an Efficient Plant
Systematic and Applied Microbiology 37 (2014) 342–350 Contents lists available at ScienceDirect Systematic and Applied Microbiology j ournal homepage: www.elsevier.de/syapm Short communication Chryseobacterium oleae sp. nov., an efficient plant growth promoting bacterium in the rooting induction of olive tree (Olea europaea L.) cuttings and emended descriptions of the genus Chryseobacterium, C. daecheongense, C. gambrini, C. gleum, C. joostei, C. jejuense, C. luteum, C. shigense, C. taiwanense, C. ureilyticum and C. vrystaatense a,b,∗∗ a c Maria del Carmen Montero-Calasanz , Markus Göker , Manfred Rohde , a a d e Cathrin Spröer , Peter Schumann , Hans-Jürgen Busse , Michael Schmid , a a,∗ b Hans-Peter Klenk , Brian J. Tindall , Maria Camacho a Leibniz Institute DSMZ – German Collection of Microorganisms and Cell Cultures, Inhoffenstraße 7B, 38124 Braunschweig, Germany b IFAPA-Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Centro Las Torres-Tomejil, Ctra, Sevilla-Cazalla de la Sierra, Km 12.2, Alcalá del Río, 41200 Sevilla, Spain c HZI – Helmholtz Centre for Infection Research, Inhoffenstraße 7, 38124 Braunschweig, Germany d Institut für Bakteriologie, Mykologie und Hygiene, Veterinärmedizinische Universität, A-1210 Wien, Austria e Research Unit Microbe-Plant Interactions, Helmholtz Zentrum München, Ingolstädter Landstraße 1, 85764 Neuherberg, Germany a r t i c l e i n f o a b s t r a c t T Article history: A novel non-motile, Gram-staining-negative, yellow-pigmented bacterium, designated CT348 , isolated Received 5 November 2013 from the ectorhizosphere of an organic olive tree in Spain and characterised as an efficient plant growth Received in revised form 21 February 2014 promoting bacterium, was investigated to determine its taxonomic status. -

Apibacter Adventoris Gen. Nov., Sp. Nov., a Member of the Phylum Bacteroidetes Isolated from Honey Bees Waldan K
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2016), 66, 1323–1329 DOI 10.1099/ijsem.0.000882 Apibacter adventoris gen. nov., sp. nov., a member of the phylum Bacteroidetes isolated from honey bees Waldan K. Kwong1,2 and Nancy A. Moran2 Correspondence 1Department of Ecology and Evolutionary Biology, Yale University, New Haven, CT, USA Waldan K. Kwong 2Department of Integrative Biology, University of Texas, Austin, TX, USA [email protected] Honey bees and bumble bees harbour a small, defined set of gut bacterial associates. Strains matching sequences from 16S rRNA gene surveys of bee gut microbiotas were isolated from two honey bee species from East Asia. These isolates were mesophlic, non-pigmented, catalase-positive and oxidase-negative. The major fatty acids were iso-C15 : 0, iso-C17 : 0 3-OH, C16 : 0 and C16 : 0 3-OH. The DNA G+C content was 29–31 mol%. They had ,87 % 16S rRNA gene sequence identity to the closest relatives described. Phylogenetic reconstruction using 20 protein-coding genes showed that these bee-derived strains formed a highly supported monophyletic clade, sister to the clade containing species of the genera Chryseobacterium and Elizabethkingia within the family Flavobacteriaceae of the phylum Bacteroidetes. On the basis of phenotypic and genotypic characteristics, we propose placing these strains in a novel genus and species: Apibacter adventoris gen. nov., sp. nov. The type strain of Apibacter adventoris is wkB301T (5NRRL B-65307T5NCIMB 14986T). Bacteria from the phylum Bacteroidetes are often constitu- In July and August of 2014, samples of the Asian honey bee ents of animal microbiotas. -

Genome-Based Taxonomic Classification Of
ORIGINAL RESEARCH published: 20 December 2016 doi: 10.3389/fmicb.2016.02003 Genome-Based Taxonomic Classification of Bacteroidetes Richard L. Hahnke 1 †, Jan P. Meier-Kolthoff 1 †, Marina García-López 1, Supratim Mukherjee 2, Marcel Huntemann 2, Natalia N. Ivanova 2, Tanja Woyke 2, Nikos C. Kyrpides 2, 3, Hans-Peter Klenk 4 and Markus Göker 1* 1 Department of Microorganisms, Leibniz Institute DSMZ–German Collection of Microorganisms and Cell Cultures, Braunschweig, Germany, 2 Department of Energy Joint Genome Institute (DOE JGI), Walnut Creek, CA, USA, 3 Department of Biological Sciences, Faculty of Science, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia, 4 School of Biology, Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK The bacterial phylum Bacteroidetes, characterized by a distinct gliding motility, occurs in a broad variety of ecosystems, habitats, life styles, and physiologies. Accordingly, taxonomic classification of the phylum, based on a limited number of features, proved difficult and controversial in the past, for example, when decisions were based on unresolved phylogenetic trees of the 16S rRNA gene sequence. Here we use a large collection of type-strain genomes from Bacteroidetes and closely related phyla for Edited by: assessing their taxonomy based on the principles of phylogenetic classification and Martin G. Klotz, Queens College, City University of trees inferred from genome-scale data. No significant conflict between 16S rRNA gene New York, USA and whole-genome phylogenetic analysis is found, whereas many but not all of the Reviewed by: involved taxa are supported as monophyletic groups, particularly in the genome-scale Eddie Cytryn, trees. Phenotypic and phylogenomic features support the separation of Balneolaceae Agricultural Research Organization, Israel as new phylum Balneolaeota from Rhodothermaeota and of Saprospiraceae as new John Phillip Bowman, class Saprospiria from Chitinophagia. -

Diversity of Multidrug-Resistant Bacteria in an Urbanized River: a Case Study of the Potential Risks from Combined Sewage Overflows
water Article Diversity of Multidrug-Resistant Bacteria in an Urbanized River: A Case Study of the Potential Risks from Combined Sewage Overflows Gabriella Balasa, Enjolie S. Levengood, Joseph M. Battistelli and Rima B. Franklin * Laboratory of Microbial Ecology, Department of Biology, Virginia Commonwealth University, 1000 West Cary Street, Richmond, VA 23284, USA; [email protected] (G.B.); [email protected] (E.S.L.); [email protected] (J.M.B.) * Correspondence: [email protected] Abstract: Wastewater contamination and urbanization contribute to the spread of antibiotic resistance in aquatic environments. This is a particular concern in areas receiving chronic pollution of untreated waste via combined sewer overflow (CSO) events. The goal of this study was to expand knowledge of CSO impacts, with a specific focus on multidrug resistance. We sampled a CSO-impacted seg- ment of the James River (Virginia, USA) during both clear weather and an active overflow event and compared it to an unimpacted upstream site. Bacteria resistant to ampicillin, streptomycin, and tetracycline were isolated from all samples. Ampicillin resistance was particularly abundant, especially during the CSO event, so these isolates were studied further using disk susceptibility tests to assess multidrug resistance. During a CSO overflow event, 82% of these isolates were resistant to five or more antibiotics, and 44% were resistant to seven or more. The latter statistic contrasts Citation: Balasa, G.; Levengood, E.S.; starkly with the upstream reference site, where only 4% of isolates displayed resistance to more Battistelli, J.M.; Franklin, R.B. Diversity than seven antibiotics. DNA sequencing (16S rRNA gene) revealed that ~35% of our isolates were of Multidrug-Resistant Bacteria in an opportunistic pathogens, comprised primarily of the genera Stenotrophomonas, Pseudomonas, and Urbanized River: A Case Study of the Potential Risks from Combined Sewage Chryseobacterium. -

Identification of Novel Flavobacteria from Michigan and Assessment of Their Impacts on Fish Health
IDENTIFICATION OF NOVEL FLAVOBACTERIA FROM MICHIGAN AND ASSESSMENT OF THEIR IMPACTS ON FISH HEALTH By Thomas P. Loch A DISSERTATION Submitted to Michigan State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Pathology 2012 1 ABSTRACT IDENTIFICATION OF NOVEL FLAVOBACTERIA FROM MICHIGAN AND ASSESSMENT OF THEIR IMPACTS ON FISH HEALTH By Thomas P. Loch Flavobacteriosis poses a serious threat to wild and propagated fish stocks alike, accounting for more fish mortality in the State of Michigan, USA, and its associated hatcheries than all other pathogens combined. Although this consortium of fish diseases has primarily been attributed to Flavobacterium psychrophilum, F. columnare, and F. branchiophilum, herein I describe a diverse assemblage of Flavobacterium spp. and Chryseobacterium spp. recovered from diseased, as well as apparently healthy wild, feral, and famed fishes of Michigan. Among 254 fish-associated flavobacterial isolates recovered from 21 fish species during 2003-2010, 211 of these isolates were Flavobacterium spp., and 43 were Chryseobacterium spp. according to ribosomal RNA partial gene sequencing and phylogenetic analysis. Both F. psychrophilum and F. columnare were indeed associated with multiple fish epizootics, but the majority of isolates were either most similar to recently described Flavobacterium and Chryseobacterium spp. that have not been reported within North America, or they did not cluster with any described species. Many of these previously uncharacterized flavobacteria were recovered from systemically infected fish that showed overt signs of disease and were highly proteolytic to multiple substrates in protease assays. Polyphasic characterization, which included extensive physiological, morphological, and biochemical analyses, fatty acid profiling, and phylogenetic analyses using Bayesian and neighbor-joining methodologies, confirmed that there were at least eight clusters of isolates that belonged to the genera Chryseobacterium and Flavobacterium, which represented eight novel species. -

Chryseobacterium Schmidteae Sp. Nov. a Novel Bacterial Species Isolated
www.nature.com/scientificreports OPEN Chryseobacterium schmidteae sp. nov. a novel bacterial species isolated from planarian Schmidtea mediterranea Luis Johnson Kangale1,2, Didier Raoult2,3,4, Eric Ghigo2,5* & Pierre‑Edouard Fournier1,2* Marseille‑P9602T is a Chryseobacterium‑like strain that we isolated from planarian Schmidtea mediterranea and characterized by taxono‑genomic approach. We found that Marseille‑P9602T strain exhibits a 16S rRNA gene sequence similarity of 98.76% with Chryseobacterium scophthalmum LMG 13028T strain, the closest phylogenetic neighbor. Marseille‑P9602T strain was observed to be a yellowish‑pigmented, Gram‑negative, rod‑shaped bacterium, growing in aerobic conditions and belonging to the Flavobacteriaceae family. The major fatty acids detected are 13‑methyl‑ tetradecanoic acid (57%), 15‑methylhexadecenoic acid (18%) and 12‑methyl‑tetradecanoic acid (8%). Marseille‑P9602 strain size was found from genome assembly to be of 4,271,905 bp, with a 35.5% G + C content. The highest values obtained for Ortho‑ANI and dDDH were 91.67% and 44.60%, respectively. Thus, hereby we unravel that Marseille‑P9602 strain is sufciently diferent from other closed related species and can be classifed as a novel bacterial species, for which we propose the name of Chryseobacterium schmidteae sp. nov. Type strain is Marseille‑P9602T (= CSUR P9602T = CECT 30295T). Using genotypic, chemotaxonomic and phenotypic characteristics of members of Flavobacterium and weeksella genus allowed revising the classifcation of the novel Chryseobacterium genus1 with Chryseobacterium gleum type strain2. Several genus members were isolated from soil, plant, waste water, fsh, sewage, sludge, lactic acid bever- age, oil, contaminated soil, and clinical samples3–12. -

TAXONOMY, GROWTH and FOOD SPOILAGE CHARACTERISTICS of a NOVEL Chryseobacterium SPECIES
TAXONOMY, GROWTH AND FOOD SPOILAGE CHARACTERISTICS OF A NOVEL Chryseobacterium SPECIES By Lize Oosthuizen Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Magister Scientiae (Microbiology) In the Department of Microbial, Biochemical and Food Biotechnology Faculty of Natural and Agricultural Sciences University of the Free State Supervisor: Prof. C. J. Hugo Co-supervisors: Dr. G. Charimba, Prof. J. D. Newman, Dr. A. Hitzeroth, Mrs. L. Steyn November 2018 DECLARATION I declare that the dissertation hereby submitted by me for the M. Sc. Degree in the Faculty of Natural and Agricultural Science at the University of the Free State is my own independent work and has not previously been submitted by me at another university/faculty. I furthermore cede copyright of the dissertation in favour of the University of the Free State. L. Oosthuizen November, 2018 TABLE OF CONTENTS Chapter Title Page TABLE OF CONTENTS i ACKNOWLEDGEMENTS iii LIST OF TABLES iv LIST OF FIGURES vi LIST OF ABBREVIATIONS ix 1 INTRODUCTION 1 2 LITERATURE REVIEW 5 2.1 Introduction 5 2.2 The genus Chryseobacterium 8 2.2.1 History 8 2.2.2 Characteristics 9 2.2.3 Significance of Chryseobacterium species in food 10 2.3 Description of novel Chryseobacterium species using a 14 polyphasic approach 2.3.1 Genotypic methods 15 2.3.2 Phenotypic characterization 21 2.3.3 Chemotaxonomic methods 24 2.4 Growth kinetics of Chryseobacterium species 27 2.4.1 Microbial growth phases 27 2.4.2 Methods for measuring microbial growth 28 2.4.3 Factors influencing microbial growth and food -

A Report of 28 Unrecorded Bacterial Species, Phylum Bacteroidetes, in Korea
Journal104 of Species Research 7(2):104-113, 2018JOURNAL OF SPECIES RESEARCH Vol. 7, No. 2 A report of 28 unrecorded bacterial species, phylum Bacteroidetes, in Korea Soohyun Maeng1, Chaeyun Baek1, Jin-Woo Bae2, Chang-Jun Cha3, Kwang-Yeop Jahng4, Ki-seong Joh5, Wonyong Kim6, Chi Nam Seong7, Soon Dong Lee8, Jang-Cheon Cho9 and Hana Yi1,10,* 1Department of Public Health Sciences, Graduate School, Korea University, Seoul 02841, Republic of Korea 2Department of Biology, Kyung Hee University, Seoul 02447, Republic of Korea 3Department of Biotechnology, Chung-Ang University, Anseong 17546, Republic of Korea 4Department of Life Sciences, Chonbuk National University, Jeonju 54896, Republic of Korea 5Department of Bioscience and Biotechnology, Hankuk University of Foreign Studies, Yongin 17035, Republic of Korea 6Department of Microbiology, Chung-Ang University College of Medicine, Seoul 06973, Republic of Korea 7Department of Biology, Sunchon National University, Suncheon 57922, Republic of Korea 8Faculty of Science Education, Jeju National University, Jeju 63243, Republic of Korea 9Department of Biological Sciences, Inha University, Incheon 22201, Republic of Korea 10School of Biosystem and Biomedical Science, Korea University, Seoul 02841, Republic of Korea *Correspondent: [email protected] In order to investigate indigenous prokaryotic species diversity in Korea, various environmental samples from diverse ecosystems were examined. Isolated bacterial strains were identified based on 16S rRNA gene sequences, and those exhibiting at least 98.7% sequence similarity with known bacterial species, but not reported in Korea, were selected as unrecorded species. 28 unrecorded bacterial species belonging to the phylum Bacteroidetes were discovered from various habitats including wastewater, freshwater, freshwater sediment, wet land, reclaimed land, plant root, bird feces, seawater, sea sand, tidal flat sediment, a scallop, marine algae, and seaweed. -
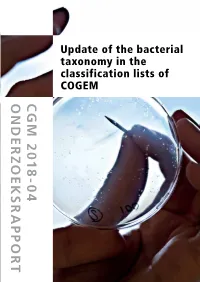
C G M 2 0 1 8 [0 4 on D Er Z O E K S R a Pp O
Update of the bacterial the of bacterial Update intaxonomy the classification lists of COGEM CGM 2018 - 04 ONDERZOEKSRAPPORT report Update of the bacterial taxonomy in the classification lists of COGEM July 2018 COGEM Report CGM 2018-04 Patrick L.J. RÜDELSHEIM & Pascale VAN ROOIJ PERSEUS BVBA Ordering information COGEM report No CGM 2018-04 E-mail: [email protected] Phone: +31-30-274 2777 Postal address: Netherlands Commission on Genetic Modification (COGEM), P.O. Box 578, 3720 AN Bilthoven, The Netherlands Internet Download as pdf-file: http://www.cogem.net → publications → research reports When ordering this report (free of charge), please mention title and number. Advisory Committee The authors gratefully acknowledge the members of the Advisory Committee for the valuable discussions and patience. Chair: Prof. dr. J.P.M. van Putten (Chair of the Medical Veterinary subcommittee of COGEM, Utrecht University) Members: Prof. dr. J.E. Degener (Member of the Medical Veterinary subcommittee of COGEM, University Medical Centre Groningen) Prof. dr. ir. J.D. van Elsas (Member of the Agriculture subcommittee of COGEM, University of Groningen) Dr. Lisette van der Knaap (COGEM-secretariat) Astrid Schulting (COGEM-secretariat) Disclaimer This report was commissioned by COGEM. The contents of this publication are the sole responsibility of the authors and may in no way be taken to represent the views of COGEM. Dit rapport is samengesteld in opdracht van de COGEM. De meningen die in het rapport worden weergegeven, zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van de COGEM. 2 | 24 Foreword COGEM advises the Dutch government on classifications of bacteria, and publishes listings of pathogenic and non-pathogenic bacteria that are updated regularly.