La Civilisation Maya
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Metaphors of Relative Elevation, Position and Ranking in Popol Vuh
METAPHORS OF RELATIVE ELEVATION, POSITION AND RANKING IN POPOL VUH Nathaniel TARN and Martin PRECHTEL Rutgers University This paper is an account of work very much in progress on the textual analysis of Popol V uh, and is one study among others (since this theme is attracting a number of students today) of inter-con nections and mutual illuminations between Popol Vuh and the con temporary ethnographic record in Highland Guatemala and Chiapas. For some considerable time now Popol Vuh has been considered as the major extant text of the Mesoamerican literary traditions, and as one of the most remarkable of all human creation stories, both for its beauty and for the complexity of its cosmological and mythical messages. While it may or may not have had a hieroglyphic original, the present alphabetic version of Po pol V uh wars written down some where between 1545 and 1558 by an anonymous member of the Cavek lineage of the Quiche Maya of Guatemala. This lineage had been a ruling house until it fell to the Spaniards in 1524. The manu script was copied by Francisco de Ximenez, a Spanish priest, some 150 years later. While there are references to Christianity in the text, these are few and it is generally regarded as one of the purest extant accounts of prehispanic Maya world-view. At the end of the hook, what we call mythical history shades into the historical history of the Quiche, so that the hook can serve as an illustration of the extent to which these two kinds of history are not held a,part by Maya generally. -

Panthéon Maya
Liste des divinités et des démons de la mythologie des mayas. Les noms sont tirés du Popol Vuh des Mayas Quichés, des livres de Chilam Balam et de Diego de Landa ainsi que des divers codex. Divinité Dieu Déesse Démon Monstre Animal Humain AB KIN XOC Dieu de poésie. ACAN Dieu des boissons fermentées et de l'ivresse. ACANTUN Quatre démons associés à une couleur et à un point cardinal. Ils sont présents lors du nouvel an maya et lors des cérémonies de sculpture des statues. ACAT Dieu des tatouages. AH CHICUM EK Autre nom de Xamen Ek. AH CHUY KAKA Dieu de la guerre connu sous le nom du "destructeur de feu". AH CUN CAN Dieu de la guerre connu comme le "charmeur de serpents". AH KINCHIL Dieu solaire (voir Kinich Ahau). AHAU CHAMAHEZ Un des deux dieux de la médecine. AHMAKIQ Dieu de l'agriculture qui enferma le vent quand il menaçait de détruire les récoltes. AH MUNCEN CAB Dieu du miel et des abeilles sans dard; il est patron des apiculteurs. AH MUN Dieu du maïs et de la végétation. AH PEKU Dieu du Tonnerre. AH PUCH ou AH CIMI ou AH CIZIN Dieu de la Mort qui régnait sur le Metnal, le neuvième niveau de l'inframonde. AH RAXA LAC DMieu de lYa Terre.THOLOGICA.FR AH RAXA TZEL Dieu du ciel AH TABAI Dieu de la Chasse. AH UUC TICAB Dieu de la Terre. 1 AHAU CHAMAHEZ Dieu de la Médecine et de la Guérison. AHAU KIN voir Kinich Ahau. AHOACATI Dieu de la Fertilité AHTOLTECAT Dieu des orfèvres. -

On the Origin of the Different Mayan Calendars Thomas Chanier
On the origin of the different Mayan Calendars Thomas Chanier To cite this version: Thomas Chanier. On the origin of the different Mayan Calendars. 2014. hal-01018037v1 HAL Id: hal-01018037 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01018037v1 Submitted on 3 Jul 2014 (v1), last revised 14 Jan 2015 (v3) HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. On the origin of the different Mayan Calendars T. Chanier∗1 1 Department of Physics, University of Namur, rue de Bruxelles 61, B-5000 Namur, Belgium The Maya were known for their astronomical proficiency. Whereas Mayan mathematics were based on a vigesimal system, they used a different base when dealing with long periods of time, the Long Count Calendar (LCC), composed of different Long Count Periods: the Tun of 360 days, the Katun of 7200 days and the Baktun of 144000 days. There were three other calendars used in addition to the LCC: a civil year Haab’ of 365 days, a religious year Tzolk’in of 260 days and a 3276- day cycle (combination of the 819-day Kawil cycle and 4 colors-directions). Based on astronomical arguments, we propose here an explanation of the origin of the LCC, the Tzolk’in and the 3276-day cycle. -
![Arxiv:1601.03132V7 [Math.HO] 15 Nov 2018 [2]](https://docslib.b-cdn.net/cover/0729/arxiv-1601-03132v7-math-ho-15-nov-2018-2-530729.webp)
Arxiv:1601.03132V7 [Math.HO] 15 Nov 2018 [2]
Solution of the Mayan Calendar Enigma Thomas Chanier1∗ 1Independent researcher, 1025 12th avenue, Coralville, Iowa 52241, USA The Mayan calendar is proposed to derive from an arithmetical model of naked-eye astronomy. The Palenque and Copan lunar equations, used during the Maya Classic period (200 to 900 AD) are solution of the model and the results are expressed as a function of the Xultun numbers, four enigmatic Long Count numbers deciphered in the Maya ruins of Xultun, dating from the IX century AD, providing strong arguments in favor of the use of the model by the Maya. The different Mayan Calendar cycles can be derived from this model and the position of the Calendar Round at the mythical date of creation 13(0).0.0.0.0 4 Ahau 8 Cumku is calculated. This study shows the high proficiency of Mayan mathematics as applied to astronomy and timekeeping for divinatory purposes.a I. INTRODUCTION In the Calendar Round, a date is represented by αXβY with the religious month 1 ≤ α ≤ 13, X one of the 20 Mayan priests-astronomers were known for their astro- religious days, the civil day 0 ≤ β ≤ 19, and Y one of the nomical and mathematical proficiency, as demonstrated 18 civil months, 0 ≤ β ≤ 4 for the Uayeb. Fig. 1 shows a in the Dresden Codex, a XIV century AD bark-paper contemporary representation of the Calendar Round as book containing accurate astronomical almanacs aiming a set of three interlocking wheels: the Tzolk'in, formed to correlate ritual practices with astronomical observa- by a 13-month and a 20-day wheels and the Haab'. -

CRÓNICAS Mesoamericanas Tomo I CRONICAS MESOAMERICANAS (TOMO I) © 2008 Universidad Mesoamericana ISBN: 978-99922-846-9-8 Primera Edición, 2008
CRÓNICAS MESOAMEricanas TOMO I CRONICAS MESOAMERICANAS (TOMO I) © 2008 Universidad Mesoamericana ISBN: 978-99922-846-9-8 Primera Edición, 2008 Consejo Directivo: Félix Javier Serrano Ursúa, Jorge Rubén Calderón González, Claudia María Hernández de Dighero, Carlos Enrique Chian Rodríguez, Ana Cristina Estrada Quintero, Luis Roberto Villalobos Quesada, Emilio Enrique Conde Goicolea. Editor: Horacio Cabezas Carcache. Traducción de textos mayas-quichés: Marlini Son, Candelaria Dominga López Ixcoy, Robert Carmack, James L. Mondloch, Ruud van Akkeren y Hugo Fidel Sacor. Revisor de estilo: Pedro Luis Alonso. Editorial responsable: Editorial Galería Guatemala. Consejo Editorial: Estuardo Cuestas Morales, Egemberto Alvergue Oliveros, Carlos Enrique Zea Flores, María Olga Granai de Zoller, Mario Estuardo Montes Granai. Diseño y diagramación: QUELSA. Ilustraciones en acuarela: Victor Manuel Aragón. Fotografía proporcionada por Fundación Herencia Cultural Guatemalteca, Fototeca de Justin Kerr de su catálogo Maya Vase Database y Fototeca de Fundación G&T Continental (páginas 119,134,140). Impresión: Tinta y Papel Derechos reservados. La reproducción total o parcial de esta obra sólo podrá hacerse con autorización escrita de la Universidad Mesoamericana. http://www.umes.edu.gt 40 Calle, 10-01, Zona 8, Guatemala, C. A. CRÓNICAS MESOAMEricanas TOMO I CONTENIDO PRÓLOGO 9 FÉLIX JAVIER SERRANO URSÚA INTRODUCCIÓN 11 HORACIO CABEZAS CARCACHE CÓDICES mayas Y MEXICANOS 17 TOMÁS BARRIENTOS Y MARION POPENOE DE HATCH Crónicas DE YAXKUKUL Y CHAC Xulub CHEN 31 ERNESTO VARGAS PACHECO CRÓNICA DE CHAC XULUB CHEN 44 TÍTULO DE LOS SEÑORES DE Sacapulas 59 RUUD VAN AKKEREN HISTORIA DE SU ORIGEN Y VENIDA DE SUS PADRES EN LAS TIERRAS DEL QUICHÉ. 78 PARTE I. FRAGMENTO QUIChé [K’iChe’] 88 TÍTULO DE CAGCOH [KAQKOJ] 93 ENNIO BOSSÚ TESTAMENTO Y TÍTULO DE LOS ANTECESORES DE 100 LOS SEÑORES DE CAGCOH SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. -

The Mayan Gods: an Explanation from the Structures of Thought
Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences Review Article Open Access The Mayan gods: an explanation from the structures of thought Abstract Volume 3 Issue 1 - 2018 This article explains the existence of the Classic and Post-classic Mayan gods through Laura Ibarra García the cognitive structure through which the Maya perceived and interpreted their world. Universidad de Guadalajara, Mexico This structure is none other than that built by every member of the human species during its early ontogenesis to interact with the outer world: the structure of action. Correspondence: Laura Ibarra García, Centro Universitario When this scheme is applied to the world’s interpretation, the phenomena in it and de Ciencias Sociales, Mexico, Tel 523336404456, the world as a whole appears as manifestations of a force that lies behind or within Email [email protected] all of them and which are perceived similarly to human subjects. This scheme, which finds application in the Mayan worldview, helps to understand the personality and Received: August 30, 2017 | Published: February 09, 2018 character of figures such as the solar god, the rain god, the sky god, the jaguar god and the gods of Venus. The application of the cognitive schema as driving logic also helps to understand the Maya established relationships between some animals, such as the jaguar and the rattlesnake and the highest deities. The study is part of the pioneering work that seeks to integrate the study of cognition development throughout history to the understanding of the historical and cultural manifestations of our country, especially of the Pre-Hispanic cultures. -

No.65 2001 Guatemala, 200 L REVISTA T:Studios SOCIALES No
Universidad Rafael landívar Instituto de lnv.estigadones Económicas y Sociales No.65 2001 Guatemala, 200 l REVISTA t:sTUDIOS SOCIALES No. 65 CUARTA EPOCA LA COSMOVISIÓN INDÍGENA GUATEMALTECA, AYER Y HOY Autor: Juan de Dios González Martín Editor: © 2001 Universidad Rafael Landívar Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IDIES) CONSEJO DEL IDIES UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR Director: Rector: Miguel von Hoegen Gonzalo de Villa, S.J. Secretario: Vicerrectora General: Danilo Palma Ramos Guillermina Herrera Peña Decana de la Facultad de Vicerrector Administrativo-Financiero: Hugo Beteta Méndez-Ruíz Ciencias Políticas y Sociales: Vicerrector Académico: Carla Villagrán René Poitevin Decano de la Facultad de Secretario General: ~iencias Económicas: Renzo Lautaro Rosal Alejandro Arévalo Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: Edición: Mario Fuentes Destarac · Ana Victoria Peláez Ponce Representante de catedráticos: Diagrarnación: Aída Franco de Linde Ernrn y Liliana Chang Reyes URL 113 G643 González Martín, Juan de Dios, 1943 - La cosmovisión indígena guatemalteca, ayer y hoy/ Juan de Dios González Martín.--Guatemala: Universidad Rafael Landívar. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 2001. viii, 254 p. ; il. Revista de Estudios Sociales No. 65·; 4a. Época. 1. Cosmovisión maya 2. Mayas 3. Mayas - Vida social y costumbres 4. Antropología cultural 5. Mayas - Religión l. t. Esta publicación es realizada con financiamiento de la fundación Konrad Adenauer, de la República Federal de Alemania. Derechos reservados. Se autoriza su reproducción parcial para fines académicos y de divulgación, siempre que sefcite-la fuente. El contenido de esta publicación es responsabilidad del autor. ,, ONTENIDO , PRESENTACION . Vll PRIMERA PARTE 1 PRÓLOGO . ... ..........· . 3 INTRODUCCIÓN . 19 1. Los documentos indígenas del siglo XVI . -

Maya Spiritual Praxis in the New Baktun: Ritual and Reclamation in 21St-Century Chiapas
MAYA SPIRITUAL PRAXIS IN THE NEW BAKTUN: RITUAL AND RECLAMATION IN 21ST-CENTURY CHIAPAS BY KELLIE CAVAGNARO A Thesis SubmitteD to the Graduate Faculty of WAKE FOREST UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS Liberal Studies May 2014 Winston-Salem, North Carolina Copyright Kellie Cavagnaro 2014 ApproveD By: Steven Folmar, Ph.D., Advisor Jeanne Simonelli, Ph.D., Chair Lucas Johnston, Ph.D. ii This work is DeDicateD to my mother, Anne, Who inspires my choice to live in an animate Universe, AnD to Laine, my better half—there is no one With Whom I would rather journey. iii ACKNOWLEDGEMENTS With gratitude, I sincerely thank my beloved mentors in this project: To Jeanne Simonelli, for the guiDance, the fielD WisDom, the community introductions, and the WorDs that Will guiDe my career…To Steve Folmar, for your endless advice, the acaDemic fathering, and for always keeping your Buddhist cool…To Lucas Johnston, for the tireless eDiting and professional advice…and to WanDa Balzano, Who has been there for me since this journey began, my enDless gratitude for a decade of friendship and support. To Leslie Sponsel in HaWaii, Who learneD the harD way that acaDemia’s fear of goD is an entirely Different beast, thanks for your Work on Spiritual Ecology. I’m reaDy for the fight…To Flori, Goyi, Chepita, Alej, anD the Women of Lunatik Collective Who Were so founDational on my quest to aprender obedeciendo…AnD to the many Dear frienDs anD community partners Who, Due to a Greater WisDom, shall remain nameless: My soliDarity. -

The Mayan Long Count Calendar Thomas Chanier
The Mayan Long Count Calendar Thomas Chanier To cite this version: Thomas Chanier. The Mayan Long Count Calendar. 2014. hal-00750006v9 HAL Id: hal-00750006 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00750006v9 Preprint submitted on 5 Aug 2014 (v9), last revised 16 Dec 2015 (v12) HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. The Mayan Long Count Calendar T. Chanier∗1 1 Department of Physics, University of Namur, rue de Bruxelles 61, B-5000 Namur, Belgium The Maya were known for their astronomical proficiency. Whereas Mayan mathematics were based on a vigesimal system, they used a different base when dealing with long periods of time, the Long Count Calendar (LCC), composed of different Long Count Periods: the Tun of 360 days, the Katun of 7200 days and the Baktun of 144000 days. There were three other calendars used in addition to the LCC: a civil year Haab’ of 365 days, a religious year Tzolk’in of 260 days and a 3276- day cycle (combination of the 819-day Kawil cycle and 4 colors-directions). Based on astronomical arguments, we propose here an explanation of the origin of the LCC, the Tzolk’in and the 3276-day cycle. -

Project Archaeology: Pennsylvania
PROJECT ARCHAEOLOGY: PENNSYLVANIA AN EDUCATIONAL STANDARDS BASED CURRICULUM FOR GRADES FOUR THROUGH EIGHT STUDENT TEXT (FOR USE WITH LESSON PLAN BOOK) AN EDUCATIONAL INITIATIVE OF THE PENNSYLVANIA ARCHAEOLOGICAL COUNCIL EDUCATION COMMITTEE THIS PROJECT IS SUPPORTED BY A GRANT FROM THE PENNSYLVANIA HISTORICAL AND MUSEUM COMMISSION PROJECT ARCHAEOLOGY: PENNSYLVANIA AN EDUCATIONAL STANDARDS BASED CURRICULUM FOR GRADES FOUR THROUGH EIGHT STUDENT TEXT (FOR USE WITH LESSON PLAN BOOK) Project Directed and Edited by Renata B. Wolynec, Ph. D. Contributing Authors: Renata B. Wolynec, Ph. D. Ellen Dailey Bedell, Ph. D. Edinboro University of PA Ellis School, Pittsburgh Sarah Ward Neusius, Ph. D. Beverly Mitchum Chiarulli, Ph. D. Indiana University of PA Indiana University of PA Joseph Baker PA Department of Transportation, Harrisburg SECTION ONE – BASIC CONCEPTS Chapter 1 -- What Is Anthropology? (Wolynec) Chapter 2 -- What Is Archaeology? (Wolynec) Chapter 3 -- Meet an Archaeologist (Wolynec, Bedell, Neusius, Baker, and Chiarulli) Chapter 4 -- How Do Archaeologists Do Their Work? (Wolynec) Chapter 5 -- How Old Is It? (Wolynec) SECTION TWO – PENNSYLVANIA BEFORE THE EUROPEANS Chapter 6 -- History and Culture in Pennsylvania Place Names (Wolynec) Chapter 7 -- What Was Pennsylvania Like Before European Contact? (Neusius) Chapter 8 -- Where Did the Ancestors of Native Americans Come From? (Wolynec) Chapter 9 -- Native American History in Pennsylvania Before the Europeans (Wolynec) SECTION THREE - COMPARING CULTURES Chapter 10 -- What Basic Needs Do -
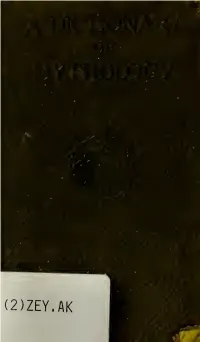
A Dictionary of Mythology —
Ex-libris Ernest Rudge 22500629148 CASSELL’S POCKET REFERENCE LIBRARY A Dictionary of Mythology — Cassell’s Pocket Reference Library The first Six Volumes are : English Dictionary Poetical Quotations Proverbs and Maxims Dictionary of Mythology Gazetteer of the British Isles The Pocket Doctor Others are in active preparation In two Bindings—Cloth and Leather A DICTIONARY MYTHOLOGYOF BEING A CONCISE GUIDE TO THE MYTHS OF GREECE AND ROME, BABYLONIA, EGYPT, AMERICA, SCANDINAVIA, & GREAT BRITAIN BY LEWIS SPENCE, M.A. Author of “ The Mythologies of Ancient Mexico and Peru,” etc. i CASSELL AND COMPANY, LTD. London, New York, Toronto and Melbourne 1910 ca') zz-^y . a k. WELLCOME INS77Tint \ LIBRARY Coll. W^iMOmeo Coll. No. _Zv_^ _ii ALL RIGHTS RESERVED INTRODUCTION Our grandfathers regarded the study of mythology as a necessary adjunct to a polite education, without a knowledge of which neither the classical nor the more modem poets could be read with understanding. But it is now recognised that upon mythology and folklore rests the basis of the new science of Comparative Religion. The evolution of religion from mythology has now been made plain. It is a law of evolution that, though the parent types which precede certain forms are doomed to perish, they yet bequeath to their descendants certain of their characteristics ; and although mythology has perished (in the civilised world, at least), it has left an indelible stamp not only upon modem religions, but also upon local and national custom. The work of Fruger, Lang, Immerwahr, and others has revolutionised mythology, and has evolved from the unexplained mass of tales of forty years ago a definite and systematic science. -
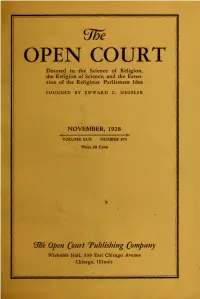
The Popol I'uh
OPEN COURT Devoted to the Science of Religion, the Religion of Science, and the Exten- sion of the Religious Parliament Idea FOUNDED BY EDWARD C. HEGELER NOVEMBER, 1928 ,< ^ VOLUME XLII ^a;MBER 870 9rite 20 Cenit UBe Open Q)urt Publishing Company Wieboldt Hall, 339 East Chicago Aveaue Chicago, Illinois — THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS 5750 ELLIS AVB^ CHICAGO THE AMERICAN PHILOSOPHY OF EQUALITY By T. V. Smith Equality, in its present vague status, has lost much of the meaning that the founders of this country attached to it. In this book Mr. Smith has set out, in effect, to rescue from oblivion whatever truth the earlier doctrine contained. "Professor Smith writes as a philosopher and an historian. His reasoning is sound, his information accurate and his style clear and virile. The volume is a notable contribution to our political philosophy."—The New Republic. ^3.00, postpaid ^3.15 THE DEMOCRATIC WAY OF LIFE By T. V. Smith T. V. Smith in this book re-endows "Liberty, Equality, Fraternity," slogans of a goal that has never been reached—with some of the spirit of the days when they were magic words. Here is a brilliant commentary upon democracy as a way of life. ^1.75, postpaid ^1.85 AESTHETICS OF THE NOVEL By Van Meter Ames The fact that there is a decided relationship between literature and philoso- phy has been singularly ignored by past writers. Mr. Ames, believing that literary criticism cannot be sound unless it is placed on a philosophical basis, in this book has successfully correlated both subjects.