La Variété Aglandau Et L'olive Aglandale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cultivated Olive Diversification at Local and Regional Scales
Cultivated Olive Diversification at Local and Regional Scales: Evidence From the Genetic Characterization of French Genetic Resources Bouchaib Khadari, Ahmed El Bakkali, Laïla Khadari, Christine Tollon-Cordet, Christian Pinatel, Guillaume Besnard To cite this version: Bouchaib Khadari, Ahmed El Bakkali, Laïla Khadari, Christine Tollon-Cordet, Christian Pinatel, et al.. Cultivated Olive Diversification at Local and Regional Scales: Evidence From theGe- netic Characterization of French Genetic Resources. Frontiers in Plant Science, Frontiers, 2019, 10, 10.3389/fpls.2019.01593. hal-02620852 HAL Id: hal-02620852 https://hal.inrae.fr/hal-02620852 Submitted on 26 May 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution| 4.0 International License ORIGINAL RESEARCH published: 24 December 2019 doi: 10.3389/fpls.2019.01593 Cultivated Olive Diversification at Local and Regional Scales: Evidence From the Genetic Characterization of French Genetic Resources Bouchaib Khadari 1,2*, Ahmed El Bakkali 3, Laila Essalouh -

Extra Virgin Olive Oils
Extra Virgin Olive Oils: French A L’Olivier Founded by a chemist in 1822, A L’Olivier is France’s most esteemed producer of specialty oils and vinegars. The picturesque Parisian shop still sells beautifully presented products in glass bottles, rustic stoneware crocks, and colorful tins. Olive Oil- A L’Olivier extra virgin olive oils are fragrant and fruity, with sweet, mild olive flavor. A L'Olivier Black and Fruity Extra Virgin Olive Oil Tin 250 ml 6 / case A L'Olivier Extra Virgin Olive Oil 250 ml 6 / case 500 ml 6 / case 1 L 6 / case A L'Olivier Extra Virgin Olive Oil Mini Drum 750 ml 6 / case A L’Olivier Extra Virgin Olive Oil Spray 200 ml 6 / case A L'Olivier Extra Virgin Olive Oil White Stoneware Crock 500 ml 6 / case Arnaud Arnaud Extra Virgin Olive Oil Salonenque, Blanquette, Verdale, Picholine, and Grossane olives 500 ml 12 / case Castelines From their orchards near Les Beaux, Jean Benoit and Catherine Hugues hand-pick a variety of olives just before they begin to blacken. These young olives are used to produce an olive oil that is light and delicate, with aromas of fresh grass and flavors of artichokes and almonds. Castelines also produces Late Harvest Fruite Noir olive oil, using only perfectly ripened native olives. The black olives are stored and lightly fermented to create a pleasantly sweet oil, with hints of truffle. Castelines Extra Virgin Olive Oil Salonenque, Aglandau, Grossane and Verdale olives 500 ml 6 / case 750 ml 6 / case Castelines Late Harvest Olive Oil (Fruite Noir) Salonenque, Aglandau, Grossane and Verdale olives 500 ml 6 / case Le Château d’Estoublon Le Château d’Estoublon Single Varietal Extra Virgin Olive Oil: Picholine 100% Picholine olives 500 ml 6 / case Le Château d’Estoublon Extra Virgin Olive Oil AOP: Vallée des Baux de Provence Béruguette, Bouteillan, Grossane, Salonenque and Picholine olives 500 ml 6 / case . -

Fringe Fruit Crops in Texas
OliveOverview Production of Olive Productionin Texas Monte Nesbitt in Texas & California Olives • Olea europaea— • Family: Oleaceae • Fruit: drupe • Origin/Native area: (Mediterranean & Middle East) Turkey, Syria • Introduced to California by Spanish settlers – Mission San Diego (1769) • >2,000 varieties Olive Fruit Use (major uses) Oil Olives Table Olives • Varieties that have • Varieties whose high oil yield and shape, volume, flesh-to-stone ratio, produce fragrant oils firmness and ease of of stable quality and detachment make good taste. them suited for • Extra virgin-implies processing and mechanically pressed, eating. rather than chemically • Treated to remove extracted. bitterness and preserved by natural fermentation, heat treatment, canning, etc. World Production Annual per Total Olive Oil Production Oil Oil capita Country Production (tons) Production % Consumption consumption (tons) (2009) (2010)[48] (2010) (2005)[49] (kg)[50] World 19,735,617 3,269,248 100% 100% 0.43 Spain 7,923,000 1,487,000 45.5% 20% 13.6 14.8 liters Italy 3,286,600 548,500 16.8% 30% 12.4 Greece 2,285,000 352,800 10.8% 7% 23.7 Syria 885,942 177,400 5.4% 3% 7.0 Morocco 850,000 169,900 5.2% 2% 11.1 Turkey 1,290,654 161,600 4.9% 2% 1.2 Tunisia 750,000 160,100 4.9% 2% 5.0 Portugal 362,600 66,600 2.0% 2% 1.8 Algeria 475,182 33,600 1.0% 2% 7.1 Others 1,126,639 111,749 3.5% 28% 1.2 U.S.=9%, 1 liter Source: Wikipedia- http://faostat.fao.org/site/636/DesktopDefault.aspx?PageID=636#ancor Perspective on world olive oil production Pro- Pro- Consum Consum Exports Exports -

Olive Oil Production in the Var Region of France, May, 1995
Olive Oil Production in the Var Region of France, May, 1995 In the south of France there are approximately 60 oil mills and cooperatives processing and retailing local olive oil today. They have a long history and tell the story of when olives were the dominant agricultural crop of the area. The Var region is at the center of what was once a thriving olive oil empire producing thousands of tons of olive oil each year. A devastating freeze in 1956 killed all of the olive trees down to the ground and most farmers replanted with the more profitable wine grapes for which France is so well known. Most of the mills in the region today still use the low technology stone mills and decantation processes their ancestors used. Unfortunately they have trouble finding enough olives nearby to sell much more than just to local residents, who bring their own olives for pressing. Mills that have modern equipment supplement their investment by bringing in olives from Spain and selling olive crafts, soaps, and canned table fruit in stores and restaurants adorned with antique processing equipment. Statistically, France is not a major producer of olive oil, processing an estimated 2,500 to 3,500 tons of olives in 1994. The Var region Chamber of Commerce economic development bulletin lists 11,136 farms in the region with an average size of just under 20 acres each. Vineyards represent 43% of the land and 47% of the earnings, cut flower production occurs on 1% of the land and represents 36% of the earnings. -

Future of Texas Olives AOOPA
THE FUTURE OF OLIVES IN TEXAS • Monte Nesbitt OLIVES ARE SOIL, DROUGHT AND SALT TOLERANT AND WE HAVE AN ABUNDANCE OF THOSE CHALLENGES IN TEXAS IS THERE AN OLIVE HISTORY IN TEXAS? Illustration by Silia Goetz, wsj.com KNOWN OLIVE HISTORY-TEXAS • Catholic archives in San Antonio indicate Spanish missionaries did not plant olives in Texas as they did in California (Denney, 1982). • Onderdonk (1900), important Texas nurseryman and fruit explorer wrote favorably of olives in San Luis Potosi, Mexico, but was otherwise silent about them. • Old trees dated 1920’s are reported to exist and bear fruit at places like Asherton & Galveston. • Mortensen (1938) described olive varieties introduced from California as “fair” for Wintergarden area and better for dooryard than commercial purposes. • Hartmann (1951) “Twenty-year effort in South Texas has failed to see fruiting” (Weslaco/Brownsville). Ernest Mortensen, Winterhaven, TX Exp. Station OLIVES ON TEXAS A&M CAMPUS 100’s of Manzanilla trees planted in 1974. Produced fruit in 1977, but were damaged by freezes in ‘78, ‘80, ‘81 (Denney, 1982) Thermal constraints on the productivity of olive (Olea europea L.) in the climates of olive-producing regions and of Texas, Thesis, Texas A&M Dept. of Horticultural Sciences, 1982 Dr. James Denney- deceased PUBLICATIONS • Denney, J.O. and G.R. McEachern. 1983. An analysis of several climatic temperature variables dealing with olive reproduction. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 108:578-581. • Denney, J.O., McEachern, G.R. and J.F. Griffiths. 1985. Modeling the thermal adaptability of the olive (Olea europaea L.) in Texas. Agric. For. Meteorol. -

Genetic and Environmental Features for Oil Composition in Olive Varieties
OCL 2014, 21(5) D504 c A.J. Bervillé, C.M. Breton, Published by EDP Sciences 2014 OCL DOI: 10.1051/ocl/2014007 Oilseeds & fats Crops and Lipids Available online at: www.ocl-journal.org Research Article –Dossier Open Access OLIVE OIL Huile d’olive Genetic and environmental features for oil composition in olive varieties André Jean Bervillé1 and Catherine Marie Breton2,, 1 INRA, UMR DIAPC, 2 place Viala, Bât 33, 34060 Montpellier Cedex 2, France ossier 2 INRA, UMR-AGAP, équipe Davem, campus Supagro, Bat 21, 34060 Montpellier Cedex 1, France D Received 21 January 2014 – Accepted 13 February 2014 Abstract – Consumption of olive oil helps both prevent and cure heart disease. Olive oils vary in their fatty acid profiles as well as those of other secondary metabolites (phenols, sterols, and terpene compounds). We seek to distinguish the genetic bases from the environmental factors that cause these variations. The genetic base is indeed wide: varieties originate in different domestication occurrences, from different oleaster trees and in differing climatic regimes. With the aid of diagrams, we set out briefly the oil synthesis pathway for fruits in comparison with that of seeds, and the specific aspects of olive oil in particular. Varieties of olive have appeared that are adapted to regions with harsh conditions where the oleaster could not thrive. Environmental stresses have consequences on drupes and their oil profiles; these have been highlighted in European countries through the use of appellations. Whilst stresses tend to enhance the quality of the end product, they do however decrease final yields with potential negative impacts on olive growers’ incomes. -
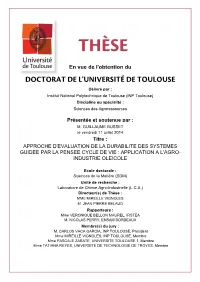
Approche D'evaluation De La Durabilite Des Systemes Guidee Par La Pensee Cycle De Vie : Application a L'agro- Industrie Oleicole
En vue de l'obtention du DOCTORAT DE L'UNIVERSITÉ DE TOULOUSE Délivré par : Institut National Polytechnique de Toulouse (INP Toulouse) Discipline ou spécialité : Sciences des Agroressources Présentée et soutenue par : M. GUILLAUME BUSSET le vendredi 11 juillet 2014 Titre : APPROCHE D'EVALUATION DE LA DURABILITE DES SYSTEMES GUIDEE PAR LA PENSEE CYCLE DE VIE : APPLICATION A L'AGRO- INDUSTRIE OLEICOLE Ecole doctorale : Sciences de la Matière (SDM) Unité de recherche : Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle (L.C.A.) Directeur(s) de Thèse : MME MIREILLE VIGNOLES M. JEAN PIERRE BELAUD Rapporteurs : Mme VERONIQUE BELLON MAUREL, IRSTEA M. NICOLAS PERRY, ENSAM BORDEAUX Membre(s) du jury : 1 M. CARLOS VACA GARCIA, INP TOULOUSE, Président 2 Mme MIREILLE VIGNOLES, INP TOULOUSE, Membre 2 Mme PASCALE ZARATE, UNIVERSITE TOULOUSE 1, Membre 2 Mme TATIANA REYES, UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES, Membre Résumé À l'heure où toute décision stratégique doit être conforme aux principes de la durabilité, l'évalua- tion des conséquences environnementales, économiques et sociales d'un choix d'ingénierie s'avère nécessaire. Parmi les outils d'évaluation des systèmes et de leurs conséquences, l'analyse de cycle de vie (ACV) dérivée de la pensée cycle de vie s'est imposée comme la méthode la plus adaptée à un tel niveau de décision. Historiquement focalisée sur les impacts environnementaux, l'ACV a naturellement étendue son champ d'évaluation aux aspects économiques, sociaux et d'ingénierie pour devenir une analyse de la durabilité (AdCV) des systèmes. L'AdCV est ainsi en train d'émer- ger et nécessite des propositions d'améliorations méthodologiques et des applications concrètes pour devenir robuste et applicable. -

Preliminary Investigation of Different Drying Systems to Preserve Hydroxytyrosol and Its Derivatives in Olive Oil Filter Cake Pressurized Liquid Extracts
foods Article Preliminary Investigation of Different Drying Systems to Preserve Hydroxytyrosol and Its Derivatives in Olive Oil Filter Cake Pressurized Liquid Extracts Lucía López-Salas 1, Inés Cea 2,3, Isabel Borrás-Linares 4,*, Tatiana Emanuelli 5 , Paz Robert 2, Antonio Segura-Carretero 4,6,† and Jesús Lozano-Sánchez 1,4,† 1 Department of Food Science and Nutrition, University of Granada, Campus Universitario S/N, 18071 Granada, Spain; [email protected] (L.L.-S.); [email protected] (J.L.-S.) 2 Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile, Casilla 133, Santiago 8380494, Chile; [email protected] (I.C.); [email protected] (P.R.) 3 Center for Systems Biotechnology, Fraunhofer Chile Research, Av. Del Cóndor 844 Floor 3, Santiago 8580704, Chile 4 Functional Food Research and Development Centre (CIDAF), Health Sciencie Technological Park, Avda. Del Conocimiento S/N, 18016 Granada, Spain; [email protected] 5 Department of Food Technology and Science, Center of Rural Sciences, Federal University of Santa Maria, Camobi, Santa Maria 97105-900, RS, Brazil; [email protected] 6 Citation: López-Salas, L.; Cea, I.; Department of Analytical Chemistry, Faculty of Sciences, University of Granada, 18071 Granada, Spain * Correspondence: [email protected]; Tel.: +34-9586-37083 Borrás-Linares, I.; Emanuelli, T.; † These authors are joint senior authors on this work. Robert, P.; Segura-Carretero, A.; Lozano-Sánchez, J. Preliminary Investigation of Different Drying Abstract: Phenolic compounds present in extra virgin olive oil (EVOO) could be retained in its Systems to Preserve Hydroxytyrosol byproducts during processing. -

Les Huiles D'olive Dégustées Lors De La 6Ème Sélection
LES HUILES D’OLIVE DÉGUSTÉES LORS DE LA 6ÈME SÉLECTION DU COUP DE CŒUR DE FEMMES /13 1 SOMMAIRE ▪ L’OLÉICULTURE COOPÉRATIVE RÉGIONALE Page 3 Les coopératives sont classées par ordre alphabétique des communes ▪ BEAUCAIRE (30) : HUILERIE COOPÉRATIVE DE BEAUCAIRE Page 4 ▪ BEZOUCE (30) : L’OULIVO Page 6 ▪ BIZE-MINERVOIS : COOPÉRATIVE OLÉICOLE L’OULIBO Page 8 ▪ CLERMONT L'HÉRAULT (34) : HUILERIE CONFISERIE COOPÉRATIVE INTERDÉPARTEMENTALE DE CLERMONT L'HÉRAULT Page 10 ▪ LIMOUX (11) : CAVALE Page 12 ▪ MILLAS (66) : SCA FORCA REAL LA CATALANE Page 13 /13 2 L’OLÉICULTURE COOPÉRATIVE D’OCCITANIE : La production des vergers, historique et traditionnelle, met en valeur des variétés locales, garantes de l’identité et de la personnalité de nos produits. L’oléiculture permet l’élaboration de 4 familles de produits : les olives de table, les huiles d’olive, les produits dérivés, les résidus valorisables. Les principales variétés identitaires de la région permettent l’élaboration d’huiles d’olive aux multiples palettes gustatives : Lucques, Picholine, Olivière, Amellau, Clermontaise, Rougette de Pignan, Verdale de l’Hérault. L’olive constitue la matière première de nombreux produits dérivés. La récolte est principalement vendue conditionnée en direct aux particuliers. La coopération oléicole représente : Huile : 35% de la production régionale et 9% de la production française Olive de bouche : 85% de la production régionale et 48% de la production française, essentiellement de l’Oulibo. Production d’olives de bouche Production d’huiles d’olive L’Occitanie -

1. GEN Variatio the Oliv Olive G Orders Showca Initiativ 1.2. Soc
Policies - France 2012 1. GENERAL DESCRIPTION OF OLIVE GROWING IN FRANCE 1.1. Introduction In economic terms, France has just over 5.1 million olive trees spread over 55 000 ha (2011) and 13 départements, located solely in the South-east. They cover less than 0.18% of the usable agricultural area (UAA). The average density is 86 trees/ha althoughh this can vary from one region to another (from 50 in Corsica to 110 in Languedoc- Roussillon). Figure 1. Localization of France (Source: UN) Over 15 000 ha, i.e. more than one-quarter of France’s olive orchards are irrigated. However, here again there are variations, ranging from 9% in the Ardèche to 34% in Bouches-du-Rhône. The olive tree is emblematic of Provence where 75% of growers are not professional farmers. Olive growing and the products of the olive tree are at the centre of many cultural phenomena. Orders of Knights swear to defend the olive tree as a symbol of peace, countless events showcase the olive tree and its products, and numerous museums, tourist routes and other initiatives have grown up around the olive. (Source: IOC questionnaire) 1.2. Socio-economic indicators • Area: 551 500 sq km (UN, 2008) • Capital city: Paris (UN) • Currency: Euro (EUR) (UN, 2009) • Population: 62 616 488 (World Bank, 2009) • Urban population: 78% (World Bank, 2010) • Rural population: 22% (World Bank, 2010) • Population growth rate: 0.4% (UN, 2005/10) • Life expectancy: 78.6 years (men), 85.1 years (women) (UN, 2010/15) • Main exports by quantity: wheat (FAOSTAT, 2009) • Main imports by quantity: soybean cake (FAOSTAT, 2009) • GNI per capita, PPP (current international $): 34 440 (World Bank, 2010) • GDP per capita, PPP (current international $): 33 820 (World Bank, 2010) • Employment in agriculture: 2.9% (World Bank, 2008) • Employees in agriculture, female: 2% (World Bank, 2008) • Employees in agriculture, male: 4% (World Bank, 2008) International Olive Council Page 1 / 12 Policies - France 2012 2. -

Vi Jornadas Internacionales De Olivar Ecológico
VI JORNADAS INTERNACIONALES DE OLIVAR ECOLÓGICO. ECOLIVA 2007 COMUNICACIONES ÍNDICE DE COMUNICACIONES APLICACIÓN DE MICROTALCOS NATURALES EN LA ELABORACIÓN DE ACEITES DE OLIVA VÍRGENES APLICACIÓN DEL CAOLÍN COMO TRATAMIENTO CONTRA LA MOSCA EN EL CULTIVO ECOLÓGICO DEL OLIVO EN DISTINTAS ZONAS DE CATALUÑA BACTROCERA OLEAE (GMELIN) CONTROL IN ORGANIC OLIVE FARMING COLLABORATIVE RESEARCH FOR INTEGRATING AND SHARING DATA ON OLIVE PEST MANAGEMENT AND FUNCTIONAL BIODIVERSITY: THE RIOMPROJECT DESIGN COMPORTAMIENTO DE LAS CUBIERTAS VEGETALES EN LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y EL AGUA EN EL OLIVAR DE MONTAÑA COMPOSTAJE DE SUBPRODUCTOS DE LA OLIVICULTURA ECOLÓGICA CONTAMINACIÓN DIFUSA POR P EN OLIVARES ECOLÓGICOS LA DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE ACEITE DE OLIVA ECOLÓGICO EROSIÓN EN OLIVAR ECOLÓGICO. MANUAL DE CAMPO. DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES ESTUDIO ECONÓMICO DEL ALPEORUJO EN LAS COMARCAS CAMPIÑA SUR, LA LOMA, SIERRA MÁGINA, SIERRA DE SEGURA Y SIERRA SUR DE LA PROVINCIA DE JAÉN ESTUDIOS SOBRE EL APROVECHAMIENTO GANADERO DE LAS CUBIERTAS VEGETALES DEL OLIVAR ECOLÓGICO ESTUDIOS SOBRE LA REPRODUCCIÓN SEXUAL EN EL OLIVO EL FUTURO DE LA COMARCA O LA COMARCA SIN FUTURO. CONCEPCIONES ACERCA DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LA SIERRA DE SEGURA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL OLIVAR ECOLÓGICO: ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS IMPACT OF CONVENTIONAL AND ORGANIC FARMING PRACTICES ON THE SOIL FAUNA OF OLIVE ORCHARDS IN MESSARA PLAIN,CRETE, GREECE. INITIAL RESULTS THE IMPACT OF SOME COMPOUNDS UTILISED IN ORGANIC OLIVE GROVESON THE NON-TARGET ARTHROPOD FAUNA: CANOPY AND SOIL -

Guide Du Planteur D'oliviers
Version 5 – janvier 2015 GUIDE DU PLANTEUR D'OLIVIERS En Languedoc-Roussillon Initialement rédigé en été 2004 par Jean-Michel DURIEZ ( Association Française Interprofessionnelle De L'Olive - AFIDOL). En collaboration avec les membres du réseau technique oléicole du Languedoc-Roussillon : Christine AGOGUE (Chambre d'Agriculture de l'Aude) Bernard ASSENAT (Chambre d'Agriculture du Gard) Eric HOSTALNOU (Chambre d'Agriculture des Pyrénées Orientales) Hélène TEISSÉDRE (Chambre d'Agriculture de l'Hérault) Avec le soutien de l'Office National Interprofessionnel des Oléagineux et des Productions Textiles et de la Région Languedoc-Roussillon. 1 Version 5 – janvier 2015 PREMIÈRE RÉFLEXION INDISPENSABLE Toute personne désireuse de planter des oliviers doit impérativement se poser ces premières questions préalables : Quelle destination vais-je donner aux olives que je vais produire ? Comment vais-je valoriser cette production d'olives ? De nombreuses plantations ont été réalisées entre 1998 et 2002, la plupart en accord avec les coopératives et les moulins privés. Elles ont bénéficié d'aides car la demande dépassait l'offre à la fin des années 1990. Elles entrent en production maintenant. La production oléicole régionale s'écoule sans trop de difficultés, mais il serait irresponsable d'installer de nouvelles plantations avant d'être certain de conquérir les nouveaux marchés indispensables. Il existe plusieurs possibilités pour écouler les produits oléicoles → Par des coopératives, → Par des moulins ou confiseries privés, → Par ses propres circuits de vente. Si vous ne comptez pas vendre vous-même vos produits oléicoles, contactez la coopérative ou les ateliers privés auprès de qui vous souhaiteriez écouler vos olives, préalablement à toute plantation. Vérifiez auprès d'eux la possibilité d'adhérer ou de devenir client.