PLAGEPOMI 2016-2021 Rhin Meuse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Debits Caracteristiques En M3/S Debits Naturels Reconstitues
© 2000 AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE BASSIN: RHIN DELEGATION DE BASSIN RHIN - MEUSE Tous droits réservés RIVIERE: MOSELLE CODE HYDRO: A7-A8--006 DEBITS CARACTERISTIQUES EN M3/S DEBITS NATURELS RECONSTITUES Zone Identification du point P.K.H Surface du Module Débits mensuels d'étiage (m3/s) hydro B.V. en km² (m3/s) F 1/2 F 1/5 F 1/10 A 700 La Moselle à l'aval du confluent de la Meurthe 654.92 6791.5 110 23.7 16.5 13.7 La Moselle à l'amont du confluent de la Mauchère 655.53 6794.0 110 23.7 16.5 13.7 La Mauchère 26.0 0.215 0.021 0.014 0.011 La Moselle à l'aval du confluent de la Mauchère 655.23 6820.0 110 23.7 16.5 13.7 (limite des zones A700 et A701) A 701 La Moselle à la station hydrométrique de Custines 656.67 6829.0 110 23.8 16.6 13.7 La Moselle à l'amont du confluent de la Natagne 665.67 6881.0 111 24.1 16.7 13.8 (limite des zones A701, A702 et A703) A 702 La Natagne 29.4 0.220 0.004 0.002 0.002 A 703 La Moselle à l'aval du confluent de la Natagne 665.67 6910.4 111 24.1 16.7 13.8 La Moselle à l'amont du confluent de l'Esche (limite des 670.90 6928.4 112 24.2 16.7 13.8 zones A703, A712 et A720) A 71- L'Esche 239.3 1.53 0.150 0.080 0.058 A 720 La Moselle à l'aval du confluent de l'Esche 670.90 7167.7 113 24.4 16.8 13.8 La Moselle à l'amont du confluent du ruisseau de Trey 679.68 7228.3 114 24.7 16.9 13.9 (limite des zones A720, A721 et A722) A 721 Le Trey 39.8 0.345 0.070 0.049 0.041 A 722 La Moselle à l'aval du confluent du ruisseau de Trey 679.68 7268.1 114 24.8 16.9 13.9 La Moselle à l'amont du confluent du Rupt de Mad 685.46 7303.8 115 -

American Armies and Battlefields in Europe 533
Chapter xv MISCELLANEOUS HE American Battle Monuments The size or type of the map illustrating Commission was created by Con- any particular operation in no way indi- Tgress in 1923. In carrying out its cates the importance of the operation; task of commeroorating the services of the clearness was the only governing factor. American forces in Europe during the The 1, 200,000 maps at the ends of W or ld W ar the Commission erected a ppro- Chapters II, III, IV and V have been priate memorials abroad, improved the placed there with the idea that while the eight military cemeteries there and in this tourist is reading the text or following the volume records the vital part American tour of a chapter he will keep the map at soldiers and sailors played in bringing the the end unfolded, available for reference. war to an early and successful conclusion. As a general rule, only the locations of Ail dates which appear in this book are headquarters of corps and divisions from inclusive. For instance, when a period which active operations were directed is stated as November 7-9 it includes more than three days are mentioned in ail three days, i. e., November 7, 8 and 9. the text. Those who desire more com- The date giYen for the relief in the plete information on the subject can find front Jine of one division by another is it in the two volumes published officially that when the command of the sector by the Historical Section, Army W ar passed to the division entering the line. -

Moselle River Crossing: 5Th Infantry Division, September 1944
ITI 0LCT AUG 9 W AlPOT.VjIC DJSTBU"U -NIiI SECURITY CLASI3FICATION OF T,41S PGE (-he Does fn.orod) REPORT D00C;-. ENTATION PAGE READ INSTRUCTICNS "BEFORE COMPLET4NG FORM I. REPORT NUMBER 2. GOVT ACCESSION NO. 3. RECIPIENT'S CATALOG NUMBER 4. TITLE (and Subatit) *j'fW/Vf /VER (4'OS$/14i' S. TYPE OF REPORT & PE-OD COVERED .:oselle River Crossing: 5th Infantry Division, Student Paper September 19.44 6. PERFORMING ORG. REPORT NUMBER 7 , ýý?e4&rsinger, ,'IkJ Johnston, I,:AJ ?:ettala, S. CONTRACT OR GRANT NUMBER(s) C.T Vurphy, I*MAJ Rossi, !KAJ Taddonio .. PERFORMING ORGANIZATION N^ME AND ADDRESS 10. PROGRAM ELEMENT. PRAOJECT, TASK Combat Studies Institute, USACCSC AREA & WORK UNIT NUMBER ATZL-S".'I Ft. Leavenworth, YS 66027 11. CONTROLLING OFFICE NAME AND ADDRESS 12. REPORT DATE Combat Studies Institute, USACC.SC 20 Y:ay, 1983 ATZL-S'I 13. NUMBER OF PAGES Ft. Leavenworth, KS 66027 77 4. MONITORING AGENCY NAME & ADDRESS(I different from Controlling Office) IS. SECURITY CLASS. (.1•fh report) Unclassified IS.. DECL ASSI FI CATION/DOWNGRADING SCHEDULE 16. DISTRIBUTION STATEMENT (a( thi R -- ) D T IC A-PRCVED K•CR ELMI!C RELEASE: C ~ . -DISTRIBUTION U1,LII,-ITED -q-L - -AUG-9UW9 17. DISTRIBUTION STATEMENT (o* the abetract entered In Block 20, It different ham RePret) B IS. SUPPLEMEI4TARY NOTES rart of the Rattle Analysis series prepared by students of the US Army Connand and Ceneral Staff College under the su:ervision of Combat Studies ins titute 19. KEY WORDS (Continue an rever•e side If nocea•w and Identify by block nimber) Eistory, Case Studies, Military Cperations, Tactical Analysis, Battles, I'ilitary Tactics, Tactical I'arfare, Antitank "arfare, Arror, Artillery, Infantry, Tactical Air Support, Tanks (Combat Vehicles). -

Déclaration D'intention De L'eptb Meurthe Madon
Déclaration d’intention de l’EPTB Meurthe Madon - Projet de lutte contre les inondations et de restauration du Madon L’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Meurthe Madon est un établissement créé en 2011, ses membres sont les intercommunalités, la Région Grand Est et les conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Son rôle est de créer, structurer et animer une stratégie globale de prévention des inondations sur son territoire. Son périmètre d'action couvre le bassin versant de la Meurthe (293 communes pour 505 000 habitants) ainsi que le bassin versant du Madon (67 communes pour 65 000 habitants) et ceci jusqu'à la confluence avec la Moselle. Les objectifs de ce syndicat mixte sont de promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l'environnement, à l'échelle des bassins versants de la Meurthe et du Madon. Les intercommunalités membres de l’EPTB ont toutes transféré la compétence « prévention des inondations ». De manière optionnelle, certaines ont transféré également la compétence « gestion des milieux aquatiques naturels », une intercommunalité a choisi de déléguer cette compétence. Ainsi, l’EPTB Meurthe Madon s’est engagé dès 2011 dans une démarche d’élaboration d’un projet global de lutte contre les inondations et de restauration des milieux aquatiques sur le bassin du Madon, qui s’est traduite par la labellisation d’un premier Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) en 2018. Cette contractualisation PAPI permet à l'EPTB depuis avril 2019 de mener l'ensemble des actions prévues au programme et de bénéficier de fonds européens (FEDER), du fond Barnier (Etat), d'aides de l'Agence de l'eau Rhin Meuse et de la Région Grand Est. -

Natural Variation of Macrophyte Vegetation of Lowland Streams at The
Limnologica 51 (2015) 53–62 Contents lists available at ScienceDirect Limnologica jo urnal homepage: www.elsevier.com/locate/limno Natural variation of macrophyte vegetation of lowland streams at the regional level a,∗ b c a b Gerhard Wiegleb , Wolfgang Herr , Bärbel Zander , Udo Bröring , Holger Brux , d Klaus van de Weyer a General Ecology, Faculty of Environmental Sciences and Process Engineering, Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Platz der Deutschen Einheit 1, 03046 Cottbus, Germany b IBL Umweltplanung GmbH, Bahnhofstraße 14a, 26122 Oldenburg, Germany c Landscape Architecture, Geoinformatics, Geodesy and Civil Engineering, University of Applied Sciences Neubrandenburg, Brodaer Straße 2-4, 17033 Neubrandenburg, Germany d Lanaplan GbR, Lobbericher Straße 5, 41334 Nettetal, Germany a r t a b i c l e i n f o s t r a c t Article history: In the present study, we present a synopsis of two macrophyte surveys of physiographic units in north- Received 8 April 2014 west Germany carried out over one decade. Data were used to test a set of hypotheses on macrophyte Received in revised form distribution at the regional level. Rank–frequency curves resembled the broken stick model. Twenty- 16 December 2014 one species of the 59 most frequent species occurred at high frequencies above 15%. Helophytes made Accepted 20 December 2014 up a high percentage (12 of 21) of the frequent species. Phalaris arundinacea was the most frequent Available online 27 December 2014 species in both sampling periods. Most species showed no considerable change in frequency over time, among them the core hydrophytes. Spatial variation of species frequencies among physiographical units Keywords: Biogeography showed a unimodal distribution in relation to frequency. -

Bricker Hits Dewey Going Yanks Gain Talk on Courts Court Packing to Pittsburgh SAN FRANCISCO
DETROIT SUNDAY TIMES f TODAY'S WAR MAPS: CLOSING IN ON JAPAN I, Page 2 -Oct. 15, 1944 Text of Bricker s Bricker Hits Dewey Going Yanks Gain Talk on Courts Court Packing To Pittsburgh SAN FRANCISCO. Oct. 14—The condensed text of a speech, delivered by Gov. Bricker at the Civic Auditorium Says 22,000,000 GOP Will Deliver Major Inside Aachen her* tonight, follows: Voters Disfranchised Speech There Oct. 20 Infantry, Bazookas In 1937, the New Deal President undertook to "pack" the U. S. Supreme Court. SAN FRANCISCO. Oct. 14 ALBANY, Oct. 14 <INS>—Gov. Mopping Up City The entire nation was shocked. (INS)—Gov, Bricker of Ohio Dewey today underscored the im- "The packing” plan of 1937 failed in the letter but succeeded charged tonight that the New- portance of 35 in the the in SUPREME HQ., AE F. spirit of attempt. Deal “now is firmly in control of electoral votes the November In a fireside chat on June 24, 1938, Mr. Roosevelt boasted election by consenting to deliver FRANCE. Oct. 14 (INS)—U. S. the federal judiciary of the coun- that all legislative objectives of his proposal had been achieved. a major speech at Pittsburgh on infantry and bazooka team*, blow- try." That and even more is literally true. Friday, Oct. 20. up whole blocks of bomb- The Republican candidate for York governor will ing The first consequence is that the New now is firmly in The New ruined buildings to obliterate Deal vice president leveled a blistering speak over an NBC network from control of the federal judiciary of the To make this attack on President Roosts Hi for p. -
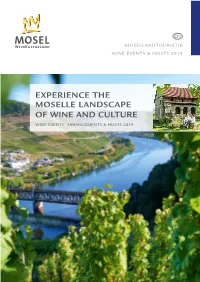
Experience the Moselle Landscape of Wine And
EN MOSELLANDTOURISTIK WINE EVENTS & HOSTS 2019 EXPERIENCE THE MOSELLE LANDSCAPE OF WINE AND CULTURE WINE EVENTS, ARRANGEMENTS & HOSTS 2019 Dear guests and friends of the Moselle region, UNIQUE ORIGINS, we are delighted by your interest in spending your For information on your SEDUCTIVE ENJOYMENT. holiday in our attractive landscape of wine and culture. Moselle vacation contact: This brochure starts off by providing you with a Mosellandtouristik GmbH comprehensive overview of the appealing package Kordelweg 1 · 54470 Bernkastel-Kues offers available for a care-free stay by the Moselle, Saar Telephone +49(0)6531/9733-0 and Ruwer rivers. Thereafter we will introduce our local Fax +49(0)6531/9733-33 hosts, who will gladly spoil you individually with the hospitality that is typical for the Moselle region. [email protected] www. mosellandtouristik.de/en Discover the Moselle region with us – be it on a www.facebook.com/mosellandtouristik short trip or an entire holiday, as a guest in a hotel, a boarding house, in a winery, or in a holiday apartment. Please don’t hesitate to contact us directly if you are Bookinghotline: +49 (0)6531 97330 seeking advice or would like to place a booking. eMail: [email protected] Web: www.mosellandtouristik.de/en, www.facebook.com/Mosellandtouristik Have fun planning your holidays! Your Moselland Tourism EXPERIENCE THE MOSELLE LANDSCAPE OF WINE AND CULTURE Map of the region 4 in the footsteps of the Romans 21 The Mosel – One of the most beautiful Exclusive short trip to the Saarburger Land 22 river landscapes in Europe 6 UNESCO World Heritage treasures in Trier 22 The most beautiful side of country life 8 Discover the city of Trier on the Roman Wine Road 22 Moselle, with body and soul 10 Girls on Tour – Discover. -

Édition N° 33 Du 7 Avril 2021
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Édition n° 33 du 7 avril 2021 L ! act ! dans l ur int#$ralit# % uv nt &tr "onsult#! à la %r#( "tur ou aupr)! d ! ! rvi" ! "on" rn#!* L r cu il % ut au!si &tr "onsult# + • !ur l !it Int rn t d ! ! rvi" ! de l,État n M urth . t.Mo! ll + ///*0 urt- . t.0o! ll *$ouv*(r RECUEIL N° 33 7 avril 2021 S O M M A I R E ARRÊTÉS, DÉCISIONS, CIRCULAIRES........................................................................................................................................................................................................2 PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE................................................................................................................................................................................................2 SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT.....................................................................................................................................................................................................2 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ GRAND EST..........................................................................................................................................................................................2 DÉLÉGATION TERRITORIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE..............................................................................................................................................................2 Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales..................................................................................................................................................................2 -

Meurthe-Et-Moselle
2015 MISE À JOUR PARTIELLE 2016 TLAS DÉPARTEMENTAL MEURTHE-ET-MOSELLE 3 ’Atlas départemental est un outil d’information et de connaissance de la Meurthe-et-Moselle. Il s’adresse aux élus, aux agents du conseil départemental ainsi qu’aux partenaires dont certains ont contribué à son ÉDITO élaboration. L’Atlas est en effet le fruit d’un travail collaboratif, mené à partir Ldes données statistiques et des analyses fournies par les services et partenaires du Département. Mise à jour de 75 indicateurs en 2016 L’Atlas départemental fait l’objet cette année d’une mise à jour de 75 indicateurs sur les 250 que contenait la version 2015. L’actualisation concerne les principaux indicateurs associés aux politiques publiques de la collectivité, les plus dynamiques et ceux dont l’évolution par rapport à 2015 présente un réel intérêt. La sélection couvre un grand nombre de thématiques : démographie, niveau de vie, emploi, économie solidaire et insertion, services à la population, solidarité, aménagement… La prochaine version complète de l’Atlas, avec l’ensemble des indicateurs, paraîtra en 2017. Comme pour les versions précédentes, les indicateurs 2016 sont illustrés par des graphiques, courbes et tableaux déclinés à l’échelle des six territoires d’action du Département ainsi que par des cartes permettant de compléter et de visualiser les éléments statistiques présentés. Un texte synthétique identifie les spécificités territoriales marquantes et permet la comparaison avec les tendances observées au sein de l’ancienne région Lorraine, de la nouvelle région Grand Est et de la France métropolitaine. Des définitions permettent en outre d’éclairer le lecteur sur les notions-clés pour chacune des thématiques. -
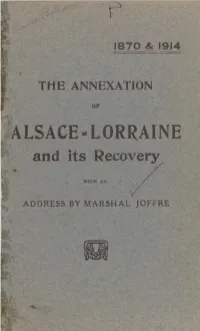
ALSACE-LORRAINE and Its Recovery
1870 & 1914 THE ANNEXATION OP ALSACE-LORRAINE and its Recovery WI.1M AN ADDRESS BY MARSHAL JOFFRE THE ANNEXATION OF ALSACE-LORRAINE and its Recovery 1870 & 1914 THE ANNEXATION OF ALSACE=LORRA1NE and its Recovery WITH AN ADDRESS BY MARSHAL JOFFRE PARIS IMPRIMERIE JEAN CUSSAC 40 — RUE DE REUILLY — 40 I9I8 ADDRESS in*" MARSHAL JOFFRE AT THANN « WE HAVE COME BACK FOR GOOD AND ALL : HENCEFORWARD YOU ARE AND EVER WILL BE FRENCH. TOGETHER WITH THOSE LIBERTIES FOR WHICH HER NAME HAS STOOD THROUGHOUT THE AGES, FRANCE BRINGS YOU THE ASSURANCE THAT YOUR OWN LIBERTIES WILL BE RESPECTED : YOUR ALSATIAN LIBER- TIES, TRADITIONS AND WAYS OF LIVING. AS HER REPRESENTATIVE I BRING YOU FRANCE'S MATERNAL EMBRACE. » INTRODUCTION The expression Alsace-Lorraine was devis- ed by the Germans to denote that part of our national territory, the annexation of which Germany imposed upon us by the treaty of Frankfort, in 1871. Alsace and Lorraine were the names of two provinces under our monarchy, but provinces — as such — have ceased to exi$t in France since 1790 ; the country is divided into depart- ments — mere administrative subdivisions under the same national laws and ordi- nances — nor has the most prejudiced his- torian ever been able to point to the slight- est dissatisfaction with this arrangement on the part of any district in France, from Dunkirk to Perpignan, or from Brest to INTRODUCTION Strasbourg. France affords a perfect exam- ple of the communion of one and all in deep love and reverence for the mother-country ; and the history of the unfortunate depart- ments subjected to the yoke of Prussian militarism since 1871 is the most eloquent and striking confirmation of the justice of France's demand for reparation of the crime then committed by Germany. -

Plateau Lorrain
Collines de Pays de l'Artois 155 km cl I canal touristique VermandoisSambre l'Avesnois Canal Source de la de Oise m Bresle 100 Somme 120 100 Amiens Ancre jOD Gland Dieppe m 37km I II 27km I II Hirson Arques Meuse 3pURQQH Guise 12km II Origny Bray (WUpDXSRQW Thon Revin 12km I(2) ArdennesEDF Somme Faux Boves m Manche 100 m Eaulne 100 Vilpion 9pORURXWH de l'Oise %pWKXQH Brune 68km I )pFDPS Thiernu 6km II(3) Moreuil 0RQWKHUPp Semoy 100 20km II D31 St Simon m Nampcelles Selle Lac des vieilles Canal Marle Cap Avre Forges Neufchatel en Bray de St- Quentin Oise Montcornet Bouillon 7KLpUDFKHSerre Tintigny 19km I(2) d'Antifert Signy 97km I Canal Serre Cap de la Noye Varenne Charleville Alderney Hague 14 Raz Blanchard 36km I 0p]LqUH Luxembourg (Aurigny) Pays de CauxAustreberthe Vaux 30km II Escames &{WHVGH0RVHOOH Cherbourg 450 Parc Barentin m Laon Porcien &{WHGH 100 100 m Canal Ardennes 08 Le Havre UpJLRQDO Aisne 02 150 UpJLRQDO Cotentin &{WH Seine 12km I II 22km I Rethel Roumois Duclair Fourquenies de l'Oise Sottevast Sedan Nacre Rouen 5RFK\&RQGp jO $LVQH 100 Bar Pt Audemer m 22km I (2) NPFDQDOLVp Douve Beauvais 35km I Chiers Parc 16 Andelle &RPSLqJQH Senuc Apach Guernsey de 45 1LHGUpXQLH des marais Fleurie Lieuvin 7KpUDLQ Woigot Brotonne Aisne Neuflize E46 Aisne 24km II Retourne 15 Fleury sur Andelle 12 Othain Northen St Peter-Port 27 30km I(2) 12km I II &RQGp Pouilly Saar Bayeux Apremont Brionne 32km I 15km I II Moselle A28 Vexin Mouy m Plateau Dahn 100 8 +RPpFRXUW Epte PP 20 100 30km I(2) Orne Vesle Heutregiville Orne 20km II Taute m 100 Oise -

La Deuxième Restructuration De L'intercommunalité. Les Propositions
« DÉCENTRALISONS AUTREMENT » NOTE N° 165. La deuxième restructuration de l’intercommunalité. L e s propositions des préfets aux commissions départementales de la coopération intercommunale (octobre 2 015) 3 ème partie. Dans la note N° 163, nous avons étudié le cas de cinq départements. Dans la note N° 164, nous en avons abordé quatre autres. Voici une nouvelle salve de cinq départements, dont les quatre départements de la Lorraine actuelle. a) Département de la Meurthe-et-Moselle. Les EPCI après la restructuration de 2 011. 1. Communauté Urbaine du Grand Nancy, 20 communes, 256 246 habitants (2 011) 2. Communauté de communes de l’agglomération de Longwy, 21 communes, 59 244 habitants. 3. Communauté de communes Moselle et Madon, 19 communes, 29 122 habitants. 4. Communauté de communes du Bassin de Landres, 11 communes dont une dans la Meuse, 14 452 habitants. 1 5. Communauté de communes du Bassin de Pompey, 13 communes, 20 723 habitants. 6. Communauté de communes de la Vezouze, 32 communes, 5 705 habitants. 7. Communauté de communes du Lunévillois, 15 communes, 29 196 habitants. 8. Communauté de communes du Pays du Sânon, 29 communes, 6 946 habitants. 9. Communauté de communes de Seille et Mauchère, 23 communes, 8 578 habitants. 10. Communauté de communes du Pays de Briey, 9 communes, 10 992 habitants. 11. Communauté de communes du Pays de Colombey-les-Belles et du Sud-Toulois, 39 communes dont deux du département des Vosges, 11 224 habitants. 12. Communauté de communes du Pays de l’Orne, 10 communes, 23 658 habitants. 13. Communauté de communes du Jarnisy, 24 communes, 19 020 habitants.