Revue Musicale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Ecumenical Movement and the Origins of the League Of
IN SEARCH OF A GLOBAL, GODLY ORDER: THE ECUMENICAL MOVEMENT AND THE ORIGINS OF THE LEAGUE OF NATIONS, 1908-1918 A Dissertation Submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by James M. Donahue __________________________ Mark A. Noll, Director Graduate Program in History Notre Dame, Indiana April 2015 © Copyright 2015 James M. Donahue IN SEARCH OF A GLOBAL, GODLY ORDER: THE ECUMENICAL MOVEMENT AND THE ORIGINS OF THE LEAGUE OF NATIONS, 1908-1918 Abstract by James M. Donahue This dissertation traces the origins of the League of Nations movement during the First World War to a coalescent international network of ecumenical figures and Protestant politicians. Its primary focus rests on the World Alliance for International Friendship Through the Churches, an organization that drew Protestant social activists and ecumenical leaders from Europe and North America. The World Alliance officially began on August 1, 1914 in southern Germany to the sounds of the first shots of the war. Within the next three months, World Alliance members began League of Nations societies in Holland, Switzerland, Germany, Great Britain and the United States. The World Alliance then enlisted other Christian institutions in its campaign, such as the International Missionary Council, the Y.M.C.A., the Y.W.C.A., the Blue Cross and the Student Volunteer Movement. Key figures include John Mott, Charles Macfarland, Adolf Deissmann, W. H. Dickinson, James Allen Baker, Nathan Söderblom, Andrew James M. Donahue Carnegie, Wilfred Monod, Prince Max von Baden and Lord Robert Cecil. -

Rome Vaut Bien Un Prix. Une Élite Artistique Au Service De L'état : Les
Artl@s Bulletin Volume 8 Article 8 Issue 2 The Challenge of Caliban 2019 Rome vaut bien un prix. Une élite artistique au service de l’État : Les pensionnaires de l’Académie de France à Rome de 1666 à 1968 Annie Verger Artl@s, [email protected] Follow this and additional works at: https://docs.lib.purdue.edu/artlas Part of the History of Art, Architecture, and Archaeology Commons, and the Music Commons Recommended Citation Verger, Annie. "Rome vaut bien un prix. Une élite artistique au service de l’État : Les pensionnaires de l’Académie de France à Rome de 1666 à 1968." Artl@s Bulletin 8, no. 2 (2019): Article 8. This document has been made available through Purdue e-Pubs, a service of the Purdue University Libraries. Please contact [email protected] for additional information. This is an Open Access journal. This means that it uses a funding model that does not charge readers or their institutions for access. Readers may freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of articles. This journal is covered under the CC BY-NC-ND license. Artl@s At Work Paris vaut bien un prix. Une élite artistique au service de l’État : Les pensionnaires de l’Académie de France à Rome de 1666 à 1968 Annie Verger* Résumé Le Dictionnaire biographique des pensionnaires de l’Académie de France à Rome a essentiellement pour objet le recensement du groupe des praticiens envoyés en Italie par l’État, depuis Louis XIV en 1666 jusqu’à la suppression du concours du Prix de Rome en 1968. -

Jacques Ibert Represents the Quintessence
Notes on the Program By James M. Keller, Program Annotator, The Leni and Peter May Chair Trois pièces brèves (Three Short Pieces), for Woodwind Quintet Jaques Ibert acques Ibert represents the quintessence awarded the prestigious Prix de Rome on his Jof the Parisian composer in the early- to first try, in 1919. Ibert never departed much mid-20th century: cultivated but not pomp- from an essentially traditional musical lan- ous, technically adept but self-effacing, blend- guage that used explicitly modern harmonies ing the “serious” with the “popular,” typically only as surface details. Apart from the Trois good-spirited and often witty. He was born in pièces brèves, his most frequently visited piec- Paris during the Belle Époque and died in the es today are his orchestral work Escales, his same city 72 years later, having weathered two Flute Concerto, and a neo-Renaissance ballet world wars. His mother, who was distantly re- score, Diane de Poitiers. lated to the Spanish composer Manuel de Falla, From 1924 on he also composed a good deal had studied piano at the Paris Conservatoire and of incidental music for dramatic productions, encouraged his musical education as a child. a natural intersection of his double-threat He was drawn to both music and the theater, background in music and theater, and it was but his first professional steps after high school one such project that gave rise to Trois pièces were hardly distinguished: he started working as brèves. The play was the five-act comedy The a movie-hall pianist and writing popular songs Beaux’s Stratagem, by Irish author George under the pseudonym William Berty. -

Download the Clarinet Saxophone Classics Catalogue
CATALOGUE 2017 www.samekmusic.com Founded in 1992 by acclaimed clarinetist Victoria Soames Samek, Clarinet & Saxophone Classics celebrates the single reed in all its richness and diversity. It’s a unique specialist label devoted to releasing top quality recordings by the finest artists of today on modern and period instruments, as well as sympathetically restored historical recordings of great figures from the past supported by informative notes. Having created her own brand, Samek Music, Victoria is committed to excellence through recordings, publications, learning resources and live performances. Samek Music is dedicated to the clarinet and saxophone, giving a focus for the wonderful world of the single reed. www.samek music.com For further details contact Victoria Soames Samek, Managing Director and Artistic Director Tel: + 44 (0) 20 8472 2057 • Mobile + 44 (0) 7730 987103 • [email protected] • www.samekmusic.com Central Clarinet Repertoire 1 CC0001 COPLAND: SONATA FOR CLARINET Clarinet Music by Les Six PREMIERE RECORDING Featuring the World Premiere recording of Copland’s own reworking of his Violin Sonata, this exciting disc also has the complete music for clarinet and piano of the French group known as ‘Les Six’. Aaron Copland Sonata (premiere recording); Francis Poulenc Sonata; Germaine Tailleferre Arabesque, Sonata; Arthur Honegger Sonatine; Darius Milhaud Duo Concertant, Sonatine Victoria Soames Samek clarinet, Julius Drake piano ‘Most sheerly seductive record of the year.’ THE SUNDAY TIMES CC0011 SOLOS DE CONCOURS Brought together for the first time on CD – a fascinating collection of pieces written for the final year students studying at the paris conservatoire for the Premier Prix, by some of the most prominent French composers. -

Encyklopédia Kresťanského Umenia Heslo PARÍŽ – PAS Strana 1 Z 62
Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia Paríž - Geo v súvislosti s heslom Kelti: viac ako 500 rokov spoluvytvárali dejiny Európy; ich vlasť sa rozprestierala severne od Álp; neskôr roku 387 pr.Kr. dobyli Rím; okolo 400 pr.Kr. založili mesto s menom Miláno a v rovnakom období Paríž, mesto pomenované podľa keltských kmeňov Parisi pozri Bartolomejská noc; Eligius; boutique Simultananée; gobelín; iluminátori; parížska škola/École de Paris (Baleka), parížski umelci; bulvár, internacionálna gotika, impresionizmus, abstraktné umenie; jednorožec (Wensleydalová); jezuiti; kabaret; kaplnka, capella; kašmírový vzor, kabelka, kníhtlač; manifest A C-Numéro d'Introduction du Groupe et de la Revue Art; J. B. Jongind; las Tullerías, Montmartre, bazilika Sacre Coeur, Le Pont-au-Change, Louvre, Tuileries, Francúzsko http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/- /staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&se archFor=data&page=19 http://viticodevagamundo.blogspot.sk/2011_02_01_archive.html Heslo PARÍŽ – PAS Strana 1 z 62 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia Attribution: Majster Getty Froissart: Kráľovná Isabella prichádza do Paríža (Historia Alexandri Magni, 1468-1475) Heslo PARÍŽ – PAS Strana 2 z 62 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia M. Merian st.: Mapa Paríža (topografická ilustrácia, rytina, 1615) M. Merian st.: Mapa Paríža (topografická ilustrácia, kolorovaná rytina, 1615) Heslo PARÍŽ – PAS Strana 3 z 62 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia C. Chastillon: Pohľad na Paríž (rytina, okolo 16.st.) Heslo PARÍŽ – PAS Strana 4 z 62 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia C. Chastillon: Slávnosti zahájenia činnosti na „Place Royale“ (pri príležitosti svadby príležitosti dvojitej svadby kráľa Ľudovíta XIII. -

The Unique Cultural & Innnovative Twelfty 1820
Chekhov reading The Seagull to the Moscow Art Theatre Group, Stanislavski, Olga Knipper THE UNIQUE CULTURAL & INNNOVATIVE TWELFTY 1820-1939, by JACQUES CORY 2 TABLE OF CONTENTS No. of Page INSPIRATION 5 INTRODUCTION 6 THE METHODOLOGY OF THE BOOK 8 CULTURE IN EUROPEAN LANGUAGES IN THE “CENTURY”/TWELFTY 1820-1939 14 LITERATURE 16 NOBEL PRIZES IN LITERATURE 16 CORY'S LIST OF BEST AUTHORS IN 1820-1939, WITH COMMENTS AND LISTS OF BOOKS 37 CORY'S LIST OF BEST AUTHORS IN TWELFTY 1820-1939 39 THE 3 MOST SIGNIFICANT LITERATURES – FRENCH, ENGLISH, GERMAN 39 THE 3 MORE SIGNIFICANT LITERATURES – SPANISH, RUSSIAN, ITALIAN 46 THE 10 SIGNIFICANT LITERATURES – PORTUGUESE, BRAZILIAN, DUTCH, CZECH, GREEK, POLISH, SWEDISH, NORWEGIAN, DANISH, FINNISH 50 12 OTHER EUROPEAN LITERATURES – ROMANIAN, TURKISH, HUNGARIAN, SERBIAN, CROATIAN, UKRAINIAN (20 EACH), AND IRISH GAELIC, BULGARIAN, ALBANIAN, ARMENIAN, GEORGIAN, LITHUANIAN (10 EACH) 56 TOTAL OF NOS. OF AUTHORS IN EUROPEAN LANGUAGES BY CLUSTERS 59 JEWISH LANGUAGES LITERATURES 60 LITERATURES IN NON-EUROPEAN LANGUAGES 74 CORY'S LIST OF THE BEST BOOKS IN LITERATURE IN 1860-1899 78 3 SURVEY ON THE MOST/MORE/SIGNIFICANT LITERATURE/ART/MUSIC IN THE ROMANTICISM/REALISM/MODERNISM ERAS 113 ROMANTICISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 113 Analysis of the Results of the Romantic Era 125 REALISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 128 Analysis of the Results of the Realism/Naturalism Era 150 MODERNISM IN LITERATURE, ART AND MUSIC 153 Analysis of the Results of the Modernism Era 168 Analysis of the Results of the Total Period of 1820-1939 -

Académie De France À Rome Directorat De Charles Thévenin (1816-1823)
Archives nationales K:\villa medicis\versement\20180401_thevenin\IR_thevenin-20180401_20180819.odtNe pas effacer ACADÉMIE DE FRANCE À ROME DIRECTORAT DE CHARLES THÉVENIN (1816-1823) Répertoire numérique détaillé du versement 20180401 Magdalena Dżoń et Corinne Jouys Barbelin Première édition électronique Archives nationales Pierrefitte-sur-Seine 2018 Archives nationales Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte. Il est en français. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d’application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales, il a reçu le visa du Service interministériel des Archives de France le ..... Archives nationales Sommaire Administration générale..............................................................................................................7 Suivi et envois des travaux des pensionnaires........................................................................7 Suivi des pensionnaires, ateliers, affaire Pradier, décoration de la Trinité des Monts, moulages des colonnes du Panthéon, décès de Bourgeois...................................................16 Suivi comptable et financier......................................................................................................26 Exercices 1816 et 1817.........................................................................................................26 Exercice 1818, retenue des pensionnaires............................................................................30 Exercices 1819 et 1820.........................................................................................................41 -

The French Flute Tradition
The French Flute Tradition by Liesl Stoltz Dissertation presented as partial fulfilment of the requirements for the degree Master of Music (Performance) Faculty of Humanities University of Cape Town Supervisor: Prof. James May February 2003 The copyright of this thesis vests in the author. No quotation from it or information derived from it is to be published without full acknowledgement of the source. The thesis is to be used for private study or non- commercial research purposes only. Published by the University of Cape Town (UCT) in terms of the non-exclusive license granted to UCT by the author. University of Cape Town DECLARATION I, the undersigned, declare that this dissertation is my own, unaided work. It is being submitted in part fulfilment of the requirements for the degree of Master of Music (Performance). It has not been previously submitted in its entirety or in part for any degree or examination at any other university. ~. : ~~o!f\ ......... ......~~ '.. ~Q~3 ..... Liesl StoI'tZ ii ABSTRACT The French flute tradition is remarkable and is admired by flautists, teachers and students of the flute all over the world. The dissertation researched the development of this tradition from the pre-Baroque period through to the modern era and tried to determine the underlying factors that stimulated its development specifically in France. The first key was added to the flute in France and with this the Hotteteres created the blueprint for the modern flute of today. During the Classical period the conservative French retarded the development of the instrument and the repertoire for the flute by initially rejecting additional keys. -
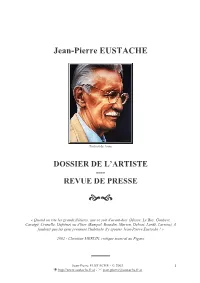
Jean-Pierre EUSTACHE
Jean-Pierre EUSTACHE Portrait de Anne DOSSIER DE L‘ARTISTE ---- REVUE DE PRESSE « Quand on cite les grands flûtistes, que ce soit d'avant-hier (Moyse, Le Roy, Gaubert, Caratgé, Crunelle, Dufrêne) ou d'hier (Rampal, Bourdin, Marion, Debost, Lardé, Larrieu), il faudrait que les gens prennent l'habitude d'y ajouter Jean-Pierre Eustache ! » 2002 - Christian MERLIN, critique musical au Figaro ____ Jean-Pierre EUSTACHE - © 2003 1 http://www.eustache.fr.st - [email protected] Jean-Pierre EUSTACHE Né le 14 octobre 1930 à Caen - Flûtiste de l‘Opéra - 1960 à 1990 - - DOSSIER D'ARTISTE œ 1936 - Enfant précoce, obtient à cinq ans et demi un diplôme de piano, division élémentaire, décerné par la "Fédération Nationale des Sociétés Musicales de Normandie", qui lui attribuent une 1ère mention avec 19 points 1/2 et les félicitations du jury. Signé: R.CLERISSE - 1 er prix de flûte à 12 ans au Conservatoire de sa ville natale, où il travaille également le piano et l‘harmonie - Elève du Conservatoire National de Musique de Paris où il a pour maîtres, M.MOYSE, R.CORTET, F.OUBRADOUS, S.PETIT. Reçu 1 er dans la classe de M.MOYSE. 1951 - Il obtient une première médaille de solfège et en 1952 un 1 er prix de flûte. 1952 - Professeur de flûte au Conservatoire de Reims et flûtiste au théâtre de cette ville où il remplace P.ETHUIN. 1953 - Nommé sur concours professeur de flûte et de solfège au Conservatoire National de Musique de Grenoble que dirige E.P STEKEL élève de Arthur NIKISCH et de Franz SCHALK, Directeur de l'Opéra de Vienne. -

Lili Boulanger (1893-1918)
1/35 Data Lili Boulanger (1893-1918) Pays : France Langue : Français Sexe : Féminin Naissance : Paris, 21-08-1893 Mort : Mézy-sur-Seine (Yvelines), 15-03-1918 Note : Compositrice. - Soeur de Nadia Boulanger (1887-1979). - Reçoit le Grand prix de Rome de composition musicale en 1913 Domaines : Musique Autre forme du nom : Marie-Juliette Olga Boulanger (1893-1918) ISNI : ISNI 0000 0000 8096 9225 (Informations sur l'ISNI) Lili Boulanger (1893-1918) : œuvres (101 ressources dans data.bnf.fr) Œuvres musicales (100) Pie Jesu D'un matin de printemps. Orchestre (1918) (1917) D'un matin de printemps. Trio avec piano D'un soir triste (1917) (1917) D'un matin de printemps. Flûte ou violon, piano Dans l'immense tristesse (1917) (1916) La terre appartient à l'Éternel. Choeur, orgue, orchestre Ils m'ont assez opprimé (1916) (1916) La terre appartient à l'Éternel. Voix, piano D'un vieux jardin (1916) (1914) D'un jardin clair Cortège (1914) (1914) Vieille prière boudhique Du fond de l'abîme (1914) (1914) data.bnf.fr 2/35 Data Soir sur la plaine Au pied de mon lit (1913) (1913) Elle était descendue au bas de la prairie Clairières dans le ciel (1913) (1913) Faust et Hélène Elle est gravement gaie (1913) (1913) Hymne au soleil Pour les funérailles d'un soldat (1912) (1912) Pendant la tempête Le retour (1912) (1912) La source Attente (1912) (1912) Soleils de septembre Mélodies (1911) (1911) Reflets Les sirènes (1911) (1911) Renouveau Morceau de piano (1911) (1911) Nocturne. Flûte ou violon, piano. Fa majeur Sous bois (1911) (1911) Musique pour piano Demain fera un an (1905) (1914) Voir plus de documents de ce genre Œuvres mixtes (1) "Gazette des classes de composition du Conservatoire" avec Lili Boulanger (1893-1918) comme Rédacteur data.bnf.fr 3/35 Data Documents sur Lili Boulanger (1893-1918) (261 ressources dans data.bnf.fr) Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (240) Documents divers , Nadia Boulanger Billet d'Andrée Karpelès à None (1887-1979) Lili Boulanger, s.d. -

Art As Propaganda in Vichy France, 1940-1944 Markj. Thériault
Art as Propaganda in Vichy France, 1940-1944 MarkJ. Thériault Department of History McGill University, Montreal 1 October 2007 A thesis submitted to McGill University in partial fulfilment of the requirements of the degree of Master of Arts ©Mark J. Thériault, 2007 Library and Bibliothèque et 1+1 Archives Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Bran ch Patrimoine de l'édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A ON4 Ottawa ON K1A ON4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-51409-2 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-51409-2 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library permettant à la Bibliothèque et Archives and Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l'Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans loan, distribute and sell theses le monde, à des fins commerciales ou autres, worldwide, for commercial or non sur support microforme, papier, électronique commercial purposes, in microform, et/ou autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur ownership and moral rights in et des droits moraux qui protège cette thèse. this thesis. Neither the thesis Ni la thèse ni des extraits substantiels de nor substantial extracts from it celle-ci ne doivent être imprimés ou autrement may be printed or otherwise reproduits sans son autorisation. -

An Annotated Bibliography of Selected Repertoire for Alto
AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY OF SELECTED REPERTOIRE FOR ALTO SAXOPHONE AND PIANO FOR DE VELOPING COLLEGE-LEVEL ALTO SAXOPHONISTS, WITH AN ANALYSIS OF YVON BOURREL’S SONATE POUR ALTO SAXOPHONE ET PIANO Scott D. Kallestad, B.S., M.M. Dissertation Prepared for the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS UNIVERSITY OF NORTH TEXAS December 2005 APPROVED: Eric M. Nestler, Major Professor Eugene M. Corporon, Minor Professor Darhyl S. Ramsey, Committee Member Graham H. Phipps, Director of Graduate Studies in the College of Music James C. Scott, Dean of the College of Music Sandra L. Terrell, Dean of the Robert B. Toulouse School of Graduate Studies Kallestad, Scott D., An Annotated Bibliography of Selected Repertoire for Alto Saxophone and Piano for Developing College-Level Alto Saxophonists, with an Analysis of Yvon Bourrel’s Sonate Pour Alto Saxophone Et Piano. Doctor of Musical Arts (Performance), December 2005, 95 pp., 25 Figures, references, 82 titles. In this study the author addresses the problem of finding quality repertoire for young college-level saxophonists. By examining graded repertoire lists from a variety of college and university saxophone instructors, the author has compiled a list of 180 works for alto saxophone and piano. Twenty-four well-known works of a difficulty-level appropriate for freshman and sophomore players are identified and annotated. Each annotation consists of bibliographical information, a biographical sketch of the composer, a difficulty rating of eight elements of performance, a discussion of performance considerations, and a bibliography of available recordings. The eight elements of performance included in the difficulty rating are: Meter, key signatures, tempo, note-values, rhythm, articulation, range, and dynamic levels.